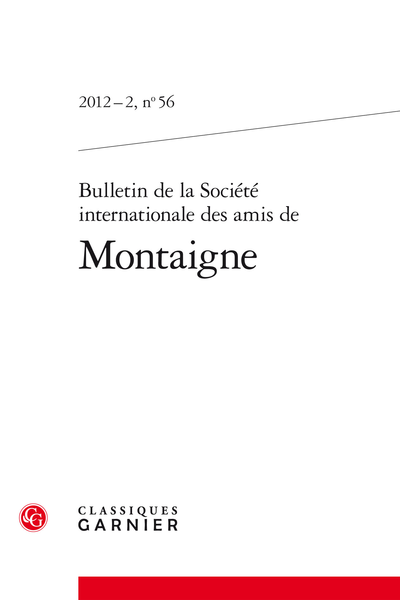
« Compter » et « peser » les emprunts aux auteurs antiques dans les Essais Méthodes et voies d’approche
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 2, 56. varia - Author: Basset (Bérengère)
- Pages: 227 to 247
- Journal: Bulletin for the International Society of Friends of Montaigne
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782812439773
- ISBN: 978-2-8124-3977-3
- ISSN: 2261-897X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-3977-3.p.0227
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 02-21-2013
- Periodicity: Biannual
- Language: French
« Compter » et « peser » les emprunts1 aux auteurs antiques dans Les Essais
Méthodes et voies d’approche
Les délimitations du sujet que nous prétendons traiter, les emprunts de Montaigne aux auteurs antiques dans le texte des Essais, ne sont guère faciles à établir. Il s’agit de s’intéresser à la bibliothèque humaniste de Montaigne. Le sujet touche à la question très large de ce que l’on pourra appeler l’intertextualité, que nous nommerions plus volontiers le plurivocalisme des Essais, plurivocalisme qui est un aussi un plurilinguisme2. Nous ne comptons pas traiter des différentes pratiques citationnelles, des différents modes d’emprunts dont use Montaigne3. Notre propos se portera plutôt sur les études consacrées à la lecture
par Montaigne de tel ou tel auteurs de l’Antiquité, sur les méthodes et les voies d’approche pour appréhender ce point. Si la question de la citation et de l’emprunt est bien sûr abordée – comment pourrait-il en être autrement – elle se trouve renouvelée par les problèmes spécifiques que pose l’attention portée sur une source particulière. Il s’agira d’établir une sorte de bilan critique des études qui ont été menées en la matière ces vingt dernières années dans les bulletins de la Société des Amis de Montaigne, devenue entre-temps Société Internationale des Amis de Montaigne4. Sans prétendre à l’exhaustivité et en opérant une sélection que nous espérons pertinente, nous tâcherons d’exposer différentes voies d’approches pour mesurer l’intérêt mais aussi les limites éventuelles que peuvent présenter chacune d’elles.
Entre « compter » et « peser », le grand écart
Nous commencerons par noter la double approche à laquelle se prête l’étude des emprunts, double approche dont le BSAM offre des exemples : d’un côté des articles qui pratiquent la recension des références à un auteur dans Les Essais, qui « comptent » les emprunts, de l’autre côté des articles qui adoptent une démarche relevant de l’herméneutique, moins globale, plus circonstanciée, qui se penchent sur un emprunt pour le « peser ». Nous prendrons deux exemples, extrêmes, de cette double voie pour montrer le grand écart de l’une à l’autre.
La pratique qui consiste à « compter » les emprunts est exemplifiée par le travail en deux volets offerts par Edouard Simon, « Montaigne et Platon », parus dans les deux livraisons du BSAM de 1994. L’auteur opère un relevé qui se veut exhaustif des citations et emprunts à Platon dans les trois livres des Essais. Il situe ces références à Platon par rapport à d’autres auteurs, évalue leur répartition dans les différents chapitres de Montaigne, tient compte de leur date d’insertion (modifications
apportées par les éditions de 1588 et 1595) et répertorie les ouvrages de Platon d’où ils proviennent. Quelques remarques s’imposent sur ce laborieux, dans le bon sens du terme, et méritoire travail :
– Ce qui est nommé citation relève, en fait, de l’allégation5.
– Edouard Simon s’est imposé des limites, quelque peu surprenantes, concernant les auteurs auxquels il a comparé les emprunts à Platon : « Il eût été sans intérêt, écrit-il, de situer Platon par rapport à tous les auteurs cités dans les Essais ; on s’est limité aux onze qui le sont le plus souvent, auxquels on a ajouté Ovide, Térence, Lucain, Diogène Laërce ». En fait, il situe Platon par rapport à 7 auteurs allégués dans les Essais, Aristote, César, Plutarque, Cicéron, Epicure, Xénophon, Sénèque, auxquels il ajoute, sans le justifier, Ovide, Térence, Lucain et Diogène. Les auteurs qu’il convie montrent qu’il se fonde non sur les citations – ce qui l’aurait conduit à convier, entre autres exemples, Horace et Lucrèce – mais sur les allégations. L’ajout de quatre noms relève un peu de l’arbitraire et l’on est surpris de voir se mêler des poètes et un doxographe.
– Une autre remarque porte sur les relevés opérés6. Ceux-ci montrent qu’aux allégations de Platon et aux emprunts qui lui sont faits se mêlent les simples mentions du philosophe, lesquelles n’ont pas le même statut. Il s’en suit une sorte de confusion entre les usages faits de l’œuvre de Platon, marque éventuelle du platonisme de Montaigne, du moins moyen de la mesurer, et la persona qu’il revêt pour les hommes du xvie siècle et que lui dessinent les Essais. Cette persona se construit à partir de sources doxographiques auxquelles Montaigne peut puiser, Diogène Laërce et Plutarque notamment, mais aussi par la manière dont il convoque ou met en scène Platon. Il y a souvent une volonté de déplacer l’intérêt de la doctrine vers les mœurs, de confronter la théorie avec la pratique. Il y a surtout, de la part de Montaigne, un jeu avec la figure d’autorité que représente Platon.
– Enfin, dernière remarque, de l’aveu même de l’auteur de l’article, le relevé opéré n’a pas cherché à prendre en compte les relais par lesquels
Montaigne a pu avoir connaissance de Platon. La chose est certes difficile. C’est cependant possible dans certains cas et s’en priver peut être dommageable. J’en donnerai un exemple. Il s’agit d’une allégation à Platon dans le chapitre I, 26 :
Ce n’est pas une ame, ce n’est pas un corps qu’on dresse : c’est un homme ; il n’en faut pas faire à deux. Et, comme dict Platon, il ne faut pas les dresser à deux. Et, comme dict Platon, il ne faut pas dresser l’un sans l’autre, mais les conduire également, comme une couple de chevaux attelez à mesme timon7.
Edouard Simon identifie l’allégation comme provenant du Timée, il gomme alors le relais plutarquien : la référence vient moins du Timée en effet que, comme l’a repéré Pierre Villey, de l’opuscule de Plutarque Règles et préceptes de santé. C’est, nous semble-t-il, évincer une source importante de ce chapitre « De l’institution des enfans ». De fait, on aura sans doute grand profit à reprendre ce texte des Œuvres morales et mêlées pour mesurer le programme d’éducation que propose Montaigne. Si le traité de Plutarque Comment il faut nourrir les enfants a inspiré la paideia humaniste et alimenté le chapitre que Montaigne consacre à ce thème8, il ne saurait être la seule source plutarquienne où puise l’humaniste. Les Règles et préceptes de santé y ont aussi contribué sans doute : ce traité refuse d’abandonner les soins du corps à la médecine, les intégrant à la philosophie qui ne saurait se réduire à la méditation ni même au soin de l’âme. Cet oubli de Plutarque conduit encore à omettre l’un des prismes, pas le seul sans doute, par lequel Montaigne lit et recueille la pensée du philosophe fondateur de l’Académie. Si, pour Montaigne, « Plutarque a les opinions Platonicques, douces et accommodables à la vie civile9 », c’est peut-être que le Platon de Montaigne est quelque peu plutarquien.
Bref, le travail d’Edouard Simon fournit un matériau – car, nous y reviendrons, c’est ainsi qu’il le conçoit – certes utile mais un peu hétéroclite et diffus.
Autre manière de procéder, aux antipodes de la précédente, celle que pratique André Tournon dans un article plus récent intitulé « Le doute
investigateur : métamorphoses d’un “refrain” de Plutarque dans les Essais », paru dans la deuxième livraison du NBSIAM de l’année 2009. Le seul titre de l’article laisse voir une voie d’approche bien différente de celle pratiquée par Edouard Simon. À l’ambition totalisante de ce dernier, se substitue, dans la méthode mise en œuvre par André Tournon, l’intérêt porté à un unique emprunt à Plutarque. Le titre, pour nous en tenir à lui dans un premier temps, montre encore l’attention portée aux manipulations que Montaigne fait subir à sa source, la torsion qu’il lui impose10. Surtout, ce titre « problématise » cet emprunt, il en dégage l’enjeu, « le doute investigateur » qui est en fait le fil conducteur de l’article. Au lieu de compter les emprunts à Plutarque, l’article en soumet un à une « pesée ». Et pas n’importe lequel. De fait, la sagacité d’André Tournon a su élire, autour de la définition du pyrrhonisme que propose le chapitre II, 12 des Essais, un emprunt qui « pose problème » et qui renouvelle la conception du courant philosophique dont s’empare Montaigne. Comme en témoigne le début de l’article, l’enquête menée est moins guidée par le souci d’étudier la réception de Plutarque dans les Essais, ni même dans ce chapitre, que par l’attention que suscite une aspérité du texte, en l’occurrence une sorte de contradiction décelée dans la définition du pyrrhonisme : Montaigne commence par distinguer les pyrrhoniens des « dogmatiques » et des « académiciens » avant de les réunir tous trois dans une même attitude dubitative. C’est pour comprendre cet apparent paradoxe qu’André Tournon se penche sur un emprunt à Plutarque donné comme une maxime de scepticisme, le philosophe de Chéronée devenant une figure du pseudo-dogmatisme : « Que signifie ce sien refrain : en un lieu glissant et coulant suspendons notre créance11 ». André Tournon montre que cet emprunt vient redéfinir l’épokhè : « le doute radical n’est pas un frein, mais un stimulant de la pensée ». Au service de cette démonstration, l’article étudie minutieusement la syntaxe du passage tel qu’il se présente en strate A du texte de Montaigne,
retourne à la source pour mesurer les torsions que l’emprunt a subies lors de son implantation dans les Essais, examine les ajouts pratiqués sur ce passage après 1580 et surtout après 1588 et les déformations, signe d’une mécompréhension, que l’éditeur de 1595 impose à ce fragment de texte. Ce dernier point conduit André Tournon à conclure à l’audace et à la singularité de la pensée de Montaigne. Et de sonder alors ce qui a pu intimider les éditeurs posthumes, en montrant la portée de ce doute investigateur, à savoir « la conscience que prendra le philosophe de son propre rôle dans l’élaboration (et non pas la découverte) d’une vérité taillée à la mesure de l’homme parce qu’assortie à son irréductible contingence12 ». Et il termine en le montrant à l’œuvre sur un point de doctrine, ô combien délicat, celui de l’immortalité de l’âme.
L’article aborde la pratique de l’emprunt par Montaigne en combinant approche philologique et approche herméneutique. Il mène une analyse pointilleuse et serrée d’un passage très circonscrit, dont il tire des conclusions de grande portée qui nous aident à mieux saisir la démarche enquérante de Montaigne. L’emprunt devient le symptôme en même temps qu’un élément de compréhension d’une conception résolument singulière et novatrice du doute. L’étude met également au jour certaines modalités de l’emprunt montaignien, soulignant les écarts avec la source, l’appropriation quelque peu irrévérencieuse. Il y a sans nul doute d’autres emprunts opérés par Montaigne tout aussi symptomatique de la singularité de sa pensée, lesquels se prêteraient à une même approche. Si l’article d’André Tournon n’est pas centré sur la réception de Plutarque dans les Essais, il nous semble cependant ouvrir des pistes d’étude en la matière, il met le doigt sur une lecture de Plutarque quelque peu hétérodoxe qui l’aborde précisément sous l’angle du scepticisme, de l’irrésolution, du propos enquérant qui est peut-être sa marque. Sans aller jusqu’à proposer une étude sur « Montaigne et Plutarque », nous suggérerions d’envisager la présence du philosophe de Chéronée dans les Essais en suivant la piste que nous ouvre André Tournon13.
Ecart donc, voire abîme entre l’approche que propose Edouard Simon et celle que pratique André Tournon. Un pont peut cependant être bâti au-dessus de cet abîme et une continuité être établie entre ces deux approches. Il faut en effet rendre justice au travail d’Edouard Simon qui ne le propose nullement comme une fin de soi, mais comme un matériau pouvant servir de fondement à des études. Du reste, le BSAM qui l’accueille ne le présente pas comme un article : il le classe dans une rubrique qui a désormais disparu et qui s’intitulait « documents ». C’est en somme un travail préparatoire14. L’on peut supposer qu’un relevé tel celui fourni par Edouard Simon peut aider à repérer des emprunts problématiques, symptomatique d’une pensée singulière, à l’image de celui qui fournit la matière de l’article d’André Tournon. Il faudrait pour y aider que l’on puisse disposer, en regard de l’emprunt tel qu’il se présente chez Montaigne, la version originelle. On peut encore penser que le morcellement du relevé peut entraver la saisie de la saillie que constitue tel ou tel emprunt. Détachés du sol dans lequel ils ont été transplantés, les lopins perdent quelque peu de leur sens. Nous tâcherons néanmoins de montrer qu’un relevé de la sorte peut mettre sur la piste d’emprunts « symptôme » d’une pensée novatrice et audacieuse.
De la pertinence du décompte ? ou est-il nécessaire
de « compter » pour « peser » ?
Le travail fourni par Edouard Simon n’a toutefois, à notre connaissance, pas trouvé d’exploitation. C’est pourquoi nous sommes en droit de nous demander quelle est la pertinence et l’utilité d’un tel travail de relevés. Le « compte » est-il un préalable nécessaire à la « pesée » des emprunts, comme le laisse entendre l’auteur de l’article sur « Montaigne et Platon » ? Vraisemblablement, nul compte n’a précédé le travail fourni par André Tournon qui semble plutôt être parti des aspérités
que présente le texte de Montaigne. On pourra s’étonner qu’un article de Jean-François Mattéi sur le platonisme des Essais n’exploite pas le « document » fourni par Edouard Simon. L’article en question, qui prend pour titre une formule de Montaigne « J’estois platonicien de ce costé là, avant que je sceusse qu’il y eust de Platon au monde15 », part du compte des références à Platon dans les Essais – auquel se mêlent avec quelque arbitraire celles à Socrate16 – qui ne doit manifestement rien au travail d’Edouard Simon. Devant l’importance de ces références, rapidement mentionnées, l’auteur de l’article conclut : « Cette présence insistante de Platon, redoublée par celle de Socrate, met l’ensemble des Essais sous le signe d’un platonisme au moins apparent dont le lecteur peut se demander s’il est réel17 » ; et d’indiquer quelques lignes plus bas : « on doit donc convenir que Platon – constamment rapporté à Socrate […] – est la figure tutélaire des Essais18 ». Le propos nous semble un peu téméraire ainsi formulé, tant en ce qui concerne la place confiée à Platon dans les Essais que son assimilation à Socrate. Après ce rapide compte des références, l’article poursuit en mentionnant la formule qu’il prend pour titre, laquelle autorise à considérer que « Montaigne est naturellement platonicien en dépit de ses réserves19 », ce qui est ensuite mesuré à propos des « questions métaphysiques essentielles, qui sont celles de l’âme, du monde et de Dieu20 » à travers un examen du chapitre II, 12. C’est passer un peu vite, nous semble-t-il, sur le « de ce costé là » de la formule de Montaigne qui sert de titre à l’article : Jean-François Mattéi la prend en considération dans un mouvement concessif qui la balaie rapidement, un peu trop rapidement à selon nous21.
De fait, il faudrait se demander ce que veut dire pour Montaigne « être platonicien », si platonisme il y a dans les Essais, c’est un platonisme « à la Montaigne » qui ne peut être cerné que par une attention plus minutieuse aux différentes références faites à Platon, ce précisément à quoi peut aider le relevé d’Edouard Simon dès lors qu’on l’a soumis à un peu d’ « ordre ». En fait, l’étude que mène Jean-François Mattéi ne s’appuie pas sur les occurrences à Platon dans le chapitre des Essais qu’il considère ni sur les emprunts qui sont faits à son œuvre. Il s’efforce de dégager des accointances entre d’une part les idées de Montaigne et d’autre part celles de Platon autour de trois points de doctrine qui structurent son article : « La critique de la raison », « le monde et l’être », « l’âme et la vérité ». Il s’agit à chaque de fois de montrer des parentés de pensée entre les deux auteurs, de repérer des motifs platoniciens chez Montaigne où semblent comme se mêler « réminiscences », allusions volontaires et « rencontres ». Jean-François Mattéi assoit en effet le platonisme qu’il repère chez Montaigne dans « l’Apologie de Raimond Sebond » à la fois sur des rapprochements qui sont de son fait et, plus rarement, sur des emprunts à Platon que compte ce chapitre des Essais. L’article a le mérite d’aborder une difficile question de la « philosophie » de Montaigne, celle de la métaphysique. Il permet de mieux comprendre les soubassements sur lesquels s’élabore « la doctrine de l’ignorance, qui est celle de Socrate, [et qui] sera également celle de Montaigne à l’école du maître de Platon22 ». Il a le mérite de ne pas évacuer les questions de l’être, de l’âme, de la vérité sous le prétexte que Montaigne délaisse les sujets métaphysiques au profit de préoccupations morales. Mais, nous semble-t-il, l’interrogation sur le platonisme de Montaigne ne peut faire l’économie d’une étude sur la réception de Platon dans les Essais. Platon a été lu par Montaigne qui s’y réfère et fait des emprunts à son œuvre, c’est une donnée qui demande à être prise en considération. Il nous semble que l’intérêt porté aux éléments de doctrine repris à Platon ne peut se passer d’une attention au geste d’écriture citationnelle, entendue au sens large. « Peser » l’empreinte platonicienne dans les Essais nécessite au minimum de « compter » les emprunts qui lui sont faits, du moins de les prendre en compte.
C’est à une autre influence sur Montaigne – qui n’est pas, elle, de nature philosophique – que s’intéresse, dans un article plus ancien, Catherine Magnien-Simonin, celle d’Aulu-Gelle23. Le titre de l’article, « Montaigne et Aulu-Gelle », rappelle celui du « document » d’Edouard Simon. Le grammairien latin est envisagé comme une source des Essais à des titres divers et son influence est étudiée à l’échelle de l’ensemble de l’œuvre de Montaigne, même si Catherine Magnien-Simonin indique fournir des remarques qui « ne prétendent pas à l’exhaustivité24 ». Elle s’engage dans une voie qui ne relève pas de l’herméneutique mise en place par André Tournon dans l’article que nous étudiions plus haut. Elle semble être partie du « compte » des emprunts à Aulu-Gelle dont elle livre le relevé à la fin de l’article25. La tâche était moins ardue et moins exigeante que pour les références à Platon, le grammairien latin étant moins présent que le philosophe grec dans les Essais, mais l’on apprécie le tri plus scrupuleux en ce qui concerne la nature des références : Catherine Magnien-Simonin distingue les citations des Nuits attiques dans les Essais, les ressemblances entre les Nuits attiques et les Essais, les traductions ou adaptations des Nuits attiques intégrées aux Essais, enfin les emprunts peu probables aux Nuits attiques que comptent les Essais. Si elle s’intéresse aux traces effectives qu’a laissées le grammairien latin dans le texte de Montaigne, elle traque aussi ce qu’elle nomme son « influence taisible ». Elle retrouve, chez l’un et l’autre, une même pratique de la citation, à laquelle est confié un rôle tout à la fois ornemental et génétique, elle montre que les Nuits attiques ont pu suggérer à Montaigne le thème de certains chapitres des Essais, notamment en ce qui concerne le premier livre. Surtout, elle dégage, preuves à l’appui, les ressemblances entre leurs poétiques respectives. L’écriture que pratique Aulu-Gelle autorise en effet une lecture de son ouvrage à pièces décousues, laquelle est rendue plus aisée encore par les index qui accompagnent les éditions renaissantes. Indéniablement, la chose a dû séduire Montaigne comme beaucoup de ses contemporains. Mais ce que montre Catherine Magnien-Simonin, c’est qu’il a encore pu chercher à l’imiter :
Il a pu non seulement y retrouver, comme l’avait souligné Pierre Villey, des anecdotes connues dès l’enfance et prendre plaisir à les traduire, à les évoquer, mais plus encore y trouver un modèle d’œuvre délibérément fragmentée en lopins, œuvre touche à tout, en voie d’augmentation aux dires mêmes de son auteur ; donc le modèle d’une œuvre rapiécée que cousent en livres les titres des paragraphes et qu’unifient, sous un titre pluriel, la singularité d’une plume curieuse et l’exercice du jugement26.
On aimerait voir développées les pistes que lance l’article, lequel ne pouvait s’autoriser à le faire dans les bornes qui lui étaient imparties. On regrette surtout que l’accent n’ait pas davantage été mis sur la singularité de l’écriture pratiquée par Montaigne, que les écarts remarqués avec les textes traduits n’aient pas été soumis à interprétation, que la figure du « grammairien », au sens générique du terme, dans les Essais n’ait pas fait l’objet d’une plus vaste et plus précise investigation. Si le compte semble bien avoir été le point de départ de l’étude menée, l’opération est très largement dépassée et l’influence d’Aulu-Gelle sur Montaigne est mesurée au-delà des résultats qu’a donnés cette première phase du travail. Mais l’on reste un peu sur notre faim en ce qui concerne la pesée, une véritable détermination du poids de tel ou tel emprunt, opération qui sans doute est peu compatible avec l’étude d’une influence à l’échelle globale de l’œuvre de Montaigne.
Nous voudrions, pour « clore ce pas » qui nous conduit à nous demander si le décompte est un préalable nécessaire à la pesée, confronter brièvement trois articles consacrés aux « emprunts27 » à Plutarque dans les Essais : celui de Brigitte Humbert « L’éducation selon Montaigne et Plutarque » (BSAM, juillet-décembre 1995, p. 46-51), celui d’Alexander Roose, « Le remède est dans le mal : Montaigne lecteur de l’essai Sur la curiosité de Plutarque » (NBSIAM, 1er semestre 2007, « Montaigne parmi les philosophes », I, p. 85-96), enfin celui, en anglais, de Cara Welch, « Accommodating means and ends in Montaigne’s first essay » (NBSIAM, 1er semestre 2010, no 51, année VI, p. 7-21). Le premier concentre son étude, en relation avec le thème étudié, l’éducation, sur le chapitre 26
du premier livre des Essais28. Nul compte des emprunts à Plutarque n’est proposé ici. L’auteur se contente de noter que « le traité De l’éducation des enfants attribué à Plutarque a inspiré les auteurs de la Renaissance qui se sont préoccupés de pédagogie, notamment Erasme29 » et de préciser que « dans cet essai, Montaigne avoue qu’il a lu Plutarque et Sénèque et que ses “opinions ont cet honneur de rencontrer souvent aux leurs30” » pour conclure à l’influence du Chéronéen en matière de pédagogie sur Montaigne. L’étude va alors prendre la forme d’une sorte de parallèle, à la Plutarque précisément, entre d’une part le traité de Plutarque, d’autre part le chapitre de Montaigne. Brigitte Humbert repère les principes d’éducation de l’un et l’autre des textes, les compare pour dégager les concordances et les écarts. La conclusion est sans surprise, un peu décevante :
Quoique le contenu des deux ouvrages soient souvent fort proche, les divergences remarquées entre Montaigne et son prédécesseur sont représentatives des différents principes qui animent chacun de ces traités. L’éducation préconisée par Plutarque s’appuie sur un apprentissage des règles qui régissent la vie sociale de son pays et de son époque, celle que Montaigne recommande accorde à l’élève une plus grande autonomie31.
L’étude aurait sans doute gagné à prendre en compte l’influence d’autres ouvrages, de Plutarque – par exemple le traité Règles et préceptes de santé, dont nous signalions, plus haut, la « présence » dans le chapitre de Montaigne – ou d’autres auteurs, les croisements, parfois insolites et inattendus, qu’opère Montaigne. Pour mieux saisir la singularité de sa posture de pédagogue, il nous semble qu’il faudrait compléter l’étude Brigitte Humbert en comparant la réception du traité de Plutarque dans le chapitre de Montaigne et dans d’autres traités d’éducation de la Renaissance. Alexander Roose se penche, quant à lui, sur la réception d’un autre traité de Plutarque, celui intitulé Sur la curiosité. Son étude ne repose pas davantage sur un compte des emprunts que fait Montaigne à ce texte que l’article commence par présenter32. S’il mentionne les emprunts
à ce traité dans les Essais, il n’en livre pas un relevé (ce dernier a-t-il été préalablement établi ?) et ne développe pas d’analyse à leur propos, à la seule exception de l’anecdote de Rusticus qui fonde le quatrième chapitre du livre II. Alexander Roose s’intéresse plutôt aux emprunts indirects, à l’empreinte laissée par ce traité plus qu’aux emprunts qui en sont faits. Concentrant son étude sur le chapitre « De l’oisiveté », il y retrouve les analyses de la curiosité que Plutarque avait proposées. À la différence de Brigitte Humbert, il donne des preuves de cette empreinte, lesquelles consistent en la reprise de métaphores. Ces échos autorisent Alexander Roose à voir dans le chapitre « De l’oisiveté » une réécriture consciente et délibérée du traité « De la curiosité33 ». Il montre alors que l’écriture des Essais peut se lire comme une mise en pratique du remède que préconisait Plutarque pour se guérir de ce vice, à savoir détourner cette curiosité du monde extérieur pour l’appliquer à soi. Cara Welch adopte une démarche encore différente qu’elle applique au chapitre inaugural des Essais, souventes fois étudié comme on sait34. Elle combine analyse des emprunts à Plutarque, soumis à une « pesée » plus qu’à un compte, et analyse de l’empreinte qu’il a pu laisser35. La prise en compte de l’intertexte plutarquien a pour but d’aider à comprendre la
mise en cause d’un idéal héroïque de la part de Montaigne, l’acceptation, voire la réhabilitation des passions comme constitutives de la nature humaine qu’il s’agit de savoir modérer, qu’il faut faire collaborer avec la raison. Montaigne suivrait, en se l’appropriant, la philosophie éthique transmise par Plutarque, s’éloignant notamment de celle héritée des Stoïciens36. Cara Welch commence par étudier les emprunts au traité de Plutarque « Instruction pour ceux qui manient les affaires d’État », lequel fournirait à Montaigne tout à la fois la thèse qui inaugure son chapitre ainsi que les exemples qui viennent le clore dans la version de 1580, ceux de Pompée et de Sylla37. Elle étudie notamment la réécriture du fait mettant en scène Sylla et dégage les implications de cette réécriture. Elle s’efforce d’élucider la différence de comportement entre les deux personnages placés face à une même situation – laquelle différence introduit, pourrait-on dire, une sorte de variation de la maxime qui donne son titre au chapitre, le transformant en « par pareil moyen, on arrive à diverses fins » – et trouve une explication dans le rôle donné aux passions. C’est alors en se penchant sur l’empreinte laissée par le traité de Plutarque « De la vertu morale » qu’elle peut expliquer cette conception de la nature humaine : la lecture de cet opuscule aurait pu inspirer à Montaigne sa conception de la vertu, laquelle intégrerait les passions qu’il s’agirait de régler et de modérer, de placer en équilibre avec la raison. Cara Welch oppose alors la metriopatheia aristotélicienne à la modération prônée par Plutarque et fait de Montaigne un adepte de la seconde contre la première38. L’article opère un va-et-vient constant et fécond entre le texte de Montaigne et les traités de Plutarque ; l’étude aborde moins les emprunts à Plutarque que les empreintes laissées par la lecture de ses traités mais parvient néanmoins à établir un certain équilibre entre ces deux approches.
Ces articles, divers dans les démarches qu’ils mettent en œuvre, montrent que l’étude de l’intertextualité dans les Essais ne saurait se réduire à la question des emprunts, qu’il convient d’être attentif tout à la fois aux emprunts et aux empreintes. Il y a en effet une présence « taisible », pour reprendre le mot de Catherine Magnien-Simonin, des auteurs de l’antiquité que Montaigne a lus. Cette présence tue – parfois volontairement sous la forme d’emprunts dissimulés, parfois involontairement quand elle prend la forme de « réminiscences », que nous appellerions plus volontiers « rencontres » – ne saurait être mesurée par l’opération de comptage. Cette dernière permet cependant de donner quelque assise à cette « influence taisible » difficilement mesurable, de lui ôter ce qu’elle pourrait avoir de subjectif et d’aléatoire. Le décompte ne paraît pas en revanche un préalable absolument indispensable à la pesée. On notera que cette dernière s’accommode plus aisément d’une étude circonscrite, de l’attention portée à un emprunt particulier. L’opération de comptage semble au contraire favoriser une approche globale qui a sans doute ses mérites et sa pertinence mais envers laquelle on invitera à garder une certaine prudence. Le risque est toujours de privilégier un auteur quand la pensée de Montaigne se nourrit à des sources multiples dont il fait son miel. On sait que cette approche a conduit à « construire » un Montaigne stoïcien, un Montaigne épicurien, un Montaigne sceptique,… alors que Montaigne est avant tout « montaignien ». Le risque est encore de chercher à donner une cohérence à la série d’emprunts relevés, de les faire rentrer dans ce qui s’apparenterait à une sorte de système dessinant la figure du « Plutarque de Montaigne », de « son Horace », de « son Lucrèce »,… systématisme toujours dommageable à la saisie d’une pensée qui se veut ondoyante, fluctuante, ouverte. Cette approche globale, quelque peu encline au systématisme, nous semble surtout ôter la part de hasard qu’il peut entrer, qu’il entre dans les emprunts de Montaigne. Nous suggérerions de placer leur étude sous le signe de la « rencontre », comme l’a fait Olivier Guerrier dans une contribution à un volume collectif récemment paru39. C’est, dans le même temps, les réinscrire dans un « art de conférer » qui prône la pertinence, l’attention aux circonstances, qui inscrit la « trace écrite », aussi paradoxale que cela puisse paraître, dans la contingence. L’emprunt pourrait dès lors
être envisagé sur le mode de l’apophtegme, ces « dits » rassemblés en recueils que la Renaissance aimait à pratiquer, des recueils qui, s’ils appartenaient aux arts de la mémoire, avaient su y faire entrer l’instant.
Du « compte » à la « pesée » :
quelques propositions autour de Platon
Notre propos ne saurait être, cependant, d’invalider ni de discréditer toute opération de comptage. Aussi voudrions-nous, pour finir, reprendre le travail méritoire d’Edouard Simon et faire quelques rapides propositions pour opérer le nécessaire passage du décompte à la « pesée ». Nous nous limiterons à deux suggestions que nous nous garderons de développer. La première se voudrait synthétique, sans pour autant prétendre à la « pesée » de l’ensemble des emprunts et des allégations à Platon, et proposera une étude à l’échelle de l’ensemble des Essais. La seconde se portera sur un emprunt qui nous semble suffisamment problématique pour nécessiter à lui seul une « pesée ».
Le document fourni par Edouard Simon nous paraît mettre en valeur la figure auctoriale que revêt Platon dans les Essais en même temps que le jeu qu’établit Montaigne autour de cette auctoritas. Il nous semble que le « compte » des emprunts à Platon pourrait être exploité dans le cadre d’une réflexion sur cette question qu’il contribue à faire émerger, que la « pesée » pourrait se faire sur la balance de cette problématique, pour filer la métaphore. Pour appuyer cette suggestion, quelques brèves et rapides remarques, livrées un peu « sans ordre » mais non pas « sans dessein » :
– Platon est très souvent convoqué sous la forme d’allégations, ce qui lui confère cette dimension auctoriale dont nous parlions.
– Nombre d’emprunts, au sens large du terme, qui lui sont faits, témoignent du « style regentant et asseverant » que Montaigne lui prête, autrement dit Montaigne use fréquemment du philosophe dans sa posture de législateur40. La chose est manifeste dans le chapitre I, 26, « De
l’institution des enfans » où sont assez fortement sollicités Les Lois et, dans une moindre mesure, La République. Mais il conviendra de noter que ces ouvrages et ce « style regentant » du philosophe sont à nouveau de mise dans le chapitre « Sur des vers de Virgile » où sont données des instructions d’une toute autre nature et où Platon est mis à contribution dans un sens bien différent. En même temps que l’autorité de Platon est reconnue et affichée par les allégations, elle est minée par des « commentaires » de Montaigne qui la mettent à distance ou invitent à se l’approprier41. Platon devient, en quelque sorte, le parangon de l’auctoritas dont les allégations relèvent du pédantisme, d’une pensée servile qui se construit sur le fondement de la mémoire et non du jugement. Il y a ainsi, autour des emprunts à Platon, tout un jeu de Montaigne sur la pratique citationnelle, le commentaire invitant le lecteur à relire, en usant de son jugement, les assertions du philosophe convoquées au titre d’argument d’autorité.
– Les avis de Platon sont parfois traités avec ironie et ouvertement contestés par Montaigne. Aussi prestigieuse que soit cette autorité, prestige que lui reconnaît Montaigne, ses ouvrages ne saurait être considérés comme un « bréviaire ».
– Les préceptes de Platon, sa doctrine sont manifestement confrontés à sa vie, à ses mœurs, que Montaigne essaie de trouver où il peut, chez Diogène Laërce ou Plutarque notamment42, ou qu’il imagine. On en
donnera un exemple, emprunté au chapitre « De la ressemblance des enfans aux peres », à propos de cette « pretieuse chose [qu’est] la santé » :
La volupté, la sagesse, la science et la vertu, sans elle, se ternissent et esvanouissent ; et aux plus fermes et tendus discours que la philosophie nous veuille imprimer au contraire, nous n’avons qu’à opposer l’image de Platon estant frappé du haut mal ou d’une apoplexie, et en cette presupposition la deffier de s’ayder de ces nobles et riches facultez de son ame43.
Sorte d’expérience de pensée qui permet de confronter la théorie à la pratique, d’imposer à la doctrine le poids du réel, d’opposer aux « beaux discours de la philosophie » les circonstances concrètes de la vie.
– Enfin, les allégations à Platon s’enrichissent de « cette forme de philosopher par dialogues » qu’il a pratiquée et qui lui permet « de loger plus decemment en diverses bouches la diversité et variation de ses propres fantasies44 », bref qui le rapproche des sceptiques.
Notre deuxième proposition de travail à partir du document fourni par Edouard Simon portera sur un emprunt particulier à Platon. Il s’agit de celui numéroté 51 dans le relevé proposé par Edouard Simon. Ce fragment issu du Timée vient clore, sur l’exemplaire de Bordeaux, le chapitre 47 du livre I des Essais, « De l’incertitude de notre jugement » :
[C] Nous raisonnons hazardeusement et inconsidereement, dict Timaeus en Platon, par ce que, comme nous, nos discours ont grande participation au hazard45.
C’est la notion de hasard convoquée ici de manière appuyée qui m’invite à m’intéresser à cet emprunt qui est aussi un ajout, ajout qui vient donc clore le chapitre et le place précisément sous le signe du hasard46. Au lieu
de ratifier, d’authentifier un discours qui a pu être le fruit du hasard, l’ajout, au contraire, invite à ressaisir toute la réflexion qui a précédé et qui a pu sembler construite et « considérée » comme le fruit du hasard. Si Platon invitait par cette remarque prêtée au personnage de Timée à considérer l’ordre divin, Montaigne la détourne et la retourne pour se maintenir dans l’ordre contingent du discours humain. Le propos est d’une grande portée ici : il inscrit la contingence non seulement dans les événements, dans ce qui part du dehors, mais encore dans notre pensée, dans ce qui part du dedans. Il y a, derrière cela, toute une révision, une reconfiguration des distinctions établies par Plutarque et reprises par Amyot47. Qui plus est, c’est ici que surgit véritablement le hasard. Le texte qui précède convoque « la fortune », laquelle, par la citation de Manulius, se trouve assimilée, selon la conception romaine, à une divinité, sorte de destin48. C’est donc autre chose qu’introduit l’emprunt à Platon, quelque chose de sans doute « plus humain », plus incertain encore. Le surgissement de cette notion de hasard est d’autant plus remarquable qu’elle semble bien être le fait de Montaigne. Il est difficile de savoir dans quelle traduction il a lu le texte de Platon qu’il cite. Si l’on suit Pierre Villey, il fréquenterait la traduction en latin de Ficin, il est également possible qu’il ait eu accès à la traduction de Louis Le
Roy, parue en 1553. Or, dans l’une et l’autre de ces traductions, il n’y a pas de trace de ce « hasard » que mentionne Montaigne :
sed nos multa utpote fortunae participes inconsiderate et temere loquimur49
« Mais nous disons beaucoup de choses inconsidérement, et comme elles se présentent50. »
L’inflexion de la fortune vers le hasard semble être plus particulièrement le fait de Montaigne qui paraît aller plus que ses contemporains et ses prédécesseurs immédiats dans cette lecture du texte de Platon51. Il nous semble qu’il y a là, de la part de Montaigne, une certaine audace de pensée. Nous ne poursuivrons pas davantage l’investigation, laissant à d’autres le soin de le faire s’ils le jugent utile et pertinent.
Nous voudrions conclure sur le fruit que nous avons tiré du travail auquel nous a conduite cette communication, travail sur Montaigne bien évidemment, mais à partir des bulletins de la SIAM dont nous avons pu mesurer, une fois encore, l’extraordinaire richesse et fécondité. À travers des documents de travail, des « articles isolés », des actes de colloque, des éléments de diffusion de travaux universitaires, les bulletins nous ont donné matière à « frotter et limer notre cervelle à celles d’autrui » sur une question qui nous préoccupe, celle de la lecture des auteurs antiques par Montaigne. Confronter les méthodes de travail des uns et des autres avec la sienne propre est un exercice extrêmement fructueux et enrichissant, qui ouvre des pistes, invite à relire Montaigne en se déprenant des habitudes dans lesquelles on s’enferme parfois. À travers la lecture ou la relecture des différents articles sur lesquels nous avons travaillé, nous avons eu le sentiment que la SIAM nous offrait la possibilité de « la conference », ce « plus fructueux et naturel exercice
de nostre esprit » comme on sait. Il nous semble que c’est le plus bel hommage que l’on pouvait rendre à Montaigne, et nous remercions la SIAM de le faire depuis tant d’années maintenant.
Bérangère Basset
1 Voir le propos de Montaigne : « Je ne compte pas mes emprunts, je les poise » (Essais, II, 10, Paris, PUF, coll. Quadrige, 1999, 3e édition, p. 408c).
2 Sur cette question, voir l’ouvrage de Floyd Gray, Montaigne bilingue : le latin des Essais, Paris, Champion, 1991. Voir aussi dans le Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, l’article de Philippe Mottet, « Des citations grecques et Du pedantisme (I, 25) », BSAM, juillet-décembre 1997 (VIIIe sérieno 7-8), Paris, Champion, p. 9-20 : l’auteur de l’article « compte » les citations grecques que fait Montaigne dans le chapitre des Essais considéré et les « pèse ». Il montre que l’investissement de cette langue autre qu’est le grec est une manière de sortir de soi pour se « purger » d’une certaine tendance au pédantisme et de son aspiration à une sagesse idéale : « Instinctivement peut-être, Montaigne aura, dès ses premiers écrits, et par le biais de la citation grecque, en cédant à la tentation de la transcendance et du pédantisme, cherché sa propre maïeutique. Si la sagesse de l’autre demeure inaccessible et non transférable, de même que son langage, tout doit se jouer dans cette distance qui subsiste. “On doit donner passage aux maladies”, écrit Montaigne dans l’essai intitulé De l’experience (III, 13). Et tout se passe comme s’il se guérissait, en citant des vers grecs, d’un certain besoin de sagesse idéale, de son insuffisance en matière de grec… et du pédantisme » (art. cit., p. 19).
3 Sur la question de la citation chez Montaigne, on consultera le travail d’Antoine Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979. Les études en la matière ont été renouvelées par l’ouvrage de Christine Brousseau-Beuermann, La Copie de Montaigne : étude sur les citations dans Les Essais, Paris, Champion, 1989, ainsi que par celui de Floyd Gray, Montaigne bilingue : le latin des Essais, op. cit. Voir aussi l’étude de Claude Blum, « La fonction du “déjà dit” dans les Essais : emprunter, alléguer, citer », CAIEF, no 33, mai 1981 ainsi que, dans le BSAM, l’article de Jules Brody, « Montaigne et la citation génétique », janvier-juin 1994 (VIIe série, no 35-36), Paris, Klincksieck Diffusion, p. 47-58.
4 Nous abrégerons Bulletin de la Société des Amis de Montaigne en BSAM et Nouveau Bulletin de la Société Internationale des Amis de Montaigne en NBSIAM.
5 Voir la définition que donne de la citation l’auteur de l’article : « tantôt Montaigne le désigne par son nom et lui attribue telle opinion ; la formule qui l’introduit est alors du type : “Platon dit : …”, ou bien, de façon plus précise : “Platon, dans la République, dit : …”. C’est ce que, dans la présente note, on appelle “citation” » (Edouard Simon, « Montaigne et Platon », BSAM, janvier-juin 1994 (VIIe série, no 35-36), p. 97.
6 Ces relevés figurent dans le deuxième volet de l’étude paru dans le BSAM de juillet-décembre 1994 (VIIe série, no 37-38), p. 79-99.
7 Essais, op. cit., I, 26, p. 165A.
8 Sur le sujet, voir l’article de Brigitte Humbert, « L’éducation selon Plutarque et Montaigne », BSAM, juillet-décembre 1995 (VIIe série, no 41-42), Paris, Champion, p. 46-51. Nous reviendrons, dans le cours de notre étude, sur cet article de Brigitte Humbert.
9 Essais, II, 10, op. cit., p. 413.
10 Voir la formule de Montaigne au chapitre 26 du premier livre des Essais : « je tors bien plus volontiers une bonne sentence pour la coudre sur moy, que je ne tors mon fil pour l’aller querir », op. cit., p. 171C. Voir encore au chapitre 12 du livre III : « Parmy tant d’emprunts je suis bien aise d’en pouvoir desrober quelqu’un, les desguisant et difformant à nouveau service. Au hazard que je laisse dire que c’est par faute d’avoir entendu leur naturel usage, je luy donne quelque particuliere adresse de ma main à ce qu’ils en soient d’autant moins purement estrangers » (ibid., p. 1056C).
11 Essais, II, 12, op. cit., p. 510.
12 André Tournon, « Le doute investigateur : Métamorphoses d’un “refrain” de Plutarque dans les Essais », NBSIAM, 2e semestre 2009, no 50, année V, p. 17. Cette pratique du doute par Montaigne est distinguée de celle mise en œuvre dans une intention purement sophistique ou polémique, sophistique et polémique émoussant finalement cette « pointe de diamant du doute » pour le dire comme le philosophe Alain.
13 Sur Plutarque dans les Essais, voir l’ouvrage d’Isabelle Konstantinovic, Montaigne et Plutarque, Genève, Droz, 1989.
14 Voir l’ « Avertissement » de l’auteur de l’article : « Le lecteur trouvera dans les pages qui suivent […] quelques matériaux rassemblés en vue d’une étude qui n’a pas été entreprise » (Edouard Simon, « Montaigne et Platon », BSAM, janvier-juin 1994, p. 97. Voir aussi, quelques lignes bas, dans l’exposé de la méthode suivie : « L’objet du présent travail est précisément de compter, laissant à d’autres le soin de peser » (ibid.).
15 Essais, III, 12, op. cit., p. 1043.
16 Sur Socrate dans les Essais, question qui ne saurait être limitée à la lecture de Platon, voir : Thierry Gontier et Suzel Mayer (dir.), Le Socratisme de Montaigne, Paris, Classiques Garnier (Etudes montaignistes, 58), 2010.
17 Jean-François Mattéi, « “J’estois platonicien de ce costé là, avant que je sceusse qu’il y eust de Platon au monde” (Essais, III, 12) », NBSIAM, 1er semestre 2007, I, p. 59.
18 Ibid., p. 60.
19 Ibid., p. 61.
20 Ibid.
21 « Montaigne était donc enclin au platonisme, de son propre aveu, avant de connaître le philosophe grec comme si la vérité de l’être […] précédait le choix que l’homme croit faire librement. Mais si la vérité de l’être, réduite ici, il est vrai, à la question de la justice civile, est antérieure à son actualisation, ce qui est l’hypothèse de Platon avec la théorie de la réminiscence, alors Montaigne est naturellement platonicien en dépit de ses réserves » (ibid., nous soulignons). On émettra quelques réserves sur les rapprochements avec la théorie platonicienne de la réminiscence qui nous semblent un peu hasardeux.
22 Ibid., p. 69.
23 Catherine Magnien-Simonin, « Montaigne et Aulu-Gelle », BSAM, juillet-décembre 1995 p. 7-23. On précisera que l’auteur de cet article a rédigé l’entrée « Aulu-Gelle » du Dictionnaire Michel de Montaigne : Philippe Desan (dir.), Paris, Champion, 2004.
24 Art. cit., p. 8.
25 Ce relevé occupe les pages 22 et 23.
26 Catherine Magnien-Simonin, art. cit., p. 21.
27 Nous plaçons le terme entre guillemets car les différentes approches mises en œuvre dans les articles que nous nous proposons de considérer vont nous conduire à distinguer l’emprunt proprement dit d’autres formes de présence des auteurs antiques dans les Essais.
28 Il aurait sans doute été utile et fructueux d’étendre l’étude au chapitre qui précède, « Du pedantisme », lui aussi concerné par des questions de « pédagogie », comme on sait.
29 Brigitte Humbert, art. cit., p. 46.
30 Ibid.
31 Ibid., p. 51.
32 Nous nous permettons de signaler que nous avons proposé une étude sur la réception de ce traité de Plutarque à la Renaissance, envisageant les traductions qui sont proposés (en latin par Erasme, en anglais par la reine Elisabeth Ier, en français par Amyot) et les emprunts que lui font Erasme, Rabelais et Montaigne. Pour ce dernier, nous sommes partie d’un « compte » des emprunts avant de proposer une pesée de ceux-ci. L’article est à paraître dans la revue en ligne Camenae (sur le site de l’université Paris Sorbonne).
33 « Les rapports textuels entre le chapitre “De l’oisiveté” (I, 8) des Essais et cet opuscule sont trop nombreux pour ne constituer qu’une coïncidence » (Alexander Roose, art. cit., p. 91).
34 Sur ce chapitre, parfois comme une introduction générale à l’ouvrage, voir, entre autres études : Karleinz Stierle, « L’Histoire comme Exemple, l’Exemple comme Histoire », Poétique 10, 1972, p. 176-198 ; Hugo Friedrich, Montaigne, Paris, Gallimard, 1970 (pages à préciser) ; E. M. Duval, « Le début des Essais et la fin d’un livre », RHLF, 1988, no 5, p. 896-907 ; F. Garavini, « Montaigne, l’exemplum et le fantasme (à propos de l’essai I, 1) » in Le Lecteur, l’Auteur, l’Ecrivain Montaigne 1492-1592-1992, éd. I. Zinguer, Paris, 1993, p. 201-209 ; Celson Martin Azar Filho, « Le premier chapitre des Essais », NBSIAM, janvier-juin 2005, p. 15-30.
35 L’auteur fournit un résumé de son article, lequel, comme elle le précise en note, est emprunté à un chapitre de sa thèse. Voici comment elle résume son propos : « Le présent article propose une lecture du premier essai de Montaigne selon laquelle l’ethos serait au cœur d’une démonstration de la faillite de l’idéal héroïque de son époque. Cette perspective prend appui sur deux essais de Plutarque dont le premier “Instruction pour ceulx qui manient les affaires d’estat” fournit à Montaigne l’enjeu qui propulse son essai et qui finit par mettre en question cet idéal. Le deuxième, “De la vertu morale”, permet de reconnaître dans cette mise en question une vision alternative de l’ethos, laquelle rétablit l’optimisme initial de l’essai et situe celui-ci dans le contexte des efforts contemporains pour accéder à l’harmonie civile par le biais de la réforme morale de l’individu » (Cara Welch, art. cit., p. 7).
36 Sur la réception à la Renaissances des idées morales du stoïcisme, voir l’ouvrage de Denise Carabin, Les idées stoïciennes dans la littérature morale des xvie et xviie siècles (1575-1642), Genève, Slatkine, 2004.
37 « Montaigne gleans the gist of his opening premise (how we might soften an adversary’s heart) as well as the examples with which he closes the 1580 edition of “Par divers moyens…” from Plutarch’s “Instruction pour ceulx qui manient les affaires d’estat” »(Cara Welch, art. cit., p. 10).
38 Il faudrait sans doute envisager aussi la metriopatheia dans l’utilisation que fait de cette notion la philosophie sceptique.
39 Voir Olivier Guerrier, « “Rencontres” de mots et de pensées de Montaigne à Richelet », in Jean-Yves Laurichesse (dir.), L’Ombre du souvenir, Paris, Classique Garnier, 2012, p. 35-51.
40 « Platon traite ce mystère d’un jeu assez descouvert. Car, où il escrit selon soy, il ne prescrit rien à certes. Quand il fait le legislateur, il emprunte un style regentant et asseverant » (Essais, op. cit., II, 12, p. 512).
41 « Nous savons dire : “Ciceron dit ainsi ; voilà les meurs de Platon ; ce sont les mots mesmes d’Aristote.” Mais nous, que disons nous de nous-mesmes ? que jugeons nous ? que faisons nous ? Autant en diroit bien un perroquet. » (ibid., I, 25, p. 137) ; « Car s’il [il s’agit de l’enfant] embrasse les opinions de Xenophon et de Platon par son propre discours, ce ne seront plus les leurs, ce seront les siennes […]. Il faut qu’il emboive leurs humeurs, non qu’il aprenne leurs preceptes. Et qu’il oublie hardiment, s’il veut, d’où il les tient, mais qu’il se les sache approprier » (ibid., I, 26, p. 151-152) ; « à toute sorte de propos et matiere, pour basse et populaire qu’elle soit, elles [il s’agit des dames] se servent d’une façon de parler et d’escrire nouvelle et sçavante, […] et alleguent Platon et Sainct Thomas aux choses auxquelles le premier rencontré serviroit aussi bien de tesmoing » (ibid., III, 3, p. 822) ; « Tel allegue Platon et Homere, qui ne les veid oncques. Et moy ai prins des lieux assez ailleurs qu’en leur source […]. Il ne faut que l’espitre liminaire d’un alemand pour me farcir d’allegations ; et nous allons quester par là une friande gloire, à piper le sot monde » (ibid., III, 12, p. 1056).
42 Il est en cela fidèle à ses « goûts » de lecteur qu’il exprime au chapitre « Des livres » : « [A] Or ceux qui escrivent les vies, d’autant qu’ils s’amusent plus aux conseils qu’aux evenemens, plus à ce qui part du dedans qu’à ce qui arrive du dehors, ceux là me sont plus propres. Voylà pourquoy, en toutes sortes, c’est mon homme que Plutarque. Je suis bien marry que nous n’ayons une douzaine de Laertius, ou qu’il ne soit ou plus estendu [C] ou plus entendu. [A] Car je ne considere pas moins curieusement la fortune et la vie de ces grands praecepteurs du monde, que la diversité de leurs dogmes et fantaisies » (ibid., II, 10, p. 416).
43 Ibid., II, 37, p. 765.
44 Ibid., II, 12, p. 509. Voir sur cette diversité d’opinions de Platon et la contradiction à l’œuvre dans sa philosophie : « Platon dissipe sa creance à divers visages ; il dict au Timæe, le père du monde ne se pouvoir nommer ; aux loix, qu’il ne se faut enquerir de son estre ; et, ailleurs, en ces mesmes livres, il faict le monde, le ciel, les astres, la terre et nos ames Dieux, et reçoit en outre ceux qui ont esté receuz par l’ancienne institution en chasque republique » (ibid. p. 515).
45 Ibid., p. 286.
46 Je suis redevable à Olivier Guerrier de cette attention portée au hasard. Je le remercie, entre autres choses, de m’avoir sensibilisée à cette question, capitale pour l’appréhension du xvie siècle.
47 Voir, notamment, l’épître à Trajan qui « préface » les recueils d’Apophtegmes de Plutarque et sa reprise par Amyot, pour établir un partage entre « histoire » et « vie », dans l’avis « Aux lecteurs » qu’il place en tête de sa traduction des Vies : « mais il y en a entre autres deux principales especes : l’une qui expose au long les faicts et adventures des hommes, et s’appelle du nom commun d’histoire : l’autre qui declare leur nature, leurs dicts et leurs mœurs, qui proprement se nomme Vie. Et combien que leurs subjects soient fort conjoints, si est-ce que l’une regarde plus les choses, l’autre les personnes : l’une est plus publique, l’autre plus domestique : l’une concerne plus ce qui est au dehors, l’autre ce qui procede du dedans : l’une les evenemens et l’autre les conseils : entre lesquelz il y a bien souvent grande difference, suivant ce que Sirammes Persien respondit à ceulx qui s’esbahissoient dont venoit que ses devis estoient si sages, et ses effects si peu heureux : “C’est pour autant, dit-il, que les devis sont en ma pleine disposition, et les effects en celle de la fortune et du roy” » (Plutarque, Vies des hommes illustres, trad. Jacques Amyot, Paris, Vascosan, 1567, non paginée.
48 « Ainsi nous avons bien accoustumé de dire avec raison que les evenemens et issuës dependent, notamment en la guerre, de la fortune, laquelle ne se veut pas renger et assujectir à notre discours et prudence, comme disent ces vers : Et male consultis pretium est : prudentia fallax,/ Nec fortuna probat causas sequiturque merentes ;/ Sed vaga per cunctos nullo discrimine fertur ;/ Scilicet est aliud quod nos cogatque regatque/ Majus, et in proprias ducat mortalia leges » (Montaigne, op. cit., p. 286).
49 Platon, Timée, traduction Marcile Ficin (Omnia divini Platonis opera, Froben, 1551).
50 Platon, Timée, traduction Louis Le Roy (Paris, Vascosan, 1553). Nous donnons, pour comparaison, le texte de Platon : ἀλλά πως ἡμεῖς πολὺ μετέχοντες τοῦ προστυχόντος τε καὶ εἰκῇ ταύτῃ πῃ καὶ λέγομεν.
51 Comme on voit, Ficin comprend la tuchê grecque en termes de « fortune » et l’adverbe temere de sa traduction ne saurait tout à fait recouper le hasard. Ce n’est pas en ce sens, en tous les cas, que l’a compris Louis Le Roy qui a sans doute travaillé avec la traduction de Ficin. Peu importe que Montaigne ait eu ou non accès à la traduction de Louis Le Roy, la comparaison montre néanmoins qu’il a « compris » la tuchê, ou se l’est appropriée, en d’autres termes.