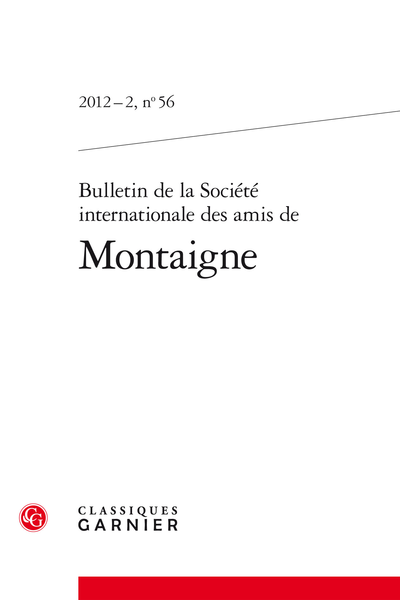
Allocution
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 2, 56. varia - Auteur : Millet (Olivier)
- Pages : 13 à 23
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439773
- ISBN : 978-2-8124-3977-3
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3977-3.p.0013
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 21/02/2013
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Allocution
Monsieur le Président, Chers et chères Ami(e)s de Montaigne,
Fêtant le centenaire de notre Société, on hésite entre deux attitudes possibles. La première serait de célébrer, dans la joie et un digne recueillement, l’anniversaire canonique d’une vieille dame associative, qui aurait vaillamment atteint l’âge d’une grande maturité, et réalisé grâce aux mérites de plusieurs générations de ses membres successifs un record de durée dans le registre des entités relevant de la loi de 1901. L’autre considérerait au contraire notre Société, qui a fait désormais ses preuves à travers de nombreuses péripéties et manifesté abondamment son utilité, comme entrant désormais dans un âge nouveau pour relever d’une nouvelle catégorie, celle d’une institution jeune, qui a devant elle, sinon l’éternité, du moins la pérennité, à l’instar de bien d’autres établissements, savants ou autres, dont l’existence va de soi et qui semblent appartenir au paysage permanent d’une culture, d’une nation, et de la République internationale des Lettres.
Placé devant ce carrefour interprétatif, je me suis demandé dans quel sens il convenait d’orienter la brève allocution que le Président me fait l’honneur de prononcer en ouverture de notre colloque. Ne désirant ni établir un bilan, qu’il serait oiseux et prétentieux de dresser, ni élaborer un programme, qu’il serait présomptueux de projeter et de proposer, ni tomber dans l’autosatisfaction nombriliste que suggèrerait un sentiment illusoire de sécurité, je me contenterai de rappeler quelques faits, inspirés par les circonstances de la fondation de la Société des Amis de Montaigne, et de nature à mettre en perspective notre situation présente d’Amis de l’écrivain philosophe. Ces faits concernent la fondation de notre Société, en 1912, et d’autre part sa place dans le paysage actuel français des Sociétés d’Amis d’écrivains.
L’article « Société des amis de Montaigne » qui figure dans le Dictionnaire de Michel de Montaigne, et qui est dû à la plume savante et alerte de notre ami Philippe Desan, est pour cela une excellente référence. Il rappelle que le premier Président de la Société fut Anatole France, et que l’initiateur et le fondateur en fut le Docteur Arthur Armaingaud, son premier Secrétaire général, qui se considérait lui-même comme le successeur du Docteur Payen (voir sur lui l’article du Dictionnaire, de la même plume informée et lucide). À vrai dire, Anatole France, qui remplit sa charge avec éloquence et bonhomie, était en 1912 à lui seul une véritable institution. Membre de l’Académie française, maître quasi-officiel de la vie des Lettres françaises, grande conscience universelle, cet illustre écrivain, né en 1844, s’était doté d’un symbolique pseudonyme qui le prédisposait à incarner une certaine idée de la culture nationale. Il devint par ailleurs le premier président d’une autre association d’amis d’écrivain, l’Association des Amis de Zola, fondée en 1921, l’année où il reçut le Prix Nobel, trois ans avant sa mort. La Société a donc eu besoin, pour exister et s’affirmer à ses débuts, d’une figure aussi considérable. La proximité d’Anatole France avec l’œuvre de Montaigne mériterait d’être étudiée pour elle-même, mais elle s’impose au premier regard si l’on tient compte des goûts communs qui apparentent ce moderne écrivain à l’auteur des Essais : admiration de la culture antique, scepticisme bienveillant, épicurisme détendu (sur lequel Anatole France insista dans son allocution du juin 1912 à propos de Montaigne, à l’intention notamment du Dr. Armaingaud), haine de l’injustice, vive conscience des séductions du style, mais refus affiché de toute prétention artiste, ironie constante. Le Dr Armaingaud, dans sa propre allocution de ce 8 juin 1912, justifia le choix d’Anatole France comme président au nom de motifs sur lesquels je passe, pour conclure par sa ressemblance avec Montaigne dans les termes suivants : « Ainsi nous pourrions presque nous sentir présider par Montaigne lui-même ». La présence des mânes de Montaigne en 1912, à travers cette médiation presque magique, ne relève-telle pas d’une étude de nature psychologique et anthropologique, qui pourrait s’attacher aux fantasmes, individuels ou collectifs, faisant exister en imagination celui qui a si justement parlé des effets de l’imagination ? Notre Association serait-elle une secte étrange, versée dans un culte initiatique, et spécialisée dans l’invocation des esprits ? Un des buts principaux, inscrit dans les statuts depuis 1912, et dont Anatole
France a lui-même favorisé la réalisation, à lire les premiers numéros du Bulletin, devrait nous rassurer : les statuts précisent en effet que l’objet de notre Société est de conduire « l’étude de l’œuvre de Montaigne et de son temps, [et] la publication de documents et de travaux » ? Ces objectifs raisonnables peuvent servir de garde-fou face aux possibles dérives suscitées par la nécessaire empathie que des amis d’écrivains et de philosophes éprouvent naturellement pour l’objet de leur étude. Anatole France écarta d’ailleurs, à l’occasion du banquet du 8 juin 1912, toute menace d’une obsession fantomatique, quand il déclara au sujet de l’Association : « Je vois bien qu’elle existe, puisqu’elle boit et mange » : les pieds solidement posés sous une table bien servie, présentant éventuellement de nouveaux documents à publier, et discutant ensemble et librement de telle ou telle page des Essais (comme nous l’avons de nouveau fait il y a quelques années à l’initiative d’André Tournon), on peut évoquer la présence de Montaigne sans risquer de s’abandonner à des fantasmes. En 1912, il n’y eut qu’une seule manifestation d’évocation directe de la voix de Montaigne, mais elle fut jouée artistiquement par Mlle Dussane, de la Comédie française, qui lut devant les Amis un chapitre des Essais (lequel ? ce n’est pas indiqué dans le compte rendu d’alors). Du reste, l’œuvre de Montaigne est aujourd’hui l’objet de pas mal d’adaptations, notamment de mises en scène théâtrales qui visent à en communiquer sinon la substance, du moins une image, à un public assez large et de manière spectaculaire et mimétique. Nous ne pouvons que nous en réjouir, même si notre rôle est peut-être de veiller à ce que cette médiatisation contemporaine soit la moins infidèle possible à l’authenticité et à la richesse des Essais.
Ainsi mis en avant comme parrain de la Société et comme porte-drapeau d’une certaine idée de la culture nationale, le nom d’Anatole France, le Dreyfusard et le militant de bien d’autres causes de l’époque, ne devait pas cependant offusquer la nécessité, amicale et savante, de la neutralité idéologique. Les statuts de l’Association naissante prévoient en effet également que l’Association « s’interdit toute discussion qui aurait trait à des questions actuelles politiques ou religieuses ». Utile précaution, à une époque de grandes passions idéologiques, mais qui va de soi dans une Société d’Amis, et singulièrement dans le cas des Amis de Montaigne, me semble-t-il. Mais qui étaient ces Amis en 1912 ?
Comme vice-présidents, on choisit à côté de Henri Roujon, qui représentait l’Académie française, Louis Barthou, lui-même ami de Roujon et son futur successeur à l’Académie. Barthou, républicain modéré, proche d’Anatole France, était un ancien ministre chevronné, et alors garde des sceaux, poste qu’il occupa de 1909 à 1913. De manière significative, on rencontre donc, comme fées de la naissante Société des Amis de Montaigne, l’association bien française de la politique (dans son orientation laïque, républicaine et modérée de l’époque) et des Lettres, dans sa version à la fois la plus institutionnelle (avec Roujon) et alors la plus prestigieuse (avec Anatole France). Depuis cette époque, plusieurs hommes politiques français se sont intéressés à Montaigne, mais c’est en général en raison d’une proximité d’abord locale et régionale des élus concernés avec l’ancien maire de Bordeaux. L’Association des Amis a toujours volé de ses propres ailes de ce point de vue, sans se rendre dépendante de patronages trop voyants, de subventions publiques trop abondantes, ni des rites des commémorations nationales, ni de quelque autre institution que ce soit. Par bonheur, la Société des Amis de Montaigne est restée ce qu’elle devait être, une société d’amis, malgré les appuis de prestige dont elle a eu besoin et dont elle a bénéficié pour devenir visible alors dans l’espace public. Quasi-institution par les faveurs qui ont entouré sa naissance associative légale, elle ne s’est pas soumise à des motivations idéologiques étrangères à la mission qu’elle s’était fixée.
Sur le plan sociologique, les séances parisiennes, qui se tenaient à l’origine à l’École de Médecine, témoignent de l’importance du milieu médical pour la réception moderne de l’œuvre de Montaigne, sans qu’il y ait eu dans ce cas aucun risque d’inféodation à quelque chapelle que ce soit. Aussi bien Montaigne, magistrat démissionnaire, honnête homme, gentilhomme, pyrrhonien, ne pouvait devenir non plus l’annexe d’aucune Faculté (des Lettres ou autre), d’aucune boutique littéraire, historique ou philosophique, d’aucune Académie, d’aucune Amicale des Anciens de…, etc. Dans le paysage critique actuel, le fait que Montaigne n’appartient ni aux seuls amateurs, ni aux littéraires ou historiens de profession, ni aux philosophes de spécialité, ni à aucune secte critique est plutôt réjouissant, et constitue pour notre Société un précieux héritage et une chance, dont il convient de continuer à titer profit.
Anatole France contribua donc à l’établissement public non-institutionnel d’un groupe au départ restreint d’admirateurs fervents de l’auteur des Essais, qui s’était d’abord réuni dans un cadre privé, autour du Docteur Armaingaud. Le lointain modèle de notre Société remonte donc à ces sodalitates humanistes de la Renaissance, qui regroupaient des amis autour d’une table et de verres de bon vin, pour partager ensemble la curiosité, le savoir et les divers goûts de la langue. Devenue immédiatement, grâces à ses activités et à son Bulletin, un foyer central des études montaignistes, la Société est sans doute de fait également le premier exemple chronologique de Société d’Amis d’auteur, un type d’Association qui a depuis prospéré, presque pullulé, puisque notre pays en compte actuellement plus de deux cents.
Certes, elle disposait lors de sa naissance de plusieurs modèles possibles, mais dont elle sut, par les circonstances de sa création et la qualité de ses membres initiaux, se distinguer de manière originale. L’un de ces modèle est mentionné plaisamment par Anatole France dans son allocution de 1912, il s’agit de la « docte congrégation de rabelaisiens dont Abel Lefranc est le prieur ». Lefranc, alors professeur au Collège de France et maître de conférences à l’École Pratique des Hautes Etudes, avait en effet fondé la Société et la Revue des études rabelaisiennes, à une époque où il mettait en route son édition monumentales des Œuvres de Rabelais. Mais il y a peut-être une pointe d’ironie dans la mention, par ailleurs affectueuse, que fait Anatole France de cette congrégation et de ce prieur des rabelaisiens : la Thélème d’Abel Lefranc présentait en effet une allure beaucoup plus grave que la Société des Amis de Montaigne, qui, en comparaison de la rabelaisienne, conserve paradoxalement certains traits d’une Société d’enfants sans souci. La Société et la Revue des études rabelaisiennes étaient en effet née en 1903 du groupement (je cite Abel Lefranc) d’un certain nombre de « travailleurs » qui participaient aux conférences du maître à l’École Pratique sur l’œuvre de l’écrivain tourangeau. On y trouvait des auditeurs et des collaborateurs français et étrangers, on s’y livrait à des excursions historiques (idée que reprendra la Société montaigniste dès 1913), et l’on avait comme objectif une édition nationale des Œuvres complètes de Rabelais et la création d’une revue (et non la production d’un simple bulletin), sur le modèle de ce qui se faisait déjà à l’étranger pour plusieurs grands
écrivains des nations concernées. Les statuts de la Société des Amis de Montaigne sont d’ailleurs une copie quasi-conforme de ceux de la société sœur rabelaisienne de 1903, y compris dans la formulation des objectifs poursuivis : étude de l’auteur et de son temps, publications, interdiction des discussions politiques et religieuses actuelles.
Mais si l’on consulte la liste des membres de la Société des études rabelaisiennes, le contraste sociologique et culturel par rapport à la nôtre ressort très nettement. Du côté de Rabelais, on trouve essentiellement un réseau de savants ou d’érudits, souvent appartenant à l’enseignement, notamment à l’Université ou au monde des Bibliothèques. C’est ce que l’on peut appeler le réseau « Abel Lefranc », qui s’étendait entre autres au monde anglais, germanique et suisse, qui sont très représentés. Ce n’est pas du tout une société d’amis, même si elle regroupait également des amis de Rabelais, sans titre professionnel. D’autre part, on n’y trouvait pas une représentation aussi significative du monde politique qu’à la Société montaigniste, et la présence parmi les rabelaisiens de Léon Blum était, en 1903, à cette époque, celle d’un écrivain, non d’un politicien. Autre contraste, du côté de notre société, on est d’abord frappé par le caractère quasiment exclusif de deux milieux géographiques français, Paris et le sud-ouest bordelais et périgourdin. Il n’y a pratiquement pas non plus d’étrangers, avant la timide apparition, en 1914, d’un officier de l’armée brésilienne, Monterroyos, mais qui réside à Paris. La dimension mondaine (autant que médicale), ainsi que journalistique, est également importante, avec par exemple le critique Paul Souday, du journal Le Temps (où Anatole France avait tenu jadis une chronique), ou bien la mécène et bibliophile avertie qu’était la marquise Arconati Visconti. On a donc affaire, à une société d’amis qui, par sa diversité de bon aloi, est une sorte d’Académie française en miniature ; il n’y manque qu’un cardinal (chose sans doute impensable à l’époque) et un militaire …français. Lefranc avait mis sur pied pour Rabelais un modèle de société savante vouée à publier une Revue et des Œuvres complètes ; le Dr Armaingaud, avec la complicité d’Anatole France, propose un modèle plus ouvert, à la fois érudit et social. Paradoxalement, c’est ce caractère hybride (bien montaignien, me semble-t-il), qui a permis à notre société de devenir l’institution qu’elle est, dans la mesure où il la distingue encore de trois autres modèles également possibles.
En ce qui concerne le précédent, essentiellement savant, de La Société et Revue rabelaisiennes, elles ont fini par se spécialiser dans la seule Revue des études rabelaisiennes, et abandonné, semble-t-il, l’idée d’une Société Rabelais. Il faut attendre 1948 pour qu’une sorte de Société Rabelais apparaisse, mais il s’agit alors de L’Association des Amis de Rabelais et de la Devinière, qui suit encore un autre modèle. Cette dernière association a été en effet fondée pour favoriser la création d’un musée à la Devinière. C’est donc en fait essentiellement une association à laquelle s’adosse une maison (en l’occurrence un musée) d’écrivain. Or dans le cas de Montaigne, le paysage est différent, puisque le château de Montaigne, resté au cours de siècles bien vivant comme demeure privée, a assuré, grâce à ses propriétaires successifs, depuis le xviiie siècle jusqu’à nos jours, un rôle remarquable pour la familiarisation des visiteurs et des touristes avec le milieu dans lequel a vécu la personne et a été composée l’œuvre de l’écrivain. C’est donc tout naturellement qu’en 1913, la propriétaire de l’époque, madame Thirion-Montauban, alors marquise de Reverseaux, apparaît parmi les membres fondateurs de la SAM, selon une claire répartition : la maison d’écrivain d’un côté, la SAM de l’autre, qu’unissent heureusement et jusqu’à nos jours des liens de naturelle collaboration. Un autre modèle, dérivé du précédent, était encore possible, qui est bien attesté dans le cas de Rabelais également : celui des études de type régionaliste, centré sur un public local, et voué à la mise en valeur des racines du grand auteur. Abel Lefranc, par ailleurs si attentif à la dimension régionale de la langue et des œuvres de Rabelais, le mentionne en 1903 : il avait existé une Société des Amis et admirateurs de Rabelais, attestée dans les années 1880-1890, et des activités de laquelle l’Union libérale, journal républicain d’Indre-et-Loire, donnait des comptes rendus. Il s’agissait, semble-t-il, d’un groupe purement local, sans lien direct avec Paris, le reste de la France ou du monde, ni avec la recherche académique. Permettez-moi au sujet de cette dimension régionaliste de mentionner un détail amusant. Dans la liste des membres fondateurs de la SAM, en 1912, un seul nom semble échapper à la loi de la gravitation bordelaise ou parisienne, celui d’un certain Delbrêl, chef de gare à Châteauroux. Je me suis demandé pourquoi ce chef de gare était apparemment la seule personnalité exorbitante en 1912, et si les horaires de train des lignes Paris-Châteauroux et Châteauroux-Bordeaux pouvaient expliquer cette anomalie. Autrement dit, le turbo-montaigniste
existe-t-il comme type fondateur, essentiel et caractéristique de notre Société ? La réponse à cette question est donnée dans le Bulletin de 1914 : monsieur Delbrel était un membre actif de la Félibrée périgourdine, qui venait d’être créée en 1901, et proposa d’associer cette fête occitane annuelle à la mémoire locale de Montaigne. Loin d’être une exception qui confirme la règle, Delbrel est donc un exilé périgourdin, soucieux de rattacher Montaigne à l’Occitanie, et peut-être de lutter contre la pente de la « centralisation », terme aux connotations un peu autoritaires qui apparaît régulièrement dans les statuts des Associations de l’époque et qui fut repris en 1912 par le Dr Armaingaud au sujet de la vocation de la SAM, dans l’expression qu’il emploie pour définir la SAM comme « lieu de centralisation » des études sur Montaigne, de manière un peu trop flatteuse, certes datée, mais désignant aussi une visée bien utile.
En tout cas, la SAM s’est appuyée dès sa naissance sur son double réseau initial, bordelais et parisien, de façon à sortir des deux limites en quelque sorte opposées qu’illustre le cas des regroupements rabelaisiens : celui de la seule érudition locale, et celui de la seule recherche académique (à laquelle la Société des études rabelaisiennes s’est au contraire immédiatement vouée). Par sa vocation initiale, et les choix judicieux de ses fondateurs, la Sam n’est donc ni une pure société savante, ni une association vouée à une tâche de type patrimonial ou régional, en tout cas pas un cénacle d’initiés. Restait un dernier modèle disponible, et indépendant de toute idée de société, celui des Revues consacrées à un auteur. En 1913, il existait déjà déjà une revue Bossuet (1900), une revue Bourdaloue (depuis 1902), ainsi que la publication Le Moliériste, fondée en 1879. Même si l’existence de pareils organes suppose un groupe uni d’admirateurs, de fidèles et de passionnés (dans le cas de Molière, il s’agit, je cite, d’« une petite église littéraire », qui se réclame de l’existence de la Société Shakespeare), ils n’appellent pas d’autres activités que celle de la publication de documents et d’études, comme ce fut effectivement le cas pour Bossuet et pour Bourdaloue. La SAM est donc la première Société d’Amis d’auteur qui soit à la fois savante et ouvertement amicale, et nous pouvons être fiers d’être membres d’une Amicale qui a donné l’exemple dans d’autres champs de la littérature française. Je pense à l’Association Emile Zola, qui avait été créée en 1909, mais qui ne devint ce qu’elle est qu’en 1921, sous la forme renouvelée et pacifiée de l’Association littéraire des Amis d’Emile Zola (l’année où la SIAM
put reprendre, après la Grande guerre, ses publications), et dont le premier Président fut justement encore Anatole France (il avait prononcé l’oraison funèbre de Zola en octobre 1902) ; elle publia un Bulletin à partir de 1922. Je pense aussi à celle des Amis de Rimbaud, de 1929, qui précède celle des Amis de Proust, de 1947, et bien d’autres, plus de deux cents en activité actuellement.
Cette combinaison du savoir et de la sociabilité, avec les réseaux de proximité que celle-ci supposait en 1912, explique au demeurant que la SAM ait été une compagnie nationale avant de devenir internationale. En 1912, on n’y trouve pratiquement pas d’étrangers, avant que ceux-ci apparaissent timidement ensuite. Son remarquable développement international par la suite, et notamment de nos jours, témoigne, entre autres, de l’essor universel des sciences humaines dans le domaine académique, notamment en littérature française et en philosophie, ainsi que de l’attractivité d’un écrivain qui sut penser son époque, que nous appelons la Renaissance, à la lumière de la découverte du Nouveau Monde. Le besoin, fréquent en sciences humaines, de lieux de rencontre et de contacts réguliers, le développement parallèle de la recherche universitaire et des moyens modernes de communication, et le rôle de l’amitié comme la facilité des déplacements, ont rendu possible cette heureuse internationalisation, qui est devenue une de nos caractéristiques les plus marquantes, et qui est bien dans le prolongement de ce que furent les goûts et la culture de Montaigne humaniste et voyageur, plus à l’aise en dehors de nos frontières que dans son propre pays, si l’on excepte (et encore) le refuge de sa maison (faut-il dire de sa tour ?).
Les circonstances de la naissance de la SAM m’inspirent une dernière observation. En 1912, le Docteur Armaingaud préparait son édition des Œuvres complètes, qui allait paraître de 1924 à 1927 en douze volumes. La question de l’édition des Essais était de manière générale à l’ordre du jour en 1912, notamment en raison de l’édition Municipale en cinq volumes, en cours de parution de 1906 à 1933. Les questions liées à l’édition du texte, au choix du texte de base à suivre ainsi que des principes à adopter pour communiquer au public moderne l’œuvre de Montaigne occupent de fait une place importante dans les discussions et les premiers Bulletins de la SAM naissante. Un
siècle après, l’actualité éditoriale n’est de nos jours pas moins vive et importante, mais je ne mentionnerai pas ici les différentes éditions qui se sont succédé ces dernières années, aussi remarquables que divergentes dans leurs principes. La SAM est née, si l’on peut dire, du triomphe de l’exemplaire de Bordeaux sur les versions issues de l’activité de Marie de Gournay. Depuis, on a commencé à explorer toutes les conséquences (et cette entreprise se poursuit) qu’impose la considération attribuée à l’exemplaire de Bordeaux, en même temps que l’on a réhabilité la fille d’alliance de Montaigne sur le plan littéraire, pour son œuvre propre, ainsi que pour le haut intérêt, quel qu’il soit, qu’offre son édition des Essais de 1595. Permettez-moi à ce sujet un scoop, et un regard rétrospectif œcuménique, je l’espère. La SAM n’est pas née, comme on le croit trop naïvement à lire nos statuts, en 1912, mais en 1592. Son Président d’honneur était une femme, madame de Montaigne, Pierre de Brach fut son premier Président, et Marie de Gournay sa première Secrétaire générale (à laquelle a succédé, depuis, Armelle Andrieux), comme on peut le constater d’après divers documents peu connus, rédigés en latin, qui datent de cette époque, mais qui ne font état, pour cette noble confrérie, de l’octroi d’aucun privilège royal ou parlementaire. Immédiatement internationale (malheureusement la liste complète des membres participants de l’époque est perdue), la SAM originaire a survécu depuis ce lointain passé de manière plus ou moins visible à travers une diaspora d’esprits éclairés et fervents, même si, au cours de siècles, tous les montaignistes n’ont pas fait partie des amis de Montaigne (je pense à Pascal). Notre SAM, refondée et devenue quasiment une institution depuis 1912, est donc l’héritière d’une longue, vaste, œcuménique et pour une bonne part indéfinissable société littéraire, savante autant que morale, qui a su rallier les esprits les plus divers sans se croire la gardienne d’un héritage, de fait sans frontière et qui ne lui appartient pas. Son véritable rôle n’est-il pas, alors, de seulement susciter le désir de connaître l’œuvre de Montaigne ? Nous ne nous étonnerons donc pas de la sagesse et des équilibres qui président à la vie officielle de notre Société depuis 1912, et qui déterminent moins un programme (car ces choses-là ne se programment pas) qu’un état d’esprit auquel nous sommes heureux de participer à notre tour.
Le champ d’action qui est le sien est en tout cas profondément homogène au projet de Montaigne dans Les Essais, puisque, je cite pour finir
encore Anatole France, la S(I)AM a pour mission « une enquête qui ne peut pas, qui ne doit pas être achevée jamais ». Lecteurs, herméneutes et amis : que chacun se sente chez lui à l’un ou l’autre de ces trois titres ; pour Montaigne, c’est égal.
Olivier Millet