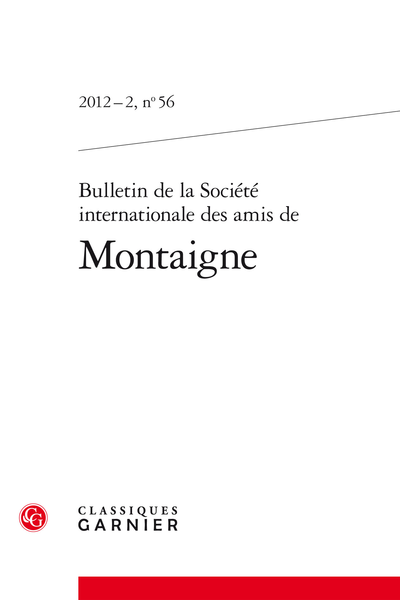
1942 : Léon Brunschvicg lecteur de Montaigne
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 2, 56. varia - Auteur : Ferrari (Emiliano)
- Pages : 81 à 97
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439773
- ISBN : 978-2-8124-3977-3
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3977-3.p.0081
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 21/02/2013
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
1942 : LÉON BRUNSCHVICG LECTEUR
DE MONTAIGNE
Notice biographique sur Léon Brunschvicg1
Léon Brunschvicg naît à Paris le 10 novembre 1869 et fait ses études au lycée Condorcet, où il se lie d’amitié avec Elie Halévy et Xavier Léon. De cette rencontre décisive devaient naître, quelques années plus tard, la Revue de Métaphysique et Morale (1893) et la Société Française de Philosophie (1901), manifestations d’un moment républicain de la philosophie qui vise à la socialisation du travail philosophique et à l’ouverture d’espaces de discussion réglée2. Ancien élève de l’École Normale et agrégé de philosophie, Brunschvicg est ensuite nommé professeur dans plusieurs lycées de France (Lorient, Tours, Rouen). Entre-temps il achève sa thèse, dont la soutenance a lieu à la Sorbonne en octobre 1897. Deux ans après, il épouse Cécile Brunschvicg, née Cécile Kahn. Sous l’influence de son mari, elle militera pour les droits politiques des femmes, jusqu’à devenir présidente de l’Union française pour le Suffrage des Femmes. Féministe « réformiste », elle s’engagera dans l’action sociale et poursuivra une carrière politique, devenant
sous-secrétaire d’État à l’éducation nationale dans le premier gouvernement de Léon Blum (1936). Un an après son mariage, Brunschvicg est nommé professeur de philosophie dans son ancien lycée, puis au lycée Henri IV.
C’est en novembre 1909 que Brunschvicg intègre l’université, devenant maître de conférences à la faculté des lettres de la Sorbonne, où il deviendra professeur sans chaire, puis titulaire de la Chaire d’Histoire de la Philosophie moderne (1927-1940). Son enseignement à la Sorbonne et à l’ENS marquera plusieurs de ses étudiants, parmi lesquels on compte Raymond Aron, Jean Hyppolite, Jean Laporte, Jean Piaget. En novembre 1919, il est élu membre de la section de philosophie de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, dont il sera président en 1932. Parmi les fondateurs de la « Societas Spinozana », il est aussi « curator » de la maison de Spinoza à La Haye. En 1937, il préside le Congrès International de Philosophie qui se tient à Paris et est placé sous le signe de Descartes, dont on célébra ainsi le tricentenaire du Discours de la méthode. Il préside également la Société Française de Philosophie de 1936 à l’interruption de son activité en 1939. Dans les mêmes années, la montée au pouvoir du nazisme assombrit les horizons internationaux : Brunschvicg dénonce ce retour à l’obscurantisme lors du Congrès de Philosophie de Lyon en 1939. Son dernier cours à la Sorbonne en 1939-1940 est consacré à l’« Esprit européen » et à la civilisation de l’Europe occidentale qu’il voit menacée dans ses valeurs les plus hautes. Suite à l’occupation nazie, il est contraint de quitter Paris à cause de ses origines juives. Il s’installe en zone libre à Aix-en-Provence où, après deux ans de travail, il achève son livre sur Descartes et Pascal lecteurs de Montaigne (1942). Il meurt à Aix-les-Bains le 18 janvier 1944, souffrant depuis longtemps d’une affection cardiaque.
L’ouvrage et son contexte de rédaction
Descartes et Pascal lecteurs de Montaigne3 est le dernier de ses ouvrages que Brunschvicg voit paraître, rédigé dans les années 1940–1941 pendant son asile à Aix-en-Provence, dans un climat perturbé par les malheurs publics et par des difficultés familiales4. Les lois imposées par les nazis en interdisant la publication en France, la première édition de l’ouvrage paraît en Suisse, à Neuchâtel, chez les « Éditions de la Baconnière » l’année 1942. L’ouvrage est réédité en 1944 par l’éditeur new-yorkais « Brentano’s » et en 1945 à nouveau chez les « Éditions de la Baconnière » ; l’on trouve aujourd’hui une édition de poche chez « Pocket » (1995).
Dès l’avant-propos, Brunschvicg nous avoue avoir toujours eu, à la lecture des Essais, le sentiment d’une « profonde amertume », encore que « dissimulée sous une affectation de nonchalance », et s’être toujours expliqué cet accent par les malheurs de l’époque où Montaigne vivait, « la plus sinistre de l’histoire du pays5 ». Le livre s’ouvre ainsi avec un parallèle entre l’époque des guerres de religion au xvie siècle et la situation de la France sous l’occupation allemande. C’est sous le signe d’un destin commun, celui du déchirement interne du pays avec ses horreurs et ses violences physiques et psychologiques, que Brunschvicg revient à Montaigne : « Les événements dont la France est aujourd’hui la victime devaient naturellement nous amener à chercher dans la compagnie de Montaigne refuge et amitié ». Comme devait le faire dans les mêmes années (1941-1942) Stephen Zweig à Petrópolis, Brunschvicg revient à Montaigne dans une situation d’abattement personnel et public, pour y chercher le baume du réconfort spirituel. Et d’ailleurs, ce réconfort ne tarde pas à arriver. Comme il l’écrit : « en prolongeant notre méditation désolée, nous avons vu surgir, avec le spectacle d’un redressement brusque et total, un motif puissant d’espoir et de confiance ». Mais ce motif, il faut le préciser, découle d’un
regard rétrospectif sur l’histoire de la France et sur le « drame » qui se trouve « aux origines de la pensée française6 ». Selon Brunschvicg, la pensée française a su surmonter la crise politique et spirituelle du xvie siècle, représentée par Montaigne, et voir surgir la figure de Descartes avec la fondation d’une nouvelle philosophie rationaliste. La France contemporaine connaîtra-t-elle ce même destin ? Quelle pensée saura survivre à l’inhumanité du présent ? Ce sont les questions implicites que Brunschvicg ne pose pas directement dans son livre, mais qui paraissent sous-jacentes à cette articulation étroite entre la crise historique et spirituelle du xvie siècle et les événements de la Deuxième Guerre mondiale, qui en représenteraient une dramatique répétition. Mais au détour d’une phrase, l’argumentation de Brunschvicg dépasse l’horizon historique et personnel pour atteindre celui de l’histoire de la philosophie. Revenir à Montaigne signifie en effet éclairer les conditions de la naissance de la pensée française moderne.
La fortune a donné à Montaigne les lecteurs les plus assidus et les plus fervents qu’auteur eut pu souhaiter : René Descartes et Blaise Pascal. Tous deux l’ont incorporé à leur propre substance, impatients pourtant de lui répondre, et par là de mettre à l’abri de ses critiques inexorables les principes de leurs convictions. L’étude parallèle de leurs réponses, radicalement divergentes et en même temps étroitement solidaires l’une de l’autre, nous a semblé offrir une chance sérieuse de préciser les termes du problème auquel la pensée française s’est attachée au sortir du Moyen-Age et d’en définir les caractères essentiels7.
Composé de trois parties et d’une conclusion, l’ouvrage de Brunschvicg s’ouvre avec une étude sur Montaigne, la plus longue des trois, accompagnée de deux études, l’une sur Descartes et l’autre sur Pascal, étudiés dans leurs rapports de solidarité et d’opposition avec Montaigne. Nous allons exposer dans un premier temps la lecture brunschvicgienne de Montaigne, pour considérer ensuite les enjeux historiographico-philosophiques de l’ouvrage, et ses rapports avec les études parues dans le bulletin de la SAM à partir des années 1960.
Le « Montaigne » de Brunschvicg
Il faut admettre que Brunschvicg a eu le mérite de reconnaître, dès les premières pages de son ouvrage, les enjeux philosophiques du dessein de la connaissance réflexive de soi dans les Essais, précisant aussitôt que l’originalité de Montaigne à ce sujet demeure dans sa capacité de nous montrer l’exécution de ce projet en même temps que l’impossibilité de le réaliser. La peinture de soi, en effet, ne peut s’achever que dans la « coïncidence entre le tableau et l’objet », mais cette coïncidence s’avère fragile et menacée par l’aporie. Les difficultés énumérées par Brunschvicg – le flux temporel, d’une part, l’instabilité du modèle, de l’autre – se réduisent au problème auquel se heurtent les méditations spirituelles, quand elles tentent d’« écarter la médiation de la conscience réfléchie, pour se rendre capables de décrire autrement qu’en imagination de rêve ce qui serait l’état primitif et pur de l’être8 ». Ainsi, quand Montaigne raconte dans l’essai III, 13, « De l’experience », avoir parfois voulu être réveillé la nuit, pour ne pas laisser échapper le sommeil, Brunschvicg interprète cet acte à la lumière d’une exigence générale d’intégrer tous les instants de l’expérience vécue dans la « durée consciente », qui se manifeste aussi dans le récit de l’accident de cheval et des états de conscience qui l’accompagnent. Au cours de l’essai II, 6, « De l’exercitation », « la curiosité des fonctions qui s’exercent “au bord de l’ame”9 » engagera Montaigne dans une « épineuse entreprise » qui l’amènera à reconnaître les limites de la connaissance de soi. Brunschvicg résume dans une belle formule cette prise de conscience : « le sage qui a l’ambition de se connaître devra donc renoncer à la prétention de se reconnaître10 ». Chaque acte réflexif nous fait paraître autre à nos propres yeux, et parce que nous changeons incessamment, et parce que change l’intensité de notre réflexion sur nous-mêmes. Brunschvicg voit ainsi, dans cette réflexion
montainienne sur les rapports entre la « durée », l’« instant » et la connaissance de soi, comme le « pressentiment » du problème qui sera le propre de la pensée d’Henri Bergson, « dans l’intervalle qui sépare de l’Essai sur les données immédiates de la conscience les Deux sources de la morale et de la religion11 ».
Mais Montaigne ne s’est pas arrêté au « plan horizontal de l’immédiat et du passif12 » : la connaissance réflexive de soi n’est pas commandée par la seule exigence gnoséologique d’observation et description de soi13. Grâce à l’écriture, Montaigne veut calmer « un remous » qu’il a éprouvé lorsqu’il a pris sa retraite, et dont l’essai I, 8, « De l’oisiveté » est un témoignage. « La rédaction des Essais représente un effort vers une discipline de l’oisiveté14 », car l’écriture, en fixant une pensée qui s’écoule sans cesse, introduit un certain ordre dans le mouvement psychique15. Brunschvicg valorise ainsi l’intention performative et pratique de l’écriture et de l’introspection et cite Gustave Lanson, à propos de l’importance des mots « ordre », « règle », « règlement » et « régler » chez Montaigne16. La spécificité philosophique des Essais réside donc, selon Brunschvicg, dans « la tension constante entre deux façons d’envisager “la culture de l’âme”, tantôt curiosité spéculative […] tantôt exigence de réforme pratique17 », où la psychologie est au service de la morale, du redressement de la conduite et de la conservation de « l’interne santé » (III, 13).
Brunschvicg voit dans la critique de la raison de l’« Apologie de Raimond Sebond », qu’il juge « précise et avertie18 », un autre mouvement essentiel de la pensée de Montaigne. Cette critique a au moins deux niveaux de lecture. Premièrement, elle est une dénonciation « nette et péremptoire [de] l’inconsistance des systèmes de panlogisme, passés, présents ou futurs19 », qui prétendent que le réel soit intégralement compréhensible par la raison et ses concepts. L’auteur pense ici à la physique et à la métaphysique aristotélico-scolastiques, qui par leurs procédés syllogistiques et formels prétendraient passer de l’abstraction à la réalité. Deuxièmement, Brunschvicg met en valeur la dimension sociologique de la critique montainienne de la raison, dans la mesure où la domination des idées logiques, physiques et métaphysiques d’Aristote (« le culte que lui a voué le Moyen Âge occidental », écrit-il) s’explique par la manière dont les institutions collectives – notamment les Collèges de l’époque – forment les opinions et les idées des hommes. En commentant un important passage de l’« Apologie de Raimond Sebond20 », Brunschvicg conclut que, aux yeux de Montaigne, « la structure d’un système corporatif commande du dehors la décision du jugement, qui ne devrait jaillir que de l’intimité de la réflexion21 ». À ce niveau, la critique de la raison scolastique acquiert aussi une dimension pédagogique, car elle préserve le « principe fondamental de l’éducation22 », qui est d’apprendre à vivre en développant l’exercice d’un jugement libre. Pour Brunschvicg, cette critique de la « raison » implique la distinction entre deux sens du mot, dont hériteront Descartes et Pascal : la raison en tant que « capacité de trier le vrai23 », qui est une fonction du jugement libre, et en tant que raison formelle, qui opère sur les propositions « pour y appliquer les règles de la déduction logique24 ».
À la critique de la raison s’accompagne chez Montaigne une critique de l’expérience qui passe, selon Brunschvicg, par une « critique de l’empirisme médical aussi méthodique et profonde que celle du rationalisme métaphysique25 ». En refusant l’idée d’uniformité de la nature, Montaigne mine la prétention de donner à la méthode inductive un fondement dans le réel. Ce qui a été observé dans un ou plusieurs cas ne permet pas de prévoir ce qui se produira dans le futur, car l’expérience directe ne nous apprend pas l’ordre de la nature et ses lois. La critique montainienne de l’exemple (III, 13, « De l’experience ») apparaît ainsi à Brunschvicg dans son statut proprement épistémologique, et non seulement moral. De ce fait, la critique de l’expérience instruit « le procès du réalisme qui fait fond sur les donnés sensibles pour pénétrer jusqu’à l’essence des choses », constituant un topos épistémologique qui « reparaîtra au seuil des Méditations cartésienne, au cœur des Pensées de Pascal26 ».
Dès lors, la critique de la raison et de l’expérience aboutit à l’impossibilité « de fonder et d’ordonner l’édifice de la connaissance27 ». Mais de cette « profession d’agnosticisme », comme il l’appelle, Brunschvicg sait apprécier la valeur profondément heuristique, car si le scepticisme repousse les tentations « du sommeil dogmatique28 » , Montaigne ne s’est pas tenu à l’ignorance. Le premier parmi les historiens français de la philosophie entre les xixe et xxe siècles, Brunschvicg a su voir dans l’ignorance montainienne le ressort qui entraîne « l’inquisition » et ouvre la recherche plutôt que de la clore29, montrant comment l’usage métaphysique et constructif du doute et du scepticisme chez les philosophes rationalistes du xviie siècle a ses racines dans Montaigne.
Puisque la raison dogmatique est incapable d’établir ce qu’il convient d’entendre par nature, elle ne pourra pas non plus pénétrer dans le domaine de la divinité que l’on suppose constituée au-dessus, et même à l’encontre, de la nature. « Tel qu’il se pose en fait à travers les Essais, le problème religieux concerne uniquement l’humanité30 ». Selon Brunschvicg, en effet, Montaigne se désintéresse des arguments métaphysiques concernant l’essence de la divinité et la démonstration de son existence, pour ramener le religieux « au problème de l’orgueil », par lequel l’homme se pose d’une manière arbitraire comme un centre d’intérêt privilégié pour la divinité. L’absolu de la foi est alors mis en rapport avec les « diverses formes de relativité auxquelles, sans le savoir, elle se trouve suspendue31 » : la pluralité des mondes, des espèces vivantes, et surtout des cultes. Ainsi, pour Brunschvicg, « sous le désordre voulu de la composition les Essais renferment, à côté d’un Traité des Systèmes, un véritable Traité des Religions, qui approfondit la psychologie du cuider, de l’orgueil humain, par un examen méthodique des raisons de croire et de ne pas croire32 ». L’intelligence d’une « relativité fondamentale » apparaît ainsi indissociable d’une « humilité sincère ».
Cette vision toute humaine du fait religieux est signifiée aussi par l’importance que Montaigne accorde, dans le jugement du christianisme, au « critère moral33 » : la civilisation chrétienne est mise en question pour ce qu’elle a fait de l’homme sur terre, et le scénario désolant des guerres de religion en atteste l’échec. Il en suit une crise de civilisation des plus aiguës, et un basculement des valeurs spirituelles vers la culture gréco-latine : « Le centre d’intérêt moral et de valeur spirituelle n’est pas du côté de Moïse et de Jésus, qui à travers les Essais ne sortent guère de l’ombre, mais bien plutôt dans les Mémorables de Xénophon et dans les Dialogues de Platon, dans les Lettres de Sénèque et dans les Vies de Plutarque34 ».
Les déclarations de soumission à l’Église catholique faites par Montaigne, n’ont pour cela aucun enjeu vraiment religieux ou spirituel, car ce qui est en jeu c’est la « conservation de la société humaine35 ».
L’essayiste se rapprocherait ainsi des positions du mouvement padouan, auquel Brunschvicg se réfère citant les recherches d’Henri Busson36. Le rapport que Montaigne entretient avec la religion comme avec la politique manifeste, selon une formule que Brunschvicg emprunte à Jean Mesnard37, l’« antinomie apparente entre la pensée et l’action » qui est le problème de la Renaissance. De ce fait, le conformisme de Montaigne, « indivisiblement politique et religieux », est vu par Brunschvicg comme « le parti du moindre mal38 », et se justifie par le spectacle d’une société déchirée et cruelle. Ce conformisme de la conduite, au dehors, qui laisse au dedans le jugement libre de s’exercer sur tout argument39, commande d’une manière factuelle « le comportement de Montaigne en matière politique et sociale40 », car la participation à la vie publique ne doit jamais compromettre l’intimité du rapport à soi. Les déclarations d’égoïsme et d’individualisme que l’on lit dans les Essais – par exemple en III, 10, « De mesnager sa volonté » – découlent selon Brunschvicg du fait que Montaigne s’« ayme trop41 », un amour de soi dont il faut préciser que « le moi aimé du moi est ici considéré dans son armature morale et non pas dans son individualité sensible42 ».
Cette « armature morale » constitue le propre de la sagesse de Montaigne, une sagesse toute humaine et naturelle qui pourtant ne saurait se réduire à un simple « naturalisme », car le naturam sequi, dont Montaigne fait « le souverain précepte » de sa morale43, devient en effet source d’« embarras » dès que l’on essaie « de préciser l’application de ce principe44 ». Selon Brunschvicg, « les fluctuations » du naturalisme de
Montaigne dépendent en partie de la diversité des positions doctrinaires de l’Antiquité dont il hérite, positions qui se contredisent l’une l’autre, témoignant de l’incertitude des philosophes quant aux « règles de Nature45 », tant sur le plan pratique que spéculatif. Brunschvicg souligne aussi, à juste titre nous-paraît-il, comme Montaigne, d’une part, dit vouloir s’abandonner à la nature, la suivre et se tenir à elle46 ; et, de l’autre, vouloir être « maître de [soi] » et se conduire par la raison47, car « la vraie liberté c’est pouvoir toute chose sur soy48 ». En vérité, « l’intention de Montaigne déborde la thèse du naturalisme », car l’essayiste, « sérieusement et sincèrement […] rend hommage à la philosophie49 » et au pouvoir pratique de la raison. De ce fait, Brunschvicg préfère voir dans la morale de Montaigne un effort où la nature et la raison se complètent et s’équilibrent l’une l’autre. Les déterminations morales doivent s’accorder et s’harmoniser avec les analyses psychologiques de la nature humaine, car la conscience morale n’est pas « une puissance transcendante dont nous subirions du dehors la contrainte », mais c’est une conscience « émanant du fond véritable de notre être50 ». « Le souci d’équilibre intérieur ramène Montaigne tout près de son point de départ, vers une morale de la conscience qui élargit et domine, sans pourtant la contredire, une psychologie de la conscience51 ».
La pensée morale de Montaigne représente ainsi quelque chose d’unique dans l’histoire de la philosophie occidentale : « Jamais idéal simplement humaine d’équilibre et d’harmonie ne s’est exprimé de façon plus exquise52 ». Mais sur cet idéal tout humain pèse la menace « certaine d’une rupture totale par la mort53 ». Ici encore, Montaigne écoute les conseils parénétiques des Anciens, épicuriens et stoïciens
notamment, mais les considère comme trop centrés sur la peur de la mort et sur sa méditation anticipée. Une autre voie se dessine : « Le problème de la mort – écrit Brunschvicg – se ramène donc à faire rentrer le savoir mourir dans le cadre du savoir vivre, en établissant une entière égalité de conscience et d’humeur entre le temps de notre existence et celui qui la terminera54 ». Une « décision d’indifférence [qui] rejaillit sur la vie pour en accroître en quelque sorte l’intensité55 » et en rendre l’expérience plus profonde et plus pleine.
Les enjeux philosophiques de l’ouvrage
et ses rapports avec le bulletin de la SAM
La lecture brunschvicgienne de Montaigne que nous venons d’exposer, introduit aux deux autres parties de l’ouvrage, qui portent sur les rapports que Descartes et Pascal ont respectivement entretenus avec la pensée montainienne. Nous ne reprendrons pas ici tous les rapprochements ou les oppositions ponctuelles donnés par Brunschvicg, pour nous arrêter plutôt sur la nature de ses thèses historiographico-philosophiques, et sur leur importance pour la réinscription de Montaigne dans l’histoire de la philosophie moderne, dont témoigne aussi l’activité du bulletin56 à partir des années 1960.
Examinant les rapports de continuité et de opposition entre trois penseurs – Montaigne, Descartes et Pascal – qui représentent pour lui la « triple origine » de la pensée française57, Brunschvicg trace une perspective de continuité entre l’auteur des Essais et les deux philosophes du Grand Siècle. En effet, au-delà de leurs oppositions, Descartes et Pascal « ont rendu à Montaigne cet hommage éclatant de définir leur problème selon exactement les termes qu’il leur avait légués58 ».
Néanmoins, après la lecture du livre de Brunschvicg, on a la nette impression que c’est Descartes qui a vraiment répondu à Montaigne,
relevé son défi, et par-là même inauguré la pensé rationnelle et scientifique moderne. Si ce rapport est d’une certaine manière privilégié par Brunschvicg, c’est parce qu’entre Montaigne et Descartes se joue directement « le passage d’un certain état de civilisation à un stade différent », après le double échec de la Réforme et de la Renaissance, dans leur aspiration commune de « retrouver la pureté des sources » par le retour à la parole du Christ et à l’exemple de Socrate59. Ce passage dramatique s’achève donc avec Descartes, et dans ses multiples aspects il est ramené par Brunschvicg à la découverte du pouvoir créateur de l’esprit humain (le « spiritualisme »), ce qui signifie, à la fois, l’abandon du « réalisme métaphysique », avec sa distance infranchissable entre sujet et objet, et de « l’érudition philosophique », avec son culte des doctrines passées60. Le scepticisme des Essais, qui ruine la métaphysique et le savoir du passé, figure ainsi comme le mouvement préliminaire du devenir de la pensée cartésienne : « Descartes a dû traverser le pyrrhonisme afin de se rendre capable de lui répondre61 ». Ou, plus clairement : « Descartes entreprend de répondre à Montaigne, il lui donnera tort sur les points essentiels, mais c’est après s’être mis à son école, après avoir tout accepté de lui62 ». Une filiation qui concerne aussi la pensée morale cartésienne, laquelle, visant à l’autonomie spirituelle et aux règlements des phénomènes affectifs, retrouve deux thèmes majeurs des Essais.
Après ce court inventaire des thèses brunschvicgiennes, discutables mais certainement stimulantes et porteuses en conséquences herméneutiques, il est temps de voir qu’elle a été leur réception dans le bulletin de la SAM. Il faut dire d’abord que le livre – à notre connaissance – n’a jamais fait objet d’un compte rendu dans le bulletin, alors qu’il compte – entre 1942 et 1951 – au moins dix comptes rendus dans des revues nationales et internationales, dont on rappellera : The Modern Language Journal [of America] (no 28, 1944), la Revue philosophique de la France et de l’étranger (no 69, 1945), la Revue de métaphysique et de morale (no 51, 1946), la Revue de synthèse (no 21, 1947), French studies63 (no 2, 1948) et les
Annales : Economies, sociétés, civilisations64 (no 1, 1951). Mais cette absence peut s’expliquer par des raisons extra-théoriques, sans aucune implication relative aux choix éditoriaux et aux orientations scientifiques du bulletin. En effet, comme déjà à l’occasion de la première guerre mondiale, le déclenchement de la deuxième guerre mondiale porte un nouveau coup sensible à la Société, qui se voit contrainte d’interrompre la publication du Bulletin de 1942, l’année de la parution de l’ouvrage de Brunschvicg, jusqu’en 194965. C’est donc cette interruption forcée qui explique vraisemblablement l’absence de comptes rendus sur l’ouvrage de Brunschvicg dans les années immédiatement successives à sa publication et même plus tard. Mais le rapport entre le livre de Brunschvicg et les recherches philosophiques dans le bulletin n’est pas borné à cette absence.
Dans son article « Descartes en Italie sur les pas de Montaigne66 », paru dans le Bulletin de l’année 1960, Léon Petit s’appuyait sur le livre de Brunschvicg pour souligner les « affinités que, entre les deux auteurs, recèlent leurs écrits ». Mais Petit renvoie aussi à l’édition critique du Discours de la méthode publié chez VRIN en 1925 par Etienne Gilson67, une édition très importante et qui marque un véritable tournant dans les études sur Montaigne et Descartes, car dans son commentaire Gilson délivre des nombreux et ponctuels rapprochements avec les Essais (dont Brunschvicg aussi avait fait profit dans son ouvrage). S’appuyant sur ces travaux, Petit rappelait d’abord que Le Discours cartésien s’ouvre avec une citation de l’essai II, 17, « De la présomption », ce qu’il interprétait comme une « réminiscence dans l’esprit d’un homme qui a lu les Essais et s’en est pénétré ». Ensuite, il soulignait la commune aversion de Montaigne et Descartes pour le dogmatisme des théologiens, leurs opinions analogues sur les leçons que l’on retire des voyages, pour conclure sur une certaine « identité » (le mot est fort, mais c’est Petit qui l’emploie) « de
leurs idéaux dans la façon de vivre ». Douze années plus tard, en 1972, Marcel Françon publie dans le bulletin un article sur « I. Montaigne, Le Discours de la méthode de Descartes et l’humanisme », accompagné d’une deuxième partie sur « II. Montaigne et l’humanisme68 ». L’auteur débute en témoignant sa dette envers le travail de Gilson et de Brunschvicg, et souligne lui aussi que le début du Discours recèle une citation des Essais. D’une façon générale, les notes de bas de page indiquent plusieurs références à l’ouvrage de Brunschvicg, dont Françon semble apprécier la volonté de saisir les rapports de solidarité et d’opposition entre les deux philosophes. Sa conclusion est nette : « l’attitude de Montaigne sur la formation du jugement, plutôt que sur l’acquisition des connaissances, sur la valeur relative de la coutume, sur la prudence avec laquelle on doit procéder si l’on veut changer les lois et les coutumes, sur l’utilité des voyages, sur le caractère relatif des opinions se compare à l’attitude de Descartes. Il y a, là, une concordance remarquable entre quelques-unes des idées principales, ou des thèmes, de Montaigne et celles de Descartes ».
Sauf erreur de notre part, après l’article de Françon en 1972, l’étude des rapports entre Montaigne et Descartes ne figure plus dans les sommaires du bulletin. Seul en 2007, un article de Denis Kambouchner sur « Montaigne et le problème cartésien de l’estime de soi69 », signale un regain d’intérêt pour ce sujet, et notamment pour l’étude des multiples liens que la philosophie morale de Descartes entretient avec les Essais.
Quant aux travaux sur Montaigne et Pascal dans le bulletin, on compte plusieurs articles dès 1960, mais l’ouvrage de Brunschvicg ne semble pas s’imposer comme une référence de la même manière qu’il l’a été pour les articles sur Montaigne et Descartes. Cela nous paraît s’expliquer par le fait que la partie du livre consacrée à la lecture pascalienne de Montaigne, apparaît comme moins réussie et sans doute moins claire dans son propos général. Néanmoins, les articles de Léon Petit70 (« Le chevalier de la Méré introducteur de Pascal aux Essais », 1960), de
Yôichi Maeda71 (« Etude sur les rapports de l’Apologie de Raymond Sebond et les Pensées de Pascal », 1961), de Jacques de Feytaud72 (« Le joueur de paume », 1961) et de Kyriaki Christodoulou73 (« Socrate chez Montaigne et Pascal », 1980), se réfèrent à Brunschvicg en tant qu’éditeur des Œuvres de Pascal74 et, à différents titres, tirent profit des notes qu’il avait rédigées pour ses éditions, là où elles proposent des rapprochements avec Montaigne.
en conclusion
Léon Brunschvicg a certainement été, avec Bergson et Alain, l’un des philosophes majeurs de la période antérieure à la Seconde Guerre mondiale. Descartes et Pascal lecteurs de Montaigne est le livre d’un homme qui avait connu, dans les années 1930, l’éminence de l’institution universitaire et académique. Précédé par un abondant corpus philosophique, l’ouvrage de 1942 hérite de deux principaux centres d’intérêt de la pensée de Brunschvicg : d’une part, l’histoire de la philosophie moderne, Descartes, Pascal, Spinoza ; de l’autre, l’histoire des progrès de la raison et de la vérité, conçues sur le modèle de la rationalité scientifique (Les étapes de la philosophie mathématique, 1912 ; L’expérience humaine et la causalité physique, 1922 ; Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, 1927 ; Les âges de l’intelligence, 1934). De ce fait, le mérite de Brunschvicg est d’avoir travaillé à reconnaître la place du scepticisme de Montaigne dans le mouvement philosophique qui, à partir de Descartes, aurait établi la certitude et l’évidence comme critères du vrai, travaillant aussi à la fondation d’une sagesse véritablement humaine.
Ainsi, malgré le caractère sans doute un peu désuet de son ouvrage aujourd’hui, c’est avec Brunschvicg que, pour la première fois, le
« Montaigne philosophe75 » sort de l’oubli dans lequel l’avait placé l’historiographie d’inspiration cousinienne du xixe siècle76 (qui considérait le scepticisme comme un épisode marginal du xvie siècle, sans aucun rapport avec la philosophie moderne née en 1637 avec le Discours de Descartes), pour être reconnu comme un moment philosophique décisif de la genèse de la pensée classique. Et enfin, last but not least, il nous est apparu évident que l’ouvrage de Brunschvicg a apporté un nouvel élan à la réflexion philosophique du bulletin et à son interrogation sur le rôle et la place des Essais dans l’histoire de la philosophie moderne.
Emiliano Ferrari
Université Lyon 3 (IRPhiL)
1 Sur la vie et l’œuvre de Léon Brunschvicg on verra aussi : la notice biographique publiée en tête de l’édition américaine de Descartes et Pascal lecteurs de Montaigne (New York, 1944) ; le numéro spécial de la Revue de Métaphysique et Morale (1945, 50, no 1-2) ; les ouvrages de M. Deschoux (La Philosophie de Léon Brunschvicg, Paris, PUF, 1949) et de R. Boirel (Brunschvicg : sa vie, son œuvre, avec un exposé de sa philosophie, Paris, PUF, 1964).
2 À ce sujet, voir : S. Soulié, Les Philosophes en République. L’Aventure intellectuelle de la Revue de métaphysique et de morale et de la Société française de Philosophie (1891-1914), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009 ; et aussi : B. Bourgeois, « Jeunesse d’une société (1901-1939) », Bulletin de la Société Française de Philosophie, 2001/5, numéro spécial du centenaire de la Société française de Philosophie (texte téléchargeable sur la page du Bulletin : http://www.sofrphilo.fr).
3 Toutes nos citations se réfèrent à l’édition de 1942 (Neuchâtel, Éditions de la Baconnière), dorénavant citée DPLM.
4 L’ouvrage est considéré par Arnold Reymond comme le « testament philosophique » de Brunschvicg (Revue de Métaphysique et Morale, 1945, 50, no 1-2, p. 10).
5 DPLM, p. 9.
6 DPLM, p. 132.
7 DPLM, p. 9.
8 DPLM, p. 13.
9 DPLM, p. 14.
10 Ibidem. Brunschvicg cite l’essai III, 11, « Des boyteux » : « Je n’ay veu monstre et miracle au monde plus expres que moy-mesme. On s’apprivoise à toute estrangeté par l’usage et le temps ; mais plus je me hante et me connois, plus ma difformité m’estonne, moins je m’entens en moy » (p. 1029 [B]). Toutes les citations des Essais renvoient à l’édition de Pierre Villey : Michel de Montaigne, Les Essais, Paris, PUF, coll. Quadrige, 2004.
11 DPLM, p. 15.
12 Ibidem.
13 « Montaigne aura beau dire : “les autres forment l’homme ; je le recite (Essais, III, 2)” ; il n’est pas vrai qu’il se soit mis à écrire simplement dans l’intention d’offrir son portrait à ses amis et voisins. Il s’agissait pour lui de calmer, sinon une tempête intérieure, du moins un remous, dont il s’est trouvé secoué à son étonnement lorsqu’il prit sa retraite dans la librairie de Montaigne […] » (DPLM, p. 15).
14 DPLM, p. 16.
15 Ce dessein est d’ailleurs clairement conçu par Montaigne lui-même : « Aux fins de renger ma fantasie à resver mesme par quelque ordre et projet, et la garder de se perdre et extravaguer au vent, il n’est que de donner corps et mettre en registre tant de menues pensées qui se presentent à elle. J’escoute à mes resveries par ce que j’ay à les enroller » (Essais, II, 18, p. 665 [C]). Sur l’articulation complexe entre l’écriture et le règlement de la « fantaisie » nous renvoyons à l’ouvrage de : O. Guerrier, Quand « les poètes feignent » : « fantasie » et fiction dans les Essais de Montaigne, Paris, Champion, 2002, p. 149-151 et passim.
16 G. Lanson, Les Essais de Montaigne, Paris, Librairie Mellottée, 1930, p. 196. Sur l’importance de la notion de « règle » dans les Essais, et notamment en rapport à la puissance de l’esprit et à ses activités, on verra le récent ouvrage de : B. Sève, Montaigne. Des règles pour l’esprit, Paris, PUF, 2007.
17 DPLM, p. 17.
18 DPLM, p. 41.
19 DPLM, p. 39.
20 Essais, II, 12, p. 540 [A].
21 DPLM, p. 40.
22 DPLM, p. 20.
23 Essais, II, 17, p. 658 [A]. Descartes l’appellera la « puissance de bien juger, et de distinguer le vrai d’avec le faux » (Discours de la méthode, Texte et commentaire par E. Gilson, Paris, Vrin, 1930, 2e éd., p. 2). On rappellera que l’incipit du Discours – « Le bons sens est la chose du monde la mieux partagée… » – recèle une citation de l’essai II, 17, « De la praesumption » : « On dit communément que le plus juste partage que nature nous aye fait de ses grâces, c’est celui du sens […] » (Essais, II, 17, p. 657 [A]).
24 DPLM, p. 41-42. C’est un point sur lequel Brunschvicg revient à plusieurs reprises, dans la conviction qu’il s’agit d’un facteur essentiel à la formation de la pensée classique : « Bref, et c’est un trait décisif pour la structure spéculative et l’efficacité des Essais, par où on verra l’œuvre d’un Descartes et d’un Pascal s’y rattacher expressément, la fonction de l’intelligence consiste, non dans le vain déroulement du formalisme logique, mais dans le ferme exercice d’un jugement indépendant » (DPLM, p. 21).
25 DPLM, p. 44.
26 DPLM, p. 46.
27 DPLM, p. 49.
28 DPLM, p. 50.
29 « Ainsi entendu, l’ignorance ne sera un point d’arrivée que sous cette condition de renvoyer au point de départ. Elle ramène l’inquisition […]. Et l’inquisition à son tour réveille l’admiration » (DPLM, p. 51). Brunschvicg se réfère au passage où Montaigne trace la généalogie de l’attitude humaine à la recherche et à la connaissance philosophique : « Iris est fille de Thaumantis. L’admiration est fondement de toute philosophie, l’inquisition le progrez, l’ignorance le bout » (Essais, III, 11, p. 1030 [C]).
30 DPLM, p. 56-57.
31 DPLM, p. 57.
32 DPLM, p. 61.
33 DPLM, p. 70.
34 DPLM, p. 74.
35 Essais, II, 12, 498 [A].
36 DPLM, p. 75, note 1. L’ouvrage d’Henri Busson auquel Brunschvicg renvoie est : Les Sources et le développement du rationalisme dans la littérature française de la Renaissance (1533-1601), Paris, Letouzey et Ané, 1922, p. 449.
37 L’Essor de la philosophie politique au xvie siècle, Paris, Boivin, 1936, p. 405.
38 DPLM, p. 77.
39 Selon la célèbre formule de l’essai I, 23, « De la coustume et de ne changer aisément une loy receüe » : « le sage doit au dedans retirer son ame de la presse, et la tenir en liberté et puissance de juger librement des choses ; mais, quant au dehors, qu’il doit suivre entierement les façons et formes receues » (Essais, I, 23, p. 118 [A])
40 DPLM, p. 33.
41 En réfléchissant sur les penchants humains pour le pouvoir politique (« empire », « Royauté ») et économique (« hautes fortunes »), pour la « grandeur » et la « gloire » mondaines, Montaigne avait écrit : « Je ne vise pas de ce costé là, je m’ayme trop » (Essais, III, 7, p. 916 [B]).
42 DPLM, p. 35.
43 Essais, III, 12, p. 1059 [B].
44 DPLM, p. 79.
45 Essais, III, 13, p. 1073 [C].
46 Essais, III, 12, p. 1059 [B] ; III, 13, p. 1073 [C] ; I, 54, p. 312 [C].
47 Essais, III, 5, p. 841 [B] ; III, 1, p. 794 [B] ; II, 8, p. 387 [A] ;
48 Essais, III, 12, p. 1046 [B]. Montaigne traduit librement la phrase de la lettre 90 de Sénèque qui est citée ensuite : « Potentissimus est qui se habet in potestate ».
49 DPLM, p. 83.
50 Ibidem. Brunschvicg cite à cette occasion les énoncés sur le « patron au dedans » et la « forme maitresse » de l’essai III, 2, « Du repentir », qui ne sont pas interprétés comme des notions métaphysiques mais comme des notions de nature morale et psychologique, donc relevant plutôt de l’anthropologie philosophique.
51 DPLM, p. 85.
52 DPLM, p. 87.
53 Ibidem.
54 DPLM, p. 91.
55 DPLM, p. 92 ; Essais, III, 13, p. 1112 [B].
56 Dorénavant nous abrégeons Bulletin de la Société des Amis de Montaigne en BSAM.
57 DPLM, p. 194.
58 DPLM, p. 191.
59 DPLM, p. 130-131.
60 DPLM, p. 131-132.
61 DPLM, p. 120.
62 DPLM, p. 97.
63 Par Alan Martin Boase, l’auteur, entre autres, de : The Fortunes of Montaigne : A History of Essays in France (1580-1669), Londres, Methuen, 1935.
64 Par Lucien Febvre, l’auteur, entre autres, de : Le Problème de l’incroyance au xvie siècle. La religion de Rabelais, Paris, Albin Michel, 1942.
65 « Pour des raisons à la fois économiques et financières », selon l’expression de Pierre Bonnet, dans son introduction historique qui précède la Table Analytique du Bulletin, 1er et 2e séries, 1913-1956, publiée dans le BSAM, no 13, 1961. C’est au début de 1949, avec la publication d’un double fascicule, que la Société annonce la reprise de ses activités.
66 L. Petit, « Descartes en Italie sur les pas de Montaigne », BSAM, no 13, 1960, p. 22-33.
67 Descartes, Discours de la méthode, Texte et commentaire par E. Gilson, Paris, VRIN, 1925 (1er éd.). Au moment de la publication, Gilson était professeur d’Histoire de la philosophie médiévale à l’Université de la Sorbonne.
68 M. Françon, « I. Montaigne, le Discours de la méthode de Descartes et l’humanisme » et « II. Montaigne et l’humanisme », BSAM, no 1, 1972, p. 49-66.
69 D. Kambouchner, « Montaigne et le problème cartésien de l’estime de soi », Nouveau Bulletin de la Société Internationale des Amis de Montaigne, I, 1er semestre 2007, p. 99-111.
70 L. Petit, « Le chevalier de la Méré introducteur de Pascal aux Essais », BSAM, no 16, 1960, p. 42-58.
71 Y. Maeda, « Etude sur les rapports de l’Apologie de Raymond Sebond et les Pensées de Pascal », BSAM, no 17-18, 1961, p. 28-39.
72 J. de Feytaud, « Le joueur de paume », BSAM, no 19, 1961, p. 40-48.
73 K. Christodoulou, « Socrate chez Montaigne et Pascal », BSAM, no 1-2, 1980, p. 21-29.
74 Notamment les éditions des : Pensées et Opuscules, Paris, Hachette, 1897 ; et des : Œuvres de Blaise Pascal, 14 volumes, Paris, Hachette, 1908-1914.
75 Il n’est pas sans importance que la première édition du livre de Brunschvicg soit parue dans la collection « Être et Penser – Cahiers de Philosophie » des Éditions de la Baconnière.
76 À ce sujet nous renvoyons à la mise au point de Renzo Ragghianti : « Letture di Montaigne tra Cousin e Brunschvicg », Montaigne contemporaneo, Atti del Convegno, a cura di N. Panichi, R. Ragghianti, A. Savorelli, Pisa, Edizioni della Normale, 2011, p. 209-224.