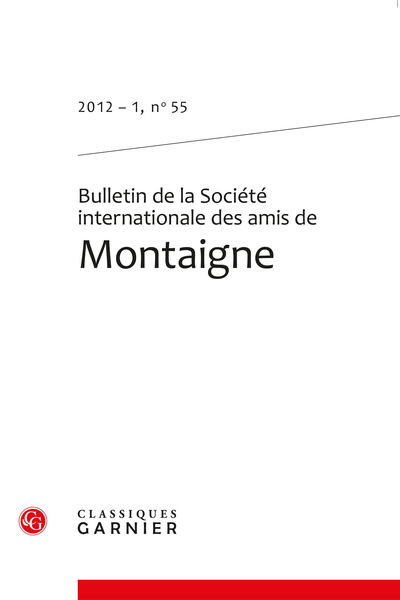
Un scepticisme sans tranquillité ?
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 1, n° 55. varia - Author: Giocanti (Sylvia)
- Pages: 63 to 90
- Journal: Bulletin for the International Society of Friends of Montaigne
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782812439766
- ISBN: 978-2-8124-3976-6
- ISSN: 2261-897X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-3976-6.p.0063
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 07-25-2012
- Periodicity: Biannual
- Language: French
Un scepticisme sans tranquillité ?
Le sceptique moderne se caractérise-t-il
par son inquiétude ?
Dans un article intitulé « Un scepticisme sans tranquillité : Montaigne et ses modèles antiques », Charles Larmore prétend que Montaigne, à la différence des sceptiques grecs, « refuse l’idéal de tranquillité d’esprit » (ataraxie), et cherche « par dessus tout à se réconcilier avec cette instabilité foncière qui constitue à ses yeux l’essence de la pensée », pour « apprendre à nous sentir chez nous dans la mutabilité qui est notre sort ». « L’inconstance » étant selon l’auteur de l’article « la marque ineffaçable de la condition humaine », toute tentative pour immobiliser l’esprit reviendrait à « une trahison de notre nature », si bien que le sceptique serait contraint à l’inquiétude, à la privation de repos de l’esprit1.
S’il est vrai que le caractère intellectuel ou exclusivement spirituel de la tranquillité sceptique ou de son contraire (l’inquiétude) est contestable – y compris dans le pyrrhonisme où, contrairement à une idée reçue mais tenace, il s’agit autant de vivre que de connaître2 – l’analyse de la modernité du scepticisme des Essais en termes de renoncement à la tranquillité mérite qu’on s’y attarde, ne serait-ce que pour en examiner l’aspect paradoxal à nouveaux frais.
En effet, n’est-ce pas contradictoire de caractériser un sceptique – soit un aspirant à l’ataraxie par l’epochè – par l’inquiétude, sous prétexte qu’il fait l’expérience incessante de l’inconstance de soi et de
l’instabilité du monde ? Comment ce sceptique peut-il se réconcilier avec son assiette agitée, sans être rongé par l’inquiétude ? En vient-il à valoriser l’inquiétude, la prise de conscience de notre « condition fautière », en tant qu’elle ouvrirait à l’espérance en une vie paisible où notre nature serait transfigurée et réformée, par la grâce de Dieu.
Ce n’est certainement pas ce que donnent à penser les Essais. Toutefois, la simple esquisse d’une éthique sceptique moderne qui, à la différence de l’éthique pyrrhonienne, serait « sans tranquillité » (selon les termes de Charles Larmore), pourrait le laisser croire. C’est d’autant plus le cas si l’on se méprend sur ce que signifie dans un contexte polémique « notre être », « notre maîtresse forme », « la forme entière de l’humaine condition », et que l’on renoue par ce biais avec des philosophies essentialistes d’inspiration thomiste, pour lesquelles il n’y a plus aucune hésitation sceptique à avoir sur ce qu’est l’homme, et qui ne peut être que conforme à l’« Église de Montaigne3 », c’est-à-dire à la conception chrétienne d’une nature imparfaite qui ne peut connaître le repos qu’en Dieu. L’inquiétude serait alors l’indice probant de notre destinée surnaturelle, « le fait apologétique par excellence4 ».
Ce contresens est toujours possible, en raison du caractère dogmatique du langage5, qui prête à confusion, surtout si l’on ne prête guère attention au contexte à la fois sceptique et polémique du discours6. Quant à l’interprétation échafaudée à partir de cette méprise, elle est stimulée par le refus des lecteurs chrétiens de croire en la réalité d’une vie sereine dans la pleine conscience du « passage » : Pascal7 niait la réalité psychique de la tranquillité d’une vie sans Dieu vantée par les libertins et autres
sceptiques. Jean-Luc Marion, parmi d’autres interprètes contemporains, s’étonne de trouver dans les Essais une éthique de l’insouciance, où le sceptique s’en remet sans vergogne, sans retenue, et même avec enjouement, à un devenir sans règles, qui n’est pas soumis à la loi de l’être, mais aux aléas du devenir : « Comment peut-on concevoir cette sérénité dans l’abandon8 ? », s’interroge-il. À la suite de son illustre prédécesseur apologète, il surmonte le malaise et l’incompréhension, en niant la sérénité du sceptique, c’est-à-dire en l’attribuant par « hypothèse » à une autre cause (une action de grâce d’un croyant) qui implique une élévation de la vie humaine au-delà d’elle-même (qui vaut justification), à partir d’une transcendance normative, pourtant expressément récusée par Montaigne9.
On ne peut que déplorer cette torsion (qui comme nous le verrons plus loin implique contradiction), en ce qu’elle tend à minimiser la richesse éthique des textes : l’un des intérêts des Essais, pour le lecteur athée, est précisément de rendre pensable, aimable, et désirable, une éthique du relâchement où l’« on se laisse aller comme on se trouve10 », non pas parce qu’on a surmonté l’inquiétude comme instabilité, mais parce qu’on a appris à s’y maintenir dans le souci de soi, c’est-à-dire dans l’acceptation de soi, sans repentir, et sans destination surnaturelle.
De ce fait, il n’est pas superflu d’établir (ou rétablir) que l’inquiétude dans les Essais est le synonyme d’une position instable qui définit notre condition (distincte d’une essence, comme l’ont souligné André Tournon et Jean-Yves Pouilloux11) ; de montrer en quoi cette position fortuite exclut toute ontologie et toute métaphysique impliquant notre
nature comme forme essentielle ; de la désolidariser en conséquence de la recherche inquiète ou exaltée d’une perfection plus grande et d’une réforme de soi, puisqu’elle fait l’objet d’une approbation totale et paisible, à titre d’existence qui s’est peu à peu imposée comme la seule réalité (contingente) qui soit nôtre, et qui ne laisse rien à désirer en dehors d’elle-même.
Quelle tranquillité au sein de l’irrésolution ?
Que le sceptique soit inquiet, au sens où l’instabilité de sa position est insurmontable et ne lui laisse aucun repos, n’est guère contestable pour le lecteur des Essais, puisque la forme même de l’essai s’explique par cette inconstance : « si mon âme pouvait prendre pied, je ne m’essaierais pas je me résoudrais », écrit Montaigne12, qui ne voit rien, pas même en songe ou par souhait, où il se puisse tenir13, et déclare que l’inquiétude et irrésolution sont nos qualités maîtresses et dominantes14.
Comment faire alors, lorsqu’on est marqué par l’irrésolution comme par une cicatrice15, pour prendre une décision et s’y tenir, lorsque l’occasion nous presse, et qu’il n’est pas possible de rester dans le doute en suspendant son jugement, alors même que l’estimation raisonnable de ce qu’il faut faire est impossible, faute de données suffisantes ? Le remède est de « vivre du monde et s’en prévaloir tel qu’on le trouve16 », sachant que « la plupart des choses du monde se font par elles-mêmes17 », et que de ce fait « jeter la plume au vent18 », c’est-à-dire s’en remettre à la fortune et au hasard, ou de manière générale à l’extériorité – les événements, les
lois, les coutumes, l’Église, l’opinion de la foule, l’autorité en général –, même si elle est arbitraire, n’est pas opposé à la sagesse : « notre sagesse même et consultation suit pour la plupart la conduite du hasard19 ». Par conséquent, s’il est vrai que l’irrésolution inquiète, ou dans les termes de Montaigne que « la plus pénible assiette (…), c’est être en suspens entre les choses qui pressent et agité entre la crainte et l’espérance20 », on peut remédier au caractère pénible de la situation en acceptant la part d’aléas et d’ignorance qui a présidé aux décisions que l’on a dû prendre.
Ceci permet d’éviter les regrets qui tourmentent l’âme hors de saison, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a littéralement « plus rien à faire », et donc d’assurer la tranquillité et même le contentement de l’âme (et non spécifiquement de l’intellect), au sein de la branloire pérenne, en dépit de l’irrésolution de l’esprit. Dans l’énoncé et commentaire de la seconde maxime de sa morale par provision (Discours de la méthode, partie III), Descartes se souviendra de ce traitement sceptique de l’inquiétude, qui tout en libérant l’action, délivre l’âme de ses tourments liés à l’indécision puis aux regrets, sans l’affranchir d’une incertitude liée à l’ignorance : il préconisera, faute de pouvoir arrêter son jugement à partir de la connaissance de la vérité, l’acceptation du vraisemblable, ou même du hasard, afin d’éviter « les repentirs et les remords, qui ont coutume d’agiter les consciences de ces esprits faibles et chancelants, qui se laissent aller inconstamment à pratiquer comme bonnes, les choses qu’ils jugent après être mauvaises ». Et dans l’article des Passions de l’âme consacré à l’irrésolution (partie III, article 170) et dans la lettre à Elisabeth du 15 septembre 1645, il confirmera qu’en matière d’éthique, le scrupule intellectuel que l’on peut avoir à choisir sans pouvoir fonder sa décision n’est pas tant à prendre en considération, que les tourments d’une âme qui est incapable de prendre position et d’assumer son choix, aussi arbitraire soit-il. Cultiver l’inquiétude en voulant trop bien faire est mal vivre son irrésolution, c’est-à-dire s’exposer sans cesse aux regrets et repentirs qui rongent l’âme.
Toutefois, pour le sceptique (à la différence de Descartes), c’est une nécessité d’apprendre à vivre dans l’irrésolution sans la subir avec
inquiétude, car l’irrésolution n’est pas susceptible d’être réduite peu à peu par la connaissance des lois de la nature, cette dernière nous offrant une infinie variété irréductible à l’unité. Il est donc exact de prétendre que l’inquiétude n’est pas surmontée dans le scepticisme moderne qui, à la différence du pyrrhonisme, ne conduit pas à l’ataraxie (définie par Montaigne comme la condition d’une vie paisible, rassise, exempte d’agitation21). L’inquiétude (à titre de position instable) fait partie de notre condition. Mais elle n’est pas pour autant valorisée comme intranquillité, puisque l’éthique sceptique moderne recherche bien plutôt à vivre de manière apaisée au sein de l’agitation : il cherche à briser le cercle qui consiste à être ingénieux à se malmener22, en luttant contre une tendance à la culpabilisation23 qui a paradoxalement pour origine notre présomption. Cette dernière, en effet, nous porte à exagérer la part réelle que nous avons dans les actions que nous entreprenons, et à nous accuser de fautes que nous n’avons pas commises, ou à stigmatiser des ressorts vicieux qui n’ont eu en réalité aucun effet sur les événements. Ainsi, dans le chapitre iii, 2, Montaigne commence par dissocier les remords éprouvés (« la repentance ») des vices (« péchés ») censés les justifier24. Lorsqu’ils sont bien ancrés en nous par l’habitude, les vices ne posent guère de cas de conscience et passent inaperçus ; ils ne sont pas la vraie et légitime cause des remords. Si on rapporte les remords à leur vraie cause, c’est-à-dire l’irrésolution, qui fait que nous sommes prompts à revenir par la pensée sur ce que nous aurions pu faire, parfois pour nous faire regretter la vertu, on comprend que le malaise n’est pas un critère pertinent pour nous condamner sur la base d’une distinction entre le vice et la vertu, et que la moralisation de l’examen de la situation a l’inconvénient, outre d’augmenter nos tourments, de nous empêcher de voir que nous avons manqué de chance : « J’ai encouru
quelques lourdes erreurs en ma vie et importantes, non par faute de bon avis, mais par faute de bon heur. Il y a des parties secrètes aux objets qu’on manie et indivinables, signamment, en la nature des hommes, des conditions muettes, sans montre, inconnues parfois du possesseur mêmes, qui se produisent et éveillent par des occasion survenantes. Si ma prudence ne les a pu pénétrer et prophétiser, je ne lui en sais nul mauvais gré ; sa charge se contient en ses limites ; l’événement me bat : et s’il favorise le parti que j’ai refusé, il n’y a remède ; je ne m’en prends pas à moi ; j’accuse ma fortune25, non pas mon ouvrage : cela ne s’appelle pas repentir26 ».
La quiétude sceptique repose donc sur la relativisation de la part qui nous revient dans nos actions, en fonction de la prise en considération de circonstances fortuites, de notre état du moment (passions, humeurs, maladie, jeunesse, vieillesse), des événements, d’un ensemble de paramètres qui constituent les conditions de notre vie d’homme agissant.
L’inquiétude ou instabilité de position
comme condition humaine
La quiétude sceptique procède donc d’une réflexion philosophique sur notre condition, qui doit être soigneusement distinguée de notre nature, qui implique une permanence propre à l’essence, et ce même s’il peut arriver à Montaigne d’utiliser le terme de nature
en un sens détourné (anthropologique), en rupture avec son origine métaphysique. En effet, si pour un sceptique nous n’avons pas accès par la raison à une définition de la nature de l’homme qui permettrait d’en énoncer l’essence, l’observation de l’homme suffit à décrire d’un point de vue anthropologique la condition humaine, c’est-à-dire la diversité et variété des phénomènes humains qui se manifestent dans l’expérience27, et permet d’en conclure à la mutabilité ou incapacité à la permanence, en dépit des apparences contraires (auxquelles s’accrochent en vain les métaphysiciens), puisque « la constance même n’est autre chose qu’un branle plus languissant28 ». D’un certain point de vue, Pascal est donc fidèle à Montaigne lorsqu’il écrit : « condition de l’homme. inconstance, ennui, inquiétude29 ». Pour la thèse : il n’y a de constant que l’inconstance. Pour le statut de cette thèse : il s’agit d’une caractérisation de l’homme, non d’une définition de nature, « qui passe l’homme », c’est-à-dire qui excède sa raison30. L’homme doute, s’inquiète, est sans cesse troublé par son inconstance, au même titre que le cheval court31. La caractérisation, à titre de description d’une condition, rejoint le portrait, et ce portrait est nécessairement dynamique, puisque ce qui caractérise l’homme est une certaine manière de se manifester.
Certes, la manifestation de l’homme, en soi, n’est pas incompatible avec l’être, qui sans « révélation », n’apparaîtrait pas. Mais elle l’est dans le cas présent, car ce qui manifeste l’homme est une mutabilité sans règles, une marche plus ou moins lente, une position ou « assiette » instable qui n’exclut jamais la transformation (puisque ce qui est universel est la variation32). La position de l’homme dans le monde définit une condition incompatible avec l’idée d’être, de nature, ou de forme qui virtuellement indiquerait une marche à suivre, qui assignerait à l’homme une place
dans la monde. À ce titre, la déclaration « je marche tout d’une pièce » ou encore « l’homme marche entier vers son croît et son décroît33 » ne renvoie pas à la nature de l’homme à laquelle Montaigne participerait comme à une forme essentielle qui serait stable, en repos, pourvue de déterminations nécessaires et non contingentes. Celui qui « se laisse aller comme il se trouve, » est bien plutôt renvoyé à une position distincte d’une place assignée : une assiette agitée, au sein de laquelle « il ne tient pas en place34 ».
Ce en quoi, contrairement à ce que prétend J.-L. Marion35, Montaigne ne cite pas littéralement saint Paul lorsqu’il écrit « je me tiens en l’assiette où Dieu m’a mis36 », car « l’assiette » n’a pas un sens ontologique (place fixe et assignée) qui permettrait de considérer cette déclaration comme un équivalent de la déclaration de l’Épître aux Corinthiens (I, 15, 10) : « c’est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis ». « Se tenir en l’assiette » (agitée, contingente) n’est pas du tout la même chose, qu’ « être ce que l’on est ». Et pour agir à partir de cette position instable, il n’est nullement requis de la stabiliser en trouvant sa place comprise comme un repos qui mettrait un terme à l’inquiétude (suscitée par l’instabilité de la position) : il suffit de s’en remettre aux conditions parfaitement contingentes propres à sa condition, afin de « se garder de rouler sans cesse », ce qui n’est pas autre chose qu’accepter le hasard. Et c’est là d’ailleurs toute la différence entre la déclaration de Pascal et la position de Montaigne : l’inconstance n’engendre pas nécessairement pour Montaigne l’ennui et l’inquiétude, qui chez Pascal traduisent un manque d’être, qui se fait douloureusement sentir même si on n’y a plus accès par la raison.
En effet, à l’inverse de cette position montanienne, et conformément à une perspective ontologique et métaphysique augustinienne (d’origine platonicienne) adoptée par J.-L. Marion dans sa lecture des Essais, l’être en mouvement, changeant, est inférieur à l’être en repos, stable, qui
bénéficie d’une densité ontologique maximale37. Dans ce cadre, la valorisation de la constance ou fixité sereine propre à l’Etre incréé a pour corollaire la dévalorisation de ce qui est en mouvement, et qui ne peut échapper à l’inquiétude qu’en prenant appui sur ce modèle de stabilité divine, ou en obtenant l’aide (grâce) de Dieu, qui seule lui permettrait de trouver la tranquillité (et même la béatitude) en regagnant sa place38. Or, cette idée d’un itinéraire qui s’imposerait à l’homme pour accomplir sa nature, ne se trouve nulle part dans les Essais, où la condition humaine, qui seule intéresse Montaigne, implique de se laisser aller « comme on se trouve » (et non pas tel qu’on est), sans être en place, sans tenir en place, et sans chercher une place assignée à l’avance, suivant le modèle du voyage sans but, de la promenade, où l’homme est toujours en marche39, marche titubante, vertigineuse, et détraquée40, précisément parce qu’il n’a pas d’être propre, en vue duquel il devrait se mettre en quête pour accéder à la plénitude d’une vie paisible.
Le sceptique exempt
d’inquiétude métaphysique ou religieuse
C’est au contraire lorsque, d’une manière non-sceptique, « nous prenons titre d’être41 », et cherchons à allonger notre être en aspirant à la gloire (qui donne l’illusion d’une conservation de notre être par notre nom42), au lieu de chercher « à se tenir sur son pied43 » dans sa position d’instabilité, que nous vivons dans l’inquiétude, et tout particulièrement dans l’angoisse de la mort. L’inquiétude face à la mort vient d’une mauvaise représentation de nous-mêmes, de la non-acceptation de notre participation au non-être qui constitue notre condition. En acceptant à rebours que notre vie n’est qu’un instant « dans le cours infini d’une nuit [c’est-à-dire d’un néant et non d’une vie] éternelle44 », l’on peut demeurer en paix auprès de notre âme, dans le passage entre l’instant présent et le suivant. Lorsqu’on vit en effet au rythme de notre disparition progressive45, où chaque jour nous dérobe46 à nous-mêmes, et nous fait passer plusieurs morts47, on n’est plus inquiété par « la mort », puisqu’on ne cesse de mourir par le fait même de vivre, la mort se confondant et mêlant partout à notre vie48.
Contrairement à ce que prétend J.-L. Marion, qui souhaite maintenir le moi dans une structure extatique propre à l’ontologie heideggerienne – alors même qu’il a reconnu préalablement très justement que le moi
montanien était « un Da- sans sein, un “ici-sans être”49 » –, on ne naît pas en vue de mourir50, on meurt sans cesse, parce qu’on est vivant. Voilà ce que signifie « je me laisse aller comme je me trouve51 » : un abandon à l’instant fugace, au non-être. L’inquiétude qui ronge naît de ce que l’on veut croire que l’on peut participer à l’être et jouir d’une gloire éternelle (en vertu de sa renommée auprès des hommes, ou de la grâce de Dieu) qui pourrait nous être octroyée à partir de l’examen de ce que nous valons à la sortie de notre vie, alors que la mort (comme fin de parcours) ne délivre aucun sens qui justifierait que l’on s’en inquiète vivant, que l’on s’y prépare par une démarche spécifique52, la meilleure attitude étant de nonchaloir53, c’est-à-dire de ne se faire aucun souci en poursuivant ses activités « branlantes ». Lorsque la vie n’est pas tendue (« bandée ») à partir de la fin – la mort comprise à tort comme passage
vers l’au-delà où nous aurions des comptes à rendre et une réparation de notre nature à espérer –, on peut demeurer tranquille (« je n’ai rien cher que le souci et la peine, et ne cherche qu’à m’anonchalir et avachir54 ») et se glorifier non sans provocation de ce laisser-aller (« toute la gloire que je prétends de ma vie, c’est de l’avoir vécue tranquille55 »), dans l’abandon serein et même satisfait au passage : « Je ne cherche qu’à passer (…) je dis passer, avec contentement56 ».
Par conséquent, non seulement l’abandon serein de Montaigne au passage est compréhensible – et ne peut susciter l’étonnement que des chrétiens fervents pour qui la vie n’a de sens qu’à partir d’un projet sotériologique –, mais encore il y a contradiction pour Montaigne entre d’une part vivre tranquille et d’autre part chercher un sens à sa vie au-delà d’elle comprise comme union de l’âme et du corps.
Cette considération donne raison à V. Carraud, qui considère que Montaigne élabore moins une métaphysique ni même une physique qu’une véritable « doctrine de l’expérience de l’union de l’âme et du corps », mais au rebours de son interprétation pieuse des Essais57 : si l’union de l’âme et du corps chez Montaigne constitue une expérience essentielle, c’est parce qu’il n’y a rien absolument parlant (un néant) en dehors de cette union, et par conséquent rien susceptible de nous inquiéter (par la crainte et l’espérance). Dans la mesure où « nous somme bâtis de deux pièces principales essentielles, desquelles la séparation c’est la mort et ruine de notre être58 », tout ce qui peut advenir en dehors de l’union de l’âme et du corps (récompense de la vie spirituelle promise par Platon, précurseur à cet égard du christianisme) ne touche pas l’homme (« car à ce compte, ce ne sera plus l’homme, ni nous, par conséquent »), homme qui « n’est plus » une fois qu’il a cessé d’être (« ce qui a cessé une fois d’être, n’est plus59 »). Ainsi, l’immortalité de l’âme, équivalent religieux du substitut d’être recherché dans la gloire
(la renommée) à laquelle la religion nous fait espérer, ne peut que nous exposer aux mêmes troubles que la gloire, alimentant une inquiétude artificielle, des craintes et tremblements vains propres à l’esprit qui se représente l’âme comme susceptible d’être sauvée ou damnée, dans une disjonction impossible d’avec le corps. Et ce dogme chrétien étant critiqué d’une manière implicite, par l’intermédiaire de la critique de sa version païenne60, on peut soutenir que, même si Montaigne a vécu et est mort en bon chrétien, il théorise bel et bien dans son éthique une manière irréligieuse (car indifférente à toute perspective sotériologique) de dissiper l’angoisse artificielle de l’au-delà suscitée par les croyances religieuses, en défendant l’acceptation tranquille de la mort comme n’étant rien, dans un rapport d’homogénéité avec la vie présente, un devenir où tout se meurt, sans aucune constance d’être, sans rien au-dedans de nous à préserver.
Il ne faut donc pas s’y méprendre : lorsqu’à la fin du chapitre iii, 9 De la vanité Montaigne fait état du vide intérieur qui est en nous, ce n’est pas comme pour Pascal pour rendre compte de l’inquiétude, qui constitue notre condition, en condamnant l’orgueil propre à un être vide de Dieu, qui se prendrait pour Dieu, et rendrait un culte au moi. La gloire dénoncée par Montaigne, par laquelle nous cherchons à échapper à notre condition en nous donnant titre d’être, n’est pas un péché qui nous ferait rechercher le repos dans un être de substitution ailleurs que là où il se trouve véritablement (en Dieu qui est l’Etre), mais au contraire ce qui est éthiquement condamnable, parce qu’il nous détourne du non-être et de nous-mêmes (qui ne sommes pas), du passage auquel nous devrions nous tenir, du vent (ou futilités) dont nous devrions nous contenter61. Chez Pascal, en revanche, si l’ennui et
l’inquiétude résultent bien de l’inconstance, de la conscience du passage, c’est parce que ce qui fait sens se situe dans une perfection à laquelle nous aspirons, et dont nous éprouvons le manque en nous, sous la forme d’une privation de l’être qui ne peut se contenter du non-être, de tout ce qui est fini. Cette idée que le moi ne peut remplir le vide intérieur (ou défaut d’être qui nous caractérise) que par Dieu, est bien une constante de l’apologétique au xviie siècle62 absente de l’éthique de Montaigne. Pour Montaigne, il faut, pour vivre sans souci, accepter l’inanité propre à notre agitation perpétuelle, non pour s’en dépiter et mortifier, s’en ronger les ongles63 ou s’en rompre la tête, mais pour apprendre à la savourer64 au cours du voyage de notre vie, qui certes porte témoigne, d’inquiétude, d’irrésolution65, comme tout ce qui est humain, mais peut néanmoins se passer doucement et non laborieusement66, au sein de cette culture indéfinie du vide. Ainsi, Montaigne est bien un sceptique inquiet, au sens où l’agitation et instabilité (opposées au repos) de sa position est structurelle, indépassable, puisqu’elle constitue la condition humaine. Mais ayant « dénoncé à tout soin guerre capitale67 », il en valorise pas l’inquiétude comme tourments de l’âme qui seraient révélateurs de la marche à suivre pour surmonter notre condition en la transfigurant.
À la question « comment le sceptique peut-il se réconcilier avec son assiette agitée, sans être rongé par l’inquiétude ? », il faut donc répondre que l’inquiétude qui ronge est celle qui naît de ce que nous nous donnons titre d’être. Elle s’évanouit d’elle-même, si l’on prend la vie pour ce qu’elle est : une perpétuelle agitation, qui n’est pas un tourment, mais une exploration du non-être en nous et en dehors de nous, sous l’impulsion du désir. Ce en quoi il faut bien distinguer l’inquiétude sceptique, comme irrésolution propre à notre condition dont on peut s’accommoder, si on a la sagesse de lui emboîter le pas, de l’inquiétude comme prise de conscience d’une imperfection de nature susceptible d’être valorisée par l’espérance en une autre vie où une gloire éternelle serait rendue possible, par la grâce de Dieu.
Mais pour montrer plus précisément en quoi la source de la sérénité sceptique est l’acceptation de notre instabilité foncière (et non l’espérance en une paix retrouvée en Dieu), il faut relire le chapitre Du repentir (iii, 2) qui contient la déclaration « chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition », et en défendre la lecture anthropologique, comme seule compatible avec l’ensemble du chapitre et l’œuvre des Essais, dans un rapport polémique avec une métaphysique inspirée d’Aristote, qui s’articule avec une ontologie posant la perfection hors de soi.
Une quiétude conquise contre l’ontologie
de la forme universelle
On peut en effet considérer que le chapitre iii, 2 est construit sur le détournement polémique de la notion de forme universelle, au niveau de l’espèce (« chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition ») et au niveau de l’individu (« il n’est personne qui ne découvre en soi une forme sienne, une forme maîtresse68 »).
La déclaration faite au niveau de l’espèce, qui fait écho à la déclaration « les âmes des empereurs et de savatiers sont jetées à même moule69 », a pour contexte l’opposition entre d’une part les vies populaires et basses
et d’autre part les vies héroïques et glorieuses, qu’il s’agit de récuser, pour contester que les hommes ne sont pas d’une commune sorte, c’est-à-dire qu’ils ne partagent pas la même condition d’existence où toutes les variations sont possibles, quelle que soit leur appartenance sociale. Après avoir remis en cause la hiérarchie naturelle opposant le supérieur à l’inférieur entre les vivants (par la critique de la théologie naturelle de Sebond en II, 12), Montaigne conteste une ligne de partage entre les hommes qui discriminerait ceux qui sont haut de ceux qui sont bas. Comme l’indique explicitement le contexte70, le rappel à l’ordre de « la forme de l’humaine condition » a donc d’abord un sens anthropologique et social.
Premièrement, Montaigne invite à ne pas être dupe des attitudes sociales (notamment la dévotion71) qui singent la grandeur morale. En effet, ceux qui recherchent l’élévation, les extases et démoneries72, et la quiétude qui procéderait d’un principe transcendant, haussent moins notre nature, qu’ils ne s’exposent davantage aux troubles. Ceux qui, comme Montaigne, préfèrent la tranquillité, à l’agitation entre la crainte et l’espérance, et savent qu’ils sont de la commune sorte73, voire de « la basse forme74 », recherchent la quiétude propre à « la plus basse marche75 », qui est la plus ferme. Les tourments naissent en effet de cette volonté d’échapper à notre condition, au lieu de se rapprocher de la sérénité du vulgaire, inégalée par la pensée intellectuelle76. Et Montaigne est tenté par la stupidité populaire, à titre de refuge77 pour tenir son âme et ses pensées en repos, repos qui avoisine la non-pensée douce et muette des bêtes. Et s’il n’y cède pas, ce n’est pas pour ne pas avoir à renoncer à la
pensée78, mais parce la torpeur bestiale empêche l’agitation plaisante procurée par le désir79.
Deuxièmement, déclarer que chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition, a pour fonction de rappeler que chacun est susceptible de mettre à profit le caractère changeant et protéiforme propre à notre condition. Chaque homme, en tant qu’il est homme, a la possibilité, de déployer une infinité de vertus/virtualités – y compris sous ses formes sociales80, mais qui ne tiennent pas à son appartenance sociale, puisque nous sommes tous de la « commune sorte ». Et les exceptions (comme Socrate) intéressent moins Montaigne à titre de modèle à imiter, que pour réfléchir sur les limites de l’humanité, à partir d’un moyen étage qui est le sien, non par nature, mais par hasard (accident), et par goût pour la médiocrité81. Il ne faut donc rien présumer des hommes à partir des apparences, et postuler au contraire que chacun recèle en lui toutes les potentialités, toutes les formes possibles, ce qui inclut les hommes considérés comme monstrueux, qui ne sont que des variations ou transformations de cette même forme.
Mais de ce fait même, on ne peut se prononcer absolument sur notre nature. Il est remarquable qu’« il y plus de distance de tel homme à tel homme qu’il n’y a de tel homme à telle bête82 », et que seule la forme sensible et apparente dont nous faisons l’expérience sensible nous garantit l’appartenance à un même genre humain83, faute de détermination (définition) a priori de la forme spécifique, ou détermination de
l’essence de notre nature, dont on ne peut que constater les métamorphoses dans la diversité de l’expérience. La lecture métaphysique de « chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition » est ainsi empêchée : l’expérience seule permet de faire ce constat, et non une réduction eidétique dans le passage du particulier à l’universel84. Il y a équivalence de l’universel, du général, du commun, dont les limites ne sont pas définies (par rapport à l’animalité) et à l’intérieur duquel toutes les formes sont possibles, à partir du moment où elles sont constatées. Et cette méthode empiriste pour connaître l’homme est la seule envisageable, car selon Montaigne la raison humaine, qui n’a « aucune communication à l’être85 », est inapte à diriger son regard sur une essence qui correspondrait à ce que la vue de l’individu illustre d’un exemple86. Sans l’expérience, ces possibles ne peuvent être connus, puisqu’ils ne correspondent pas au déploiement ordonné des virtualités d’un être (forme), mais aux variations du non-être.
Il n’y a donc pas à se justifier lorsqu’on confère à « forme » un autre sens qu’un sens métaphysique dans l’interprétation de la déclaration de Montaigne faite en III, 2, comme le prétend J.-L. Marion87. Ce serait plutôt le contraire : il est contradictoire de réintroduire de la métaphysique dans un discours qui a rendu impossible à conceptualiser ce qui
ne provient pas de l’expérience88. La forme de l’humaine condition n’est pas essentielle89, c’est une condition d’existence. Et il est impératif de dissocier la forme de l’essence pour ne pas commettre de contresens, puisque, notre manière non pas d’être, mais d’aller, est un mouvement hasardeux et détraqué que Montaigne dit « informe90 ». La forme de l’humaine condition intègre l’informe, des transformations prises dans ce mouvement imparfait, irrégulier et multiforme qu’est notre vie91, ce qui n’incite pas à la contemplation d’un ordre transcendant, mais à l’observation de ce qui se déforme sous nos yeux, devient difforme, se vide.
Or, que serait une forme « qui se vide », si nous devions le comprendre au sens propre, soit ontologiquement ou métaphysiquement ? Chez Montaigne, en effet, notre forme se vide92 peu à peu, à mesure que nous vieillissons, c’est-à-dire que la vigueur de la jeunesse s’amenuise, que nos appétits s’affaiblissent, emportés par « cette puissante maladie qui se coule naturellement et imperceptiblement93 » en nous. La déchéance n’a pas de sens théologique eu égard à une première nature ; elle a un sens biologique, vital, corporel : lorsque Montaigne parle d’où il est tombé94, il renvoie à la jeunesse, à la vitalité perdue, à une époque où son âme était constamment « non seulement exempte de trouble, mais
encore pleine de satisfaction et de fête95 », et non à une première nature que nous aurions souillée par notre faute, à une place haute dont nous serions tombés96. Ce qui est malheureux, c’est de bouder les plaisirs de la jeunesse, parce qu’on n’a plus la force d’en jouir, donnant l’illusion que l’on s’est amendé en vieillissant97, alors que rien n’est moins sûr, puisque par dépit, sur cette pente, nous avons tendance à blâmer ce que l’impuissance seule nous porte à déprécier98. Or, c’est toujours un tort, et même une horreur, de considérer notre nature comme vicieuse99, un vice caractéristique des hommes de se prendre en haine, au lieu d’accepter leur existence telle qu’elle leur échoit. La forme, même lorsqu’elle se corrompt, ne renvoie pas à une unité perdue, et n’a pas à être rapportée à une chute originelle. « La teinture universelle qui me tache » exprime la conscience d’une imperfection relative de notre nature, par rapport à d’autres natures que l’on peut imaginer plus réglées et plus hautes que les nôtres, sans procurer un sentiment spécifique de contrition100. Il n’y a pas à se dégoûter de notre nature malade ou viciée par le péché, ni à se tourmenter par la recherche d’une réforme de cette nature dans le cadre de la recherche d’une perfection située hors de nous, comme s’il fallait nous relever101 de nos vices par la pensée.
En conséquence, et cela devient explicite p. 811-813, c’est contre l’idée de réforme morale, contre le repentir, que Montaigne mobilise, de manière polémique, dans le chapitre iii, 2, le terme de « forme », et prétend que chaque individu ne fait jamais que persévérer dans un rapport de conformité avec une « forme sienne, une forme maîtresse », sa « forme universelle », que l’on ne peut pas changer, et par conséquent corriger. À l’injonction de corriger ses défauts, Montaigne oppose la résistance de sa forme à toute modification et amendement. C’est par là qu’il peut donner une légitimité à la déclaration : « Je ne puis faire mieux » (p. 813).
Souci de soi et réjouissance sans repentir :
contre la réforme morale et le souci de Dieu
Nous en venons ainsi à l’examen de la forme maîtresse et universelle de l’homme au niveau de l’individu. Là encore, les actions réglées par rapport à notre nature et notre condition ne doivent pas égarer l’interprète : comme en II, 17102, il y a en III, 2 une équivalence entre la forme maîtresse et la façon dominante et singulière de se tenir, de marcher – attestée par la formule de la p. 812 : « je marche tout d’une pièce » – d’un seul « train », terme qui équivaut à « forme » dans le contexte montanien, car il renvoie à l’allure, au rythme qui unifie une progression. La forme maîtresse et universelle n’exclut donc pas l’art ou la coutume (comme l’atteste l’exemple culturel de l’usage latin, cité à titre d’échantillon de ses qualités originelles), ni la variation (changement de cadence), ou la diversité, pour ne pas dire la multiplicité et l’informe, puisque que « nous sommes tous de lopins et d’une contexture si informe et diverse, que chaque pièce, chaque moment, fait son jeu103 ».
Autrement dit, la forme n’est pas originelle au sens où elle aurait toujours été là (depuis Adam), mais désigne en l’individu les habitudes contractées qui lui confèrent son allure générale, et que le moi reconnaît (assume) rétrospectivement en se retournant sur ce qu’il est devenu, en
constatant moins ce qu’il« est », que comment il s’est constitué, dans l’après coup104, à partir du jugement qu’il porte sur lui-même.
Le moi est intégralement constitué par ses déterminations empiriques, sans s’y dissoudre105, parce qu’il se ressaisit sans cesse par le jugement, qu’il accepte ce qu’il est devenu en même temps qu’il se constitue, c’est-à-dire produit sa forme maîtresse et la retrouve, la reconnaît en lui. C’est le jugement qui est un et qui tient la route, qui donne forme106, qui « doit tout par tout maintenir son droit107 ». Ce n’est pas notre nature comme essence unifiée que l’on trouverait en Dieu, et qui permettrait de soustraire le moi à la vaine dispersion dans laquelle il se perd et s’inquiète108. Par l’exercice du jugement, la singularité accidentelle que le moi manifeste en surgissant dans le monde, devient nécessité ; le sujet humain se configure et peut se référer à une forme maîtresse et dominante. Le moi n’est donc qu’une force spontanée en situation, qui réagit aux circonstances. Mais à partir de là, le jugement l’affirme d’une manière irréversible comme étant ce qu’il est. C’est pourquoi Montaigne peut écrire : « à circonstances pareilles, je serais toujours tel (…) et ferais autant d’ici à mille ans en mêmes occasions » (p. 813).
Ce à quoi il faut ajouter que ce qu’est le moi dépend moins de sa puissance et résistance, de ses capacités, que de sa volonté délibérée de se maintenir dans sa forme maîtresse109, d’être fidèle à sa manière de se tenir en général, à l’image qu’il a constituée de soi et à laquelle il veut se
tenir, afin de s’accréditer à ses propres yeux en lui donnant une « forme arrêtée110 ». Chercher à persévérer en sa forme maîtresse, au lieu de chercher à se réformer, c’est prendre le parti de réformer son jugement, en l’ajustant au circonstances, dans le souci de soi bien compris : comme une pratique qui fait l’économie des tourments sur ce que l’on a fait, ce que l’on n’a pas fait et que l’on aurait dû faire : « si j’avais à revivre, je revivrais comme j’ai vécu, ni je ne plains le passé, ni je ne crains l’avenir » (p. 816).
C’est en ce sens qu’assumer sa forme, c’est refuser le repentir, la reconnaissance de soi comme pécheur, à travers la confession ou l’examen de conscience, que l’on fait sous le regard de Dieu111. Il s’agit au contraire de légitimer les vices contractées, y compris ceux qui passent inaperçus parce qu’ils sont bien ancrés en nous, en les rapportant à une forme qui est nôtre, et qui n’a pas d’autre ordre que celui qu’on y met par le discours selon lequel on se déchiffre et se justifie par ses actes. Ceci revient à accepter les vices qui sont passés en notre complexion et dont on a raison de s’accommoder112, dans la mesure où l’accoutumance a l’inestimable avantage de faire que nous n’ayons plus à en souffrir113. S’en repentir serait hypocrite (feindre de se corriger), puisque ces vices et péchés faisant désormais partie de notre forme naturelle (qui ne se réforme pas), c’est persévérer dans notre nature que de ne pas aller contre, et contre nature, c’est-à-dire notre intérêt personnel, de leur résister. Y céder, c’est les accomplir comme si nous les voulions constamment, suivant notre forme maîtresse, contre laquelle il serait déraisonnable de s’élever. Ce en quoi l’intérêt que nous avons à jouir de nos péchés, à partir du moment
où nous en avons conscience – contrairement à l’habitude incorporée que l’entendement ne perçoit plus – et que nous y acquiesçons, c’est-à-dire les assumons comme vicieux, les excuse, en les contrebalançant et compensant, de telle sorte qu’il n’y ait pas lieu de s’en repentir.
Cela ne signifie pas que la tranquillité du sceptique se conquiert finalement au détriment de l’intérêt des autres, car suivre sa forme naturelle est être fidèle à sa propre image, telle qu’on l’élabore non seulement pour soi, mais pour un public. Le moi « se fictionne », dans une reprise toujours à recommencer de soi qui procède d’un récit de soi constitutif de son identité sous le regard des autres, et se juge aussi à partir de là, dans sa singularité irréductible114.
Toutefois, ce jugement ne bride pas l’amour propre, car il est étroitement lié à un art de plaire, à la satisfaction que nous éprouvons en donnant consistance à notre nature inconstante, dans la confession publique de sa vie, non pour se glorifier en se donnant l’illusion de l’être, mais pour se donner les moyens de s’aimer et de jouir de soi dans l’acceptation entière de ce que l’on est devenu. La quiétude ne se conquiert donc pas à partir d’une désappropriation de soi jusqu’à son anéantissement115, d’une lutte contre l’amour propre, en faveur de l’amour de Dieu, en qui on trouverait le repos116 par l’expiation des péchés, la réforme de son âme ; et l’imagination toujours possible de natures infinies et plus réglées que la nôtre ne suscite pas en Montaigne le désir d’amender ses facultés en suivant un modèle de perfection supérieure117. Elle se trouve dans l’invention jouissive de soi à partir d’une réappropriation permanente qui procède d’une rétrospection dans un récit, où l’on se peint et retouche dans le passage, à partir de ce que l’on n’est plus, en résistant aux forces négatives de réforme de soi qui impliquent une réification préalable du moi.
La quiétude a donc paradoxalement pour moteur le désir, l’intérêt que tout vivant accorde à lui-même, qui ne s’exerce pas au détriment des autres, mais en quelque sorte grâce aux autres, sans lesquels on ne saurait jouir de son être. Pour en effet jouir de son être, même si ce n’est pas toujours loyalement, mais vicieusement, il est besoin de se laisser tenter, c’est-à-dire d’accepter que l’instabilité de notre position inscrit la vie humaine dans une dynamique du désir.
C’est pourquoi, finalement, Montaigne traite avec la même mansuétude (puisque là aussi, le plaisir, loin de susciter le repentir, excuse le péché) la dernière catégorie de péchés distingués dans le chapitre iii, 2, c’est-à-dire ceux qui, impétueux, prompts et subits, agissent à secousse sur l’âme, et la précipitent parfois de manière irrésistible là où elle a été violemment tentée, comme c’est le cas dans la fréquentation des femmes. La force d’affirmation et de jouissance de soi, à titre de puissance pour persévérer dans l’existence, qui s’est constituée sur les ailes du désir, n’est jamais pénalisée comme concupiscente ; et le jeu du désir, désir de la chasse auquel jouent les amoureux, et qui par l’incertitude de la prise, donne prix à la recherche, n’est jamais dévalorisé par rapport un état plus parfait où le désir pourrait se débarrasser de toute agitation, de toute inquiétude et incertitude, pour jouir en quelque sorte par anticipation de biens supérieurs promis, dans une paix inaltérable118. Au sein même de l’existence, humaine, la distinction entre d’une part un désir troublé et inquiet par l’incertitude de l’obtention, et d’autre part un désir comblé par la possession divine de l’âme, distinction que l’on trouve chez les mystiques119, ne se fait jamais comme chez ces derniers en faveur du repos dans lequel le désir s’épanouirait. Le désir, comme agitation conforme à notre condition, doit être préservé, contre le repos léthargique (la stupidité des bêtes ou la béatitude en Dieu), suivant le
modèle de Thrasonidez : ce « jeune homme grec, fut si amoureux de son amour, qu’il refusa, ayant gagné le cœur d’une maîtresse, d’en jouir, pour n’amortir, rassasier et alanguir par la jouissance cette ardeur inquiète de laquelle il se glorifiait et paissait120. » Non seulement l’inquiétude ou trouble du désir n’est pas à combattre, mais il faut même le cultiver, car il est davantage susceptible de nous satisfaire que ce vers quoi il tend, et qui nous plaît parce, nous échappant, il maintient l’âme dans une dynamique de recherche.
Il ne s’agit pas pour autant de renoncer à la jouissance, mais de lui accorder une place au sein de l’agitation, fût-elle de plus en plus tranquille, lorsque le passage des ans diminue peu à peu l’ardeur des appétits121 : « Je courais d’un bout du monde à l’autre chercher un bon an de tranquillité plaisante et enjouée, moi qui n’ai autre fin que vivre et me réjouir122 ».
Ce en quoi Montaigne promeut bien un modèle non chrétien de souci de soi, qui consiste à se laisser aller comme on se trouve, sans craindre de mal faire, ni regretter ce qui a été fait dans une sorte d’« approbation dionysiaque du monde123 ».
Peut-on alors aller jusqu’à dire que, sans aller jusqu’à se défaire de toute inquiétude, l’auteur des Essais aurait atteint une telle acceptation de soi, qu’il pourrait confirmer son existence dans une sorte d’éternel retour, où le souci de soi, s’articulant avec la jouissance de soi et du monde, serait non seulement sans repentir, mais désireux d’une sempiternelle confirmation124 ?
Certainement pas, car une telle assurance du moi conduirait à une réification du sujet, qui n’aurait plus le même rapport au monde, à lui-même, et au désir qui, devenu volonté de régularité, et même de cyclicité, ne pourrait faire surgir de la nouveauté, ni vivre au rythme naturellement détraqué qui est le sien.
En revanche, on suit volontiers Nietzsche, lorsque dans ses Considérations inactuelles (III), il prétend au sujet de l’auteur des Essais, dont il salue « la joviale sérénité », qu’« en vérité, du fait qu’un tel homme a écrit, le plaisir de vivre sur terre en a été augmenté ».
Sylvia Giocanti
Université Toulouse II – Le Mirail,
UMR 5037 (CERPHI)
1 Voir in Montaigne : scepticisme, métaphysique, théologie, dir. V. Carraud et J.-L. Marion, Paris, Puf, Epiméthée, 2004, p. 29-30.
2 Voir Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, I, 11 (23), Paris, éditions du Seuil, 1997 (traduction P. Pellegrin) : « Donc en nous attachant aux choses apparentes, nous vivons en observant les règles de la vie quotidienne, sans soutenir d’opinions […] ».
3 Voir M. A Screech, Montaigne and Melancoly. The Wisdom of the « Essays », Duckworth & Co., Londres, 1983, p. 144 (trad. fr. Paris, 1992, p. 136).
4 J’emprunte l’expression à Jean Deprun. Voir La philosophie de l’inquiétude en France au xviiie siècle, Paris, Vrin, 1979, chap. ix, l’Apologétique de l’inquiétude, p. 124-125.
5 Dans les Essais (éd. Villey, Puf Quadrige, 1992, II, 12, p. 603), Montaigne insiste sur l’illusion de l’être véhiculée par le vocable « être », qui ne convient pourtant qu’à Dieu, qui seul repose dans une éternité immuable.
6 Ibid., p. 527 : « Je vois les philosophes pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur générale conception en aucune manière de parler : car il leur faudrait un nouveau langage. Le nôtre est tout formé de propositions affirmatives, qui leur sont du tout ennemies ». Nous pourrions dire la même chose de la connotation métaphysique et théologique ou des implications ontologiques propres aux expressions utilisées par Montaigne, pour combattre ce sens ou le détourner.
7 Voir Pensées, fragment 427 (Lafuma) où Pascal dit des libertins, sceptiques et athées : « la plupart de ceux qui s’en mêlent se contrefont et ne sont pas tels en effet ».
8 Voir in Montaigne : scepticisme, métaphysique, théologie, « Qui suis-je pour ne pas dire, ego sum, ego existo ? », op. cit., p. 264.
9 Voir III, 13, p. 988 : « La vie est un mouvement matériel et corporel, action imparfaite de sa propre essence, et déréglée ; je m’emploie à la servir selon elle ». Dans un article consacré à cette page « Action imparfaite de sa propre essence… » (in Montaigne, scepticisme…. op. cit., p. 37 et suiv.), A. Tournon souligne au contraire l’irréductibilité de cette imperfection de la vie humaine, telle qu’elle est conçue par Montaigne, à un modèle immuable et transcendant.
10 Essais, II, 10, p. 409 : « Je me laisse aller comme je me trouve (…) ».
11 A.Tournon, voir La glose et l’essai, Paris, H. Champion, 2000, chap. vi, p. 273 ; Route par ailleurs, Le nouveau langage des Essais, H. Champion, 2006, p. 130 et suiv. J.-Y Pouilloux, dans le chap. iv (La question de l’identité) de Montaigne, l’éveil de la pensée, H. Champion, 1995, p. 175-187, présentait déjà la nature humaine comme une fiction accréditée par l’apprentissage de la tradition.
12 III, 2, p. 805.
13 III, 9, p. 988 : « Oui, je le confesse, je ne vois rien, seulement en songe et par souhait, où je me puisse tenir ».
14 Ibid.
15 II, 17, p. 653-654 : « Je ne veux donc pas oublier encore cette cicatrice, bien mal propre à produire en public : c’est l’irrésolution, défaut très incommode à la négociation des affaires du monde. Je ne sais pas prendre parti es entreprises douteuses. »
16 III, 10, p. 1012.
17 III, 8, p. 933.
18 II, 17, p. 654 : « Ainsi j’arrête chez moi le doute et la liberté de choisir, jusqu’à ce que l’occasion me presse. Et lors, à confesser la vérité, je jette le plus souvent la plume au vent, comme on dit, et m’abandonne à la merci de la fortune : une bien légère inclination et circonstance m’emporte. »
19 III, 8, 934.
20 II, 17, p. 644.
21 Voir II, 12, p. 503.
22 III, 5, p. 879 : « Nous ne sommes ingénieux qu’à nous malmener ; c’est le vrai gibier de la force de notre esprit (…) ».
23 III, 9, p. 990 : « L’homme s’ordonne à soi-même d’être nécessairement en faute ».
24 III, 2, p. 808 [B] : « Mais ce qu’on dit, que la repentance suit de près le péché, ne semble pas regarder le péché qui est en son haut appareil, qui loge en nous comme en son propre domicile. On peut désavouer et dédire les vices qui nous surprennent et vers lesquels les passions nous emportent ; mais ceux qui par longue habitude sont enracinés et ancrés en une volonté forte et vigoureuse, ne sont sujets à contradiction. Le repentir n’est qu’une dédite de notre volonté et opposition de nos fantaisies, qui nous promène en tous sens. Il fait désavouer à celui-là sa vertu passée et sa continence (…) ».
25 Il arrive également à Montaigne de remercier la fortune, ou plutôt de s’en féliciter. J.-L. Marion (op. cit., p. 265) interprète les mots par lesquels Montaigne remercie Dieu d’avoir reçu immédiatement tout ce qu’il a reçu (III, 9, p. 968) comme une reconnaissance du don par lequel il lui fait grâce de la vie. Nous estimons au contraire que, dans les Essais « par la grâce de Dieu » est une expression commune qui a le même sens que « fort heureusement », c’est-à-dire qui renvoie à la Fortune : Montaigne estime avoir eu de la chance de n’avoir rien à demander de plus que ce qu’il a reçu, sans efforts, sans l’avoir mérité, et sans avoir par conséquent à prier les princes de ce monde de lui accorder davantage. Sur les méprises interprétatives liées en partie à l’usage non technique de certaines expressions courantes, nous nous permettons de renvoyer à notre article « Quel place pour Dieu au sein du discours sceptique de Montaigne ? », in L’Écriture du scepticisme chez Montaigne, dir. M.L Demonet et A. Legros, Genève, Droz, 2004, p. 63-76.
26 III,2, p. 814.
27 III, 13, p. 1065 : « La raison a tant de formes, que nous ne savons à laquelle nous prendre ; l’expérience n’en a pas moins. »
28 III, 2, p. 805.
29 Pensées, frag. 24 (Lafuma).
30 Ibid., frag. 131 (L) : certainement cela passe le dogmatisme et pyrrhonisme, et toute philosophie humaine. L’homme passe l’homme. Qu’on accorde aux pyrrhoniens ce qu’ils ont tant crié (…). »
31 Ibid., frag. 505 (L) : « Nier, croire et douter bien sont à l’homme ce que le courir est au cheval ».
32 III, 13, p. 1065 : « Il n’est aucune qualité si universelle en cette image des choses que la diversité et variété. »
33 Voir respectivement III, 2, p. 812 et 817.
34 III, 13, p. 1105 : « Mon marcher est prompt et ferme et ne sais lequel des deux, ou l’esprit et le corps, j’ai mal arrêté plus malaisément en même point (…) tant que j’ai de remuement et d’inconstance en quelque lieu que je les place. »
35 « Dans ce contexte, on attachera une attention plus précise à trois textes qui citent littéralement les formules par lesquelles saint Paul expose la grâce divine et l’homme qui la reçoit (…) », écrit J ;L Marion, op. cit., p. 265.
36 II, 12, p. 565.
37 Saint Augustin, Du libre arbitre, III, VIII, 23, Œuvres, Paris, Desclée, 1re série, t. VI, 1941, p. 369 (tr. de F. J. Thonnard) : « Or ce qui est en repos n’est pas un pur néant ; bien mieux, il a plus d’être que ce qui est dans le trouble ; car le trouble fait varier nos affections, de telle sorte que l’une détruit l’autre ; le repos implique au contraire la constance que l’on a surtout lorsqu’on dit d’une chose : “Elle est” ».
38 Saint Augustin, Confessions, XIII, IX, 10, 1964, éd. Garnier-Frères, GF-Flammarion, tr. Joseph Trabucco, p. 320-321 : « Les choses qui ne sont pas à leur place s’agitent ; mais quand elles ont trouvé leur place elles restent en repos. Mon poids, c’est mon amour ; en quelque endroit que je sois emporté, c’est lui qui m’emporte. »
39 Voir A. Compagnon, « Penser en marchant », in Montaigne : scepticisme, métaphysique, théologie, op. cit., p. 197-209, et tout particulièrement la p. 204 où est judicieusement opposé le « branle », marche relâchée proprement montanienne, au « bandé » par l’effort, la tension, selon un modèle éthique stoïcien.
40 III, 9, p. 964 : « C’est un mouvement d’ivrogne, titubant, vertigineux, informe, ou des joncs que l’air manie casuellement selon soi. ». II, 10, p. 409 : « Je veux qu’on voie mon pas naturel et ordinaire, aussi détraqué qu’il est. »
41 II, 12, p. 526.
42 II, 12, p. 553 : « Un soin extrême tient l’homme d’allonger son être ; il y a pourvu par toutes ses pièces. Et pour la conservation du corps sont les sépultures ; et pour la conservation du nom, la gloire »
43 Ibid. : « L’âme, par son trouble et faiblesse, ne pouvant tenir sur son pied, va quêtant de toutes parts des consolations, espérances et fondements en des circonstances étrangères où elle s’attache et se plante ».
44 II, 12, p. 526 : « Pourquoi prenons nous titre d’être, de cet instant qui n’est qu’une éloise dans le cours infini d’une nuit éternelle, et une interruption si brève de notre perpétuelle et naturelle condition ? La mort occupant tout le devant et tout le derrière de ce moment, et une bonne partie encore de ce moment ».
45 Cf. III, 13, p. 1102 : « J’ai des portraits de ma forme de vingt et cinq et trente cinq ans. Je les compare avec celui d’asteure : combien de fois ce n’est plus moi ! Combien est mon image présente plus éloignée de celles là que de celle de mon trépas ! »
46 II, 17, p. 642 : « Je m’échappe tous les jours et me dérobe à moi-même ».
47 II, 12, p. 602 : « Nous autres sottement craignons une espèce de mort, là où nous en avons déjà passé et en passons tant d’autres ».
48 III, 13, p. 1102.
49 Dans l’op. cit., p. 236 où après avoir accordé, que « nous n’avons aucune communication à l’être », et déployé ce thème pendant plus de 20 pages, J.-L. Marion conclut contradictoirement que le moi reçoit son propre être ou vie comme donation (p. 266). Cette équivalence entre être et vie ne peut pourtant plus être posée, d’après les prémisses même de l’article, et d’après les déclarations de Montaigne qui opposent vie et être. Voir par exemple III, 3, p. 818 : « c’est être, ce n’est pas vivre, que de se tenir attaché et obligé par nécessité à un seul train ». Le branle de la vie est incompatible avec toute ontologie (permanence de l’être). En inventant un eidos du moi (p. 249) sous ses déterminations empiriques, puis en conférant à la notion de « vivre bien » un sens édifiant qui prépare une élévation à l’être, J.-L. Marion réintroduit l’ontologie qu’il avait pourtant jugée incompatible avec le texte des Essais.
50 J.-L. Marion prétend en effet p. 250, au sujet du moi qu’« avant même d’être un étant, le moi naît en vue de mourir », amorçant ainsi un retour progressif à l’interprétation ontologique du moi chez Montaigne, via la lecture métaphysique de la déclaration du chapitre iii, 2 « chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition ». On ne peut sans inconséquence admettre qu’il n’y a pas d’ontologie chez Montaigne et défendre une métaphysique (science de l’être, de Dieu, de l’immortalité de l’âme) des Essais, qui est en vérité rendue « impossible » et même destituée par le scepticisme de Montaigne. C’est ce qu’analyse justement Ruedi Imbach dans son article « Notule de quelques réminiscences de la théologie scolastique chez Montaigne » paru dans le même recueil, p. 91-106, où il montre de surcroît qu’il n’y dans les Essais aucune théologie, même négative, qui aurait pour fin d’exalter la transcendance divine (voir p. 99 et la note 1), mais une anthropologie, c’est-à-dire une description de la condition humaine dans toute sa contingence.
51 II, 10, p. 409.
52 Voir III, 9, p. 982 : « Ce que je veux faire pour le service de ma mort est toujours fait ».
53 Voir I, 20, p. 89 : « Je veux qu’on agisse, et qu’on allonge les offices de la vie tant qu’on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d’elle et encore plus de mon jardin imparfait ». Le commentaire d’A. Tournon « “Plantant mes choux.” – action et projet » in Montaigne et l’action, BSAM, Paris, H. Champion, janv-juin 2000 (p. 90 et suiv) insiste (voir la note 14) sur l’opposition entre Montaigne et l’être pour la mort (Sein zum Tode) heideggerien, authentifié par l’inquiétude ou souci (Sorge).
54 III, 9, p. 954.
55 II, 16, p. 622.
56 III, 9, p. 949.
57 Voir in Montaigne : scepticisme, métaphysique, théologie, la conclusion de l’article « De l’expérience, Montaigne et la métaphysique », op. cit., p. 85, et (pour ce qui est de la lecture pieuse) dans le même recueil « L’imaginer inimaginable : Le Dieu de Montaigne », où V. Carraud mentionne parmi les éléments de conclusion concernant son analyse des Essais « un accès à Dieu par voie d’éminence » (p. 171).
58 II, 12, p. 519.
59 Ibid.
60 Page. 549, Montaigne estime que le jugement dernier (tel qu’il est présenté par Platon) qui consiste à juger d’une âme prétendue éternelle à partie de sa vie très courte dans le corps, serait un dispositif inique de la part des dieux., ce qui autorise à le considérer comme imaginaire, et à ne rien craindre sur la base de cette représentation. Page 559, dans le cadre d’un développement sur la nécessité de discipliner l’esprit, Montaigne présente la crainte qu’inspire la religion (à partir des « menaces de peines et récompenses mortelles et immortelles » – les peines profanes étant mises sur le même plan que les châtiments célestes –) comme des inventions sociales qui servent de garde-fou. Cette manière indirecte de critiquer les dogmes chrétiens deviendra systématique sous la plume des libertins du siècle suivant.
61 III, 13, p. 1107 : « Moi qui me vante d’embrasser si curieusement les commodités de la vie, et si particulièrement, n’y trouve, quand j’y regarde ainsi finement, à peu près que du vent. Mais quoi, nous sommes partout vent. Et le vent, plus sagement que nous, s’aime à bruire, à s’agiter, et se contente de ses propres offices, sans désirer la stabilité, solidité, qualités non siennes. »
62 Jean Deprun, dans La philosophie de l’inquiétude, op. cit., chap IX, p. 128 fait ainsi converger les déclarations de Pascal (Pensées, frag. 148 L : « Ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c’est-à-dire par Dieu même »), de Malebranche (De la recherche de la vérité, II, 1, IV, 2 : « mais le vide des créatures ne pouvant remplir la capacité infinie du cœur de l’homme, ces petits plaisirs au lieu d’éteindre sa soif ne font que l’irriter »), et François Malaval (Pratique facile pour élever l’âme à la contemplation : « Tout ce que peuvent faire les objets du monde les plus parfaits est d’occuper l’âme ; mais rien que Dieu ne peut la remplir »).
63 II, 17, p. 642 : « Car j’en suis là que, sauf la vie et la santé, il n’est chose pour quoi je veuille me ronger mes ongles, et que je veuille acheter au prix du tourment d’esprit et de la contrainte. »
64 III, 9, p. 997 : « Mes humeurs ne sont pas trop vaines, qui [si] elles sont plaisantes. »
65 III, 9, p. 988 : « Je sais bien qu’à le prendre à la lettre, ce plaisir de voyager porte témoignage d’inquiétude et d’irrésolution. Aussi sont-ce nos maîtresses qualités et prédominantes. »
66 II, 10, p. 409 : « Mon dessein est de passer doucement, et non laborieusement, ce qui me reste de vie. Il n’est pourquoi je me veuille rompre la tête. »
67 III, 9, p. 970.
68 III, 2, p. 811.
69 II, 12, p. 476.
70 III, 2, p. 805 : « Je propose une vie basse et sans lustre, c’est tout un. On attache aussi bien toute la philosophie morale à une vie populaire et privée qu’à une vie de plus riche étoffe : chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition. »
71 III, 2, p. 813 : « Je ne trouve aucune qualité si aisée à contrefaire que la dévotion. »
72 III, 13, p. 1115.
73 II, 17, p. 635 : « Je me tiens de la commune sorte, sauf en ce que je m’en tiens. »
74 III, 9, p. 988 : « Pour moi, je ne suis qu’une homme de la basse forme ». « Forme » a ici un sens explicitement social, et ne renvoie pas à la nature, l’origine.
75 II, 17, p. 645.
76 III, 12, p. 1052 : « Est-ce pas que nous disons que la stupidité et faute d’appréhension du vulgaire lui donne cette patience aux maux présents et cette profonde nonchalance des événements futurs, que leur âme, pour être crasse, et obtuse, est moins pénétrable et agitable. ? Pour Dieu, s’il est ainsi, tenons d’ores en avant école de bêtise. »
77 C’est en ce sens qu’il faut comprendre« cette mienne stupidité populaire » (III, 10, p. 1020).
78 Nous nuançons sur ce point l’analyse d’Antoine Compagnon qui écrit : « Ne faut-il pas enfin marcher sans penser, marcher tout court ? La sagesse, l’ataraxie, ne serait-elle pas là ? Non, car penser et marcher font un, sont insécables. », voir « Penser en marchant », op. cit., p. 209.
79 III, 5, p. 853 « La tranquillité sombre et stupide se trouve assez pour moi, mais elle m’endort et entête : je ne m’en contente pas. »
80 Ce en quoi, la forme ne s’oppose pas « à l’apparence sociale et accidentelle », comme le soutient J.-L. Marion, op. cit., p. 254, mais intègre toutes les apparences, y compris sociales, comme autant de manière de se manifester aux autres dans le monde.
81 III, 7, p. 917« Je suis duit [habitué] à un étage moyen, comme par mon sort, aussi par mon goût. » Voir dans Eloge de la médiocrité, le juste milieu à la Renaissance, Paris, éd. de la rue d’Ulm, 2005, l’article d’E. Naya « De la médiocrité à la mollesse, prudence montaignienne », (p. 195-216) qui, à partir d’une analyse de l’instabilité du sujet montanien, montre comment l’éthique montanienne procède d’une critique de la vertu aristotélicienne.
82 I, 42, p. 258.
83 Voir en II, 12, p. 485- 486, l’analyse de l’épisode de l’Odyssée où les compagnons d’Ulysse sont transformés en pourceaux par Circé, et la déclaration de III, 13, p. 1070 : « Si nos faces n’étaient semblables, on ne saurait discerner l’homme de la bête. »
84 Voir p. 211 de l’article de J.-L. Marion : « On remarquera immédiatement qu’un tel passage du particulier à l’“universel”, pour autant qu’il s’agit d’une “forme entière”, définit très exactement ce que peut accomplir une réduction eidétique. »
85 II, 12, p. 601.
86 Contrairement à ce que prétend l’auteur de l’article, Montaigne, pour qui « tout exemple cloche » (III, 13, p. 1070), ne pourrait déclarer avec Husserl (cité par J.-L. Marion p. 251, note 1) : « il n’est pas d’intuition de l’individu sans que ne puisse mettre en œuvre librement l’idéation et, ce faisant, diriger le regard sur l’essence correspondante que la vue d’un individu illustre d’un exemple. »
87 Voir le même article, p. 253, où J.-L. Marion écrit : « Reste qu’en tout état de cause, dans la séquence “chaque homme porte la forme de l’humaine condition”, le sens de condition dépend de celui de “forme”, qui la porte : elle ne peut donc échapper à la métaphysique que si la “forme” elle-même échappe la première à une métaphysique ». Notons que c’est ici le cas (la forme échappe à la métaphysique), puisque le sens de « forme » dépend de celui de « condition » (et non l’inverse), et a un sens anthropologique et social. La « forme » de l’humaine condition renvoie à toutes les manières possibles d’exister propres à l’homme. La plupart des occurrences de « forme » renvoie dans les Essais à la façon de faire (mais on trouve aussi le sens de « figure », « visage », au sens physique, comme en iii, 13, p. 1102), sans que le terme ait d’acception technique spécifique. C’est d’ailleurs l’une des caractéristiques du discours sceptique de détourner le vocabulaire technique des philosophes, pour renouer avec le sens ordinaire des mots et leurs différents usages.
88 Ainsi, « l’universel visible, commun et n’appartenant à personne, parce que phénomène de tous et par tous » évoqué par J.-L. Marion p. 259 ne correspond à aucune expérience selon les critères des Essais (l’expérience est sensible), et est proprement incompréhensible dans ce contexte du chapitre iii, 2, et dans les Essais en général. Il est d’ailleurs contradictoire que J.-L. Marion en vienne là, lui qui avait quelques pages plus haut (p. 245) caractérisé la méthode de Montaigne de la manière suivante : « il s’agit de redéfinir la philosophie toute entière à partir de notre fait ». On ne peut à la fois soutenir une lecture empiriste et métaphysique de Montaigne.
89 J.-L. Marion prétend exactement le contraire, op. cit., p. 254--255 : « La forme fait donc bien connaître l’essence (…) et garde ici son acception aristotélicienne ». Il contredit ses propres déclarations de la p. 240 : « Aucune définition de l’essence de l’homme ne peut se concevoir, parce que les règles-mêmes de la définition en métaphysique la rendent problématique. »
90 III, 9, p. 964 : « C’est un mouvement titubant, vertigineux, informe… ».
91 III, 9, p. 988 ; III, 3, p. 819.
92 III, 10, 1010 : « Mon monde est failli, ma forme est vidée ». Cf. III, 13, p. 1095 l’expression « ma vie que je vide peu à peu ».
93 III, 2, p. 817.
94 C’est la dernière phrase de III, 2, qui conclut ainsi sur la « corruption » de la vieillesse : « Je ne sais enfin où elle me mènera moi-même. À toute aventure, je suis content qu’on sache d’où je serai tombé. » (p. 817)
95 III, 13, p. 1098.
96 Pascal en revanche insiste sur le fait que « l’homme est tombé de sa place, qu’il la recherche avec inquiétude » (Pensées, frag 430 L).
97 III, 9, p. 964 : « Moi à cette heure et moi tantôt, sommes bien deux, mais quand meilleur, je n’en puis rien dire. Il ferait beau être vieil si nous ne marchions que vers l’amendement. ». Cf. III, 2, p. 815 : « ma raison est celle-même que j’avais en l’âge plus licencieux, sinon, à l’aventure, d‘autant qu’elle s’est affaiblie et empirée en vieillissant. »
98 III, 2, p. 817 : « Nous appelons sagesse la difficulté de nos humeurs, le dégoûts des choses présentes ». Cf. p. 815 : « Misérable sorte de remède, devoir à la maladie sans santé ! »
99 III, 5, p. 879 : « Quel monstrueux animal qui se fait horreur à soi-même, à qui ses plaisirs pèsent, qui se tient à malheur ! »
100 J.-L. Marion écrit, croyant paraphraser Montaigne : « Je suis universellement imparfait, fautif et pécheur, c’est-à-dire totalement taché comme individu, de part en part » (op. cit., p. 256). Montaigne, qui reproche aux hommes de considérer leur nature comme vicieuse, dit exactement le contraire, en se désolidarisant de cette imperfection partagée : « ce n’est pas macheure, c’est plutôt une teinture universelle qui me tache » (III, 2, p. 813). Partout, il reproche à l’homme de s’en prendre à sa nature, qui est saine. Voir par exemple III, 5, p. 879 : « Nous estimons à vice notre être. ». L’homme en général, comme l’individu, n’est jamais globalement et par nature fautif.
101 Contrairement à ce qu’écrit J.-L. Marion (p. 261), faisant parler Montaigne, ce dernier, « qui ne se manie que terre à terre » (III, 13, p. 1106), ne pourrait écrire « j’élève cet être à son bien être ».
102 II, 17, p. 638 : « Comme à faire, à dire aussi je suis tout simplement ma forme naturelle. »
103 II, 1, p. 337.
104 II, 17, p. 634 : « Je n’ai point mes moyens en proposition et par état ; et n’en suis instruit que par l’effet : autant douteux de moi que de tout autre chose ».
105 Là encore, il faut souligner contre J.-L. Marion (op. cit. p. 249-250), qu’il ne peut y avoir chez Montaigne un eidos du moi individué qui serait essentiel, par différenciation avec des déterminations empiriques, puisque comme l’analyse magistralement Jocelyn Benoist dans l’article qui précède celui de J.-L. Marion, en le déclinant dans son titre même, l’empirisme de Montaigne est radical et non transcendantal. Voir « Montaigne penseur de l’empirisme radical : une phénoménologie non transcendantale ? », in Montaigne : scepticisme, métaphysique, théologie, op. cit., p. 211-228.
106 III, 2, p. 812 : « Il [le jugement] est un : même inclination, même route, même forme. »
107 II, 17, p. 632.
108 Saint Augustin, Confessions, II, 1 : « Délices heureuses et sûres, qui me recueillez en vous, m’arrachant à la dispersion où je me dissipais, à l’époque où, me détournant de votre unité, je me perdais en mille vanités. »
109 II, 17, p. 643 : « J’ai une âme toute sienne, accoutumée à se conduire à sa mode. » Et p. 645, Montaigne ajoute qu’il suffit « de maintenir la condition dans laquelle on est né et dressé », ce qui est une autre façon d’exprimer sa volonté de suivre sa forme maîtresse, ou de persévérer en elle.
110 II, 17, p. 656 : « Le pis que je trouve en notre état, c’est l’instabilité, et que nos lois, non plus que nos vêtements, ne peuvent prendre aucune forme arrêtée. »
111 Voir de Jésus Navarro-Reyes, « Le divin interlocuteur : le souci de soi, la confession et l’essai », in Dieu à notre commerce et société, Montaigne et la théologie, dir. Ph. Desan, Genève, Droz, p. 232, où l’auteur analyse les pratiques montaniennes du souci de soi héritées des Anciens dans un rapport de détachement par rapport à leur révision chrétienne.
112 La même idée est exprimée en II, 17, p. 633 : « Il n’est pas inconvénient d’avoir des conditions et propensions si propres et incorporées en nous, que nous n’avons pas les moyens de les sentir et reconnaître. »
113 III, 2, p. 812 : « Ces autres péchés à tant de fois repris, délibérés et consultés, ou péchés de complexion, voire péchés de confession et de vacation, je ne puis concevoir qu’ils soient plantés si longtemps en un même courage, sans que la raison et la conscience de celui qui les possède le veuille constamment et l’entende ainsi ; et le repentir qu’il se vante lui en venir à certain instant prescrit, m’est un peu dur à imaginer et concevoir ».
114 J.-L. Marion, op. cit., p. 258 considère au contraire que dans les Essais « l’accès du moi à la forme universelle s’accomplit souvent par l’intermédiaire d’autrui, et selon le miroir qu’il me présente de moi-même. »
115 Comme c’est le cas pour les mystiques (que J. Deprun appelle « maximalistes ») qui, dans la lignée du purisme de saint François de Sales, prêchent l’éviction de l’inquiétude en se fondant sur la valeur purifiante du mépris de soi et de tout ce qui peut tenter le moi. Voir La philosophie de l’inquiétude, op. cit., chap. ix, p. 146-148.
116 Saint Augustin, Confessions, I, 1, op. cit. : « notre cœur est inquiet, jusqu’à ce qu’il repose en vous. »
117 III, 2, p. 813 : « J’imagine infinies natures plus hautes et plus réglées que la mienne ; je n’amende pourtant mes facultés. »
118 Voir Bossuet dans des pages inédites des Principes communs de l’oraison chrétienne, chap. 31, qui conçoit l’homme parfait comme désirant Dieu sans inquiétude, « à cause que par la foi et la certitude des biens promis, l’espérance en est une jouissance avancée, ce qui à proprement parler n’est ôter au désir que l’inquiétude et l’incertitude. » Cité par J. Le Brun, op. cit., note 47 du chap. x.
119 Voir Marie de l’Incarnation, Correspondance, Lettre à son fils du 22 sept. 1666 où elle distingue dans la vie spirituelle, en utilisant des termes et des métaphores très érotisés, un jeu de l’âme qui souffre de saintes inquiétudes et d’impatiences amoureuse, d’une paix profonde et sans désir, où l’âme possédée par Dieu est purifiée dans son fond. Cité par J. Deprun, op. cit., chap. x, note 33.
120 III, 5, p. 881.
121 III, 9, p. 952 : « Je me contente de jouir le monde, sans m’en empresser. » cf. p. 996 : « Je m’emploie à faire valoir la vanité même et l’ânerie, si elle m’apporte du plaisir ».
122 III, 5, p. 843.
123 Selon l’expression de Pierre Statius, voir Le réel et la joie, Essai sur l’œuvre de Montaigne, éd. Kimé, 1997, p. 235.
124 Nietzsche, Gai savoir, IV, §341, éd. Gallimard, 1950 (tr. A. Vialatte) : « comme il faudrait que tu l’aimes, ta vie, pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle confirmation ! » (C’est Nietzsche qui souligne.)