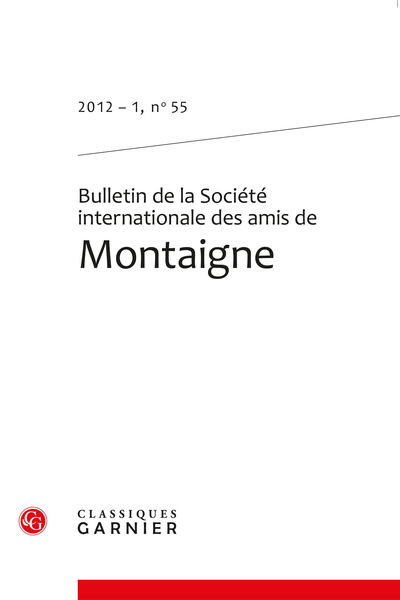
Naturaliser l’art ?
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 1, n° 55. varia - Auteur : Jeanneret (Michel)
- Pages : 143 à 153
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439766
- ISBN : 978-2-8124-3976-6
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3976-6.p.0143
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/07/2012
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Naturaliser l’art ?
Art, nature : des concepts qu’il vaudrait mieux éviter, peut-être, tant leurs acceptions sont vastes et instables. Mais Montaigne, qu’un certain flou sémantique ne gêne pas, travaille avec eux et investit en eux quelques points majeurs de sa pensée. Je voudrais m’aventurer avec lui sur ce terrain glissant en analysant le fonctionnement du couple art/nature, les relations d’opposition ou de complémentarité des deux termes, et cela, dans le chapitre iii, 5, « Sur des vers de Virgile1 ». Autant ou plus que de préciser les significations, il s’agira de mesurer la valeur des deux principes. L’art et la nature sont-ils bons, sont-ils mauvais ? On verra que l’évaluation ne débouche pas, elle non plus, sur des conclusions simples.
J’esquisse pour commencer une définition de nature, qui devrait s’appliquer à Montaigne, mais aussi, en général, à la sensibilité naturiste du xvie siècle : Force diffuse qui commande toutes les manifestations de la vie et en assure le maintien ; flux vital, principe animé et animant, immanent aux êtres et aux choses, dont il règle le fonctionnement2. Le concept est d’ordinaire pris en bonne part : la nature est une mère bienveillante, un principe universel dont les sages acceptent les lois. En témoignent les dernières pages du chapitre « De l’expérience », qui sont un acte de soumission aux principes souverains de la nature, un aveu de confiance et un hymne de célébration. Mais l’évaluation peut aussi basculer vers le pôle négatif. Si par exemple le sexe, dont il est beaucoup question
dans le chapitre iii, 5, exalte la dynamique créatrice de la nature, il réveille aussi en nous des instincts brutaux, une « rage indiscrette », qui nous « abrutit et abestit » (877). Ou cette autre imperfection : le déroulement inéluctable que nature imprime à toutes choses les conduit à leur déclin, selon un enchaînement de processus déterminés, qui ne laissent aucune liberté de choix ; ainsi, à l’échelle de la vie individuelle, le mouvement douloureux qui conduit à la déchéance de la vieillesse. Lorsque Montaigne écrit « Nature se devoit contenter d’avoir rendu cet aage miserable, sans le rendre encore ridicule » (887), ce n’est pas d’une bonne mère qu’il parle, mais d’une marâtre impérieuse et malfaisante.
Face à cette puissance qui nous embrasse et nous emporte se dresse l’art, l’industrie humaine, qui, dans l’acception reçue alors, pourrait se définir comme une action qui corrige la nature, une intervention volontaire pour changer le cours normal des choses. C’est aussi le ou les procédé(s) mis en œuvre dans une construction purement humaine, ou le résultat de cette opération. Quant à sa place dans l’échelle des valeurs de Montaigne, elle varie. L’art peut être indifférent, ni bon ni mauvais, lorsqu’il désigne par exemple une compétence technique, ou la transformation d’une matière. Mais souvent, on le sait bien, il est chargé d’une connotation négative. Il est répréhensible dans la mesure où il offense les « loix universelles et indubitables » (879) de la nature, où il détourne les choses de leur cours normal et travestit leurs propriétés. L’art complique ce qui est simple, il participe de l’école et de l’artifice, il est associé aux formes creuses et à la vaine sophistication d’esprits coupés du réel. En un mot, il risque la redondance ou la falsification parce qu’il est second. Or c’est justement sur ce point qu’il peut s’inverser pour prendre une acception positive. S’il risque de pervertir la nature, il peut aussi remédier à ses défaillances, en atténuant, par exemple, les disgrâces de la vieillesse. L’art est un supplément, mais un supplément légitime, et même bienvenu, lorsqu’il permet aux hommes de pallier les défauts d’un monde, d’un corps ou d’un quelconque système imparfaits.
Nous voici donc devant deux notions dont la valeur est relative, puisqu’elles changent de signe selon la perspective où on les place. Encore leurs variations obéissent-elles à une règle : quand la nature est bonne, l’art est mauvais, mais quand la nature est mauvaise, l’art est bon. Ce mouvement de bascule correspond au mécanisme de l’antipéristase, que
Terence Cave a remis en circulation3 : l’esprit va et vient entre deux pôles opposés et, par contrecoups, il corrige les déficiences de l’un en recourant aux mérites de l’autre. Si la nature m’afflige, je sollicite les ressources de l’art, mais dès que l’art verse dans l’excès, je retourne à la nature, dans une série d’oscillations qui peut continuer à l’infini. Cette dynamique circulaire et ce mode de pensée par renversements successifs trouvent une expression privilégiée dans le chiasme, que Montaigne affectionne particulièrement.
Dans « Sur des vers de Virgile », le recours à l’art est d’autant plus important que la nature est prise en défaut. Montaigne se présente comme un vieillard, qui assiste au refroidissement de son ardeur sexuelle et voit ainsi un des plaisirs de la vie lui échapper. Quels sont donc, dans cette configuration, les atouts de l’art, quels sont les moyens dont il dispose pour inverser la déchéance naturelle de l’âge, voilà ce que je voudrais examiner ici.
Le cours de la nature, on l’a dit, échappe au contrôle du sujet, livré à des lois qui, pour le meilleur ou pour le pire, règlent son existence. L’art, de son côté, n’est qu’un supplément, mais il au moins le mérite d’être un acte volontaire, à la fois la preuve et le produit de la liberté humaine. « Je veus estre maistre de moy » (841), dit Montaigne, et il ajoute : si la jeunesse « eschappe de mon sang et de mes veines, au moins n’en veus-je desraciner l’image de la memoire » (842). Tel est le privilège de l’esprit : par un effort délibéré, il refuse la fatalité du dépérissement, ou du moins l’infléchit. Au lieu de se soumettre passivement au déterminisme biologique, il en appelle à l’art, exploite ses ruses et se donne ainsi une chance de corriger la pente du déclin.
Montaigne détaille longuement sa stratégie : « Je me laisse à cette heure aller un peu à la desbauche par dessein » (841). Par tous les moyens possibles, il travaille à raviver sa libido, car le sexe est « salubre, propre à desgourdir un esprit et un corps poisant (…). Nous avons besoing d’estre sollicitez et chatouillez par quelque agitation mordicante comme est cette-cy » (891-92). L’amour neutraliserait l’humeur mélancolique qui me gagne, il réchaufferait mon sang, « il me rendroit la vigilance, la sobrieté, la grace, le soing de ma personne ; r’asseurerait ma contenance à ce que les grimaces de la vieillesse, ces grimaces difformes et pitoiables,
ne vinssent à la corrompre » (893). À travers tout le chapitre court un parallèle implicite entre deux groupes qui subissent, malgré eux, la tyrannie de la continence et des idées reçues : les vieux, supposés impotents, et les femmes, asservies à la pudeur et la chasteté. Les uns et les autres, aliénés de leur corps par des coutumes frileuses, sont condamnés à languir, et Montaigne, courageusement, s’emploie à les émanciper.
À l’inertie et la résignation, il va donc opposer les expédients de l’art. Deux techniques sont mises en œuvre. La première est la mémoire, le souvenir « des jeunesses passées » (841), comme si revivre mentalement les performances d’autrefois, c’était, par antipéristase, ressusciter la vigueur perdue. Le second remède est l’imagination : « A un corps abattu, comme un estomac prosterné, il est excusable de le rechauffer et soustenir par art, et, par l’entremise de la fantasie, luy faire revenir l’appetit et l’allegresse, puis que de soy il l’a perdue » (892). Que Montaigne utilise, à côté de fantaisie, les termes de jouet, amusoire, songe ou folie, il s’agit toujours de lâcher la bride aux fantasmes, d’exploiter les puissances du rêve et de la fiction.
À travers ces deux facultés, la mémoire et l’imagination, Montaigne sollicite les ressources de l’autosuggestion. Mais comment stimuler cette fonction ? Comment susciter les images psychotropes ? Le chapitre est là, tout entier, pour répondre : la méthode passe par l’écriture. « Sur des vers de Virgile » énonce un programme et, simultanément, l’applique en fournissant à l’esprit les matériaux dont il a besoin pour se régénérer. En ravivant des souvenirs intimes, en collectionnant des histoires lascives et en déployant les capacités érogènes du style, Montaigne fait appel à un autre art, la littérature, pour infléchir la courbe de son destin.
Sur la formule la plus efficace, en matière d’érotisme, il hésite entre deux partis. Le premier consiste à défier les censures et à tout dire : « Je me suis ordonné d’oser dire tout ce que j’ose faire » (845). Montaigne refuse les précautions de la pudeur, les mensonges de la pruderie : « Qu’a faict l’action genitale aux hommes, si naturelle, si necessaire et si juste, pour n’en oser parler sans vergnongne et pour l’exclurre des propos serieux et reglez ? » (847). Encore la pudeur le rattrappe-t-elle assez vite : il enrobe ses aveux de tournures prudentes et, pour parler crûment du sexe, recourt à la médiation des « auctoritez receuës » (888), qu’il cite en latin. Au reste, le « parler scandaleux » (889) est-il vraiment le meilleur moyen de fouetter le désir ? Montaigne opère ici un de ses
renversements coutumiers en vantant les mérites de la méthode inverse. « Celuy qui dict tout, il nous saoule et nous desgouste » (880), ce qui revient au principe élémentaire de l’érotisme : pour entretenir l’appétit et ouvrir une « belle route à l’imagination » (880), laisser quelque chose à deviner. Faut-il donc voiler ou dévoiler ? La réponse est que les deux techniques sont bonnes et que Montaigne va les mettre, l’une et l’autre, à l’épreuve.
Au plan des souvenirs, il rallume les « vestiges de [s]on ancienne flamme4 » en détaillant son commerce avec les prostituées. Mais la mémoire est moins sollicitée que l’imagination et les expériences personnelles sont moins spectaculaires que les exploits prêtés à autrui. En matière de pratiques sexuelles hyperboliques ou déviantes, le chapitre offre une étonnante collection d’anecdotes scabreuses – de quoi nourrir tous les fantasmes et éprouver, par procuration, les plaisirs les plus fous. Les histoires de cocuage, selon la bonne vieille tradition gauloise, ne surprendront personne. Mais on rencontre aussi des maris qui prostituent leur femme ; des cas de masturbation et d’homosexualité ; des pratiques comme l’adoration du phallus, le dépucelage rituel et la nécrophilie. À plusieurs reprises, Montaigne revient sur la puissance irrépressible du désir féminin : cliché commode, qui entretient le rêve de la femme offerte, comme une proie facile à prendre. Voici par exemple une impératrice qui subit vingt-cinq hommes en une nuit et une autre nymphomane qui fait l’amour en public ; une reine qui, mécontente des performances de son époux, le fait étrangler ; ou cette autre alliance de lubricité et de sadisme : « Les femmes Scythes crevoyent les yeux à tous leurs esclaves et prisonniers de guerre pour s’en servir plus librement et couvertement » (866). Tout se passe comme si Montaigne se constituait un répertoire de contes grivois ou recueillait les bribes, discontinues et embryonnaires, d’un traité de la sexualité, qui répondrait moins, comme le voudrait Michel Foucault, à la volonté de savoir, qu’à la volonté de jouir5.
Cet érotisme dont Montaigne s’entoure, ce brasier qu’il découvre partout, ardent ou provisoirement assoupi, illustrent la puissance universelle du désir : « Tout le mouvement du monde se resoult et rend à cet accoupplage : c’est une matiere infuse par tout, c’est un centre où
toutes choses regardent » (857). La fameuse invocation de Lucrèce, citée au passage, « Tu, Dea, tu rerum naturam sola gubernas » (848), hante la pensée de Montaigne comme elle sature le chapitre. D’autres citations latines, moins majestueuses, viennent à l’appui, pour corser le plaisir. Il s’agit d’une bonne dizaine de passages licencieux ou même pornographiques : des vers de Martial, surtout, mais aussi de Catulle, d’Horace, de Juvénal et deux extraits que Villey rapporte à une anthologie de Priapea. Certains de ces extraits sont même si risqués que Villey n’ose pas les traduire : « Le sens de ces deux vers, trop libres pour être traduits, est que le gentilhomme n’avait jamais donné de marques de virilité » (867). Il est probable que ces ouvrages inconvenants, Montaigne les avait sous la main. Dans sa bibliothèque telle que Villey l’a reconstituée figurent, outre les poètes que j’ai déjà nommés, le Satyricon, un Décaméron, un Heptaméron, un Rabelais et les Nouvelles Récréations de des Périers6. Le plus libre de ces auteurs, Martial, est aussi l’un de ceux que Montaigne cite le plus souvent : au total quarante et un extraits, répartis dans les trois livres7. Il a beau désavouer les auteurs trop explicites, sous prétexte qu’ils inhibent l’imagination, il n’en conserve pas moins une jolie collection d’erotica.
Voilà donc autant de béquilles, fournies par l’art, pour remédier aux défaillances de la nature. Mais nous n’en sommes pas à un renversement près. À peine le supplément des souvenirs et des lectures a-t-il été sollicité que Montaigne en dénonce les limites. La fugacité des chimères le laisse sur sa faim : « Ma philosophie est en action, en usage naturel et present : peu en fantasie » (842). Que valent les constructions imaginaires lorsque le corps demande des plaisirs palpables ? « Certes il y faudroit autre remede qu’en songe : foible luicte de l’art contre la nature » (842). À la fin du chapitre, l’efficacité des feintes et le pouvoir de l’amour apparaissent même, dans un moment de découragement (ou de lucidité ?) incapables d’arracher le « pauvre homme » à ses « chagrins melancholiques » (893). La diversion ne trompe plus8.
Si l’art venait au secours de la nature, il faut donc maintenant que la nature subvienne aux défauts de l’art, il faut, comme dit le même
chapitre iii, 5, « naturaliser l’art » (874). Nous revoici devant la bascule de l’antipéristase. Mais il y a une différence. Il ne s’agit plus d’alterner d’un pôle à l’autre, mais de coaliser les forces opposées, d’en opérer la synthèse. « Naturaliser l’art », ce n’est pas y renoncer, mais lui insuffler la force vitale de la nature, le régénérer en le faisant participer de l’énergie universelle. La technique d’autosuggestion qui, on l’a vu tout à l’heure, ne repose que sur des souvenirs et des fantasmes livresques est un artifice trop cérébral, un palliatif inconsistant. Il faut que le plaisir prenne corps et, comme un corps, touche les sens, émeuve la chair autant que l’esprit.
Cet art naturalisé, somatisé, est-ce un leurre, un expédient purement intellectuel ? Pas nécessairement. Car l’écriture a un corps – le style -, et c’est là, dans le corps de l’écriture, dans la matérialité d’une parole incarnée, que l’art prend vie. Les pornographes comme Martial ne font qu’agiter des idées, leur diction n’a pas cette épaisseur charnelle qui distingue les vrais poètes. Au contraire, les mots d’un Virgile et d’un Lucrèce sont « de chair et d’os » (873), ils procurent la même volupté que la caresse ou l’étreinte. Cette satisfaction n’est ni mentale, ni substitutive, ni illusoire, puisqu’elle s’alimente à des sons, des rythmes, des effets de présence qui ne sont pas moins délicieux que les plaisirs de l’amour. Montaigne le dit : les Muses et Vénus, la beauté de la diction et la jouissance sexuelle s’accordent et se complètent. Lorsque la poésie parvient à ce degré d’accomplissement, la distinction de l’art et de la nature se trouve surmontée, l’industrie humaine et la puissance vitale conjuguent leurs forces9.
C’est même trop peu dire que la poésie provoque un plaisir égal à celui de la chair ; elle le surpasse. Lire les vers érotiques de Virgile, c’est comme voir, plus beau que nature, le corps désiré : « Les forces et valeur de ce Dieu [Eros] se trouvent plus vives et plus animées en la peinture de la poesie qu’en leur propre essence (…). Elle represente je ne sçay quel air plus amoureux que l’amour mesme. Venus n’est pas si belle toute nue, et vive, et haletante, comme elle est icy chez Virgile » (849). L’enargeia, l’illusion de présence – une sorte de parousie poétique – s’accomplissent pleinement, comme l’attestent les deux occurrences de l’adjectif vif :
surgie de la page, la vie est là, allègre, éclatante et voluptueuse. Au milieu de ce passage, Montaigne a d’ailleurs inscrit ces paroles magnifiques de Juvénal : « Et versus digitos habet10 » : la poésie a des doigts pour chatouiller et caresser, elle réveillerait les morts. Plus loin dans le chapitre, après avoir cité les vers de Lucrèce sur le couple enlacé de Mars et Vénus, Montaigne se lance dans un superbe commentaire qui, regroupant les passages des deux poètes, renchérit encore sur la sexualisation du verbe poétique (872-74). La modulation sur la racine vi- continue : les vertus que Montaigne reconnaît aux chantres de l’amour sont la vie, la vigueur, la virilité, le ravissement. Le langage des bons poètes, dit-il, « est tout plein et gros d’une vigueur naturelle et constante ». Leur éloquence « est nerveuse et solide (…), elle remplit et ravit, et ravit le plus les plus forts espris. (…) C’est la gaillardise de l’imagination qui esleve et enfle les parolles » (873). Chacune de ces qualités évoque l’énergie sexuelle – cette puissance défaillante que Montaigne tente de ranimer par la grâce de la lecture – et la récurrence de la syllabe vi, qui résonne jusque dans le nom de Virgile, n’est évidemment pas innocente. Ici encore, Montaigne a glissé une citation latine qui appuie l’idée : « Contextus totus virilis est » : la texture de la poésie authentique est totalement virile, elle a la fermeté du mâle11.
Ce commentaire se déploie comme une méditation cratylienne sur les vertus mimologiques des grands textes littéraires12 – des textes qui surmontent doublement l’arbitraire du signe : parce que le mot se confond avec la chose qu’il nomme, et parce que la personne de l’auteur habite et anime ses propos. Pour le dire autrement, lire un grand texte, c’est invoquer, par la magie du verbe, et le sujet et l’objet du discours, donc embrasser toute la richesse du réel.
La lecture ne sert pas seulement de support à l’imaginaire ; elle fournit matière à l’écriture ; Montaigne lecteur de textes érotiques est donc également concerné dans son activité d’écrivain. L’esthétique de l’art naturel, le rêve d’une langue qui soit matière ou corps vivant,
c’est aussi un idéal qui guide sa plume, si bien que le commentaire sur Virgile et Lucrèce revêt aussi une valeur réflexive. S’il postule au début que l’aptitude à naturaliser l’art repose sur des qualités innées, il reconnaît bientôt que ces mêmes qualités s’acquièrent. Le labeur des poètes est comparé à celui des gens de métier par toute une série de métaphores qui renvoient d’abord à la besogne des artisans : étirer, ployer, appesantir, enfoncer, pour enchaîner ensuite sur les techniques du couturier et du jardinier (873-74). On peut donc travailler à insuffler dans l’art la vitalité de la nature, et le disant, Montaigne le fait. Lui-même se pose en ouvrier de la langue et il illustre sa théorie, hic et nunc, en l’appliquant. Sous sa plume, les idées s’incarnent et, traitées dans un vocabulaire concret, rapportées aux activités manuelles, à la réalité physique et biologique, elles prennent la consistance d’une matière. Ce qu’il dit d’Horace, on peut le lui appliquer : « son esprit crochette et furette tout le magasin des mots et des figures pour se représenter ». Quant à Plutarque, ajoute-t-il juste après, « il veid le langage latin par les choses ; icy de mesme : le sens esclaire et produict les parolles ; non plus de vent, ains de chair et d’os » (873). On peut se demander à quoi renvoie ici : aux passages commentés des poètes, ou au commentaire lui-même ? Peu importe, puisque les uns et les autres partagent cette vertu mimétique qui donne aux mots l’allure de la chose. Les métaphores, par exemple, qui se recrutent dans le registre de la vie élémentaire, ramènent les idées sur terre, les inscrivent dans l’environnement quotidien et le vécu corporel. Le chapitre iii, 5 en fournit quelques beaux échantillons : il faut que l’esprit, pour échapper à la vieillesse, « verdisse, qu’il fleurisse (…) comme le guy sur un arbre mort » (844) ; les humeurs chagrines sont « comme les vantouses qui ne hument et appetent que le mauvais sang » (845) ; Virgile et Lucrèce « sont tout epigramme, non la queuë seulement, mais la teste, l’estomac et les pieds » (873) ; quant à Plutarque, « je ne le puis si peu racointer que je n’en tire cuisse ou aile » (875).
Mais il faut surtout écouter Montaigne, ausculter ses phrases qui, par leurs sons et leurs cadences, se donnent réellement à percevoir comme messages sensoriels. Les figures de construction, les rappels symétriques, les effets d’écho et les jeux sonores abondent. Les parallélismes et les chiasmes, les séries binaires et ternaires impulsent au discours des rythmes qui le changent en musique. Ecoutons ces quelques scansions :
« Je ne suis meshuy que trop rassis, trop poisant et trop meur » (841) ; « Venus n’est pas si belle toute nue, et vive, et haletante, comme elle est icy chez Virgile » (849). Les assonances, les allitérations, les homéotéleutes transforment la phrase en événement acoustique et inscrivent le sens dans le corps de la voix. Les maladies « sont subjects graves et qui grevent » (841) ; la haute éloquence « remplit et ravit, et ravit le plus les plus forts espris » (873).
Les paroles « de chair et d’os » (873) ne sont donc pas seulement celles des poètes, mais celles de Montaigne lui-même qui, proposant ailleurs d’offrir à d’éventuels amis « des essays en cher et en os » (844), s’approprie l’expression. Le fantasme du livre comme corps, comme son corps, hante les Essais et, dans le chapitre iii, 5, s’exprime dans un chiasme qui rend parfaitement la réciprocité du lien : « Est-ce pas ainsi que je parle par tout ? me represente-je pas vivement ? suffit ! J’ay faict ce que j’ay voulu : tout le monde me reconnoit en mon livre, et mon livre en moy » (875). Le livre s’anime, l’auteur et son œuvre partagent la même vie : c’est le rêve de Pygmalion – un Pygmalion qui serait aussi, d’ailleurs, un Narcisse. Entraîné par cette logique, Montaigne en vient même à imaginer que, par la médiation du livre auquel il s’identifie, il pénètre dans l’intimité des dames, comme si, grâce à ce substitut fantasmatique, il allait faire l’amour avec elles : « Je m’ennuie que mes essais servent les dames de meuble commun seulement, et de meuble de sale. Ce chapitre me fera du cabinet » (847).
Voilà des chimères qui laisseront de glace les esprits positifs. Cet art naturel, ce livre organique et incarné, ce ne sont que des rêveries, ou des constructions rhétoriques, des fictions produites par de vaines métaphores. Mais est-ce à nous, littéraires, de les démystifier ? Notre rôle est au contraire de rappeler que Montaigne est aussi un artisan de la langue, un poète pour qui les mots sont des êtres vivants, des objets doués de vigueur et de saveur. Sa pensée est si captivante, elle mobilise à tel point le lecteur que l’analyse intellectuelle s’expose à occulter la sensualité de l’écriture, sa prégnance et sa présence. Certes, l’agilité de l’esprit et la sensibilité aux formes et aux matières ne sont pas incompatibles. Mais notre approche savante, nos élucubrations d’historiens ou de philosophes risquent d’éclipser la qualité matérielle d’une prose qui veut participer, elle aussi, du plaisir des sens et de l’immédiateté des phénomènes. Montaigne menace de revenir « de l’autre monde pour
démentir celuy qui me formeroit autre que je n’estois » (III,9 ; 983). Tâchons donc de ne pas encourir le reproche qu’il adresse à Aristote, chez qui, dit-il, « Je ne recognois pas […] la plus part de mes mouvemens ordinaires : on les a couverts et revestus d’une autre robbe pour l’usage de l’eschole » (874).
Michel Jeanneret
Université de Genève
1 Cet article reprend une communication, restée inédite, présentée au Colloque « Le dialogue des arts dans les Essais de Montaigne » à l’université de Harvard (2003). Les citations renvoient à l’édition des Essais de Pierre Villey, Paris, PUF, 1965. Sans autre indication, elles sont toutes extraites de « Sur des vers de Virgile ». Des très nombreuses études sur ce chapitre, je ne citerai que le commentaire qui reste peut-être le plus complet et le plus équilibré, celui de Jean Starobinski, dans Montaigne en mouvement, Paris, Gallimard, 1982, chap. 5.
2 On complétera en consultant Robert Lenoble, Esquisse d’une histoire de l’idée de nature, Paris, Albin Michel, 1969.
3 Voir Pré-histoires. Textes troublés au seuil de la modernité, Genève, Droz, 1999, p. 35-50.
4 Citation de Virgile, Enéide IV, 23, p. 848.
5 Voir Michel Foucault, Histoire de la sexualité, 1. La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976.
6 Voir « Catalogue des livres de Montaigne », dans l’éd. citée (note 1), p. xli-lxvi.
7 Ibid., p. liv.
8 Voir Olivier Guerrier, Quand « les poètes feignent » : « fantasie » et fiction dans les Essais de Montaigne, Paris, Champion, 2002, p. 246-52.
9 Sur la poésie et l’érotisme dans III, 5, voir Gisèle Mathieu-Castellani, Montaigne. L’écriture de l’essai, Paris, PUF, 1988, p. 90-132.
10 Satires VI, 197, dont le texte est moins séduisant que la version de Montaigne : c’est la voix caressante et libertine d’une vieille qui, dans l’original, « digitos habet ».
11 Tom Conley montre bien comment les signifiants du sexe s’infiltrent dans le discours de III, 5 : voir « Montaigne moqueur. ‘Virgile’ and its Geographies of Gender », dans High Anxiety. Masculinity in Crisis in Early Modern France, éd. Kathleen P. Long, Kirksville, MO, Truman State University Press, 2002, p. 93-106.
12 Voir Gérard Genette, Mimologiques. Voyage en Cratylie, Paris, Seuil, 1976.