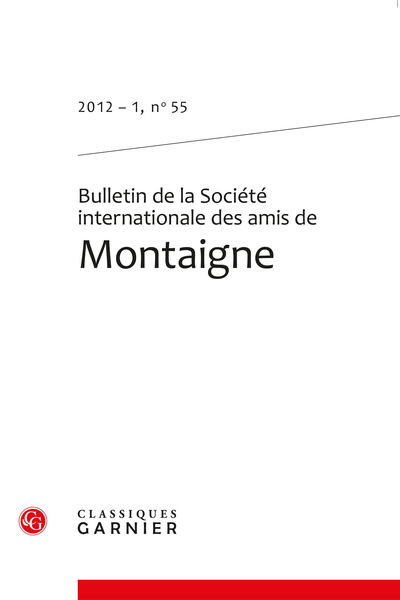
Montaigne, le « sublime » et la provocation lyrique
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 1, n° 55. varia - Auteur : Langer (Ullrich)
- Pages : 155 à 174
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439766
- ISBN : 978-2-8124-3976-6
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3976-6.p.0155
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/07/2012
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Montaigne, le « sublime »
et la provocation lyrique
Depuis les travaux de Michel Magnien, d’Olivier Guerrier et de Mary B. McKinley, incontournables sur l’esthétique du sublime, sur le rapport entre poésie et imagination, et sur la fonction des citations poétiques latines, on connaît l’importance du commentaire de la poésie que constituent certains chapitres des Essais. Ce commentaire concerne très précisément la force, la véhémence, de la poésie, et il n’est pas sans rappeler l’inspiration évoquée dans l’Ion de Platon, et il n’est pas non plus sans nous rappeler, mais peut-être pas à Montaigne lui-même, les formulations du Pseudo-Longin dans son traité Du sublime. Michel Magnien a montré à juste titre que les expressions utilisées par Montaigne pour commenter la force de la poésie pourraient tout aussi bien provenir d’une méditation sur un « sublime genus dicendi » chez Quintilien, ou sur le style de Sénèque et de Tacite, voire de certains passages de l’Orator de Cicéron. Et, à l’inverse, qu’une lecture assidue du traité du Pseudo-Longin aurait dû suggérer à Montaigne des textes et des appréciations qui, pourtant, sont absents des Essais1. Olivier Guerrier a pris la mesure de la théorie de l’inspiration poétique, platonicienne et ficinienne, à la fois pour cerner la fonction que Montaigne attribue à la poésie et pour éclairer la composition mi-commentaire de prose, mi-citation poétique, mi-écrite, mi-orale des Essais. Montaigne met l’accent sur la réception, et non sur la production poétique ; il semble accorder à l’interprétation
une fonction dans le « ravissement » qui auparavant était l’apanage de la performance2. Mes propres remarques iront tout à fait dans ce sens. Mary B. McKinley, pour sa part, avait attiré notre attention sur l’importance du contenu des citations poétiques latines, surtout dans « Sur des vers de Virgile ». Ce contenu sémantique, parfois marginalisé devant le commentaire et, plus généralement devant le texte de Montaigne, ne va pas de soi ; il contribue tout autant à la « force » de la poésie que ne le fait sa forme3.
J’aimerais reprendre les trois moments-clef du commentaire de la poésie chez Montaigne, non pas, dans un premier temps, pour refaire une analyse de ce que Montaigne dit de la poésie, mais pour regarder de très près ses choix de fragments de poésie. Il s’agit évidemment de vers extraits de l’Énéide et du De natura rerum. Les trois sommets, les trois champions, sont les suivants : tout d’abord, l’éloge très succinct de Caton par Virgile au livre VIII de l’Énéide, que Montaigne reproduit à la fin du chapitre « Du jeune Caton » ; ensuite, l’évocation plus ample de la séduction de Vulcain par son épouse Vénus qui précède de peu l’éloge lapidaire de Caton, notre premier échantillon, dans le même livre de l’Énéide – celle-là est commentée par Montaigne dans son chapitre « Sur des vers de Virgile » ; et finalement, un passage du poème de Lucrèce dans lequel figure à nouveau Vénus, cette fois-ci soumettant le dieu de la guerre. Ce dernier passage est l’objet d’un commentaire plus étendu dans ce même chapitre « Sur des vers de Virgile ». Ces trois fragments de poésie constituent une sorte de « sublime », transportant et ravissant les plus forts, en l’occurrence le lecteur avide de poésie latine qu’est Montaigne.
Pourquoi ces fragments et non pas d’autres ? Qu’y a-t-il dans cette poésie qui transporte et qui ravit ?
D’emblée la réponse nous échappe, ou devrait nous échapper, et cela à cause des termes par lesquels nous formulons la question. Si la force de cette poésie est un nescio quid, un je ne sais quoi, si nous en sommes
« ravis », aucune analyse calme et délibérée du langage poétique lui-même ne sera à la hauteur de l’effet qu’elle provoque. C’est sans doute un peu le paradoxe d’une poétique qui insiste sur l’effet provoqué au détriment de la composition, du sens et des niveaux de sens. La poésie, dans ses moments les plus forts, est poésie parce qu’elle élude l’analyse ; elle se pose toujours au-delà de notre saisie rationnelle, ou, a contrario, si nous arrivions à élucider la technique qui sous-tend l’apparente force d’un poème, celui-ci ne posséderait pas ou ne posséderait plus, la force que nous lui avions prêtée. Sophismes plaisants mais que la tradition du sublime, qu’elle soit pseudo-Longinienne ou autre, ne me paraît pas décourager, comme ne le fait d’ailleurs pas Montaigne lui-même : « il est plus aisé de la [= la poésie] faire, que de la cognoistre » (I.37, p. 231)4.
En dépit de cette difficulté pérenne, quasi structurelle, je voudrais revenir aux trois fragments choisis par Montaigne, pour en dégager quelques éléments pertinents dans un premier temps, mais en évitant la question de la « force », et sans oublier, dans un second temps, ce que Montaigne en dira lui-même.
La première instance de poésie qui « ravage » est l’éloge de Caton par Virgile, au bout d’une longue et bien célèbre description du bouclier d’Énée, cadeau de Vénus, qui s’est présentée (« seque obtulit », VIII, 611) toute vive à la vue du héros troyen. Ce bouclier se trouve parmi les armes qu’elle avait présentées après avoir embrassé son fils : « dixit et amplexus nati Cytherea petivit, / arma sub adversa posuit radianta quercu » (VIII, 615-616) (« Vénus dit, chercha l’étreinte de son fils, et elle posa les armes brillantes sous un chêne devant lui »). Suit une évocation des armes : d’abord le casque, ensuite l’épée, la cuirasse, la lance et finalement le bouclier. Celui-ci – je ne reviendrai pas sur les détails de sa description qui est un des passages les plus connus de Virgile – contient l’histoire à venir de Rome. Montaigne indique d’ailleurs le contexte dans lequel se trouve l’éloge de Caton : « Et le maistre du chœur, apres avoir étalé les noms des plus grands Romains en sa peinture, finit en cette manière : … » (I.37, p. 232). En effet, avant la mention de Caton, figurent Manlius, les Gaulois devant les portes de Rome, et la procession des Luperques. Mais immédiatement avant Caton, Vulcain avait dépeint l’enfer et la
punition de Catilina, suspendu d’une falaise, tremblant devant le visage des Furies : « hinc procul addit / Tartareas etiam sedes, alta ostia Ditis, / et scelerum poenas, et te, Catilina, minaci / pendentem scopulo Furiarumque ora trementem » (666-669) (« Éloignés de ceux-là il ajoute les sièges du Tartare, les hautes portes de Pluton, et les peines des criminels, et toi, Catilina, qui pends d’un rocher qui menace de sa chute, toi qui trembles devant les visages des Furies »). Pour compléter la peinture de l’enfer, Vulcain avait figuré les « pieux », bien loin, et Caton leur donnant des lois : « …[addit] secretosque pios, his dantem iura Catonem » (670). Alors que Montaigne suggère que Caton se trouve en position finale, chez Virgile l’ekphrasis n’est pourtant pas terminée : le poète continue en évoquant les mers entourant ces scènes, les dauphins se débattant dans les vagues, et, plus important, le futur empereur Octavien, Agrippa, son adversaire Marc-Antoine, les batailles et le triomphe final d’Octavien. La figure de Caton se situe donc au seuil du passage de la république à l’empire, ce qui pour Montaigne, au moins, est au bout de cette liste des « plus grands Romains », même si, pour Virgile, le plus grand des Romains viendra après l’éloge de Caton.
« … his dantem iura Catonem » est évidemment le fragment de ce passage ekphrastique sélectionné et primé par Montaigne, dans un geste magistral et péremptoire. Penchons-nous en premier lieu sur ce petit texte. Tout d’abord la traduction française : « … Caton donnant à ceux-ci des lois ». « Ius » se traduit normalement par « le droit, la raison » (Robert Estienne, 1552), distinct, donc, des lois précises, « leges ». L’utilisation de « ius » au lieu de « lex » se comprend dans ce cas précis, car Caton n’est pas, littéralement, un législateur, mais quelqu’un qui, par l’exemple moral qu’il propose, par sa droiture et par son refus de se soumettre, dicte aux autres le « droit », ce qui est juste. Mais au pluriel « dare iura » peut en effet avoir le sens de « lois » ou « règles », comme on le voit ailleurs dans l’Énéide même (par exemple, « Iuppiter, hospitibus nam te dare iura loquuntur », I.731). Toujours est-il que « iura » retient la proximité avec la justice, iustitia, ce qui est moins le cas de « lex5 ». En tout cas le geste de Caton, comme celui de Jupiter, est une expression de la souveraineté, de celui qui pose une règle, par sa présence même
parmi les bons, les justes, les « pieux ». Et ces derniers sont plus aptes à recevoir les lois données par Caton, car ils sont de nature à reconnaître leurs devoirs et à suivre les lois. Comme les bons sont « secreti », à part, éloignés de ceux qui subissent les tourments infernaux, Caton, dans ce geste de « donner des lois » se sépare encore des bons. Je vais revenir à ce procédé de distinction, de ségrégation progressive.
Toutefois, avant de me tourner vers le langage poétique précis, j’aimerais ouvrir une parenthèse qui paraîtra contestable à certains, voire à moi-même – mais je ne suis sûrement pas le premier à le faire. Comment ne pas entendre, dans les mots choisis par Montaigne, l’écho de celui qui fut le plus grand des poètes à évoquer l’enfer, le purgatoire et le paradis, certainement à l’égal d’un Virgile qui figura comme son guide ? « His dantem iura Catonem », dans ce contexte de la représentation de l’enfer païen, ne peut pas ne pas rappeler à un lecteur du xvie siècle, et à Montaigne lui-même qui semble connaître et qui de toute manière cite la Divine comédie dans ses Essais, le poète Dante6. L’intervention de Caton dans le poème de Dante revêt une importance particulière. C’est le premier personnage que rencontre le poète toscan lorsqu’il accède au Purgatoire, et Caton est tout aussi nimbé de vertu chez Dante que chez Virgile, car il apparaît accompagné de quatre étoiles qui représentent les quatre vertus « cardinales » dont il est évidemment la meilleure incarnation (Purgatorio, I.22-108). Caton au-dessus de l’Enfer et au seuil du Purgatoire : la même position supérieure et pourtant liminaire caractérise le Caton de Dante et le Caton virgilien. Mais la poétique de Montaigne ne semble pas vraiment autoriser ce genre de lecture : lorsque Montaigne loue Virgile de ce sublime de l’éloge, il ne le fait pas pour la richesse herméneutique du fragment cité. Il ne s’agit pas de christianiser l’auteur païen, de lui trouver des allégories évangéliques, à la manière de « Frère Lubin » pour Ovide ou du pseudo-Héraclide du Pont pour Homère, comme nous le rappelle Rabelais. D’ailleurs toute lecture au fond allégorisante méconnaîtrait la place très ambiguë qu’occupe Caton chez Montaigne, admirable mais pas vraiment à imiter. Que faire, alors,
de cet écho certain et tout à fait anachronique, que faire de Dante, au milieu du sublime virgilien ?
Montaigne ne cite pas l’éloge de Caton pour son sens, pour sa terre féconde où se cultivent les commentaires. Il le cite pour sa force. L’écho de Dante, je pense, ajoute à cet effet de raccourci, de télescopage qui provoque l’étonnement, à l’effet subit et sans détours de ce fragment. L’histoire, les siècles, sont parcourus en un instant, se recoupent pendant le temps d’un fragment de vers. Comme la grande poésie est toujours axée sur un avenir – le bouclier d’Énée est une série de prophéties – Virgile, pourquoi pas, se trouve dans la position de son héros, apercevant un avenir qu’il ne pourrait pas connaître.
Le télescopage est perçu, pourtant, par un lecteur au présent. Virgile annonçant à son insu son propre voyage, sa conduite de Dante, au moyen de l’éloge d’un héros que tous connaissent, nous rend présent ce héros comme aucun des autres vers n’a pu le faire. Le mouvement – le temps d’un souffle – d’un passé moitié fictif moitié historique vers le moment présent, se fait par l’anachronisme, par ce marquage à rebours et tout implicite du temps.
Un autre élément pertinent, et ma parenthèse dantesque se ferme ici, est le déictique : « … his dantem iura Catonem ». À ceux-ci, c’est-à-dire aux secretos pios, aux justes déjà sélectionnés, ou comme le dit Montaigne, étalés dans la peinture de Virgile, Caton donne ses lois. Le déictique his réduit les grands Romains à un groupe anonyme – par rapport au sublime Caton, ils sont tous pareils. Il y a plus de ressemblance parmi les grands qu’entre les grands et celui qui sort absolument du lot. Cet effet de mise à distance se fait dans un geste qui est déjà contenu dans le pronom démonstratif : dantem iura n’est qu’une manière de rendre explicite ce que le démonstratif implique. Caton désigne ceux qui lui sont inférieurs, et ils sont rendus inférieurs par le fait même qu’ils sont indiqués par le « ceux-ci ». En principe, bien sûr, c’est Virgile qui choisit ce langage précis, le déictique « his », mais Caton dans son geste se confond avec Virgile. Par rapport à Caton et par rapport à Virgile les « pieux » sont « ceux-ci ». C’est donc comme si Caton lui-même disait : « moi et non pas ceux-là ».
Mais le déictique n’est pas simplement un geste du souverain, ou un geste souverain. C’est aussi le geste principal du poète encomiaste, et plus largement le geste de celui qui représente. Et c’est Montaigne lui-même
qui attire notre attention sur cette analogie, entre le geste de désigner ses inférieurs et celui qui consiste à les « étaler en sa peinture ». Or – et c’est bien une technique des plus communes de l’evidentia – l’ekphrasis de Virgile, cette peinture de l’histoire à venir de Rome, est ponctuée par les déictiques, les indications spatiales d’un poète représentant un monde par des gestes qui font voir : illic … illic … nec procul hinc … hauc procul inde … hic … hic … hinc procul … (etc.). Faire voir un monde à venir, et faire voir celui qui fait voir, à son tour, ceux qui sont en-dessous de lui : une série de correspondances, ou pour mieux dire, un télescopage des niveaux de la mimésis semblent inséparables du « sublime » de Virgile louant Caton. Le dernier dans la suite des « donneurs de lois » est bien sûr Montaigne lui-même, celui qui ne manque pas d’indiquer, de faire voir les éloges de Caton par sa propre formulation déictique : « Mais voylà nos gens [les “cinq poëtes Latins sur la louange de Caton”, p. 231] sur la carriere » (p. 232).
Nous voilà donc devant une chaîne de « monstrations » : Caton comme désignant, se démarquant des pieux est lui-même dans un enfer désigné, « étalé » par Virgile – par l’entremise de Vulcain –, se démarquant par là même de Martial, de Manilius, de Lucain, d’Horace, et qui est lui-même désigné, distingué par Montaigne ayant mis le poète de l’Énéide en position finale. Ne serait-on pas tenté de voir ici une analogie avec la chaîne d’inspiration, décrite par l’essayiste lui-même dans le commentaire platonisant précédant le florilège de citations :
Et il se void plus clairement aux theatres, que l’inspiration sacrée des muses, ayant premierement agité le poëte à la cholere, au deuil, à la hayne, et hors de soy où elles veulent, frappe encore par le poëte l’acteur, et par l’acteur consecutivement tout un peuple. C’est l’enfileure de noz aiguilles, suspendues l’une de l’autre. (p. 232)
La chaîne des instances démonstratives, reliant Caton à Virgile, à Montaigne, est-elle un exemple de plus de cet effet d’inspiration, d’attirance, exercé par la fureur qui lie Muse, poète, rhapsode et public ? Montaigne nous ferait-il la démonstration, pour ainsi dire, du rhapsode ?
Avant de pouvoir répondre directement à la question, je dois m’arrêter à une difficulté. Le déictique, même lié à l’ekphrasis ou à l’evidentia, me paraît d’une nature double. S’il sert à rendre présent, donc plus vif et plus percutant, voire « ravissant », un sujet, son utilisation comporte
une suggestion de distance entre celui qui désigne et ce qui est désigné. L’exemple de Caton « donnant ses lois à ceux-ci » le dit très clairement : le déictique « his » connote déjà la séparation entre Caton et les autres « pieux », séparation que le geste de « donner des lois » rend explicite. Si Virgile avait dit : « ceux-ci … et Caton », l’effet n’aurait pas été bien différent. Mais ne serait-ce pas un effet général du déictique, dans la poésie de l’ekphrasis ? Cet effet de distance se voit plus clairement dans la comparaison entre le poète encomiaste et l’acteur. L’acteur qui récite un rôle de théâtre n’est pas un poète qui représente, qui « peint » : celui qui se met à la place même de Caton, parle pour lui, n’est pas celui qui le désigne, le fait vivre à distance. Voilà Caton tout vif mais ce n’est pas moi. Il s’agit d’une part, évidemment, de l’antique distinction entre le genre dramatique ou « imitatif » (le poète fait parler d’autres) et le genre « exégématique » ou « énarratif » (le poète parle lui-même) que nous trouvons chez Platon (République, III, 392d-394a), Diomède (Ars grammatica, III), Isidore de Seville (Etymologiae, VIII.7.11), et pour la Renaissance, Josse Bade (préface à son commentaire de l’Art poétique d’Horace)7. Mais dans ce cas précis la distance – forcément affective ou existentielle – que comporte l’utilisation du déictique semble rendre celui-ci inapte au « ravissement » poétique. Toutefois, à l’encontre de toutes mes mises en garde, dans son commentaire Montaigne lui-même choisit le théâtre comme manifestation de l’attraction de la fureur, tout en déplaçant dans les exemples de l’éloge de Caton, la situation d’énonciation vers la poésie « exégématique ». La situation dramatique équivaut pour Montaigne à la situation ekphrastique ou épidictique. Il ne semble pas y voir de différence.
En d’autres mots, la chaîne Muse – poète – acteur – public se reproduit, dans la sélection du fragment de l’Énéide, sous forme d’une chaîne démonstrative à rebours : Montaigne désigne Virgile qui désigne Caton qui donne des lois aux justes. Montaigne fait ressortir Virgile qui fait ressortir Caton qui lui-même est au-dessus des grands. Le déictique, au cœur de la louange, revêt donc une importance fondamentale : le
commentaire, lorsqu’il se veut épidictique, peut véhiculer en quelque sorte la présence ravissante de l’objet poétique. Il peut aussi annuler l’effet de distance qui semble affaiblir la démonstration, qui fait qu’elle ne se confond jamais avec le dramatique. Non pas : je désigne ce qui ravit, donc il ne ravit plus, et je ne suis plus ravi, mais : je désigne ce qui ravit, et cela n’enlève rien à ce ravissement8.
Finalement, il faut noter une fois de plus la coïncidence entre le geste implicite au déictique et le geste que fait l’objet lui-même. Virgile « démontre » Caton qui désigne ceux qui lui sont inférieurs. L’acte de représenter Caton est déjà présent dans Caton lui-même : mimésis et objet « imité » se confondent, dans la poésie sublime. Caton est aussi présent, voire plus présent, ici chez Virgile qu’il ne l’est parmi les ombres de l’enfer.
Ce qui, naturellement, nous conduit au deuxième exemple de poésie ayant la force du sublime, les vers de Virgile évoquant la séduction de Vulcain par son épouse. Nous passons d’un sublime « bref » à un sublime plus « copieux », mais l’amplification n’empêche point le passage de l’éclair. Le commentaire et les citations sont parmi les plus connus des Essais ; je les cite évidemment en prolongeant les réflexions sur la force du déictique, et sur la confusion entre le sujet de la représentation et la représentation même :
Mais de ce que je m’y entends : les forces & valeur de ce Dieu, se trouvent plus vives & plus animées en la peinture de la poesie, qu’en leur propre essence,
Et versus digitos habet :
Elle represente je ne sçay quel air, plus amoureux que l’amour mesme : Venus n’est pas si belle toute nue, & vive, & haletante, comme elle est icy chez Virgile.
Dixerat, & niveis hinc atque hinc diva lacertis
Cunctantem amplexu molli fovet : Ille repente
Accepit solitam flammam, notusque medullas
Intravit calor, & labefacta per ossa cucurrit.
Non secus atque olim tonitru cum rupta corusco
Ignea rima micans percurrit lumine nimbo :.
ea verba loquutus,
Optatos dedit amplexus, placidumque petivit
Conjugis infusus gremio per membra soporem. (III, 5, p. 849)9
Nous retrouvons, tout d’abord, quelques éléments qui nous permettent de rapprocher l’éloge de Caton et la séduction de Vulcain par Vénus, commentée par Montaigne : la poésie, à son apogée, dans ce qu’elle fait de mieux, réalise une représentation hyper-réelle10, tellement que celle-ci est plus « belle » que la déesse de l’amour « toute nue, et vive, et haletante » (et non pas : « toute nue, vive et haletante » – le rythme de la série d’adjectifs dans cette gradation souligne, marque, ponctue la provocation, en refusant l’énumération par asyndète)11. Donc la mimésis, – et Montaigne se sert ici d’un langage de l’ekphrasis (« vive et animée ») –, réussit étonnamment, paradoxalement.
L’amour donne à la poésie le pouvoir de faire vivre la déesse de l’amour ; toutefois, la poésie ne représente pas vraiment la personne en la décrivant. La beauté de Vénus ne se communique pas par un portrait – les seules informations, dans ce passage précis, concernant l’apparence physique de la déesse sont ses « bras de neige » (« niveis … lacertis »). Le choix de lacertus pour « bras » semble d’ailleurs provenir d’un contexte militaire, plutôt qu’érotique, mais il est vrai qu’ici Vénus soumet son mari. C’est lui qui accepte la « flamme » et qui se laisse pénétrer par une chaleur soudaine semblable à l’éclair qui parcourt les nuages. Les « forces » de l’amour se
manifestent non pas, donc, dans un portrait, mais dans un geste de Vénus (par l’étreinte érotique, « amplexu molli »), et dans l’évocation de l’effet produit par ce geste. La citation de Juvénal qui précède celle de Virgile est révélatrice : « Et versus digitos habet ». « Les doigts » du vers signifie son effet, ce qu’il provoque, et non pas ce qu’il fait voir ou ce qu’il recèle dans sa richesse herméneutique. De même Vénus est « vive » et « haletante » non pas parce qu’elle est belle, parce que ses seins ressemblent à des pommes vertes et ses cheveux à des liens d’or, mais parce qu’elle se sert de ses doigts, ou plutôt de ses bras, dans un geste d’amour. Vénus fait ce que fait la poésie lorsque celle-ci s’inspire de l’amour.
Les « doigts » du vers tout comme les bras de Vénus ne sont pas sans nous rappeler le déictique de Virgile et le geste de Caton. Le sujet de la représentation mime le geste de sa propre « monstration ». Vénus chatouille comme la poésie chatouille, et c’est à travers ce geste qu’elle devient plus vivante que vivante, et que la poésie exprime au mieux les forces de l’amour. Pour Montaigne l’emboîtement des niveaux de la représentation n’affaiblit aucunement la force étonnante de la représentation.
Montaigne ne choisit pas non plus, comme exemple de cette force, les paroles mêmes prononcées par Vénus pour émouvoir Vulcain. Si ces paroles ne relèvent pas vraiment de la poésie d’amour – la déesse fait plutôt appel à sa compassion – Vénus pénètre ses paroles d’un souffle d’amour divin (« dictis divinum adspirat amorem », VIII, 872). Or, ce souffle d’amour est moins important pour Montaigne que le geste qui va suivre. La citation souligne le fait que finies les paroles, nous passons maintenant aux actes : « Dixerat, etc. ». Comme dans le cas de l’éloge de Caton, il s’agit non pas du genre « dramatique » mais d’un passage « exégématique » dans un poème qui, évidemment, est du genre « mixte ». Et cela même si la situation dramatique précédente se serait prêtée à cette chaîne d’inspiration qu’évoque Montaigne avant de citer les éloges de Caton. Le souffle d’amour de Vénus aurait inspiré Virgile qui fait parler Vénus dont les paroles inspirent l’acteur et pour finir, le public. De même, les paroles de Vulcain, déjà vaincu par son amour immortel (« aeterno … devinctus amore », VIII, 394), ne figurent pas dans la citation de Montaigne qui préfère passer directement au geste qu’est l’étreinte de l’époux et à son sommeil tranquille. La symétrie est voyante : « Dixerat » et voici la caresse (« amplexu »), suivi par « Ea verba loquutus » et les caresses de Vulcain (« optatos … amplexus »).
Le passage des paroles aux gestes fait voir, peut-être, la force des paroles : elles sont déjà « inspirées », ou elles sont prononcées, dans le cas de Vulcain, par un homme déjà vaincu par l’amour. Les paroles laisseraient ainsi passer ce souffle de Vénus. Pour obtenir donc que les armes soient forgées par Vulcain, on aurait pu en rester là. Mais les vers choisis par Montaigne ne sont pas, je le répète, les paroles des époux ; plutôt, les vers de Virgile « démontrent » le geste érotique et l’effet fulgurant qu’il provoque : les paroles toutes seules ne seraient-elles pas suffisantes ? Sont-elles même inutiles, par rapport aux pouvoirs du geste de Vénus ? C’est d’ailleurs ce que suggère Vulcain lui-même, en terminant sa réponse à la precatio de son épouse : « … absiste precando / viribus indubitare tuis » (VIII, 403-404) (« cesse, en priant, de douter de tes forces »). Tout doute qui pourrait subsister est effacé par l’effet de la présence et de l’étreinte de Vénus. Ce qui compte est le fait de la monstration, et non pas l’argument. De même, ce qui distingue Caton est le fait qu’il se distingue et non pas le contenu même des leçons qu’il donne aux illustres Romains.
Nous aussi, nous pourrions en rester là. La troisième citation, la plus sublime de toutes, celle qui a inspiré Virgile, car il s’en est souvenu en composant la scène de la séduction de Vénus, ne semble que confirmer cette primauté de l’effet, et des représentations de la force, sur le « sens » de la poésie. Elle suscite le plus long des commentaires de Montaigne, et qui a suscité à son tour les commentaires critiques les plus abondants. Je me limiterai à la citation elle-même et à la courte et abrupte présentation de Montaigne :
Ce que Virgile dict de Venus & de Vulcan, Lucrece l’avoit dict plus sortablement d’une jouissance desrobée, d’elle & de Mars :
belli fera mœnera Mavors
Armipotens regit, in gremium qui sæpe tuum se
Reiicit, æterno devinctus vulnere amoris :
[Atque ita suspiciens tereti cervice reposta]
Pascit amore avidos inhians in te Dea visus,
Eque tuo pendet resupini spiritus ore :
Hunc tu diva tuo recubantem corpore sancto
Circunfusa super, suaveis ex ore loquelas
Funde12 :
Tout d’abord, pour Montaigne, ce que dit Lucrèce est la même chose que dira Virgile après lui. La différence porte uniquement sur le decorum, sur la convenance de la chose par rapport au statut des personnages. En effet, Mars et Vulcain se trouvent tous les deux dans la position passive de l’amant séduit par Vénus, décidément plus puissante que son mari et que le dieu des armes. Si la pénétration du mari par la foudre du désir est absente de la scène évoquée par Lucrèce, Mars est tout aussi passif que Vulcain, offrant son « souffle », son âme, aux lèvres de la déesse. L’abandon amoureux de Mars étendu sous les bras de Vénus précède les paroles de la déesse : alors que chez Virgile les gestes érotiques de Vénus et de Vulcain sont précédés par leurs paroles respectives, chez Lucrèce ce hors-cadre que sont les paroles termine le passage. Dans les deux cas Montaigne a choisi de ne pas les rapporter13. Ce qui accentue encore la gestuelle de la scène, et ici nous retrouvons l’amplexus de Vénus : « tuo … corpore sancto circunfusa », ton corps saint répandu autour de Mars. Comme dans sa sélection du fragment de l’Énéide, Montaigne accentue la situation « exégématique » : nous sommes en présence d’un poète qui nous montre Vénus qui enlace son amant. Ni Vénus ni Mars ne parlent eux-mêmes, même si, comme dans le cas de Virgile, leur amour s’exprime par leur « souffle ». La déesse « inspire » ses paroles (« dictis divinum adspirat amorem ») chez Virgile, et chez Lucrèce le souffle (« spiritus ») de Mars est suspendu aux lèvres de son amante. Tout est donc en place pour une situation amoureuse « dramatique », mais les vers choisis par Montaigne ou bien se situent après le discours direct ou bien s’en abstiennent.
En revanche, la deixis est bien présente dans ces vers. Il s’agit d’une véritable invocation de Vénus, de sa désignation réitérée par le poète. Toi Vénus, tu soumets par tes forces, par ton giron, par ta bouche, et par ton corps, le plus viril des dieux : « in gremium tuum », « in te Dea », « tuo… ore », « tu diva tuo… corpore sancto ». Je désigne celle qui transforme le plus fort en un homme couché, défaillant. Je montre
Vénus donnant ses lois à Mars, comme Virgile montre Caton donnant ses lois aux Grands. Et je ne décris pas le giron, la bouche et le corps, je les désigne, simplement, pour, en revanche, souligner la force avec laquelle l’amour pénètre le dieu des armes. Alors que Virgile avait accordé à Vénus au moins des « bras de neige », chez Lucrèce aucun adjectif descriptif n’embellit le corps de la déesse qui, de toute évidence, n’en a pas besoin. Ses gestes, son étreinte, démontrent sa beauté plus que les épithètes trouvées par le poète.
Ces trois citations, trois instances du « sublime » chez Montaigne, participent, j’espère l’avoir montré, à une isotopie qui est à cheval entre sémantique et procédés rhétoriques : primauté de l’effet sur le sens, une « hyper-réalité » de la fiction fondée sur le déictique ou la « monstration », absorption de la figure du commentateur Montaigne dans une chaîne de démonstratifs, en commençant par le geste représenté dans la fiction elle-même.
Il reste à réfléchir à la pertinence de cette isotopie : quelle valeur a-t-elle ? J’aimerais éviter le recours – d’ailleurs tout à fait justifié – à des raisons « extrapoétiques », à une philosophie sous-jacente, à la composition des Essais elle-même ou à des hypothèses sur la sexualité de Montaigne lui-même14. Il ne s’agirait donc pas d’examiner les fantasmes de l’écrivain, ni d’éclairer les techniques de l’essayiste, à la lumière de son commentaire de la poésie. Mais de comprendre la poésie dans les Essais par rapport à la poésie.
Pour ce faire, il faudrait prendre un peu de recul et revenir au sens des choix de Montaigne. Les trois fragments poétiques « sublimes » proviennent d’une épopée et d’un poème « scientifique » à dimensions épiques. Dans le cas de Caton, le fragment se trouve dans un épisode ekphrastique, une pause pour ainsi dire au milieu des événements guerriers, occasionnée par l’étreinte de Vulcain par Vénus. Caton se trouve représenté sur le bouclier d’Énée, bouclier dont la cause formelle est la séduction de Vénus. Le deuxième fragment virgilien est cette séduction même. Le troisième fragment concerne la passion amoureuse qui soumet
le dieu de la guerre, et qui le rejette en arrière, suspendu aux lèvres de Vénus. À l’intérieur de la poésie, au sens général de la « lyre », ce qui émeut Montaigne surtout, c’est la suspension du temps de la guerre, pour faire place à la force du lyrisme amoureux. Montaigne l’a dit lui-même : « les forces & valeur de ce Dieu [de l’amour], se trouvent plus vives & plus animées en la peinture de la poesie, qu’en leur propre essence ». La poésie d’amour, donc, en plein milieu guerrier. Et d’ailleurs en dépit du commentaire « viril » et militaire qui suit la citation des vers de Lucrèce, commentaire qui signifie un peu le bruit des armes environnant la pause lyrique.
Je reprends donc ma question : quelle pertinence faut-il attribuer à l’isotopie de ces éléments précis du « sublime » ? La réponse, dont je ne formulerai que quelques bribes, est peut-être trop simple, mais elle n’est pas simplement évidente : consciemment ou non, Montaigne a mis en relief la provocation que constitue le lyrisme amoureux après Pétrarque. C’est dire que les plus ravissants fragments poétiques chez Virgile et Lucrèce sont ceux qui mettent en scène, qui « animent », certaines techniques valorisées par le lyrisme pétrarquéen.
Montaigne connaissait bien la poésie lyrique de Pétrarque, contrairement, peut-être, à la Divine comédie de Dante, car nous avons pu repérer son exemplaire du Canzoniere15, et il cite le poète toscan à quelques reprises. Toutefois je précise bien que les scènes de séduction chez Lucrèce et Virgile ne sont pas pétrarquéennes avant la lettre, tout au contraire. Le Canzoniere ne contient que très peu d’allusions à une consommation du désir érotique, même si dans la tradition lyrique qui lui succède, le songe amoureux peut figurer fréquemment dans les recueils. Et que Caton vient-il faire ici ? La connaissance qu’a eue Montaigne de Pétrarque m’importe moins que les transformations du langage lyrique effectuées par Pétrarque, transformations dont les échos se retrouvent, paradoxalement, et par un anachronisme criant, dans ces mises-en-scène lyriques classiques des Essais.
Ces transformations sont multiples ; leur analyse détaillée et toute l’histoire de la poésie les sous-tendant seraient au-delà de mes compétences. Mais j’aimerais en relever quelques-unes, en vue de leur pertinence par rapport à ce que nous venons de constater chez Montaigne :
– la « féminisation » de l’amant, et en l’occurrence, du poète lyrique, son point de départ de victime, de proie, de soumis. L’amant est l’animal chassé, pris : c’est Vulcain qui se trouve enlacé par les bras de son épouse, et c’est lui qui « accepte » la flamme dont la chaleur « entre » dans son corps. De même Mars se trouve défait, en position inférieure, vulnérable par rapport à Vénus l’entourant de ses bras, d’en haut.
– le langage du « ravissement », de la « destruction » de l’amant, par la force de l’amour (« la luce / che m’arde et strugge dentro », Rime sparse, XVIII, 3-4 ; « [il] piacer s’accende / che dolcemente mi consuma et strugge », LXXII, 38-39)16. Les os de Vulcain sont labefacta, « détruits » par la chaleur du désir ; Mars, jeté en arrière, offre le souffle de son âme aux lèvres de son amante. Le commentaire de Montaigne, par le choix des mots qu’il « rumine », et par les observations sur les paroles qui « remplissent » et « ravissent », renforce le contenu de la représentation par le langage interprétatif même.
– la tension exacerbée entre un passé et un présent : à la fois leur différence radicale et dans cette radicalité même, la présence constante d’un passé autre (« esser non può [mon cœur] giamai cosi com’ era », XXI, 8 ; « Lasso, che son ! che fui ! », XXIII, 30)17.
– l’importance relative du déictique, comme garant de la singularité paradoxale de l’objet aimé, et une diminution correspondante de l’éloge copieux (voir toutes les variations sémantiques sur « Tu sola mi piaci », CCV, 8)18.
– la mise en œuvre des moyens « rhétoriques » en faveur de l’effet existentiel du poème, de son effet hic et nunc, sur une existence (et non pas, par exemple, au service d’une finalité universelle).
La thématique est, surtout pour nous – mais pas forcément pour un lecteur du xvie siècle nourri du lyrisme latin –, d’une banalité criante, et je n’ai pas besoin de refaire un chemin que nous connaissons tous trop bien. La représentation du désir comme faiblesse, soumission, proprement impossible à gérer, à maîtriser, détruisant ici et maintenant toute perspective d’un équilibre physico-psychologique chez les plus forts ou les plus assagis (quoique, chez Pétrarque, au début du Canzoniere, une sagesse fragile semble conquise, au prix de la mort de la bien-aimée, et grâce à la vieillesse) : Montaigne est fasciné par la perte de maîtrise qu’implique la poésie et le désir, et il est le premier à le dire lui-même, et à le représenter dans ses choix de poésie « sublime ».
Ce « ravissement » poétique est véhiculé, j’espère l’avoir montré, non pas par le descriptif copieux et par la richesse herméneutique, mais par le démonstratif, par le geste à tous les niveaux de la diégèse. Et c’est à mon sens un des éléments essentiels de la lyrique pétrarquéenne. Je ne pourrai pas, dans l’espace de cette étude, apporter un nombre vraiment suffisant de preuves, et je me contenterai pour conclure, d’une seule parmi tant, sachant à la fois que rien de ce que j’en dis n’est nouveau et que le véritable travail reste à faire.
Tout d’abord il me semble important de souligner la place relativement réduite de la description copieuse représentant Laura dans les Rime sparse. Si les Pétrarquistes multiplient la description, accumulant des métaphores et des détails ornementaux, chez Pétrarque lui-même la présentation de la dame n’est que rarement remplie d’effets de surface, puisés dans la copia verborum19. L’exemple auquel je me limite est une strophe d’une canzone, faisant partie d’un triptyque consacré aux yeux de Laura. Il ne représente pas en lui-même le « ravissement » – la canzone suivante et la vision d’un plaisir proprement béatifique seraient plus aptes20 – mais il met en avant les techniques pertinentes de sa représentation. Les vers sont relativement pauvres, lexicalement, et les épithètes se limitent aux très banales mortal, sereni, beate, et liete :
Dolor, perché mi meni
fuor di camin a dir quel ch’i’ non voglio ?
Sostien’ ch’io vada ove ‘l piacer mi spigne.
Già di voi non mi doglio,
occhi sopra ‘l mortal corso sereni,
né di lui ch’a tal nodo mi distrigne.
Vedete ben quanti color’ depigne
Amor sovente in mezzo del mio volto,
et potrete pensar qual dentro fammi,
là ‘ve dì et notte stammi
adosso, col poder ch’à in voi raccolto,
luci beate et liete
se non che ‘l veder voi stesse v’è tolto ;
ma quante volte a me vi rivolgete,
conoscete in altrui quel che voi siete. (LXXI, 46-60)21
La position absolument faible du poète-amant, mené par la douleur, poussé par le plaisir, lié par le nœud de l’amour, et dominé par l’amour (qui littéralement lui est assis sur le dos, jour et nuit22), est évoquée dans une double apostrophe, désignant d’abord la douleur, ensuite les yeux de la bien-aimée. Leur pouvoir se mesure par leur effet, non pas par la composition de leur beauté elle-même, qui est impossible à décrire, car « au-dessus du mouvement humain », tels les étoiles et les dieux. Les yeux se connaissent eux-mêmes dans autrui : « conoscete in altrui quel che voi siete ». Primauté, donc, de l’effet, de la réception, sur les éléments de la beauté elle-même. Les yeux ne sont pas beaux grâce à leur harmonie, incarnation de l’harmonie céleste, à la lumière, expression d’un soleil tout aussi lumineux, mais grâce à une puissance qui « détruit »… Lorsqu’il est question de représentation, par les
« couleurs » peintes par Amour, elles ne dépeignent pas les yeux de la dame mais le visage de l’amant, elles signifient les yeux à travers les effets qu’ils produisent dans le poète-amant. Les « couleurs » de la rhétorique se déploient uniquement par reflet. Elles sont indiquées, et non pas présentées. Comme on ne peut que s’imaginer l’effet que les yeux lui font – « potrete pensar qual dentro fammi » ; on ne peut pas le dire. « Elles [les paroles] signifient plus qu’elles ne disent » (Montaigne, III.5, p. 873)23.
Les formes verbales à la deuxième personne du pluriel, qu’elles soient à l’impératif, au futur ou au présent – vedete, potrete, rivolgete, conoscete – et les formes pronominales de la deuxième personne – voi (quatre fois), vi (deux fois) – rappellent l’apostrophe insistante de Vénus (« in te Dea… tu diva… ») dans la citation de Lucrèce par Montaigne. De même, le déictique et non pas le descriptif évoque le cœur de l’amant, ravagé par le désir : « et potrete pensar qual dentro fammi, / là ‘ve dì et notte stammi / adosso » (v. 54-56). Priorité absolue, donc, de l’indication sur la description.
Finalement, une dernière manifestation de cette primauté de l’effet : les vers que je viens de citer, « et potrete pensar qual dentro fammi, / là ‘ve dì et notte stammi / adosso », contiennent une contraction, « fammi » pour « fa a me » (« [Amour] me fait »). « Fammi », par paronomase, suggère « fiamme », les flammes qui détruisent le cœur. Mais précisément, la poésie est ici indication, monstration, démonstration, et non pas représentation. On voit qu’elle fait, et les flammes sont ce faire. La poésie se limite au geste et elle est d’autant plus forte qu’elle s’y limite. « Caton donne ses lois à ceux-ci », mais non pas : « Caton est plus sage que les grands ».
La priorité du geste – dans l’apostrophe, dans la monstration, dans les divers éléments du langage démonstratif – rejoint, me semble-t-il, cette insistance dans la poésie pétrarquéenne sur la tension existentielle, sur la visée du « ici et maintenant », même sous la perspective d’une sublimation finale du désir. Les apostrophes aux yeux de Laura, « vedete…vi rivolgete…conoscete », concernent tout aussi bien le poète énonciateur (« je parle à vous ») que le lecteur : regardez ce qu’Amour me fait24 ! En
désignant, tout simplement, le poète fait participer le lecteur à l’effet du désir. « Et versus digitos habet » comme le dirait Montaigne. La lyrique pétrarquéenne est ainsi une poésie des plus intenses mettant en scène la faiblesse. En cela elle correspond au « sublime » des moments lyriques que Montaigne découvre au milieu du bruit des armes.
Ullrich Langer
University of Wisconsin, Madison
1 « Montaigne et le sublime dans les Essais », in éds. John O’Brien, Malcolm Quainton, James J. Supple, Montaigne et la rhétorique, Paris, Champion, 1995, p. 27-48, et surtout p. 42-47. La relative banalité des propos du pseudo-Longin est soulignée par Francis Goyet, dans son introduction à son éd. du Traité du sublime, Paris, Librairie générale française, 1995, p. 5-60. Je remercie Jan Miernowski de ses commentaires toujours judicieux sur une première version de mon texte. J’ai également profité des différents points de vue exprimés au cours du débat suivant mon intervention, au cours de l’assemblée générale de la SIAM, en janvier 2012.
2 Quand « les poètes feignent » : « Fantasie » et fiction dans les Essais de Montaigne, Paris, Champion, 2002, surtout p. 95-124. Voir aussi, pour une interprétation divergente du chapitre « Du jeune Caton », David L. Sedley, Sublimity and Skepticism in Montaigne and Milton, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2005, p. 58-71 (Montaigne, par un geste sceptique, supprimerait toute possibilité d’apprécier la « grandeur » de Caton).
3 Words in a Corner : Studies in Montaigne’s Latin Quotations, Lexington, French Forum Publishers, 1981, surtout p. 78-94.
4 À moins d’indication contraire, les citations des Essais renvoient à l’éd. Pierre Villey, Verdun-L. Saulnier, Paris, Presses universitaires de France, 1965.
5 Sur toute la question du rapport entre le langage juridique, le jugement esthétique, l’éthique et la composition des Essais, y compris dans ce vers, voir de toute évidence les travaux indispensables d’André Tournon.
6 La question de la connaissance de Dante par Montaigne reste, pourtant, controversée : les citations de la Divine comédie pourraient être de seconde main (Stefano Guazzo et Benedetto Varchi), et il subsiste des doutes sur la présence d’un exemplaire (l’édition 1571 chez Rouillé à Lyon) dans la bibliothèque de Montaigne. Voir récemment sur le sujet Concetta Cavallini, L’Italianisme de Michel de Montaigne, Fasano, Schena, 2003, p. 42 et 220-221.
7 L’Énéide, en tant qu’épopée, appartient bien sûr au genre « mixte », car Virgile fera aussi parler ses personnages. L’ekphrasis du bouclier d’Énée, prise séparément, est un récit « exégématique », comme les Géorgiques. Sur Josse Bade et l’influence de sa typologie au xvie siècle, voir Jean-Charles Monferran, L’École des muses : les arts poétiques à la Renaissance (1548-1610), Genève, Droz, 2011, p. 142-143 n. 98.
8 Je rejoins ici l’analyse d’Olivier Guerrier : « À la chaîne des réactions de l’Ion se substitue une chaîne d’un nouveau genre, qui installe le jeune homme [“l’enfant bien nourry” mentionné par Montaigne] en lecteur-modèle des fragments choisis par un écrivain frappé lui-même par leur pouvoir. Communion dans l’effet poétique requise par le privilège accordé à l’interprétation, qui nous entraîne loin des situations magistrales de l’éloquence puisqu’elle implique un assentiment, une compréhension du jugement porté sur les vers, décelable dans leur enregistrement » (Quand « les poètes feignent »…, op. cit., p. 118). Cette chaîne « interprétative » est déjà, à mon sens, préfigurée dans la citation poétique elle-même.
9 « Elle avait parlé, et, avec une douce étreinte de ses bras de neige tout autour de lui, la déesse réchauffe celui qui hésite. Lui tout à coup accepta la flamme accoutumée, et une chaleur connue entra dans sa moelle et courut à travers ses os secoués. Non autrement que parfois, avec le tonnerre agité, un éclair éclatant, brillant de feu, parcourt les nuages avec sa lumière. (…) Ayant dit ces paroles, il donna les étreintes souhaitées, et chercha dans ses membres le tranquille sommeil, couché dans le giron de son épouse » (VIII, 387-392, 404-405 ; je traduis très littéralement). J’ai corrigé la ponctuation de Villey, à partir de l’exemplaire de Bordeaux (facsimile en quadrichromie, Fasano, Schena, 2002).
10 Comme le formule Marc Fumaroli, « Le sublime abolit la béance entre présence et représentation », cité par Magnien, « Montaigne et le sublime », art. cit., p. 29. Dans le cas précis des histoires où figurent de belles héroïnes, Plutarque nous avait déjà rappelé les attraits supérieurs de la fiction, préférable à la présence des plus belles femmes (Non posse suaviter vivi secundum Epicurum, 1093C).
11 Un bel exemple de ce style « coupé » mis en évidence par la scansion montaignienne de sa propre prose : voir André Tournon, « L’énergie du “langage coupé’” et la censure éditoriale », in Montaigne et la rhétorique, op. cit., p. 117-133.
12 III.5, p. 872. « Mars, le maître des armes, préside aux tâches cruelles des combats ; mais souvent il vient sur ton sein et s’abandonne, sous l’emprise de l’éternelle blessure d’amour : [Et, regardant ainsi de bas en haut, la nuque élégante rejetée en arrière,] il repaît d’amour ses regards avides, Déesse, dans son désir de toi, et renversé en arrière, il suspend son souffle à tes lèvres ; tandis qu’il repose sous toi, Déesse, enlace-le, couvre-le de ton corps sacré et laisse de douces plaintes échapper de tes lèvres » (trad. Maryse Tournon). J’ai restitué la ponctuation de l’exemplaire de Bordeaux, et le vers que Montaigne a supprimé de la citation (De natura rerum, I,33-41).
13 Ni Lucrèce non plus, préférant la présentation indirecte : « petens placidam Romanis… pacem » (I, 41).
14 À l’instar d’Elisabeth Joly, « ‘Une jouissance desrobée’ : une érotique des Essais de Montaigne », Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, VII, 27-28 (2002), p. 47-59, et en particulier, p. 50-52 sur Virgile et Lucrèce. Elle prend la relève, d’ailleurs, de Floyd Gray et de Terence Cave qui remarquèrent eux aussi la « sexualisation » du langage du commentaire poétique suivant la citation de Lucrèce dans III.5.
15 Voir Cavallini, L’Italianisme de Michel de Montaigne, op. cit., p. 61.
16 Je cite l’édition de Marco Santagata, Milan, Mondadori, 2004 (1e édition 1996). Le « ravissement » de l’amant par (le regard de) la dame n’est évidemment point autrement absent de la poésie latine : voir Ovide, Ars amatoria, I.243 : « Illic [lorsque les hommes ont bu trop de vin] saepe animos iuvenum rapuere puellae ». Pourtant, la scène et les modes de l’énoncé sont totalement différents.
17 Formule qui rappelle, selon Santagata, Ovide, Métamorphoses, II, 551 : « quid fuerim quid simque vide ». Chez Ovide, toutefois, il s’agit d’un changement concret de couleur d’un oiseau, grâce à sa trahison.
18 Ce qui reprend mais transforme profondément le sens du vers latin « Tu mihi sola places » (Tibulle, III.xix.3, Properce, Elégies, II.vii.19, et Ovide, Ars amatoria, I.42), utilisé comme instrument – tout provisoire – de séduction.
19 On peut citer le sonnet CLVII (« Quel sempre acerbo et onorato giorno… »), et surtout les tercets : « La testa or fino, et calda neve il volto, / ebeno i cigli, et gli occhi eran due stelle », etc. La variété descriptive concerne le plus souvent les éléments et phénomènes naturels, reflets du trouble affectif ou contexte de la rencontre ou contexte de la vision de Laura, et les diverses fables qui enrichissent le sens que peut avoir l’amour du poète.
20 Le célèbre « Vaghe faville, angeliche, beatrici / de la mia vita, ove ‘l piacer s’accende / che dolcemente mi consuma et strugge, etc. » (LXXII, 37-45).
21 « Douleur, pourquoi donc m’entraîner / hors de ma voie pour dire ce que je ne veux pas ? / Souffre que je m’en aille où [le plaisir] me pousse. / Certes, ce n’est de vous que je me plains, / yeux sereins au-delà de mortelle mesure, / ni de celui qui par un tel nœud me lia. / Regardez ces couleurs si nombreuses que peint / Amour souvent sur mon visage, / et pourrez concevoir quel me fait au-dedans, / où jour et nuit il ne me lâche, / fort du pouvoir qu’il a [recueilli dans vous], / bienheureuses lumières joyeuses / à qui ne manque que pouvoir vous contempler. / Mais chaque fois que devers moi vous vous tournez, / chez autrui apprenez tout ce qu’êtes vous-même[s] », trad. Pierre Blanc, Paris, Bordas, 1988, p. 161, j’ai modifié la traduction pour la rendre plus littérale.
22 Santagata souligne les multiples sources de cette image (éd. cit., p. 367) ; chez Dante, surtout : « E’ m’ha percosso in terra e stammi sopra » (« Così nel mio parlar… », 35), ce qui rappelle très précisément la situation de Mars, renversé en arrière, dominé par Vénus.
23 Citation de Quintilien (Institutio oratoria, VIII.3.83), commentée par Gisèle Mathieu-Castellani, Montaigne ou la vérité du mensonge, Genève, Droz, 2000, p. 52-53.
24 Ce qu’a bien compris Ronsard, dans les Amours de 1552 (« Qui voudra voir… », I,1).