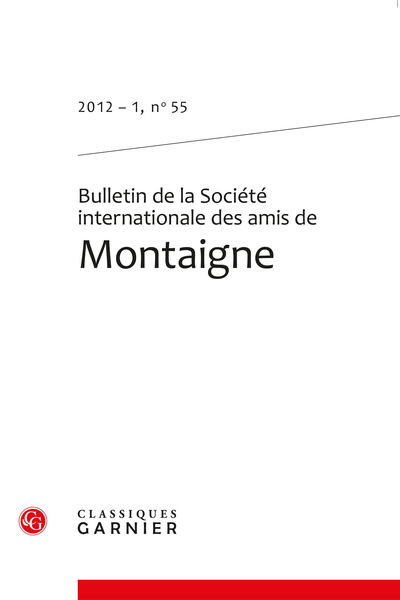
Montaigne. Être, croire, construire
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 1, n° 55. varia - Author: Benmakhlouf (Ali)
- Pages: 23 to 36
- Journal: Bulletin for the International Society of Friends of Montaigne
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782812439766
- ISBN: 978-2-8124-3976-6
- ISSN: 2261-897X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-3976-6.p.0023
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 07-25-2012
- Periodicity: Biannual
- Language: French
Montaigne
Être, croire, construire
Être et devenir
L’apologie de Raymond Sebond se clôt sur ce que certains comme Albert Thibaudet ont appelé le mobilisme de Montaigne : Lucrèce et Héraclite sont une référence appuyée en la fin de ce chapitre 12 du livre II des Essais. « Nous n’avons aucune communication à l’être » (II, 12, 601) pour la simple raison que nous ne cessons de nous remuer : « Pendant que nous nous remuons, nous nous portons par préoccupation où il nous plaît : mais étant hors de l’être nous n’avons aucune communication avec ce qui est » (I, III, 17).
L’être : ce mot si général qu’aucune signification appropriée ne peut lui être accordée par celui qui a fait du mot « distingo » le « plus universel membre » de sa logique. Le contexte cependant où intervient ce passage indique que Montaigne l’oppose au devenir et non au non être. Il prend appui sur les présocratiques pour inscrire la nature humaine dans le changement, le devenir, la métamorphose même. L’homme n’est pas être car il est devenir, passage, et Montaigne se plaît à dire qu’il ne peint pas l’être mais le passage (III, II, 805). L’homme n’est pas un être qui devient, c’est un devenir qui prend des allures d’être, quand il va sur « un seul train ». Autrement dit, être c’est ne plus avoir la capacité de devenir, de mettre son âme à plusieurs étages, en somme, de vivre. L’être indique l’inertie, la conservation et non l’épanouissement.
Comme l’homme est « milieu entre le naître et le mourir », il ne subsiste pas, il est passage. Le philosophe américain Quine avait indiqué qu’il n’y a pas d’entité sans identité, ni d’identité sans entité. C’est aussi en cette façon logique de poser les choses que Montaigne souligne que ce qui a mutation « ne demeure pas un même, et s’il n’est pas un même, il n’est
donc pas aussi » : donc pas d’entité s’il n’y a pas d’identité, « l’être devenant toujours autre d’un autre » (603). Ni identité donc, ni même ressemblance car celle-ci ne « fait pas tant un que la différence fait autre » (III, 13, 1065).
Pas d’entité sans identité, mais aussi pas d’identité s’il n’y a pas d’entité. L’être véritable est celui qui est le même, échappant à toute mesure du temps. Dieu a ce privilège et c’est bien à lui que nous n’avons aucune communication. De même qu’il ne convient de ne témoigner de gloire qu’à Dieu, de même, il ne convient de parler d’être que pour Dieu qui en tant qu’entité pérenne n’a pas besoin d’être signifiée. Le versant sémantique de cette non communication à l’être consiste en l’absence d’une correspondance entre le nom et la chose. Nom et chose sont dans un rapport tout extérieur l’un à l’autre, conventionnel : « Il y a le nom et la chose : le nom, c’est une voix qui remarque et signifie la chose ; le nom, ce n’est pas une partie de la chose ni de la substance, c’est une pièce étrangère jointe à la chose et hors d’elle » (II, 16, 618).
Il faudrait être au-dessus de la condition humaine pour prétendre à une communication avec le divin ou une participation à lui, ce qui n’est possible que par une « grâce divine » qui réaliserait en nous « une divine et miraculeuse métamorphose » : l’homme « s’élèvera si Dieu lui prête extraordinairement la main ; il s’élèvera abandonnant et renonçant à ses propres moyens, et se laissant hausser et soulever par des moyens purement célestes » (II, 12, 604). En l’absence de cette « miraculeuse métamorphose », nous sommes pris dans les métamorphoses ordinaires qui sont suffisamment fortes pour nous donner de quoi les étudier, si nous étions bons écoliers de nous-mêmes, c’est-à-dire du changement.
Construction étagée versus être
À supposer que la grâce divine opère, à supposer un homme conçu, qui soit « accompagné d’omnipotence » (III, 7, 919), « il faut qu’il vous demande de l’empêchement et de la résistance » tant son « être et son bien est en indigence » (idem). L’homme est en défaut de lui-même, « chacun fuit à le voir naître, chacun suit à le voir mourir » (III, 5, 878), car « nous estimons à vice notre être » (879). « Quel monstrueux animal qui se fait
horreur à soi-même, à qui ses plaisirs pèsent ; qui se tient à malheur ! » (879). L’homme est cette espèce singulière qui a la détestation d’elle-même.
L’être s’oppose au changement, par là-même il s’oppose aussi à la vie et à la variété. Hormis Dieu, dont l’immutabilité est puissance, les autres êtres ne sont « êtres » que de façon inertielle, par instinct de conservation du même, qui est une autre façon de nier la vie : « notre principale suffisance c’est savoir s’appliquer à divers usages. C’est être, ce n’est pas vivre, que se tenir attaché et obligé par nécessité à un seul train » (III, 3, 818). Hors de l’être, dans la variété des usages, l’homme est construction, bâtiment « à divers étages qui sache et se tendre et se démonter » (III, 3, 821), qui sache parler aux riches comme aux pauvres, aux métaphysiciens comme aux cuisiniers. Le thébain Epaminondas, excellent homme selon Montaigne, est une « âme de riche composition » : il fait la guerre mais y met de la civilité en lui faisant « souffrir le mors de la bénignité » (III, 1, 801). La construction de soi suppose une grande variété d’humeurs dont le pendant politique est de ne pas tuer l’ami ou l’hôte qui se trouvent combattre dans l’armée ennemie, de réduire « la disparité entre les valets et les maîtres », dès lors que, souples dans leurs dispositions, les hommes entretiennent commerce avec tous leurs semblables quelles que soient leurs conditions. Les bonnes polices sont d’ailleurs celles qui réduisent les inégalités entre les hommes et le signe de cette réduction des inégalités est la possibilité d’une communication entre personnes de condition sociale disparate.
La variété des usages, la possibilité d’aller d’un usage à un autre se révèle être un moteur de vie dans les cas où le deuil nous frappe. Faire son deuil, ce n’est pas approfondir une même pensée, celle de l’être aimé, c’est être capable de penser à autre chose tout en sachant que si la pensée de l’être aimé revient, elle s’accompagnera d’une vive douleur comme au premier jour de sa perte. « Un sage ne voit guère moins son ami mourant au bout de vingt et cinq ans qu’au premier an » (III, 4, 836) mais il faut bien reconnaître que « toujours la variation soulage, dissout et dissipe » (III, 4, 836). La diversion, loin d’être une façon d’échapper à soi, est un jeu subtil de construction d’une distance de soi avec soi pour se guérir de ses souffrances, de ses deuils.
Croyance, fortune, providence
À la grâce divine, nous n’avons pas accès par les moyens naturels qui nous sont dévolus comme l’humaine raison par exemple. Quand notre croyance prétend aller au-delà et percer les mystères divins, elle se fourvoie. Croire ce n’est pas conforter les fondements divins par un credo relatif aux événements humains. Ceux qui invoquent la providence pour expliquer les phénomènes humains font une double erreur :
1) D’une part, ils affaiblissent ce qu’ils prétendent renforcer car à vouloir « appuyer notre religion par le bonheur et prospérité de [leurs] entreprises », ils en viennent à ébranler notre foi en la rendant tributaire d’événements qui tantôt succèdent, tantôt non, car que dirions-nous quand les événements nous sont « désavantageux » ? De fait « notre créance a assez d’autres fondements sans l’autoriser par les événements » (I, 32, 216). Montaigne critique ceux qui à la suite de la bataille de Lépante en 1571, bataille qui a permis une victoire sur les Turcs, se sont dit que la providence avait montré son doigt bienveillant à l’égard des catholiques : « C’est une belle bataille navale qui s’est gagnée ces mois passés contre les Turcs, sous la conduite de Don Joan d’Austria, mais il a bien plu à Dieu en faire autrefois voir d’autres telles à nos dépens » (I, 32, 216). La reconnaissance de la contingence des choses de la guerre–comme l’avait bien indiqué Aristote dans le chapitre ix de son De Interpretatione– ne souligne ni la bienveillance de Dieu, ni la nécessité dans les choses.
2) Ils oublient combien Dieu en sa pré ordonnance des choses a pourvu aussi à des causes fortuites, c’est-à-dire celles qui président à la contingence et laissent l’homme libre de faillir. On peut donc dire que c’est Dieu qui libère l’homme de la nécessité, au lieu de l’enfermer dans un fatum quelconque : « Ce que nous voyons advenir advient ; mais il pouvait autrement advenir, et Dieu au registre des causes des événements qu’il a sa prescience, y a aussi celles que l’on appelle fortuites, et les volontaires, qui dépendent de la liberté qu’il a donnée à notre arbitrage, et sait que nous faillirons parce que nous aurons voulu faillir » (II, 29, 709). La fortune n’est pas une autre façon de parler de la providence. D’elle-même, elle est neutre : « la fortune ne nous fait ni bien, ni mal ; elle nous en offre seulement la matière et la semence, laquelle notre
âme plus puissante qu’elle, tourne et applique comme il lui plaît, seule cause et maîtresse de sa condition heureuse ou malheureuse » (I, 14, 67).
Il y a plusieurs façons de crisper la croyance humaine :
1) en prenant pour elle un objet qui n’est pas à sa mesure comme la providence divine ;
2) en l’enfermant dans la dualité du pour ou du contre, alors que bien souvent une tierce possibilité est à envisager. Dans l’opposition entre Copernic et Ptolémée il y a peut-être une « tierce opinion » (II, 12, 570) qui viendra renverser les deux. Montaigne utilise l’argument de la tierce possibilité également dans la confrontation religieuse entre les catholiques et les protestants. L’imagination d’une troisième voie permet de mettre à distance la réalité d’une dualité douloureuse. Elle décrispe la croyance sans l’annuler en la portant à une forme de considération de son objet sans l’aspect pathologique de la conviction non étayée de preuves.
3) en faisant précéder nos observations et nos expériences de nos croyances. Notre parler doit être tout en devis et non en avis. Tout ce que l’on dit n’est pas dit pour être cru : « Je ne serais pas si hardi de parler s’il m’appartenait d’en être cru » (III, 11, 1033). Le devis consiste à exposer les points de vue contradictoires pour « éclaircir » le jugement non pour « l’obliger » (III, 11 ; 1033).
4) l’expression « Comme on dit » (723) consacre cette dissociation entre dire et croire : on présente une idée à considérer, non pas à croire. C’est ce que fait Plutarque qui n’est pas compris quand il est rapporté à nos croyances, et qui est instructif quand on le lit pour aiguiser notre jugement.
La méthode d’histoire :
enregistrer la matière brute
Plutarque n’est pas « incroyable » car les histoires qu’il raconte ne sont pas objets de croyance mais de réflexion. Avant qu’une hypothèse ne soit soumise à la croyance, elle est d’abord simplement considérée. Tacite de même raconte des histoires avec la liberté que n’a ni le théologien ni le philosophe, qui sont des « directeurs de conscience » (III, 8, 943).
Plutarque nous apprend à ne pas assujettir le récit à notre jugement. Même quand il fait ses parallèles en relatant la vie des hommes illustres, il « apparie » certes les pièces mais il les juge séparément (II, 23, 727). Parmi les histoires à raconter, il y a non seulement « les événements d’importance », mais aussi « les bruits et opinions populaires », qui ne sont pas proposées à nos croyances : « A la vérité, j’en rapporte plus que je n’en crois, car je ne puis ni affirmer ce dont je doute, ni supprimer ce que m’a transmis la tradition » dit Quinte-curce, cité en III, 8, 942. Montaigne change notre regard sur la tradition : ce n’est pas quelque chose qu’il faut croire, mais c’est une autorité à prendre en compte, dont on tire « registre », comme d’un « événement » historique. La tradition entre dans le champ de l’histoire et devient un « fait » parmi d’autres faits. Il faut se défendre d’altérer « jusqu’aux plus légères et inutiles circonstances » (I, 21, 106) laissant aux autres de juger la matière brute que l’historien se contente de rapporter.
L’histoire pluralise les voix du passé, mais n’en présente aucune à notre croyance. Elle fait passer ainsi la tradition de la norme au fait, ou encore, de la parole reprise à son compte à la parole citée : « comme on dit ».
Aussi Bodin se trompe quand il considère que dans sa « méthode d’histoire » (II, 23, 722) entre ce qui est cru, que ce soit plausible ou incroyable. Plutarque lui semble « incroyable », mais en réalité, il le serait s’il ne multipliait pas les perspectives, les façons de voir, s’il ne récitait pas « diversement même histoire » (II, 23, 722), s’il ne faisait pas de l’histoire une myriade de voix diversement considérées. Plus l’histoire est multiple, plus elle aide à former le jugement, elle est alors une « anatomie de la philosophie » (I, 26, 156), même si, comme le reconnaissait Aristote, elle est si difficile d’usage pour un philosophe. Ainsi, par exemple, à propos du roi de Sparte, Plutarque dit aussi bien de lui qu’« il ne saurait être bon, puisqu’il n’est pas mauvais aux méchants », que : « Il faut bien qu’il soit bon puisqu’il l’est aux méchants même » (III, 12, 1063). Plutarque parle donc « diversement et contrairement », nous laissant faire notre opinion dans cette valse hésitation, cet équilibre entre opinions contraires. Autre application utile de la méthode d’histoire de Plutarque et que Montaigne met à profit : croire et concevoir « mille contraires façons de vie » (I, 37, 229).
Jamais la devise de Montaigne : je m’abstiens, c’est-à-dire, je me tiens en équilibre n’aura eu meilleure illustration qu’en cette méthode d’histoire
initiée par Plutarque. Par lui, nous apprenons le pouvoir de la fortune et des causes fortuites car nous présentant les faits sous divers aspects, Plutarque nous indique comment fait la fortune puisque « l’inconstance du branle divers de la fortune fait qu’elle nous doive présenter toute espèce de visages » (I, 34, 220), aussi ne nous précipitons pas à pencher d’un côté et examinons toujours.
Le rare et l’inusité : sortir de la croyance
Quand Plutarque récite quelque chose d’incroyable, il le met au crédit du transmis, non du cru, et ajoute « comme on dit » afin de « nous avertir et tenir en bride notre créance » (II, 23, 723). Montaigne nous propose un changement de catégorie : faire basculer l’incroyable de la modalité du croire à la factualité du « rare », de « l’étrange » et de l’infinie variété des choses. Ce n’est pas parce qu’on ne parvient pas à comparer le rare, à mettre en raison et en comparaison l’étrange, que le rare et l’étrange doivent être dits incroyables. D’un côté, abandonnons les similitudes supposées pour donner plein crédit aux dissemblances réelles, d’un autre côté, face aux faits les plus extraordinaires ou encore monstrueux, imaginons les relations qui les inscriraient dans un ordre du monde que nous ne connaissons pas encore.
Montaigne considère que la méthode d’histoire se rapporte à ce qui est advenu ou peut advenir, c’est-à-dire au possible, au contingent, au fortuit, à ce qui est soumis à la fortune. Mais il y a loin du possible au croyable : « Il ne faut pas juger ce qui est possible et ce qui ne l’est pas selon ce qui est croyable et incroyable à nos sens » (II, 23, 725). Il y a la mesure de nos sens et celle de nos actions qui en dérivent : aussi pensons-nous difficile de croire ce que nous ne savons pas faire : « et est une grande faute en laquelle la plupart des hommes tombent (ce que je ne dis pas pour Bodin) de faire difficulté de croire d’autrui ce qu’eux ne sauraient faire » (II, 23, 723). L’expédient que les hommes trouvent pour limiter l’action de leurs semblables est de la dire impossible et incroyable.
Montaigne n’est pas un pré cartésien en sa méthode car il refuse d’assimiler le non vraisemblable, et a fortiori le vraisemblable, au faux
et pense que c’est orgueil et outrecuidance de se « donner l’avantage d’avoir dans la tête les bornes et limites de la volonté de Dieu et de la puissance de notre mère nature » (I, 27, 179). Il s’agit ni d’être dans la « facilité de croire » comme le sont les enfants, ni dans la « sotte présomption » de ne rien croire ou de rejeter pour faux et impossible les « sorcelleries », « les enchantements », et « les pronostics des choses futures » (I, 27, 179). Mieux vaut inscrire dans la catégorie de l’étrange ce qu’on ne parvient pas à authentifier, et laisser en suspens les choses présentées ainsi à la croyance.
Certes il arrive qu’on nous raconte des choses « peu vraisemblables » mais de là à les juger impossibles, il y a un pas qu’il faut se garder de franchir, vu que la connaissance ne cesse de transgresser les bornes du possible, et que notre humaine condition est dans l’ignorance de ce qui est vraiment possible. À Alice qui ne cesse de dire : « Mais c’est impossible ! », la reine, dans le célèbre conte de Lewis Carroll, répond : « Je vois que vous ne vous êtes pas assez exercée ». De même nous sommes dans l’ignorance de la limite entre « l’impossible et l’inusité » (I, 27,180). Montaigne nous fait quitter le domaine du cru et du non cru pour nous porter vers ce dont nous avons usage et vers l’étrange qui, avec le temps et les progrès de la connaissance, devient familier. C’est un naturalisme exacerbé, doublé d’un essentialisme qui nous pousse à juger qu’une chose est impossible et par conséquent digne de n’être pas cru : « Nous appelons contre nature ce qui advient contre la coutume » (II, 30, 713). Mais nous sommes bien souvent « obligés d’abandonner » notre croyance qui, « d’article de foi » passe à l’état de « fable » (I, 27, 182), simplement parce que nous n’avons pas laisser leur chance à la conception et à la possibilité.
La dualité du vrai et du faux n’est pas remise en cause par Montaigne, mais ce qui est remis en cause c’est la capacité humaine à tracer distinctement la limite entre ces deux valeurs de vérité. Il se trouve que chaque limite posée par l’homme est soumise à transgression car la connaissance ne cesse de réduire l’étrange pour le rendre familier, or l’étrange, c’est ce que nous déclarons communément faux quant au jugement à son sujet et impossible quant à sa réalité.
Il y a des situations où nous sommes embarrassés et ballottés par nos croyances : vivre caché ou en pleine lumière ? « Nous sommes, je ne sais comment, doubles en nous-mêmes, qui fait que ce que nous
croyons nous ne le croyons pas, et nous pouvons nous défaire de que nous condamnons » (II, 16, 619). Non seulement comme le dit le titre de l’essai 38 du livre 1, nous rions et pleurons des mêmes choses, mais nous sommes suffisamment dissociés de nous-mêmes pour adhérer et ne pas adhérer à une même chose. Est-ce jeu d’apparences diverses qui nous met tantôt dans l’une, tantôt dans l’autre ? Nous sommes tout entier à la cérémonie et « laissons la substance des choses » (II, 17, 632) : « La cérémonie nous défend d’exprimer par paroles les choses licites et naturelles, et nous l’en croyons ; la raison nous défend de n’en faire point (d’en faire) d’illicites et mauvaises, et personne ne l’en croit » (II,17, 632). Résumons : nous sommes dissociés de nous-mêmes et nous passons facilement d’un contraire à un autre. Par ailleurs, la raison par sa nature est séparatrice et en tant que telle démobilisatrice puisque nous ne parvenons pas à faire ce qu’elle nous recommande de faire. Du coup nous sommes entièrement à la cérémonie. Cela facilite une disposition à la crédulité.
Crédulité
La crédulité se nourrit de la persuasion immédiate qui fait que le plus éloigné des faits y adhère plus facilement : « De manière que le plus éloigné témoin en est mieux instruit que le plus voisin, et le dernier informé mieux persuadé que le premier » (III, 11, 1029). La construction des miracles consiste d’abord en une construction de la manière de croire. Persuasion immédiate et justice expéditive font la réussite des sorcières qui sont moins liées au crime que prisonnières d’une folie ; c’est pourquoi les juges « se vengent » sur les accusés de leur propre « sottise » (III, 11, 1030) en expédiant les affaires de sorcières.
S’il y a du rare et de l’extraordinaire, il n’est pas dans les miracles supposés des sorcières ou des faiseurs de tours, il est d’abord en nous : « Je n’ai vu monstre et miracle plus expres que moi-même » (III, 11, 1029). Les tours de prestidigitation ne sont pas des illusions venues « du dehors » mais des illusions « domestiques et nôtres » (III, 11, 1032). C’est ainsi que nos rêves et nos cauchemars nous portent à agir d’une façon que notre
propre raison ne peut que désavouer : se tuer parce qu’on a imaginé par les hurlements de son chien un danger fictif, tuer son frère parce qu’on a rêvé qu’il devient roi à notre place. Voilà des exemples qui font de nous des sorciers de nous-mêmes. C’est ainsi que « nos raisons anticipent souvent l’effet » (III, 11, 1034) et nous font imaginer des causes « fortes et pesantes » quand elles ne sont parfois que « frivoles » (1029). Comme les causes « échappent de notre vue par leur petitesse », nous sommes portés à les rechercher ailleurs. Imaginer des causes, se faire « plaisant causeur » de « cent autres mondes », c’est substituer à l’ordre des choses l’ordre de notre imagination. Même s’il pleut pendant que je rêve qu’il pleut, mon rêve reste un rêve et ne dit pas la réalité soulignait Wittgenstein. Même si le feu prend dans la chambre de mon fils et que je rêve cela, mon rêve reste une suite de choses imaginées : nous avons « une invention à forger des raisons à toutes sortes de songes » (III, 11, 1034). Hormis les prophètes, les autres hommes ne « voient » les choses que dans leur « sommeil » ou en raison d’une « maladie » quelconque (II, II, 348).
Construire sans fonder
Les Essais sont un livre « maçonné » des « dépouilles » (721) de Sénèque et de Plutarque. « Allongeail », « marqueterie », « fagotage de tant de diverses pièces » (II, 37, 758) : ce lexique est celui de la construction patiente et de l’ajout qui n’est jamais une correction, du savoir si bien tissé et cousu qu’on ne voit plus par où le fil est passé. Les cités dans lesquelles nous vivons sont elles aussi des bâtiments faits de pièces diverses mais si bien jointes qu’il est difficile de changer une pièce sans toucher à l’ensemble : « Une police est comme un bâtiment de diverses pièces jointes ensemble, d’une telle liaison, qu’il est impossible d’en ébranler une que tout le corps ne s’en sente » (I, 23, 119).
La métaphore architecturale parcourt l’œuvre de Montaigne, mais elle n’est jamais au service d’une problématique des fondations ou du fondement. Bâtir, construire, « maçonner » c’est bien plus rapiécer que fonder, et c’est sans cesse être menacé de construire sur du sable. Montaigne utilise beaucoup le verbe « forger » au sens de construire :
on peut cependant « bâtir aussi sur le vide que sur le plein » (III, 11, 1027) et croire être bien adossé à un mur quand il ne s’agit que d’une « muraille sans pierre » (III, 2, 805), d’une instruction qui fait fi de la science parce qu’elle n’est que de la cuistrerie apprise dans les écoles de la « parlerie ». Montaigne préfère parler « d’exercitation » que d’instruction, insistant ainsi sur le travail à accomplir sans cesse. Il y a une flexibilité de notre invention à « forger des raisons à toutes sortes de songes » (III,11,1034). Mais pour limiter cette propension à construire sur du vide, Montaigne se met à l’école des faits et préfère demander : « Se fait-il ? » plutôt que : « Comment se fait-il ? » (Idem). À rechercher les causes, on risque de se perdre en chimères, mieux vaut tenir registre des faits, construire patiemment leur liaison sans les rendre tributaire d’un ordre causal bien souvent arbitraire.
« Forger », c’est ciseler, aiguiser, ce n’est pas encombrer : « j’aime mieux forger mon âme que la meubler » (III, 3, 819) ce qui fait écho au principe éducatif de la tête bien « faite » plutôt que bien « pleine ».
Construction de soi plutôt que souci de soi : faire passer le thym et la marjolaine à l’état de miel par travail, « institution », métamorphose, « ouvrage » : « Les abeilles pillotent (butinent) deçà delà les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur ; ce n’est plus thym ni marjolaine : ainsi les pièces empruntées d’autrui, il les transformera et confondra, pour en faire un ouvrage tout sien » (I, 26, 152). Montaigne ne cesse de parcourir le chemin qui va du moi au mien puis du mien au moi. Du moi vide et vain au mien fait de tout ce qui est emprunté, y compris emprunté au cosmos : « L’eau, la terre, l’air, le feu et autres membres de ce mien bâtiment ne sont non plus instruments de ta vie qu’instruments de ta mort » (I, 20, 96) ; puis du mien ainsi construit, ainsi composé, faire sa substance, son moi, faire passer la forme acquise en substance pour que les emprunts ne soient pas logés en nos lèvres seulement et ne se résument pas à la simple écorce de la matière connue. Là est l’enseignement de la fin du chapitre sur l’institution des enfants : que la science soit non seulement logée en nous mais que nous puissions l’épouser (I, 26, 177).
Construction de soi comme nouvelle façon d’interpréter le « connais-toi toi-même », une façon constructive comme l’est celle des artisans et non simplement réflexive. l’avantage du paradigme de l’artisan est de nous faire sortir du « commandement paradoxe » (III, 9, 1001) de l’oracle
de Delphes : il n’y a paradoxe que parce qu’il y a de l’homogène entre celui qui connaît et qui il connaît. Or l’artisan est dissemblable à la matière qu’il travaille. L’abeille est un artisan faisant passer la fleur à l’état de miel. L’homme fait de même et se connaît d’autant mieux : c’est qu’il faut de l’hétérogénéité entre soi et soi pour s’atteindre. Il y a du subversif dans cette façon de prendre le travail constructif de l’artisan comme paradigme de la connaissance de soi : d’une part, il s’agit d’une pratique commune et quotidienne, d’autre part il y a un ennoblissement de la technique souvent laissée aux esclaves. Critias et Charmide ne s’y sont pas trompés quand ils convoquent, dans les dialogues de Platon, Socrate pour lui interdire d’enseigner, lui intimant l’ordre de ne plus parler des cordonniers, des charpentiers et des forgerons : « Il y a longtemps qu’ils sont excédés de figurer dans les entretiens » disent-ils. – « Eh bien, dit Socrate, je laisserai là tout ce qui s’ensuivait, le juste, le saint, et le reste ? ». Par sa réponse, Socrate persiste et signe : oui, c’est bien de cela qu’il s’agit, excéder les hommes à ne plus ignorer l’ignorance où ils sont d’eux-mêmes et de ce qui importe pour eux : le juste, le saint et le reste seront abordés à partir du travail des artisans. l’âme est mue naturellement quand elle parle comme l’artisan : Socrate « n’a jamais en la bouche que cochers, menuisiers, savetiers et maçons. Ce sont inductions et similitudes tirées des plus vulgaires et connues actions des hommes ; chacun l’entend » (III, 12, 1037). En faisant référence aux « inductions et aux similitudes », Montaigne donne écho au début des Topiques d’Aristote où la dialectique, l’art de mener un dialogue, consiste à saisir le poids des exemples et des comparaisons dans les micro-raisonnements de la vie quotidienne, les raisonnements que « chacun entend » et qui se rapporte aux actions communes et connues des hommes. L’homme ne se connaît donc lui-même que quand il est engagé dans une construction où il fait son fait. Et voilà de nouveau Platon : « ce grand précepte est souvent allégué en Platon : fais ton fait et te connais » (I, III, 15). Et cela jusqu’au bout à la façon du roi de Fez Molley Molluch qui jusque dans son lit de mort continua ses « offices », ses actions « très laborieusement et exactement » (II, 21, 678).
Les limites que nous reconnaissons nôtres sont fécondes : c’est ainsi qu’on ne laisse pas l’esprit faire le cheval échappé, mais qu’on le ramène à soi en bridant ses forces. La « vraie et naïve philosophie » est celle
qui arrête notre « âme en certaines et limitées cogitations où elle se puisse plaire » (I, 39, 248). Regarder en soi, tenir à soi, se reconnaître, se resserrer, se soutenir (III, 9, 1001) : voilà des actions constructives qui sont plus modestes que « se connaître », plus à notre portée, et par conséquent porteuses de plus de contentement.
Socrate dit qu’il ne cesse de corriger sa nature vicieuse telle qu’elle apparaît au physionomiste Zopyre : « comme Socrate disait de la sienne (sa laideur) qu’elle en accusait justement autant en son âme, s’il ne l’eût corrigée par institution » (III,12, 1058) ou encore : « Socrate avouait à ceux qui reconnaissaient en sa physionomie quelque inclination au vice, que c’était à la vérité, sa propension naturelle, mais qu’il avait corrigée par discipline1 » (II, XI, 429).
Se construire une conscience pour ne pas tomber dans la mauvaise foi qui consiste à penser qu’il suffit de croire aux châtiments éternels. D’un côté, construction à partir d’une mise entre parenthèse de la croyance, de l’autre destruction à partir d’un enfoncement dans la croyance : « Ruineuse instruction à toute police, et bien plus dommageable qu’ingénieuse et subtile, qui persuade aux peuples la religieuse créance suffire, seule et sans les mœurs, à contenter la divine justice. L’usage nous fait voir une distinction énorme entre la dévotion et la conscience » (III, 12, 1059), c’est toute la distinction entre la conviction pathologique qui incrimine et tue pour des détails, et la conscience, voix de la justice en nous.
L’autre dissociation majeure est celle qui existe entre la croyance et la foi : les croyances peuvent être contredites les unes par les autres, la foi, c’est une présence qui est en dehors de cette dualité des contraires. la foi n’est pas pour Montaigne une opinion, c’est pourquoi elle résiste à la négation et par là même ne peut être engagée dans des controverses, des polémiques ou des guerres.
Au terme de ce périple dans la trilogie « être, croire, construire », il apparaît que la méthode sceptique de Montaigne n’est pas réductible à une méthode de suspension du jugement. Prenant acte d’un mobilisme
radical, Montaigne déjoue les fixations des croyances par leurs flexibilités et leurs variétés. L’histoire comme récit et non comme jugement est le théâtre où les multiples voix entendues sont enregistrées comme de la matière brute, sans considération de l’importance ou de la non importance de ce qui est ainsi enregistré. Pour juger d’une matière, il importe de laisser à chacun la liberté de construire les liaisons. Des trois termes être, croire, construire, c’est bien le dernier qui semble avoir raison des deux autres : l’être se résorbe dans le devenir et la croyance dans la conception de mille mondes possibles, ceux qui sont advenus, comme ceux qui peuvent advenir.
Ali Benmakhlouf
Université Paris Est – Créteil Val-de-Marne
1 Cicéron Tusculanes, IV, 37. 80, rapporte l’anecdote ainsi : « Zopyre qui se donnait pour un habile physionomiste, ayant examiné [Socrate] devant une nombreuse compagnie, fit le dénombrement des vices qu’il découvrait en lui et chacun se prit à rire, car on ne voyait rien de tout cela en Socrate. Il sauvait l’honneur de Zopyre en déclarant que véritablement il était porté à tous les vices, mais qu’il s’en était guéri avec le secours de la raison », cité par A.Thibaudet, Socrate, 2008, p. 173, note 1. CNRS éditions.