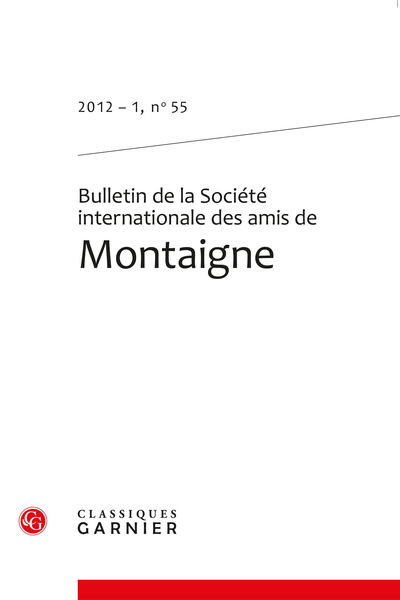
Ménager le fortuit
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 1, n° 55. varia - Auteur : Sève (Bernard)
- Pages : 275 à 287
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439766
- ISBN : 978-2-8124-3976-6
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3976-6.p.0275
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/07/2012
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Ménager le fortuit
La précarité de l’art photographique est […] liée à la contingence, au caractère hasardeux de la genèse de l’image : beaucoup plus que dans n’importe quel autre art, le simple hasard objectif peut produire un résultat esthétiquement tout aussi appréciable qu’une prise d’image longuement réfléchie selon des exigences artistiques. Le photographe est peut-être toujours responsable d’une photo ratée, il ne l’est pas toujours d’une photo réussie. Cette fonction créatrice du hasard incontrôlable tient à la spécificité de la genèse de l’image photographique : l’importance de la disponibilité de l’imprégnant, le nombre restreint de variables à fonction figurative que le photographe peut maîtriser conjointement lors de la prise de l’image, la brièveté du geste qui déclenche l’image, mais aussi, de nos jours, la rapidité avec laquelle se suivent les différentes prises grâce à la motorisation et à l’automatisation, sont autant de facteurs qui limitent la maîtrise iconique tout comme ils peuvent la contrefaire. Il en découle qu’une « œuvre » est difficilement identifiable au niveau de l’image isolée : si l’auteur d’un seul livre peut être à la limite un grand écrivain, personne n’irait qualifier l’auteur d’une seule image, fût-elle géniale, de grand photographe. […] Il y a donc dissociation entre le jugement de goût porté sur les qualités d’une image individuelle et la notion d’«œuvre » en tant que référable à un talent régulier : nous pouvons avoir un chef-d’œuvre sans œuvre et sans maître d’œuvre1.
Non, Lecteur, tu ne t’es pas trompé d’article. Et l’auteur ne s’est pas trompé de texte. Je n’ai pas osé intituler la présente étude « Montaigne photographe », mais l’idée est bien celle-là. Quand Montaigne peint non pas l’être mais le passage2, il est cinéaste ; quand il entend arrêter la promptitude de la fuite du temps par la promptitude de sa saisie3, il est
photographe. Le modèle qu’il sollicite pour penser le portrait de lui-même que sont les Essais, c’est évidemment la peinture – qu’aurait-ce pu être d’autre, en 1580 ? Mais nous pouvons aujourd’hui lire l’auto-portrait de Montaigne comme une suite d’instantanés pris sur le vif, voire comme un photo-montage avec toutes les retouches et surimpressions qu’autorise l’art de la photographie dans ses deux époques argentique et numérique.
Je sais que je sollicite un peu le sens obvie de la formule « arrêter la promptitude de sa fuite par la promptitude de ma saisie » dans le chapitre « De l’expérience », et je n’entends pas filer trop longtemps la métaphore photographique. Elle a pourtant sa pertinence. L’art précaire qu’est la photographie donne beaucoup au hasard, et même doublement : hasard du monde qui offre un bref spectacle intéressant, hasard du geste du photographe qui appuie sur le déclencheur au bon moment. Est-on si loin d’une pensée du fortuit ? Le photographe est celui qui sait accueillir le hasard, voire l’organiser, et, dans certains cas, le truquer – comme dans une des plus célèbres photographies de Robert Doisneau4. La présente réflexion sur « ménager le fortuit » gardera toujours en arrière-fond la pensée du hasard photographique telle que Schaeffer l’analyse.
Le fortuit relève d’abord chez Montaigne d’une réflexion ontologique, ou plutôt anti-ontologique. Mais il relève aussi d’une approche pratique, éthico-politique, et c’est sous cet aspect que je l’envisagerai. Comment agir quand on sait qu’il y a du hasard, du fortuit, de la fortune, dans les choses naturelles et humaines ? Faut-il s’en remettre au fatalisme ou à la superstition pour conjurer le sort ou pour se rendre la fortune favorable ? Telle n’est pas en général la position de Montaigne.
1) Le fortuit n’est pas défini par Montaigne comme un « en soi » mais comme un « pour nous ». Dans son article « Fortuit » du Dictionnaire de Michel de Montaigne5, Philippe Desan suggère que le « fortuit » chez Montaigne ne doit pas être pensé selon le carré modal classique (possible, impossible, nécessaire, contingent). Cette idée me paraît très juste, je la reprends et la développe sous ma seule responsabilité. Pensé dans le
carré modal classique, le fortuit s’identifierait au contingent ; mais le contingent classique est indissociable de ses relations de contradiction avec le nécessaire ou de sub-contrariété avec le possible ; les différentes catégories modales classiques sont permutables, par le simple jeu des négations pré ou post-posées. Le « contingent » est ainsi identique au « non-nécessaire », ou au « non impossible que ne pas ». La pensée montanienne du fortuit ne s’inscrit pas dans un tel réseau serré de relations elles-mêmes nécessaires. Le fortuit n’est pas l’élément d’un système catégorial, mais le caractère de certaines expériences humaines, et probablement de toutes.
Pensé en lui-même, de façon non modale donc, le « fortuit » montanien n’est ni une catégorie logique ni une « propriété » objective du monde (propriété que l’on pourrait penser comme un trou dans l’ordre du monde ou dans le jeu régulier des lois de la nature, ou encore, comme chez Aristote, comme la part d’indétermination que comporte la matière des choses pratiques). C’est plutôt le mot « situation », malgré son caractère anachronique, qui me paraît ici le plus adéquat à la notion de fortuit. Le mot proprement montanien serait sans doute celui d’« occasion », dont Olivier Guerrier souligne qu’il désigne le plus souvent « la circonstance fortuite, purement accidentelle6 ». On notera ainsi « l’occasion soudaine » dans le récit de la chute de cheval (II, 6, 373/71), ou les « occasions » qui incitent Montaigne à modifier son itinéraire dans le Journal de voyage. « Les occasions et les matières roulent et changent sans cesse » (III, 2, 814/58).
Le fortuit est quelque chose comme une défaillance de la situation, ce qui, dans la situation, échappe à toute prise. Le mot « fortuit » renvoie parfois à la pratique athénienne du tirage au sort (I, 11, 43/100). La Concordance de Leake nous apprend que « fortuit » (sous la forme « fortuite ») n’est employé qu’une fois substantivement par Montaigne et une fois adverbialement ; dans toutes ses autres occurrences, « fortuit » est employé comme adjectif. Or quels sont les substantifs auxquels est accolé l’adjectif « fortuit » ? Ce sont des mots comme : changement, passage, mouvement, figure, consentement, instinct, réputation, attouchement, défaillance, élection, opinion, suite et proportion, innocence, liberté, témérité, règle, faveur, impulsion, occasions, allégresses, commerce, mouvements, discours. Cette liste n’est pas complète, mais on voit que
la majorité de ces substantifs désignent des actions humaines ou des mouvements extérieurs auxquels l’homme est confronté. Le fortuit, c’est l’événement qui se produit sans raison apparente ou prévisible et qui vient interférer avec mes projets, qui vient les perturber ou, par chance, les favoriser. Le fortuit présente donc une double face : une face ontologique, il est apparemment sans cause, une face pratique, il traverse mon action. Mais ce n’est pas en tant qu’il est apparemment sans cause qu’il intéresse le plus Montaigne ; c’est parce que, étant sans cause, il n’est pas anticipable ou prévisible, et ne peut donc pas faire partie des paramètres d’une action raisonnable. Sa face « ontologique », son être sans cause, présente donc elle même un aspect « pratique » ou « éthique », à savoir que le fortuit n’est pas anticipable. C’est principalement en tant qu’il n’est pas anticipable que le fortuit vient traverser et même dérouter mon action.
Le fortuit devient donc pour ainsi dire « co-acteur » de ma propre action. La puissance du fortuit est toujours chez Montaigne plus forte que la puissance du calcul et de la maîtrise raisonnable de sa propre action : « la plupart des choses du monde se font par elles-mêmes » (III, 8, 933/233). La fortune se joue d’ailleurs de la sagesse du monde : « On s’aperçoit ordinairement aux actions du monde que la fortune, pour nous apprendre combien elle peut en toutes choses, et qui prend plaisir à rabattre notre présomption, n’ayant pu faire les malhabiles sages, elle les fait heureux à l’envie de la vertu. Et se mêle volontiers à favoriser les exécutions où la trame est plus purement sienne » (III, 8, 933/233).
La question est donc : le fortuit peut-il devenir la matière et l’objet de mon action ? Peut-on « ménager » le fortuit, au sens ou « ménager » veut dire : gérer, administrer, régler, maîtriser, organiser ?
2) Il semble dans un premier temps qu’une réponse positive à cette question serait une contradictio in terminis. Et ce, pour deux raisons distinctes :
a) la première est que l’action humaine ne peut s’exercer que sur des objets offrant un minimum de stabilité et de prévisibilité. Or le fortuit, par définition, n’est ni stable ni prévisible. Il échappe, et n’est finalement connu que sur le moment même, ou après-coup. C’est l’irruption non pas tant du nouveau que de l’inattendu, c’est la rencontre inopinée, l’obstacle imprévu, la phrase qui nous échappe, la mauvaise ou tout aussi bien la
bonne humeur qui nous envahit soudain, c’est la réaction surprenante d’autrui, c’est le revirement brusque, c’est la main qui dérape, c’est la parole qui manque à l’orateur, et, pour prendre un exemple célèbre entre tous, c’est le membre viril qui défaille au point de son action. Ce thème est abondamment illustré tout au long des Essais. Le fortuit pourrait être décrit comme ce qui, précisément, échappe à tout projet de maîtrise et de « ménagerie ».
b) la deuxième raison est plus redoutable encore : c’est que le fortuit travaille au cœur même de la volonté humaine7. Le fortuit ne gouverne pas moins notre action en amont, dans la réflexion et la prise de décision, qu’en aval, dans les effets imprévus de ce que nous nous sommes finalement résolus à faire : « Selon moi ce ne sont que mouches et atomes qui promènent ma volonté » (III, 2, 814/59). Et cela vaut même pour les actions les plus prudentes et les plus réfléchies : « Il y a quelques actions en ma vie, desquelles on peut justement nommer la conduite difficile, ou, qui voudra, prudente. De celles là mêmes, posez que la tierce partie soit du mien, certes les deux tierces sont richement à elle [la Fortune] » (III, 12, 1061/420). « Notre sagesse même et consultation suit pour la plus part la conduite du hasard. Ma volonté et mon discours se remue tantôt d’un air tantôt d’un autre, et y a plusieurs de ces mouvements qui se gouvernent sans moi. Ma raison a des impulsions et agitations journalières et casuelles » (III, 8, 934/234-235). Ma vertu même, dit encore Montaigne, « c’est une vertu, ou innocence pour mieux dire, accidentelle et fortuite » (II, 11, 427/154).
Si le fortuit gît au cœur de l’instance subjective chargée de le régler ou de le ménager, si la volonté est d’intelligence avec l’ennemi, alors la réponse à notre question ne peut être que négative.
3) Cette réponse négative n’est toutefois que partiellement acceptable. Les arguments que nous venons d’esquisser portent contre une conception « rationaliste » de l’action, une conception relevant de ce que l’on appelle les théories du choix rationnel. Cette théorie de l’action et du choix a certes de nombreux titres à faire valoir, mais elle n’est pas celle de Montaigne. La conception montanienne de l’action, beaucoup plus souple et vraisemblablement beaucoup plus sage, offre des ressources
philosophiques dont se prive une théorie purement rationaliste. La prise en compte du fortuit n’est pas renoncement au raisonnable, mais, au contraire, détermination d’une raison pratique concrète. Je vais essayer de le montrer par deux arguments.
4) Premier argument. Le fortuit se trouve et dans les choses extérieures, actions des autres hommes y compris, et dans ma propre volonté. Mais le fortuit n’est pas la structure dernière du monde, ni de ma volonté. Si tout était fortuit, l’idée même de le « ménager » n’aurait aucun sens, puisqu’il n’existerait aucune instance qui lui échappe et qui puisse si peu que ce soit en contrôler les effets. Mais même dans le passage cité du chapitre « Du Repentir », Montaigne ne donne au fortuit que les deux tiers de la causalité totale de ses actions les plus prudentes : c’est beaucoup, c’est énorme, mais ce n’est pas tout. La part de la maîtrise, la part de la prudence, est au moins ici d’un tiers. Ce tiers est déjà quelque chose, il est comme le levier qui permet de peser sur les choses.
5) Second argument. Le fortuit est enveloppé dans toute action technique ou politique. Qu’elle soit politique, militaire, discursive, amoureuse, économique ou technique, toute action est confrontée au fortuit. Volens nolens, le fortuit est bien sinon la matière, du moins un paramètre de mon action. Mais tout le problème que je traite tient à la distinction entre « paramètre » et « matière ». Que le fortuit soit un des paramètres de l’action humaine n’est pas une nouveauté ; le contingent, l’indétermination partielle des choses pratiques ou le hasard étaient déjà pris en compte par Aristote. La question est de savoir si le fortuit peut être directement pris comme matière de mon action. Il me semble que pour Montaigne la réponse est « oui », et même doublement « oui ». Ce double « oui » se décline sous les deux concepts de préméditation et d’improvisation.
6) Il y a chez Montaigne une pensée de l’improvisation8. Devant l’événement imprévu et perturbateur, je peux perdre mes moyens,
perdre la tête, et faire n’importe quoi. Mais je peux aussi improviser, et réagir avec audace, sang-froid et détermination. C’est l’un des thèmes de l’important quoique bref chapitre « Du parler prompt et tardif » : « Au don d’éloquence, les uns ont la facilité et la promptitude, et ce qu’on dit le boute-hors si aisé, qu’à chaque bout de champ ils sont prêts ; les autres plus tardifs ne parlent jamais rien qu’élaboré » (I, 10, 39/93). Cette différence du prompt et du tardif est théorisée par Montaigne selon un double modèle. Un premier modèle est professionnel : le prompt, c’est l’avocat, le tardif, c’est le prêcheur, le prédicateur. Un second modèle semble relever d’une sorte de théorie des facultés : la promptitude est le fait de l’esprit, la tardivité est le fait du jugement. « On récite de Severus Cassius qu’il disait mieux sans y avoir pensé, qu’il devait plus à la fortune qu’à sa diligence » (ibid., 40/94). Dans cette « condition de nature », poursuit Montaigne, la parole de l’orateur qui improvise « veut être échauffée et réveillée par les occasions étrangères, présentes et fortuites » (ibid., 40/95). Ce qui est remarquable ici est que, dans l’improvisation, le fortuit répond au fortuit. La présence d’esprit, comme on dit si bien, consiste à répliquer au fortuit sur le mode du fortuit. Le jugement demande à être réfléchi et bien pesé, il n’est pas l’instance capable de réagir à une situation inattendue. L’esprit, puissance dangereuse, comme j’ai essayé de le montrer ailleurs9, est ici l’instance capable. Rien ne peut d’ailleurs suppléer cette capacité d’improvisation quand elle fait défaut : « Et à la charge qu’on me fait, si je n’ai de quoi répartir brusquement sur le champ, je ne vais pas m’amusant à suivre cette pointe, d’une contestation ennuyeuse et lâche, tirant à l’opiniâtreté ; je la laisse passer, et baissant joyeusement les oreilles, remets d’en avoir ma raison à quelque heure meilleure » (III, 8, 938/241).
Ce thème peut être suivi tout au long des Essais. La réflexion de Montaigne sur la parole privée et la parole publique prend en compte la part de « fortuit » que comporte toute situation de conférence ou de « parlement ». C’est bien sûr le cas des deux petits chapitres jumeaux du livre I, « Si le chef d’une place assiégée doit sortir pour parlementer » (chap. 5) et « L’heure des parlements dangereuse » (chap. 6). Mais, à l’autre extrémité des Essais, c’est encore le cas du chapitre « De l’Art
de conférer » (III, 8). La capacité à répondre au fortuit, qui relève de la manière du dire (III, 8, 928/225) et non de sa matière, s’appelle ici l’à propos : « On répond toujours trop bien pour moi si on répond à propos » (ibid., 925/221). La notion d’à propos déborde celle d’improvisation, mais elle lui est à certaines égards apparentée : il y a une part d’improvisation dans la capacité à répondre à propos, même quand cet « à propos » est étayé sur un savoir solide et un jugement construit. On le voit bien dans les pièges que Montaigne conseille de tendre à l’interlocuteur vaniteux et vain. Si l’interlocuteur s’exclame sur la beauté d’une œuvre, l’interroger sur le point exact où se marque cette beauté, et le presser s’il tente de s’en sortir par des banalités vagues. Contraindre l’autre à improviser est l’un des « tests », assez redoutables, conseillés par Montaigne pour juger de la capacité de l’interlocuteur. Cette situation n’est pas un cas pur de fortuit : le jugement y a sa part, et la bêtise de l’interlocuteur plus que son incapacité à improviser. Mais cette dernière fait partie de cet ensemble complexe.
7) À la pensée de l’improvisation répond la pratique de la préméditation, de la préparation, du travail sur soi. Le thème de la praemeditatio est ancien, et Montaigne nourrit ici sa pensée des éthiques épicuriennes et stoïciennes. Mais il les reprend de façon originale. J’insisterai sur deux points : le renoncement aux jeux de hasard et la méfiance envers la puissance des commencements.
Le jeu, comme la chasse, occupent ou « amusent » l’âme et l’esprit en profondeur. « Considérez qu’aux actions mêmes qui sont vaines et frivoles, au jeu des échecs, de la paume et semblables, cet engagement âpre et ardent d’un désir impétueux jette incontinent l’esprit et les membres à l’indiscrétion et au désordre : on s’éblouit, on s’embarrasse soi-même. Celui qui se porte plus modérément envers le gain et la perte, il est toujours chez soi ; moins il se pique et passionne au jeu, il le conduit d’autant plus avantageusement et sûrement » (III, 10, 1008-1009/342-343). Montaigne aime les jeux de hasard, mais explique pourquoi il y a renoncé : « J’aimais autrefois les jeux hasardeux des cartes et dés ; je m’en suis défait, il y a longtemps, pour cela seulement que, quelque bonne mine que je fisse en ma perte, je ne laissais pas d’en avoir au dedans de la piqure » (ibid., 1015/352). Il n’est pas directement question du fortuit dans cette explication ; il est pourtant conceptuellement présent. Le gain ou la
perte sont liés au hasard de ces jeux, et la « piqure » marque l’incapacité de la volonté à accepter le hasard, à accepter la loi du hasard à laquelle on s’est pourtant soumis en acceptant de jouer. Première leçon donc : éviter de se mettre dans des situations dans lesquelles le hasard est roi.
La réflexion sur la puissance des commencements est un des thèmes éthiques les plus importants des Essais. « Qui n’arrête le partir n’a garde d’arrêter la course. Qui ne sait leur fermer la porte ne les chassera pas entrées. Qui ne peut venir à bout du commencement ne viendra pas à bout de la fin. Ni n’en soutiendra la chute qui n’en a pu soutenir l’ébranlement » (ibid., 1017/355). Ces quatre formules en forme de proverbe ou de sentences gnomiques disent une seule et même chose : la volonté s’exerce plus facilement sur le commencement d’un processus que sur son développement. « Il est plus aisé de n’y entrer pas que d’en sortir » (ibid., 1018/357) ; « Nous guidons les affaires en leurs commencements, et les tenons à notre merci ; mais par après, quand ils sont ébranlés, ce sont eux qui nous guident et emportent, et avons à les suivre » (ibid., 1018/357). Deuxième leçon : se défier, dans leurs commencements, des affaires comportant une part important de hasard. « De toutes choses les naissances sont faibles et tendres. Pourtant [pour cette raison] faut-il avoir les yeux ouverts aux commencements, car comme lors en sa petitesse on n’en découvre pas le danger, quand il est accru on n’en découvre plus le remède » (ibid., 1020/360). Il ne s’agit plus ici des jeux de société, que l’on peut et doit refuser ; il s’agit des occupations sérieuses, dans lesquelles le hasard joue un rôle plus ou moins important. Il ne faut pas renoncer à ces occupations, mais il faut en mesurer la dynamique au moment de s’y engager.
Un troisième niveau de la préméditation, le plus proche des éthiques hellénistiques, consiste à se préparer aux épreuves. « La plus sûre façon est donc, se préparer avant les occasions » (ibid., 1015/352). Et Montaigne d’opposer les grandes figures des sages antiques affrontant de face les plus grands maux, et les « âmes communes », au nombre desquelles il se compte. « À nous autres petits, il faut fuir l’orage de plus loin » (ibid., 1015/353) ; et Montaigne de citer dans la même page le « Notre Père » : ne nos inducas in tentatiomen. Ce thème déborde largement la question du fortuit, il concerne d’abord les épreuves de la vie, les « orages de la vie », la maladie, les passions. Mais la question du fortuit est enveloppée dans ce que Montaigne appelle « les occasions ».
Ces deux techniques de l’éthique montanienne, l’improvisation et la préméditation, mettent en jeu le temps et le rapport humain au temps : la capacité à réagir sur le champ à une situation imprévue, la construction anticipée d’une disposition mentale et éthique. L’improvisation est la seule attitude possible devant l’événement fortuit arrivant fortuitement. Ce pléonasme est volontaire. Car si le fortuit est l’inattendu, il reste que nous savons qu’il y a des situations, à la guerre par exemple, où l’inattendu est plus probable que dans d’autres situations. Un guerrier ou un responsable politique doivent davantage se préparer à l’inattendu qu’un laboureur ou qu’un cordonnier. En ce sens, l’événement fortuit qui survient à la guerre n’est pas totalement fortuit : nous savions bien que la guerre est l’un des lieux électifs du fortuit. Nous ne savons pas quel événement arrivera fortuitement, mais nous savons qu’il y aura de tels événements. C’est encore plus vrai des jeux de pur hasard. On peut dire qu’en jouant aux dés, la volonté se rend complice et esclave du fortuit, c’est pourquoi il est plus sage d’y renoncer. On remarquera enfin que la préméditation, qui est anticipation, se déploie selon des amplitudes temporelles nettement différenciées : renoncement pur et simple à entrer dans certaines situations (jeu de hasard) ; attention aiguë aux commencements (amour, guerre, etc.) ; préparation avant les occasions (situations ordinaires de la vie). Et quand l’occasion est là, ne reste que l’improvisation. Mais l’ensemble de ces techniques de vie construit, à petites touches, mais de façon extrêmement cohérente, un ménagement du fortuit.
Résumons la doctrine morale du fortuit. Il faut savoir accueillir le fortuit, lui faire sa part, ne pas tenter l’impossible (le maîtriser est impossible) et donc ne pas s’en laisser affecter. Ménager le fortuit, ce sera d’abord faire un juste partage entre ce qui relève de mon action et de ma responsabilité, et ce qui relève de la fortune. On peut évoquer ici le célèbre portrait du Prince que l’on pense en général être Henri de Navarre : « Lequel maître s’est ainsi peint soi-même à moi : qu’il voit le poids des accidents comme un autre, mais qu’à ceux qui n’ont point de remède il se résout soudain à la souffrance [à les supporter] ; aux autres, après y avoir ordonné les provisions nécessaires, ce qu’il peut faire promptement par la vivacité de son esprit, il attend en repos ce qui s’en peut suivre. De vrai, je l’ai vu à même, maintenant une grande
nonchalance et liberté d’actions et de visage au travers de bien grands affaires et épineux » (ibid., 1008/342).
8) Mais l’exemple majeur de « ménagement » du fortuit, ce sont bien sûr les Essais eux-mêmes, œuvre d’un philosophe « imprémédité et fortuit » (II, 12, 546/343). « Fortuit » signifie ici « de hasard, d’occasion ». Cette déclaration fameuse, qui est un ajout sur l’Exemplaire de Bordeaux, est à rapprocher d’un autre ajout C fait à la fin du chapitre « Du parler prompt ou tardif » : « Ceci m’advient aussi, que je ne me trouve pas où je me cherche, et me trouve plus par rencontre que par l’inquisition de mon jugement » (I, 10, 40/95). Le double récit que fait Montaigne de son entrée en écriture insiste sur le caractère fortuit de cet événement (I, 8 et II, 8), et c’est fortuitement encore que l’enregistrement des pensées du scripteur prit peu à peu la forme de l’essai, la forme des Essais. Je rappellerai ici l’hypothèse d’Alain Legros selon laquelle l’ordre des chapitres des Essais reproduirait purement et simplement l’ordre d’enregistrement des pensées de Montaigne10. Je ne discuterai pas ici cette hypothèse, qui me paraît très séduisante. Elle permet de mettre un jour une paradoxale « logique du fortuit » dans la rédaction des Essais, rédaction dans laquelle on pourrait distinguer plusieurs niveaux :
– premier niveau : la production de la pensée. « Mon âme me déplait de ce qu’elle produit ordinairement ses plus profondes rêveries, plus folles et qui me plaisent le mieux, à l’improuvu et lorsque je les cherche le moins, lesquelles s’évanouissent soudain, n’ayant sur le champ où les attacher : à cheval, à la table, au lit, mais plus à cheval, où sont mes plus larges entretiens » (III, 5, 876/150). Ce qui déplaît à Montaigne, ce n’est pas que ses plus profondes rêveries lui arrivent à l’imprévu, c’est qu’il n’ait pas de quoi les noter et risque ainsi de les perdre (son défaut de mémoire est connu). Le fortuit est aussi l’évanouissant, le fugace, l’instant perdu s’il n’est saisi au vol, la pensée « tumultuaire et vacillante » (III, 11, 1033/379). Et encore : « Je commence volontiers sans projet, le premier trait produit le second » (« Considération sur Cicéron », I, 40, 253/409).
– deuxième niveau : l’enregistrement de la pensée. Il faut y procéder au plus vite, pour ne pas la perdre : « J’écris mes lettres toujours en poste
[à la hâte], et si précipiteusement que, quoique je peigne insupportablement mal, j’aime mieux écrire de ma main que d’y en employer un autre, car je n’en trouve point qui me puisse suivre, et ne les transcris jamais » (I, 40, 253/409). Là il s’agit des lettres, de la correspondance de Montaigne. L’enregistrement des « imaginations » contenues dans les Essai est sans doute un peu décalé dans le temps. Mais, comme l’a montré Daniel Ménager dans un texte important11, Montaigne essaie de recréer dans sa librairie les conditions de l’improvisation « improuvue ». Qu’un grand nombre de pages des Essais aient été dictées renforce cette dimension, ainsi que les diverses déclarations de Montaigne soulignant l’oralité des Essais : « Je parle au papier comme je parle au premier que je rencontre » (III, 1, 790/21).
– troisième niveau : le refus de la correction. « J’ajoute, je ne corrige pas » (III, 9, 963/276) ; « Au demeurant je ne corrige point mes premières imaginations par les secondes ; oui à l’aventure quelque mot, mais pour diversifier, non pour ôter » (II, 37, 758/671). La correction, quelle que soit son ampleur, est un désaveu du fortuit. Refuser de corriger, ou déclarer hautement que l’on ne corrige pas (même si l’on corrige en fait), c’est à l’inverse confirmer le fortuit, c’est donner une valeur au « fortuit de pensée ».
– quatrième niveau : le refus de la construction d’un livre. « Je n’ai point d’autre sergent de bande à ranger mes pièces que la fortune. À même que mes rêveries se présentent, je les entasse ; tantôt elles se pressent en foule, tantôt elles se traînent à la file » (II, 10, 409/125). « Les fantaisies de la musique sont conduites par art, les miennes par sort » (III, 2, 805/44). Le livre de Montaigne refuse l’architectonique ou la composition, qui est le contraire du fortuit. À défaut d’être « un chef-d’œuvre sans œuvre et sans maître d’œuvre », pour reprendre la formule de Jean-Marie Schaeffer, Les Essais sont assurément un chef d’œuvre dont l’auteur a tenté de dissoudre son statut de maître d’œuvre. « Toutes choses, dit Platon, sont produites par la nature, ou par la fortune, ou par l’art. Les plus grandes et plus belles, par l’une ou l’autre des deux premières ; les moindres et imparfaites, par la dernière » (I, 31, 206/345).
Que cet entassement fortuit, que ce « fagotage de tant de diverses pièces » (II, 37, 758/671), fasse l’objet de réaménagement plus ou moins pensés est certain ; mais la dimension fortuite continue à vivre sous le réaménagement. Pour reprendre ma métaphore initiale, la série d’instantanés fait l’objet d’un choix et d’une composition photographique établie après coup ; mais, dans cette composition même, l’instantané reste un instantané, un « effet de nature cru et simple » (III, 2, 805/44). « Mon dessein est de représenter en parlant une profonde nonchalance et des mouvements fortuits et imprémédités comme naissant des occasions présentes12 » (III, 9, 963/275). Une notation prise sur le vif, une réflexion véhémente et fortuite, que Montaigne écrit en marge de son livre, un mot ajouté, une majuscule de scansion porté sur l’exemplaire imprimé, restent autant d’instantanés de pensée, même une fois intégrés dans la marche générale du livre. Une photographie prise sur le vif reste prise sur le vif, même une fois imprimée. Ces marques vives si fréquentes dans les Essais sont à lire comme des instantanés, qui, par leur « montage » et leur rapidité, disent le mouvement et permettent de comprendre les « mutations » de Montaigne. Comme on sait, le cinéma est né de la photographie.
Bernard Sève
Université Lille 3, UMR 8163 STL
1 Jean-Marie Schaeffer, L’Image précaire, du dispositif photographique, Seuil, collection « Poétique », 1987, p. 159-160. On notera que ce texte date de l’époque argentique de la photographie. L’époque numérique, dans laquelle nous vivons présentement, ne fait me semble-t-il que renforcer l’analyse ici proposée par Schaeffer.
2 Essais, III, 2, 805/43. Mes références renvoient d’abord à l’édition Villey-Saulnier (PUF, 1965) et ensuite à l’édition Tournon (Imprimerie Nationale, 1998).
3 Essais, III, 13, 1111-1112/497-498 : « Principalement à cette heure que j’aperçois la mienne [ma vie] si brève en temps, je la veux étendre en poids ; je veux arrêter la promptitude de sa fuite par la promptitude de ma saisie, et par la vigueur de l’usage compenser la hâtivité de son écoulement ; à mesure que la possession du vivre est plus courte, il me la faut rendre plus profonde et plus pleine ».
4 Pour mémoire, Le baiser de l’Hôtel de Ville (1950).
5 Philippe Desan, article « Fortuit », in Dictionnaire de Michel de Montaigne, dir. Philippe Desan, Champion, 2007
6 Olivier Guerrier, article « Occasion », in Dictionnaire de Michel de Montaigne, op. cit.
7 Je me permets de renvoyer ici à mon Montaigne, Des règles pour l’esprit, PUF, 2008, p. 340-341.
8 Thierry Gontier me fait remarquer qu’il faudrait distinguer entre une improvisation conflictuelle et une improvisation non-conflictuelle. Il est sûr que je n’improvise pas de la même manière selon que je suis en situation de conflit (un général lors d’une bataille) ou en situation de coopération (un musicien lors d’une improvisation collective en jazz). La part du fortuit est vraisemblablement plus grande dans le premier cas. Il me semble toutefois que, dans les deux cas, il y a à « ménager » le fortuit, mais selon des modalités différentes.
9 Bernard Sève, Montaigne, Des règles pour l’esprit, op. cit.
10 Alain Legros, « Genèse d’un philosophe », Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, janvier-juin 2006.
11 Daniel Ménager, « Improvisation et mémoire dans les Essais », in Rhétorique de Montaigne, Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, 1985, no 1-2.
12 Cette formule présente une difficulté, que m’a signalée Ali Benmakhlouf. La « nonchalance » et les « mouvements fortuits et imprémédités » semblent ici être non pas naturels, mais le fruit d’un « dessein » délibéré et, donc, prémédité. Attitude rhétorique classique consistant à feindre la spontanéité voire la naïveté ? Une autre interprétation est possible, si l’on donne à « représenter » non pas le sens de « donner délibérément à voir », mais celui de « donner son droit à », « laisser être ». Dans le premier sens on présente les choses comme elles ne sont pas, et, dans le second, comme elles sont. Le contexte de ce passage difficile du chapitre « De la vanité » donne me semble-t-il des arguments pour l’une et l’autre interprétations.