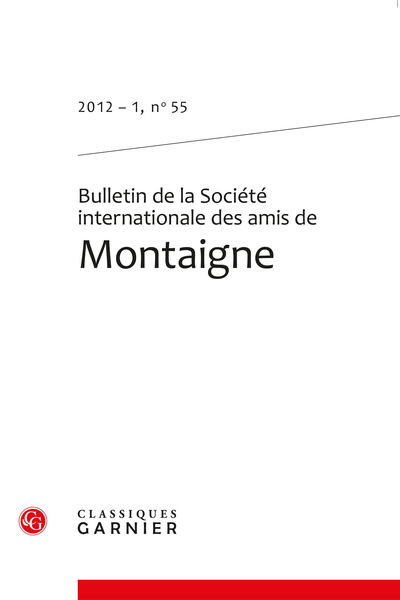
Le magistrat comme philosophe : La Roche Flavin, lecteur de Montaigne et de Charron
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 1, n° 55. varia - Auteur : O'Brien (John)
- Pages : 221 à 234
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439766
- ISBN : 978-2-8124-3976-6
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3976-6.p.0221
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/07/2012
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
LE MAGISTRAT COMME PHILOSOPHE :
LA ROCHE FLAVIN, LECTEUR
DE MONTAIGNE ET DE CHARRON
C’est à André Tournon que nous devons la découverte de La Roche Flavin comme lecteur des Essais. Dans La Glose et l’essai, Tournon montre avec l’appui de preuves textuelles que La Roche Flavin avait lu et cité Montaigne lors de sa discussion de la torture dans le dernier livre des Treze Livres des Parlemens de France, ouvrage publié à Bordeaux en 1617. « Il est certain, » affirme-t-il avec justesse, « que l’auteur a lu et apprécié les Essais : il en transcrit littéralement plusieurs passages […] » et il commente : « Larcins, si l’on veut, mais tout à son honneur : la protestation contre les “gehennes” y est reproduite intégralement, sans être falsifiée comme elle l’avait été naguère par Charron1 ». Le critique ébauche par ses paroles incisives habituelles la triple démarche qui s’impose à qui cherche à approfondir les rapports entre les Parlemens et les Essais : la présence de Montaigne dans le texte de La Roche Flavin ; la question du plagiat ; et le rapport de l’œuvre de La Roche Flavin à celle de Charron. C’est à cette triple élucidation que nous consacrerons nos efforts.
Revenons pour commencer sur les pas du savant marseillais. Dans le treizième et dernier livre des Parlemens, La Roche Flavin se concentre sur le problème de la torture. Le chapitre lxxiii, intitulé « D’aucunes punitions ou condemnations trop seueres, rigoureuses, voire cruelles… », est effectivement émaillé de renvois explicites à Montaigne. Le premier de la série, dans la section X, mentionne son nom par une formule-type qui sera répétée dans la section tout entière : « Le Sieur de Montagne au second liure de ses Essays …2 ». Cette formule sert ici de repère à une
citation du chapitre 2.32, où Montaigne relate l’exemple d’un paysan préférant souffrir les pires tourments plutôt que de promettre une rançon3. Cependant, à y regarder de plus près, la citation du chapitre 2.32 avait déjà commencé, mais sans que la source en soit avouée : au milieu de la phrase précédente se faufile une forme modifiée du contexte original, « pendant nos guerres ciuiles, il s’est trouué … » (p. 867 ; cf. VS, p. 724), qui supprime – et c’est crucial – le signe du témoignage personnel (« je sais ») en faveur de la tournure objective servant à raccorder la diversité des exemples.
Même démarche dans la deuxième allusion à Montaigne, à la page suivante, qui répertorie toute une suite de morts cruelles pour finir sur une attribution « au rapport du sieur de Montagne au liure 2. de ses Essais » (p. 868). Le lecteur aurait tout lieu de supposer que l’annotation se rapporte au dernier exemple donné, la mort de Sechel raconté dans « Couardise mere de la cruauté ». Ce n’est pas le cas. De fait, toute la section XIV, ainsi que les sections précédentes, XI, XII et XIII, sont empruntées en bloc d’un seul et même ajout post-1588 au chapitre 2.27 qui cite l’un après l’autre Chalcondyle et Crœsus avant d’arriver à Sechel (VS, p. 701). La Roche Flavin a redistribué, classifié et subordonné entre eux l’entassement des épisodes qui ont pour effet chez Montaigne l’intensification de la cruauté de par la longueur et la richesse des détails qu’il leur consacre. Et, là encore, disparaît complètement le signe du jugement personnel de la part de l’essayiste, « Je n’estime pas qu’il y eut grand sentiment en ce mouvement » (VS, p. 701), la réflexion qui prend ses distances par rapport aux faits narrés pour les peser et évaluer. Les troisième et quatrième exemples suivent le même schéma. Le troisième partage avec le deuxième la formule d’attribution « au rapport de Montagne au premier liure des Essais » (p. 870) pour faire valoir la célèbre histoire, tirée de la fin de i.30 (VS, p. 201), des ambassadeurs du
roi de Mexico et le message qu’ils transmettent à Cortez ; y sont soudés deux autres récits, qui font partie du même ensemble d’occurrences de ce même chapitre « De la moderation », sur les cruautés d’Amurat et des indigènes du Nouveau Monde (VS, p. 201). Le quatrième rassemble, dans la section XLIV (p. 875), une suite d’anecdotes assignées explicitement au « sieur de Montagne en ses Essays » et qui ont pour sujet la dérision ou la plaisanterie au moment de l’exécution racontées dans le chapitre 14 du premier livre (VS, p. 52). Comme dans les deux premiers exemples, les marques de l’évaluation sont supprimées.
Toutefois, ce n’est là que le premier temps de l’entreprise de La Roche Flavin. Un second temps va plus loin, car aussi bien que des emprunts avoués, marqués par le nom de l’essayiste, le magistrat n’hésite pas à en tirer des passages non avoués. Avant le premier extrait, avoué comme montaignien et provenant de ii.32, est ainsi placé un long commentaire sur la validité de la torture : « Estant tres-veritable, que c’est vne dangereuse inuention, que celle des gehennes ; & semble, que ce soit plutost vn essay de patience, que de verité » (p. 866). Le lecteur y reconnaît tout de suite, légèrement remaniée en son introduction, l’une des plus célèbres réflexions du chapitre ii.5, « De la conscience », prolongée par ailleurs jusqu’à la phrase « voyez combien de fois il ayme mieux mourir sans raison que de passer par cete information plus penible que le supplice, et qui souvent, par son aspreté, devance le supplice, et l’execute » (VS, p. 369). Mais elle est tout de suite assortie à deux exemples du chapitre ii.32, le supplice du paysan espagnol entre les mains de Lucius Piso et celui d’Epicharis sous Néron, et les morts qu’il se donnent pour éviter une seconde session de torture, ce qui fait suite, pour l’illustrer et la confirmer, à l’observation de Montaigne donnée tout de suite avant. Le troisième exemple est encore plus marqué de ce point de vue. L’histoire des ambassadeurs des Incas, que semble clore l’attribution explicite à Montaigne, est suivie directement de la section XXX (p. 870), dévouée à la colère de Piso et de ses représailles contre ses deux soldats et le bourreau tenu de les exécuter, en quoi le lecteur perçoit un extrait du chapitre ii.31, « De la colere » (VS, p. 717). Le quatrième cité témoigne de la même activité. La section XLI use de l’histoire de Canius Julius, dont la mise à mort par Caligula est reprise dans toute son ampleur, mais sans indication explicite de source, au chapitre « De l’exercitation » (VS, p. 371). Dans ces deux derniers
emprunts, comme dans les deux premiers, le nom de Montaigne n’y apparaît pourtant pas.
Ces épisodes identifiés grâce à André Tournon témoignent des traits essentiels de l’auteur des Parlemens. Au travail de dépeçage et de dispersion des Essais succède le souci de l’homogénéité œuvrant par effets de recentrage et d’organisation de blocs textuels portant sur une même idée ou thème. Les prélèvements pratiqués dans le corps des Essais créent des passages qui gravitent autour d’un nom marqueur et d’autres isolés de ce centre mais qui n’en sont pas moins rattachés au même centre. La citation du nom de Montaigne est dans ce cadre le signe qu’un travail est en cours de s’effectuer ; c’est le signe non pas d’une source avouée de mauvaise grâce et à contrecœur, mais d’un procédé textuel qui privilégie la coordination et le rapiéçage. Le nom de l’auteur des Essais fait effet de phare, de luminescence, qui indique la source originelle, tout en s’en écartant par le montage qui en est fait, mais qui irradie tout de même de sa présence discrète toutes les sections avoisinantes. Objectera-t-on que si cette technique correspond à une volonté de reconstruction de Montaigne qui accentue la cohérence de sa pensée, elle s’achète au prix d’une simplification de cette même pensée et d’une méconnaissance de l’essai et de sa marqueterie mal jointe ? L’objection pourrait être fondée si l’on ne s’en tenait qu’à la première impression de lecture, celle d’un La Roche Flavin qui s’était borné à refaire des Essais un livre de sagesse ou un simple manuel pour magistrats étoffé d’exemples. Ces emplois ne sont pas exclus ; mais ils ne constituent pas la particularité de la mission que notre auteur se donne, ni, sur ce point, l’essentiel. La systématisation de l’héritage montaignien se réalise au contraire, comme on le verra, en fonction d’une conception philosophique de la nature du magistrat. Les procédés intertextuels de lecture et de rédaction par lesquels le parlementaire sollicite de son lecteur la reconnaissance de ses sources ne visent qu’au renouvellement de la tradition juridique par le montage des extraits et le jeu des auteurs qui les fournissent.
Il suffit, pour s’en convaincre, de retourner en arrière vers le livre 8 des Parlemens, l’un de ceux où notre auteur discute de l’idéal du magistrat4.
Une citation du chapitre vi, à propos de l’expérience requise du juge, semble initier les développements par une citation de Manile :
Per uarios vsus artem experientia fecit
Exemplo monstrante viam. (p. 427)
C’est bien entendu un lieu commun juridique et rien n’indique que La Roche Flavin l’eût tiré du début du chapitre iii.13 des Essais plutôt que de la tradition commune à laquelle l’essayiste et lui-même appartenaient l’un et l’autre5 ; même observation pour l’histoire de la femme de Smyrne, évoquée obliquement dans « Des boyteux », mais tout aussi largement répandue dans la littérature vernaculaire et juridique6. En revanche, le chapitre vii, concernant l’intégrité du juge, poursuit la même trajectoire par une réminiscence indubitable du chapitre « De la liberté de conscience » :
Entre autres exemples nous en rapporterons vn de l’Empereur Iulian dit l’Apostat, par ce que s’estant faict Chrestien, il apostata, & retourna au paganisme, homme d’ailleurs accompli de rares vertus, & qui mourut en l’année 31. de son aage en la guerre contre les Parthes, au dire d’Ammian Marcellin. Or il prenoit luy mesme la peine d’ouyr les parties : & encores que par curiosité il demandât à ceux, qui se presentoient à luy, de quelle religion ils estoient : toutesfois l’inimitié qu’il portoit à la nostre, ne donnoit aucun contrepoix à la balance de la iustice. Et n’estoit-il si aspre ny cruel ennemy des Chrestiens qu’on le descrit : car nos historiens recitent de luy ceste histoire, que se pourmenant vn iour au tour de la ville de Chalcedoine, Marius Euesque du lieu, osa bien l’appeller meschant, traistre à Christ : & qu’il ne fit autre chose, sauf luy respondre : Va miserable, pleure la perte de tes yeux. A quoy l’Euesque encores repliqua : Ie rends graces à lesus Christ, de m’auoir osté la veue, pour ne voir ton visage impudent. Les historiens disent qu’il affectoit en cela vne patience Philosophique, comme celuy qui auoit son ame viuement teinte des discours de la Philosophie : suiuant lesquels il faisoit profession de regler toutes ses actions, en ayant laissé de notables exemples, noircis neantmoins par son apostasie. (p. 429)
La réorganisation par La Roche Flavin de cet extrait de ii.19 met en relief un aspect de la personnalité de Julien ; la clausule « affectant en
cela une patience philosophique », qui chez Montaigne est éloignée de son sujet grammatical, lui est désormais rattachée et raccordée à une description précédente faisant également valoir la disposition philosophique de l’empereur. Montaigne avait brossé le portrait de Julien qui englobait, par un prolongement, la rencontre avec l’évêque ; La Roche Flavin y voit l’opportunité de commenter en un seul et même endroit la caractérisation de l’apostat. L’un et l’autre soulignent son attitude philosophique ; la question est donc de savoir l’importance de ce trait.
Une réponse à cette question commence à s’ébaucher dès lors que le magistrat toulousain, ayant parcouru le problème de la prudence politique, en vient au deuxième volet de son tableau, la prudence domestique et privée, qu’il est nécessaire de citer in extenso en raison de l’orientation intellectuelle que notre auteur lui donne :
Retranchant plusieurs discours de laquelle publiez par vn fort beau, poli, & iudicieux esprit de nostre siecle, nous dirons seulement auec luy neantmoins, que le principal point, & fondement d’icelle est à apprendre, à demeurer, se delecter, & contenter seul, voire se passer de tout le monde, si besoing est & faire se pouuoit : la plus grand chose estant de sçauoir estre à soy. La vertu se contente de soy : gaignons sur nous de pouuoir à bon escient viure seuls, & y viure à nostre aise. Apprenons à nous passer, & nous despecher, & deslier de toutes ces liaisons, qui nous attachent à autruy ; & que nostre contentement depende de nous, sans rechercher, ny aussi desdaigner les compagnies ; voire gayement y aller, & s’y trouuer, si le besoing nostre ou d’autruy le requiert. Mais sans nous y acoquiner, & y establir nostre plaisir, comme aucuns : qui sont comme demy perdus estans seuls. Il faut auoir au dedans soy de quoy s’entretenir & contenter, & in sinu suo gaudere. Qui a gaigné ce point, se plaist par tout, & en toutes choses. Il faut bien faire la mine conforme à la compagnie, & à l’affaire qui se présente, & se traicte, & s’accomoder à autruy, triste si besoing est, mais au dedans se tenir tousiours mesme. Cecy est la meditation, qui est l’aliment, & la vie de l’esprit, cuius viuere est cogitare. Or par le benefice de nature il n’y a occupation que nous facions plus souuent & plus long temps, qui soit plus facile, plus naturelle, & plus nostre, que mediter, & entretenir ses pensées. Mais elle n’est pas à tous de mesme, ains bien diuerse selon que les esprits sont : aux vns elle est foible, aux autres forte : aux vns est fetardise, oysiueté languissante, vaccance, & disette de toute autre besogne : mais les grands en font leur principalle vaccation, & plus serieux estude : dont ils ne sont jamais plus embesoignez, ny moins seuls (comme il est dict de Scipion) que quand ils sont seuls, & sejournent d’affaires, à l’imitation de Dieu, qui vit, & se paist d’eternelle pensée. C’est la beatitude des Dieux, dict Aristote, de laquelle naist leur beatitude, & la nostre. (p. 440, § XIV)
Le lecteur des Essais saisira au passage de multiples souvenirs : le chapitre ii.39 pour le précepte d’Antisthènes, « la vertu se contente de soy » (VS, p. 241) et pour l’idée de se délier de toutes liaisons7, tandis que c’est une addition manuscrite à « De trois commerces » qui est à l’origine de la longue méditation sur la méditation, avec son dicton cicéronien emprunté aux Tusculanes8. Néanmoins, la formulation précise de l’ensemble n’est pas de Montaigne ; elle est de Charron, comme le signale discrètement l’introduction, « Retranchant plusieurs discours de laquelle publiez par vn fort beau, poli, & iudicieux esprit de nostre siecle, nous dirons seulement auec luy neantmoins, que…9 ». Si Montaigne est lu et apprécié par La Roche Flavin – et on s’accordera avec André Tournon que c’est bien le cas – il ne l’est dans cette section qu’à travers l’hommage que Charron lui fait. Double lecture que celle du magistrat toulousain, et double technique, centrée sur le nommé et l’anonymat et qui fournit non une textualité auto-suffisante, mais une façon de repenser la tradition juridique pour en fonder une conception philosophique.
C’est bien de re-conception qu’il s’agit et, dans cette perspective, le choix de Charron s’avère logique, car c’est lui qui développe, de la façon la plus appuyée, les qualités intérieures requises par son sage. Le passage cité vient du chapitre « De la Iustice et Devoir de l’homme a soy-mesme » de la Sagesse où Charron souligne la nécessité d’une solitude passée dans l’entretien de ses pensées, activité qui seule nous permet de « sçauoir estre à soy », la cogitation étant la vie de l’esprit ; une dernière allusion la compare à la béatitude des dieux. Pareil titre, pareille section, étaient faits pour attirer l’attention du magistrat toulousain, mais La Roche
Flavin détourne cet extrait dans la mesure où il n’est plus question du sage mais du magistrat, et de sa prudence plutôt que de sa justice ; il en fait pourtant la clé de voûte d’une philosophie de la magistrature, en axant celle-ci sur une double réminiscence, Montaigne lu par le biais de Charron, d’une part dans le but de donner à son initiative une ascendance impeccable, mais d’autre part, au niveau intertextuel, pour justifier la technique du prélèvement et de la combinaison des extraits dont la tradition remonterait, à son sens, au philosophe périgourdin en passant par le chanoine de Condom. La Roche Flavin inscrit son projet dans la droite ligne de cet héritage du sud-ouest, dont il est le fier successeur, et auquel il signale son adhésion par l’application assidue de la même technique. Son identification avec ses prédécesseurs se traduit donc par l’emploi de la combinatoire textuelle qu’ils avaient eux-mêmes savamment illustrée et qui met en relief de ce fait la généalogie intellectuelle dont le Toulousain se réclame. Dans le livre 8, il avoue sa dette en mettant près du centre de ses Parlemens cette longue séquence qui résume et couronne l’idée qu’il se fait de la personnalité du juge. Si l’application est une nouveauté, le concept ne l’est pas, étant apparu dès l’ouverture de la Sagesse10. Ce qui chez Charron relevait de l’éthique personnelle, du devoir qu’on doit à soi-même, se transforme néanmoins en véritable réflexion sur la nécessité, chez le magistrat, d’« entretenir ses pensées » et le contentement qui en découlera par voie de conséquence. Et alors même que l’esprit en est montaignien, surtout dans ces dernières phrases si essentielles empruntées directement à l’essayiste, c’est en grande partie un Montaigne filtré par Charron à qui La Roche Flavin doit la facture de ce passage et son idée clé.
La suite du passage en accentue l’aspect complémentaire, non moins fondamental :
Or ceste solitaire occupation, & cet entretien ioyeux ne doibt point estre en vanité, moins en chose vitieuse : mais en l’estude, & cognoissance profonde, & plus diligente culture de soy-mesme. C’est le pris faict, le principal, le premier, & plus plein ouurage d’vn chacun. Il faut tousiours se guetter, taster, sonder, jamais ne s’abandonner : estre tousiours chez soy, se tenir chez soy. (p. 440)
Le magistrat n’est plus ici l’instrument anonyme de la justice ; il a un moi qui se doit de se cultiver, un centre de réflexion où l’étude et la connaissance de soi ont pour accompagnement l’entretien des pensées dans la joie. Suivant toujours le sillage de Charron11, La Roche Flavin personnalise par cette intériorité ce que ses compatriotes parlementaires avaient laissé sombrer dans l’oubli ou le silence. Ce passage, aussi court soit-il, constitue le noyau conceptuel de cette philosophie juridique centrée sur une « culture de soy-mesme » que définit la dernière phrase tout en échos montaigniens12, alliant le visuel, le gustatif et le spatial pour cerner au plus près le lieu de soi. Ce développement peut néanmoins paraître incongru chez un écrivain qui déplore si amèrement dans ses Parlemens l’abondante culture littéraire de ses collègues (p. 363-69). C’est en réalité la parade, l’étalement d’un savoir inutile, la surabondance creuse, qui sont les cibles : la poésie, la théologie, la citation de mots ou d’expressions grecs sont pour notre auteur superflues dans une cour de justice13. C’est pour cette raison qu’il y oppose dans le présent contexte le nécessaire centre qu’est la culture de soi, et ses associés, la pensée et le jugement. Cette démarche redéfinit au fond la culture qui n’est plus synonyme d’un retour vers l’antiquité classique ni d’un rapport avec le renouveau des lettres, mais d’un approfondissement et d’un raffinement de l’entendement et de la réflexion en vue de la compréhension du droit et de l’exercice de la justice.
En vertu de ce noyau et des principes qu’il énonce est organisée la suite du texte. Aussi la section suivante, le no XVI du chapitre (p. 441), insiste-t-elle sur la vigilance et le sérieux du magistrat comme aspects d’une maîtrise de soi et d’un ménage de la volonté sachant faire profit
de toutes occasions et ne jouissant que de la fréquentation d’honnêtes hommes et de bons livres. Ces propos empruntés textuellement à Charron14 sont prolongés et approfondis par une très longue séquence enjambant les sections XVII-XIX (p. 441-42) qui traitent à tour de rôle des trois parties dont le Condomois fait consister les devoirs de l’homme envers lui-même, à savoir l’esprit, le corps et les biens15. L’ensemble prend ainsi l’allure d’une méditation tripartite qui creuse en suite continue les implications éthiques de la culture de soi, dans le registre, cependant, de la mise en garde. Tandis que les sections précédentes avaient porté aux nues l’action de la cogitation et du travail de l’esprit, ici l’accent est mis sur les écueils qui pourraient saboter le jugement et l’entendement : vanités, niaiseries, opinions fantastiques ou extravagantes, et surtout présomption et opiniâtreté ; et la section se termine en opposant le fou et le sage dans la pratique des vertus intellectuelles. Le même schéma se répète dans l’alinéa suivant, mais sur le mode mineur favorisant un seul élément conducteur : ici, l’esprit se voit confier la garde du corps, de même que, dans la troisième sous-division, c’est la « médiocrité » qui freine la course aux biens matériels et en règle à la fois l’acquisition et la dépense.
Au terme de cette section sur la justice due à soi-même, dans laquelle La Roche Flavin emprunte largement à son proche contemporain, non toutefois sans silencieusement l’abréger par moments16, un long alinéa revient à la question de la prudence, question charonnienne par excellence et qui a une place de choix dans la Sagesse17. Ce n’est pourtant pas Charron qui parle ici ; une autre voix résonne, plus sonore :
On sçait qu’il est encore reproché à ces deux grands personnages, Octavius et Caton, aux guerres ciuilles ; l’vn de Sylla, l’autre de Cesar, d’auoir laissé
plustost encourir toutes extremitez à leur patrie, que de la secourir aux despens, & prejudice de ses loix, & que de rien remuer. Car à la verité en ces extremes necessitez, où il n’y a plus que tenir, il seroit à l’aduenture plus sagement faict de baisser la teste, & prester vn peu au coup, que s’ahurtant outre la possibilité à ne rien relascher, donner occasion à la violence de fouler tout aux pieds : & vaudroit mieux faire vouloir aux loix ce qu’elles peuuent, puis qu’elles ne peuuent ce qu’elles veulent. Ainsi fist celuy qui ordonna qu’elles dormissent vingt et quatre heures : & celuy qui remua pour cette fois vn jour de Calendrier : & cest autre qui du mois de Iuin fist vn second May. Les Lacedemoniens mesmes, tant religieux obseruateurs des Ordonnances de leur pays, estans pressez de leur loy, qui deffendoit d’eslire par deux fois Admiral vn mesme personnage, & de l’autre part leurs affaires requerans de toute necessité, que Lysander print de rechef cette charge : ils firent bien vn Aracus Admiral ; mais Lysander surintendant de la marine. Et de mesme subtilité, vn de leurs Ambassadeurs, estant enuoyé vers les Atheniens, pour obtenir le changement de quelque Ordonnance, & Pericles luy disant qu’il estoit deffendu d’oster le tableau, ou vne loy estoit une fois posée, luy conseilla de le tourner seulement, d’autant que cella n’estoit pas defendu. C’est ce dequoy Plutharque loüe Philopæmen, disant qu’estant nay pour commander, il sçauoit non seulement commander selon les loix ; mais aux loix mesmes, quand la necessité publique le requeroit. Ce que toutefois n’appartient à faire qu’aux grands Magistrats, & Magistratures, comme aux Cours souueraines, & encores auec grandes, & mœures deliberations, la Cour pleine, & toutes Chambres assemblees. Comme il n’appartient qu’aux grands Poëtes d’vser des licences de l’art : tout de mesmes qu’il n’est suportable qu’aux grandes ames, & illustres de se priuillegier au dessus de la coustume. Si quid Socrates & Aristipus contra morem & consuetudinem fecerunt, idem sibi ne arbitretur quilibet licere : magnis enim illi & diuinis bonis hanc licentiam assequebantur. (p. 442, § 24)
Cette longue citation de l’ultime fin du chapitre i.23 des Essais (VS, p. 122-23), attelée à une autre du chapitre i.26 (VS, p. 154), sert à faire mieux comprendre dès lors l’agencement de toute cette partie si importante des Parlemens : de part et d’autre du noyau central charronien, mais tout imprégné d’un esprit montaignien, des sections empruntées directement aux Essais concentrées sur des personnages de statut aussi bien philosophique que politique, Julien l’Apostat, Lysandre et Philopœmen, et partant sur leur qualité d’exceptions comme sur les entorses qu’ils font subir à tout système de sagesse simpliste. Les personnages se font signe, fût-ce de loin, si bien que Montaigne encadre toute la réflexion par La Roche Flavin sur la nature et l’opération de la prudence, de même qu’au milieu, dans l’articulation de la culture de soi, son influence se fait
sentir par les formulations de son disciple et imprime à tout l’épisode son caractère philosophique18. Le tout se déroule, cependant, dans le plus strict anonymat qui requiert la complicité du lecteur pour reconnaître le jeu d’appropriation et de réorganisation opéré par le magistrat toulousain.
En elle-même, cette démarche n’a rien d’insolite chez La Roche Flavin et il serait parfaitement possible de répéter le même exercice sur d’autres occurrences prises dans les Parlemens : les rapports avec les travaux d’un Pasquier, d’un Du Tillet ou d’un Du Haillan ont déjà été remarqués, par exemple19, et la récolte intertextuelle serait certainement plus riche encore pour l’ensemble des Parlemens. L’essentiel n’est toutefois pas là. Il réside plutôt, en premier lieu, dans la façon dynamique dont le président au parlement de Toulouse reprend sur nouveaux frais la pratique de l’allusion et de la citation en faisant de son texte un basculement entre lecture avouée et lecture cachée, avec une préférence nette pour celle-ci. Notre auteur est parfaitement capable de mettre côte à côte un passage comportant une référence précise et une autre, puisée ailleurs dans le corpus montaignien, mais vierge de tout renvoi ; au lecteur de reconnaître l’emprunt, de le repérer parmi les chapitres des Essais et de comprendre le nouvel emploi auquel il sert. Un mouvement en deux temps gère cette technique. L’esprit de synthèse de La Roche Flavin se plaît à regrouper les occurrences d’un motif, souvent parsemées de long en large dans les Essais, pour en faire un ensemble cohérent portant sur un même thème ou message. À la réorganisation d’extraits en suite homogène correspond, par complémentarité plutôt que par succession, la manipulation de séquences textuelles déjà existantes ; le premier moment de la citation montaignienne, directement redevable aux Essais, cède le pas, dans les exemples discutés, devant un hommage fait à l’essayiste à travers Charron, avant de reprendre le dessus de nouveau, dans un jeu intertextuel subtil auquel La Roche Flavin prend plaisir ne serait-ce que parce que cela souligne chaque fois son affiliation intellectuelle. Et s’il ne dresse pas de hiérarchie précise, encore moins d’opposition ou de
contradiction, entre Montaigne et Charron, c’est parce qu’autant il se produit chaque fois une irradiation vers la source, une mise en valeur de l’essayiste bordelais, autant Charron sert de moyen positif de réfraction, de vecteur de valeurs perçues comme montaigniennes et qui constituent dans leur totalité comme un épisode de la réception de l’essayiste en ce début du xviie siècle.
Dans cette orchestration du legs humaniste et surtout juridique, le montage se révèle fondamental en fonction de la stratégie que notre auteur développe. La Roche Flavin aurait-il compris à sa manière la rhapsodie des Essais ? Rien ne l’indique, mais certains éléments le suggèrent. Alors qu’il souhaite pour son livre une approche systématique de son sujet, classée et codifiée, il ne dédaigne pas d’accueillir des saillies de tout genre20, au point que son ouvrage compose des mosaïques textuelles alliant regroupements thématiques et arabesques citationnelles. Entre le code et le palimpseste, entre le tout qui légifère et le morceau qui enrichit et diversifie, il ne choisit ni ne voit la nécessité de choisir, travaillant par accrétions dans une volonté encyclopédique qui ne refuse aucun apport. S’il serait excessif de prétendre que cette entreprise ait pu bénéficier d’un bout à l’autre du mouvement par sauts et gambades des Essais, il est sûr que la structure des Parlemens, abritant en son cœur une réflexion sur la nécessaire constitution intellectuelle de la magistrature, soumet à un examen montaignien les tout faits en la matière et fait preuve d’un travail du jugement et surtout d’un esprit critique qui a valu à l’auteur l’accueil que l’on sait.
Qu’en est-il, pareillement, de la connaissance de soi ? Le terme n’apparaît pas, à la différence de Charron qui le pose comme principe dès les premières pages de la Sagesse21. En revanche, en classant cette activité dans le livre 8 au sein de la prudence du magistrat et en en faisant moins un idéal abstrait qu’une pratique indispensable au bon fonctionnement de la jurisprudence, La Roche Flavin ne fait que prendre à la lettre le précepte de Montaigne, pour qui « prudence n’est autre chose que l’execution de cette ordonnance » (VS, p. 1075), en référence à l’injonction du dieu de Delphes qui imposait à tous le devoir de se connaître. Une fois de plus, il est intéressant de suivre le tracé de ce concept au cours d’une période de vingt-cinq ans : « se cognoistre soy mesme » chez Montaigne (VS, p. 1075), justice envers soi-même chez Charron, prudence pour La Roche Flavin, ce qui correspond à trois destinataires spécifiques, le philosophe, le sage, le magistrat. Loin d’une reproduction passive, tout se passe comme si le parlementaire toulousain découvrait chez le Condomois mué en précédent ou du moins en parallèle des possibilités d’inspiration et d’intégration montaigniennes et appliquait dans son domaine particulier la culture de soi qu’il jugeait convenable à la magistrature. Dans le livre 8 des Parlemens, les qualités de cette dernière sont agencées selon une fonctionnalité charronienne alliée pourtant à un esprit d’enquête, voire de jouissance montaigniennes. C’est là l’une, mais seulement l’une, des voies par laquelle l’essayiste est apprécié dans les premières décennies du xviie siècle22, voie qui relève strictement dans ce cas du milieu juridique et par laquelle La Roche Flavin fait sienne la vision de Montaigne à la fois lue directement dans le texte des Essais et transmise et interprétée par Charron, dans un dialogue permanent entre contemporains et prédécesseurs.
John O’Brien
Royal Holloway,
Université de Londres
1 André Tournon, Montaigne : la glose et l’essai, réédition (Paris : Champion, 2000), p. 382, n. 81.
2 Bernard de La Roche Flavin, Treze Livres des Parlemens de France (Bordeaux : Millanges, 1617), p. 867. Les renvois seront désormais insérés dans le texte et le titre abrégé en Parlemens. Sur cet auteur, on consultera Carole Delprat, « Savoirs et déboires d’un juriste, Bernard de La Roche Flavin », Histoire, économie, société 19/2 (2000), p. 163-84 et « Officiers et seigneurs chez Bernard de la Roche Flavin », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 27 | 2001, mis en ligne le 23 novembre 2008. URL : http://ccrh.revues.org/index1193.html. Consulté le 25 novembre 2011. Sur l’ouvrage, consulter Jacques Krynen, « A propos des Treze livres des parlemens de France », in Les Parlements de province. Pouvoirs, justice et société du xve au xviiie siècle, éd. Jacques Poumarède et Jack Thomas (Toulouse : Framespa, 1996), p. 691-705.
3 Les Essais de Michel de Montaigne, éd. Pierre Villey et V.-L. Saulnier (Paris : PUF, 1965), p. 724. Les renvois seront désormais insérés dans le texte précédés du sigle « VS ».
4 Pour le sujet, voir Carole Delprat, « Magistrat idéal, magistrat ordinaire chez La Roche Flavin : les écarts entre un idéal et des attitudes », in Les Parlements de province, op. cit., p. 707-719 ; Jacques Krynen, « La Roche Flavin et le Barreau », Revue de la Société internationale d’histoire de la profession d’avocat, 10 (1998), p. 49-56
5 Pour une autre occurrence, chez Jean de Coras, voir notre étude, « Comment être un bon juge ? », in La Justice, éd. J.-C. Arnould, BSAM, 8e série, no 21-22 (2001), p. 185-192.
6 Cf. Stéphan Geonget, La Notion de perplexité à la Renaissance (Genève : Droz, 2006), p. 85-89, 155.
7 VS, p. 240. La phrase de départ est subtilement différente : « faisons que nostre contentement despende de nous ; desprenons nous de toutes les liaisons qui nous attachent à autruy, gaignons sur nous de pouvoir à bon escient vivre seuls et y vivre à nostr’aise ».
8 VS, p. 819 : « Le mediter est un puissant estude et plein, à qui sçait se taster et employer vigoureusement : j’aime mieux forger mon ame que la meubler. Il n’est point d’occupation ny plus foible, ny plus forte, que celle d’entretenir ses pensées selon l’ame que c’est. Les plus grandes en font leur vacation, quibus vivere est cogitare. Aussi l’a nature favorisée de ce privilège qu’il n’y a rien que nous puissions faire si long temps, ny action à la quelle nous nous adonons plus ordinairement et facilement. C’est la besongne des Dieus, dict Aristote, de laquelle nait et leur beatitude et la nostre ».
9 Pierre Charron, De la sagesse (Bordeaux : Millanges, 1601), p. 572-573. Ce rapprochement n’a pas été remarqué, pour autant que nous sachions, malgré les études de Christian Belin, L’Œuvre de Pierre Charron (1541-1603). Littérature et religion de Montaigne à Port-Royal (Paris : Champion, 1995) et d’Emmanuel Faye, Philosophie et perfection de l’homme : De la Renaissance à Descartes (Paris : Vrin, 1998).
10 Charron, p. 2 : « Le mediter & entretenir ses pensées est chose sur toutes facile, ordinaire, naturelle, la pasture, l’entretien, la vie de l’esprit, Cuius viuere est cogitare ». Dans l’exemplaire de la deuxième édition de la Sagesse (Paris, 1604), conservé à la Bayerische Staatsbibliothek, cote Ph. Pr. 269, p. 24, le dicton latin est souligné d’une main ancienne, comme aussi à la p. 574 (et d’ailleurs toute cette section).
11 Charron, p. 573.
12 Pour les échos montaigniens, cf. VS, i.53, p. 309 : « le temps que nous mettons à contreroller autruy et à connoistre les choses qui sont hors de nous, que nous l’emploissions à nous sonder nous mesmes » ; ii.1, p. 338 : « il faut sonder jusqu’au dedans » ; iii.3, p. 828 : « Miserable à mon gré, qui n’a chez soy où estre à soy, où se faire particulierement la cour, où se cacher ». Cf. 1 i.39, p. 241 : « nostre ordinaire entretien de nous à nous mesmes ».
13 Cf. Parlemens, p. 372 : « L’experience nous faict voir, que ces grands discours en Grec, en poësie, en histories, & Philosophie, & autres lettres humaines, Nihil habent præter inania verba, & tinnitum verborum ; sans aucune bonne ou solide doctrine du droict, ne saçhant la moindre decision ou resolution d’iceluy. […]. De telles gens ressemblent à vn Roy de tragedie, qui au dehors a vne belle monstre & apparence de Roy, mais despouillé de ces ornemens emprumtés [sic], est quelque chestif & malotru escholier, choisi pour joüer ce personnage, pour sa belle taille, ou targue : ou ressemblent aussi à la teste de marbre du loup d’Aesope, qui estoit fort belle, mais n’auoit point de ceruelle ».
14 Charron, p. 574.
15 Charron, p. 574-77.
16 Sont omises, par exemple, toutes les remarques de Charron sur le doute comme effet de la science : « plustot se tenir au doute en suspens, principalement es choses, qui reçoiuent oppositions & raisons de toutes parts, mal aisées a cuire & digerer, c’est vne belle chose, que scauoir bien ignorer & douter, & la plus seure, de laquelle ont faict profession les plus nobles philosophes, voire c’est le principal effect & fruict de la science » (Charron, p. 575). Ces mots, qui font partie de l’exposé sur l’esprit, ont tout simplement été omis ou supprimés dans les Parlemens, p. 441, §17. Ils n’avaient cependant pas été l’objet des suppressions pratiquées dans les éditions de la Sagesse postérieures à la première de 1601. Ils restent tout aussi inchangés dans l’édition remaniée de 1604.
17 La prudence en tant que première des quatre vertus morales est traitée au début du livre 3 de la Sagesse, p. 458-565.
18 Pour Emmanuel Faye, qui contredit en cela Christian Belin, la Sagesse serait elle-même une philosophie et non pas une théologie : voir Philosophie et perfection de l’homme, Quatrième partie, p. 241-286. La question est de savoir si elle a été reçue comme telle au xviie siècle.
19 Voir François Saint-Bonnet, « Regards critiques sur la méthodologie en histoire constitutionelle. Les destinations téléologiques des options épistémologiques », Jus Politicum 2 (2009), consulté en ligne le 26 novembre 2011, http://www.juspoliticum.com/Regards-critiques-sur-la.html.
20 Un exemple blotti au sein du livre 8, dans la section V du chapitre viii, p. 431 : « Estant remarquable, & digne d’estre icy inserée la tres-belle comparaison qu’vn rare, mais seditieux esprit de nostre temps, a faict du Soleil auec l’homme juste, & equitable, tel que le Magistrat doit estre. Comme le Soleil, dict-il, ne marche que par compas… » etc. Il s’agit de Louis Dorléans, dont l’ouvrage, Les Ouuertures des Parlements (Paris : Des Rues, 1607), fournit la comparaison citée textuellement dans toute son étendue : « Car comme le Soleil ne marche que par compas & par mesure, l’homme iuste dresse toutes ses actions auec la mesure, & la reigle de la raison. Le Soleil n’outre-passe iamais ses bornes, l’homme iuste se tient tousiours dedans les termes &limittes que Dieu luy a prescrites. Le Soleil ne seiourne iamais plus en vne maison qu’en l’autre, l’homme iuste, ne fauorise en iustice, non plus le grand que le petit. Le Soleil lance sa clarté sur les bons &mauuais : aux mauuais & aux bons, le iuste faict droicture. Et c’est pourquoy le Soleil gouuerne les astres, il regit les elemens, & est le Roy de ce monde sensible, comme le iuste est le Roy de son petit monde, qui commande à ses passions, qui sied sur ses affections, & qui s’affermit aux varietez de la nature, & de qui la puissance ne se meut pour chose qui luy arriue » (fo 505ro-vo). La Roche Flavin discute des ouvertures des Parlements dans le livre 5.
21 Charron, p. 1 : « Le plus excellent & diuin conseil, le meilleur & plus vtile aduertissement de tous, mais le plus mal pratiqué, est s’estudier & apprendre a se cognoistre… » et p. 3, l’exhoration d’Apollon à se connaître, pris dans les Essais, 3.13, VS p. 1075.
22 Il faudrait un jour revoir l’ouvrage pourtant admirable d’Alan Boase, The Fortunes of Montaigne : A History of the « Essays » in France, 1580-1669 (Londres : Methuen, 1935).