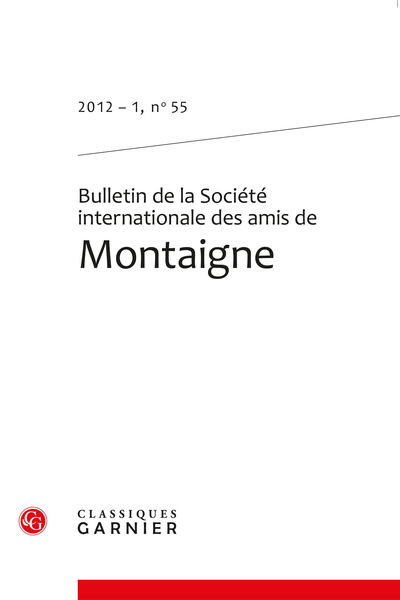
La présomption et la jouissance loyale de soi
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 1, n° 55. varia - Author: Litwin (Christophe)
- Pages: 175 to 195
- Journal: Bulletin for the International Society of Friends of Montaigne
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782812439766
- ISBN: 978-2-8124-3976-6
- ISSN: 2261-897X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-3976-6.p.0175
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 07-25-2012
- Periodicity: Biannual
- Language: French
La présomption
et la jouissance loyale de soi
« La mere nourrice des plus fauces opinions »
Dans le chapitre « De la présomption », Montaigne accorde à ce qu’il appelle ailleurs « nostre maladie naturelle et originelle1 », le rang éminent de principe des dérèglements humains : « La philosophie ne me semble jamais avoir si beau jeu que quand elle combat nostre presomption et vanité, quand elle reconnoît de bonne foy son irresolution, sa foiblesse et son ignorance. Il me semble que la mere nourrisse des plus fauces opinions et publiques et particulières, c’est la trop bonne opinion que l’homme a de soy2. »
La généralité de cette proposition ne laisse pas d’étonner chez un sceptique qui affirme simultanément que « [A] c’est un subject merveilleusement vain, divers, et ondoyant, que l’homme », en lequel « il est malaisé [de] fonder jugement constant et uniforme3 » tant on y trouve « une si extrême variété de jugements, un si profond labyrinthe de difficultés les unes sur les autres4 ». Si comme le dit A. Tournon, « Montaigne élimine assez vite ‘‘l’homme’’, ce fantôme philosophique, pour mettre en question son support du moment, cet x qui pense, parle, écrit, et s’y essaye, reflet en contrechamp saisi à la relecture des “opinions” et “fantasies” qu’il a ‘‘mises en rolle’’, il y a dix ans, ou hier, ou bien à l’instant même où vient de s’immobiliser la plume5 », comment comprendre qu’il
formule une proposition aussi générale s’appliquant à tous les hommes, qui réduit l’ « extrême variété de jugements » à la simplicité de la trop bonne opinion de soi, et qui fait justement de « l’homme » le sujet général et réflexif de cette trop bonne opinion de soi ?
Il faut en revenir à une analyse de l’opinion en général. Celle-ci tend naturellement à confondre le devenir avec l’être, à conférer à ce qui naît et périt, et plus généralement à la « branloire pérenne6 » du monde la stabilité de ce qui est. « Mais qu’est-ce donc qui est veritablement ? Ce qui est eternel, c’est à dire qui n’a jamais eu de naissance, ny n’aura jamais fin ; à qui le temps n’apporte jamais aucune mutation7. » Montaigne s’accorde sur ce point avec l’enseignement de Socrate et la critique platonicienne de l’illusion sensible. L’opinion tend ainsi à se prendre pour ce qu’elle n’est pas, c’est-à-dire pour un savoir, si bien que le sujet de cette opinion se méprend aussi nécessairement sur lui-même. Il a immanquablement, quel que soit le contenu de son opinion, une trop bonne opinion de soi puisque, ignorant son ignorance, il s’arroge abusivement l’accès à ce qui est. C’est en fait déjà l’usage ordinaire du langage qui nourrit, avec la croyance naturelle en sa grammaire et en sa fonction référentielle, l’illusion d’un accès immédiat et premier à l’être. La critique de la présomption ne repose donc pas ici sur quelque savoir d’une propriété essentielle du genre humain, de quelque défaut consubstantiel à l’espèce, jugement qui s’accorderait mal avec la perspective sceptique, mais sur une analyse générale de l’opinion et de son sujet. C’est cette analyse qui permet ici de parler de l’homme sans supposer la connaissance de sa nature ; « l’homme », divers et ondoyant par ses jugements, se méprend sur son être et celui des choses, en tant qu’il est subjectivé par l’opinion.
Mais si Montaigne admire la maïeutique qui désenfle l’opinion en la différenciant du savoir, « l’exercitation » qui fait mener au philosophe « l’humaine vie conformément à sa naturelle condition8 » c’est avec prudence : les « ecstases » et les « démoneries » de Socrate déplaisent autant au sceptique que les « humeurs transcendentes » de Platon l’effraient9.
Car, pour Montaigne, la raison ne nous donne jamais accès qu’à « ce qui soufre mutation », ce qui « ne demeure pas un mesme, et, [qui] s’il n’est pas un mesme, […] n’est donc pas aussi10 ». Ainsi à la différence du Socrate du Phédon, l’âme n’a chez Montaigne aucune réminiscence de son immortalité dans l’exercice de la pensée : « toujours au milieu entre le naistre et le mourir », « nous n’avons aucune communication à l’estre11 ». La connaissance de soi censée remédier à notre présomption n’emprunte donc pas la haute voie de Platon – cette voie qui, parce qu’elle prétend que l’âme du philosophe s’apparente12 aux réalités intelligibles qu’il pense, s’avère encore présomptueuse au regard du sceptique. La véritable connaissance de soi suit au contraire la voie basse et incertaine d’une âme humaine qui ne trouve en elle-même aucun point d’appui ferme, aucune subsistance qui lui permette de s’élever au-dessus de ce milieu entre le naître et le mourir : « Si mon ame pouvoit prendre pied, je ne m’essaierois pas, je me resoudrois13 ».
Dès lors, ce que Montaigne récuse, c’est l’idée que la raison humaine coïncide avec quelque intelligence des Formes, et qu’ainsi le philosophe s’élève en quelque manière au-dessus de sa condition d’homme. Un tel dépassement doit rester l’horizon strict de l’au-delà, du tout-autre, non celui d’une pratique ici-bas, ce que le christianisme peut aider à penser contre une certaine philosophie antique, puisque « c’est à nostre foy Chrestienne, non à sa vertu Stoique, de pretendre à cette divine et miraculeuse metamorphose14 ». Sans toutefois s’appuyer directement sur cette foi, la « basse exercitation » de Montaigne consiste à s’efforcer de vivre cette vie sans détourner les yeux de sa condition, sans prétendre en quelque manière s’y soustraire partiellement, car « chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition15 ».
Cette phrase célèbre pourrait sembler évoquer une formule scolastique faisant de « l’humaine condition » la cause formelle du fait que chaque homme est homme, et c’est ainsi que certains commentateurs
– à commencer par Charron – l’ont interprétée16. Cette hypothèse ne s’accorde cependant pas avec l’affirmation qu’il « n’y a aucune constante existence, ny de nostre estre, ny de celuy des objects17 ». En réalité, la proposition de Montaigne subvertit l’interprétation scolastique du mot « forme », car ce qui caractérise « l’humaine condition » c’est précisément la difformité de chaque homme : ce que chaque homme porte, ce n’est pas quelque essence ou réalité intelligible dont il participerait, mais littéralement la charge pesante18 de l’humaine condition. La forme de cette condition est dite entière, parce qu’on n’en peut rien retirer : on ne peut davantage s’en alléger partiellement qu’on peut partiellement être en communication avec ce qui est, s’affranchir de ce « milieu entre le naître et le mourir ». Mais la trop bonne opinion que l’homme a de soi nourrit justement l’illusion que nous pouvons nous alléger au moins partiellement de cette charge, l’illusion que nous ne sommes pas tout entier ici-bas, que nous échappons en quelque partie à ce lieu.
De la présomption à la jouissance
Cette illusion fait de la présomption un amour de soi décevant19 car « l’homme qui présume de son sçavoir, ne sçait pas encore que c’est que sçavoir », et lui, « qui n’est rien, s’il pense estre quelque chose, se seduit soy mesmes et se trompe20 ». Par cette séduction et cette tromperie de soi-même, parce qu’elle est « naturelle et originelle »,
« nostre maladie » revêt une certaine ressemblance avec l’amor sui de l’humanité pécheresse chez saint Augustin21. Un Charron22, un Pascal, lorsqu’ils citeront Montaigne n’hésiteront d’ailleurs pas à la nommer « amour de soi » ou « amour-propre ». Toutefois, dans les Essais, la trompeuse séduction de la présomption est seulement un effet de l’ignorance. Montaigne ne situe pas le principe de notre dérèglement dans quelque malice originelle du cœur humain, bien plutôt il regarde toujours la malice comme l’effet d’une sottise première : « [A] Je ne pense point qu’il y ait tant de malheur en nous comme il y a de vanité, ny tant de malice comme de sotise : nous ne sommes pas si pleins de mal comme d’inanité ; nous ne sommes pas si miserables comme nous sommes viles23. » Et « ceux-là ont raison qui disent » du vice « qu’il est principalement produict par bestise et ignorance24 ». À cet égard, malgré sa ressemblance avec l’amour-propre augustinien, la présomption est plus proche de cette folie que la Renaissance nomma philautie, et dont J. Mesnard, dans deux articles importants25, a montré les origines platoniciennes.
C’est pourquoi la saine philosophie qui « combat nostre presomption et vanité26 » ne consiste pas en une malheureuse « repentance en l’ame, qui tousjours s’egratigne et s’ensanglante elle-mesme27 ». Estimer trop le repentir, c’est ne pas bien connaître ce qui rend le vice naturellement répugnant
à l’âme28. En ce sens, le repentir est toujours lui-même conditionné par la méconnaissance de soi, la présomption, dont il reproduit la meurtrissure en l’âme humaine au lieu de véritablement la soigner. Donner pour tâche à la philosophie de combattre la malice originelle du cœur humain, le péché qui « loge en nous comme en son propre domicile » serait d’ailleurs parfaitement vain, car « [B] on peut desavouer et desdire les vices qui nous surprennent et vers lesquels les passions nous emportent ; mais ceux qui par longue habitude sont enracinés et ancrez en une volonté forte et vigoureuse, ne sont subjects à contradiction29. » L’entreprise philosophique de Montaigne ne s’attaquera donc pas la malice du cœur de l’homme, mais à cette maladie qui nous empêche de « bien et naturellement sçavoir vivre cette vie » et sous sa forme « la plus sauvage » nous conduit à « mespriser nostre estre30 ».
Cette connaissance de soi ne peut consister pour celui qui l’entreprend à connaître ce qu’il est par l’intelligence, c’est-à-dire à « se résoudre », mais seulement à « s’essayer », à donner une peinture fidèle du « naistre et mourir » qui fait sa condition : « Les traits de ma peinture ne forvoyent pas, quoy qu’ils se changent et se diversifient. […] Je ne peints pas l’être. Je peints le passage : non un passage d’age en autre, ou […] de sept ans en sept ans, mais de jour en jour, de minute en minute31 ». Les traits du pinceau ne peuvent certes qu’esquisser ce passage, mais, sans en reproduire le détail infini, ils en suivent néanmoins un temps, sans dévier, la tendance ponctuelle et instantanée, la différentielle : « Je ne puis asseurer mon object. Il va trouble et chancelant d’une yvresse naturelle. Je le prens en ce point, comme il est, l’instant que je m’amuse à luy32 ». Une copie figurative de l’être serait mensongère d’une part en tant que simulacre, d’autre part parce qu’elle nourrirait l’illusion d’une communication avec ce qui est. Au contraire la fidélité de la peinture au passage mime la loyauté du peintre envers sa naturelle condition.
Encore faut-il pour cela que le peintre ne se place pas lui-même à un point de vue extérieur à cette condition, comme s’il n’en portait pas lui-même la forme entière et n’en était pas aussi le sujet. Parce qu’en outre, sa propre matière est plus commode à examiner qu’aucune autre, l’entreprise d’une peinture fidèle de l’humaine condition fait de soi le sujet privilégié, quoique non exclusif, de l’étude : « Je m’estudie plus qu’autre subject33. ». Aussi le rapport du modèle à la peinture s’inverse-t-il dans cette démarche ; le sujet difforme et constamment changeant de cette étude façonne moins les Essais qu’en retour ceux-ci colorent, informent, règlent et s’approprient la matière monstrueuse et étrange de ce « moy » : « Moulant sur moy cette figure, il m’a fallu si souvent dresser et composer pour m’extraire, que le patron s’en est fermy et aucunement formé soy-mesmes. Me peignant pour autruy, je me suis peint en moy de couleurs plus nettes que n’estoyent les miennes premieres. Je n’ay pas plus faict mon livre que mon livre m’a faict34 ».
Cependant, comme le repentir, la peinture de soi n’est-elle pas conditionnée par le dérèglement auquel elle entend remédier ? Si la « basse exercitation » s’avérait être l’effet, le symptôme de ce qu’elle combat, elle ne serait pas moins vaine et négative que le repentir. Or, l’entreprise de Montaigne n’est certes pas morale, puisqu’il ne s’agit pas de raviver la conscience du mal dans notre volonté, mais son ambition est bien éthique35. Il lui faut dès lors dégager un autre principe, plus « originel et naturel » que « nostre maladie » elle-même. Ce principe, Montaigne semble le trouver dans « cette esjouyssance naturelle » de la vie à laquelle est rappelée l’âme de qui s’essaie. Cette jouissance qui s’approfondit à l’épreuve de la peinture de soi « est le seul payement qui jamais ne nous manque36 » et ne nous fourvoie pas au sujet de notre condition d’homme. La preuve même qu’il s’agit d’un véritable principe, c’est la manière dont cette jouissance autorise le sceptique à réinvestir d’un nouveau sens le lexique de la présomption qu’il a si implacablement critiqué. Nous venons ainsi de voir que la peinture de soi renverse le rapport du modèle à la peinture (puisque c’est la seconde qui façonne le
premier), mais elle le conduit encore à nommer son étude « ma metaphisique », « ma phisique37 », et ainsi à rétablir un certain usage des notions de « propre » (« d’une occupation propre »), de totalité (« membre de ma vie ») et de substance (« livre consubstantiel à son autheur »). La jouissance parfait ce renversement, puisque – avec la réserve d’un « comme » – elle complète ce lexique métaphysique par les notions de perfection absolue, de divinité et, surtout par celle de l’être : « C’est une absolue perfection, et comme divine, de scavoyr jouyr loiallement de son estre38 ». Sauf à admettre que Montaigne se contredit grossièrement39, il faut bien supposer que l’être avec lequel nous ne communiquons pas n’est pas celui dont nous jouissons : le premier a en effet le sens de l’étant subsistant par soi (« Estant hors de l’estre, nous n’avons aucune communication avec ce qui est40 »), non le second. La jouissance se substitue ainsi à la raison pour nous donner à penser un sens d’être qui n’est pas ontique. Ce principe ouvre donc à rien moins qu’une compréhension humaine du sens de l’être dans sa différence avec l’étant. Il ne s’agit bien entendu pas de fonder une nouvelle métaphysique rationnelle, mais néanmoins de dégager, à partir de la jouissance, un usage légitime et propre du lexique métaphysique que la critique de la présomption a préalablement disqualifié. C’est en approfondissant l’interprétation de cette jouissance que nous cernerons mieux cette compréhension originale de l’être.
Le normal et le pathologique
Notons d’abord que le concept de cette jouissance permet de résoudre une difficulté centrale de l’entreprise de Montaigne. En effet, en montrant que l’humaine condition ne peut être ramenée à la constance et à l’uniformité d’aucune règle, d’aucune véritable nature ou essence de l’homme, la critique sceptique risque de dissoudre tout critère permettant
de distinguer en droit pour l’homme le normal et l’anormal. De fait, chaque homme, par sa difformité, revêt pour Montaigne quelque chose de monstrueux. À l’inverse, « [C] ce que nous appelons monstres, ne le sont pas à Dieu, qui voit en l’immensité de son ouvrage l’infinité des formes qu’il y a comprinses ; et est à croire que cette figure qui nous estonne, se rapporte et tient à quelque autre figure de mesme genre inconnu à l’homme. De sa toute sagesse il ne part rien que bon et commun et reglé ; mais nous n’en voyons pas l’assortiment et la relation41. » La raison ne nous laisse pas connaître a priori une forme de l’humanité, mais elle ne nous permet pas non plus d’induire de la répétition de cas que nous jugeons semblables par l’effet de la coutume, une distinction objective entre ce qui est normal et ce qui ne l’est pas. Ce que nous jugeons « anormal » selon l’observation coutumière, ce n’est qu’une incongruité dans le cours très limité de notre expérience particulière, qu’une anomalie statistique sur un nombre de cas sans proportion avec la diversité infinie de l’univers. Qu’il soit souvent plus prudent de s’en remettre à la coutume pour régler nos vies, ne change pas qu’elle ne fournit pas de critère permettant de distinguer objectivement ce qui est bien réglé ou normal de ce qui est déréglé et pathologique. Or quel sens Montaigne donnerait-il à sa propre entreprise éthique, à sa manière de combattre en lui « nostre maladie naturelle et originelle » s’il ne disposait d’un critère permettant de différencier sinon objectivement, du moins subjectivement, le normal et le pathologique ?
La formulation de cette question fait sciemment référence à un essai de Canguilhem42. Interrogeant le problème de la relation entre la physiologie et la thérapeutique, celui-ci montre que la première (la science qui tente de déterminer quantitativement des constantes du fonctionnement d’un organisme en état de santé) autorise certes l’usage d’un certain concept de « normalité », mais qui demeure purement descriptif. Le contraire de cette « normalité » de la physiologie n’est pas en effet la pathologie, mais seulement ce qu’on appelle une anomalie43 – quelque chose qui s’écarte de la loi statistique que le physiologiste a le plus souvent observée. Dès
lors, puisque l’expérience médicale nous enseigne que l’existence d’une anomalie n’implique pas nécessairement celle d’une pathologie, la physiologie ne parvient pas par elle seule à déterminer le concept de normalité dont a besoin la thérapeutique, bien que celle-là prétende souvent trouver dans la physiologie la science déterminant objectivement et quantitativement ce critère.
Quelle est donc la source du concept normatif de normalité qui commande la thérapeutique, si la science de la physiologie ne rend pas compte par elle-même du passage de l’anomalie statistique à la pathologie ? Ce critère ne relève pas d’une mesure objective et quantitative selon Canguilhem, mais bien de l’expérience même de la vie : « C’est la vie elle-même et non le jugement médical qui fait du normal biologique un concept de valeur et non un concept de réalité statistique44. » Loin de pouvoir trouver la différence entre le normal et le pathologique dans une mesure objective qu’établirait primordialement notre raison, ou encore de pouvoir simplement l’établir comme un écart quantitatif par rapport à une constante statistique, il faut considérer que c’est dans l’expérience de la vie elle-même, entendue comme activité normative45, polarisée, spontanément productrice de valeurs que se situe l’intelligibilité première de cette distinction : « On peut décrire objectivement des structures ou des comportements, on ne peut les dire ‘‘pathologiques’’ sur la foi d’aucun critère purement objectif. Objectivement, on ne peut définir que des variétés ou des différences, sans valeur vitale, positive ou négative46. » C’est ainsi la vie elle-même qui, comme activité normative, est l’origine première pour Canguilhem de l’invention de techniques thérapeutiques : « Toute technique humaine, y compris celle de la vie, est inscrite dans la vie, c’est-à-dire dans une activité d’information et d’assimilation de la matière47. Ce n’est pas parce que la technique humaine est normative que la technique vitale est jugée telle par comparaison. C’est parce que
la vie est activité d’information et d’assimilation qu’elle est la racine de toute activité technique48. »
Ce détour par les travaux de Canguilhem éclaire bien notre problème : ce n’est pas parce qu’il n’existe pas de règle extérieure pouvant servir de norme pour juger de notre condition que la différence entre un état normal et un état pathologique de notre condition doit être abolie. Si c’est une erreur pour la thérapeutique de croire que l’origine de la différence entre le normal et le pathologique réside dans les fonctions que détermine la physiologie, c’est parce que « la vie elle-même, par la différence qu’elle fait entre ses comportements propulsifs et ses comportements répulsifs, […] introduit dans la conscience humaine les catégories de santé et de maladie. Ces catégories sont biologiquement techniques et subjectives et non biologiquement scientifiques et objectives. Les vivants préfèrent la santé à la maladie. Le médecin a pris parti explicitement pour le vivant, il est au service de la vie, et c’est la polarité dynamique de la vie qu’il traduit en parlant de normal et de pathologique49. » Il n’y a pas d’autre source possible pour connaître la différence entre un état normal et un état pathologique de notre condition que l’expérience même de la vie.
Cette comparaison nous aide à comprendre qu’il n’y a pas de contradiction entre le rejet montaignien d’une essence ou d’une nature de l’homme qui servirait à lui donner généralement sa mesure et la possibilité de penser la présomption comme une maladie, un dérèglement. Ce n’est pas un dérèglement au sens d’un écart par rapport à une norme générale de l’humain : c’est un dérèglement au sens d’une opposition qualitative entre une expérience de jouissance (c’est-à-dire ici de jouissance de l’activité normative qu’est la vie – ce à quoi on donne aussi le nom de santé), et une expérience de cette même activité qui est le « sentiment d’une vie contrariée50 ». Il y aurait ainsi une double analogie : entre le rapport de la santé à la maladie et celui de la jouissance à la présomption d’une part ; entre le rapport de la thérapeutique à la physiologie et celui de l’éthique à la coutume d’autre part.
Conservation politique et jouissance éthique
Les analyses de Canguilhem nous permettent cependant d’aller plus loin. Le propre de l’état pathologique, constate en effet Canguilhem, n’est pas la pure cessation du processus vital de production de normes et de règles, mais plutôt un affaiblissement de notre capacité à produire des normes vitales adaptées aux variations des conditions de notre expérience : « La maladie est encore une norme de vie, mais c’est une norme inférieure en ce sens qu’elle ne tolère aucun écart des conditions dans lesquelles elle vaut, incapable qu’elle est de se changer en une autre norme. Le vivant malade est normalisé dans des conditions d’existence définies et il a perdu la capacité normative, la capacité d’instituer d’autres normes dans d’autres conditions51. » La normativité propre à l’état pathologique pouvant moins s’adapter aux variations des conditions, elle produit des effets différents de ceux d’une régulation saine et est vécue comme un mal-être. Elle n’est pas une simple variation quantitative des normes propres à l’état de santé, mais bien un processus de régulation qualitativement distinct : « la maladie n’est pas une variation sur la dimension de la santé ; elle est une nouvelle dimension de la vie52. » Cette régulation qualitativement distincte est celle d’une vie contrariée, dont le comportement n’est plus propulsif, mais tente d’abord de stabiliser son état et de se conserver. Alors que, selon Canguilhem, « la santé, au sens absolu, n’est pas autre chose que l’indétermination initiale de la capacité d’institution de nouvelles normes biologiques53 », la normativité de l’état pathologique se caractérise d’abord et avant tout par la recherche de la stabilisation de son état. Si elle innove, c’est péniblement, pour se conserver, non pour jouir activement de soi comme puissance auto-normative. Ainsi, si elle devait s’avérer irrémédiable, « nostre maladie originelle et naturelle » ne nous empêcherait pas de vivre, mais condamnerait, la perspective d’une régulation de la vie nous reconduisant à un état sain, où nous pourrions jouir de notre capacité d’institution de nouvelles normes. Nous serions condamnés à une vie
qui parviendrait à se régler, mais en pâtissant toujours des effets négatifs et pénibles de sa propre normativité, sans jamais vraiment jouir de soi comme activité. Nous « régler » reviendrait primordialement à parvenir à stabiliser notre état déréglé, à l’empêcher de se dégrader davantage, mais jamais à le rendre sain – jamais à nous rendre capables de jouir de la vie en notre condition, de jouir loyalement de notre être.
En fait, ce paradigme d’une normativité propre à l’état pathologique s’applique parfaitement à l’analyse des lois politiques et coutumes sociales54 par Montaigne. Celles-ci ont beau être « ordinairement », « lourdement et largement » fautières55, « souvent faictes par des sots, plus souvent par des gens qui, en haine d’equalité, ont faute d’équité, mais tousjours par des hommes, autheurs vains et irresolus56 », malgré leurs effets potentiellement dérégulateurs et corrupteurs, malgré l’absence de justice dans leur conception et l’injustice ordinaire de leur effet, il importe qu’elles se maintiennent en crédit, car elles règlent au moins de façon externe et supplétive57 les effets négatifs de l’humaine présomption, préservent le corps socio-politique de plus graves désordres civils, d’où ne pourraient résulter des lois mieux fondées.
Si l’idée d’une régulation propre à l’état pathologique s’applique bien à l’espace socio-politique, c’est cependant celle d’une régulation propre à un état sain qui convient à l’éthique, car, ayant « mes loix et ma court pour juger de moy », si l’ordre social fait que « je restrains bien selon autruy mes actions », « je ne les estends que selon moy ». La jouissance n’est pas au principe de la première restriction, mais elle est en revanche au principe de cette extension « selon moy », puisque « c’est une vie exquise, celle qui se maintient en ordre jusques en son
privé58 ». On peut dire en somme que la jouissance offre le critère censé distinguer le sain gouvernement de soi selon des « lois éthiques » d’un gouvernement des autres selon des lois et coutumes dont toute la fonction est la conservation du corps socio-politique malade : « Puisque les loix ethiques, qui regardent le devoir particulier de chacun en soy, sont si difficiles à dresser, comme nous voyons qu’elles sont, ce n’est pas merveille si celles qui gouvernent tant de particuliers le sont d’avantage. Considerez la forme de cette justice qui nous regit : c’est un vray tesmoignage de l’humaine imbecillité, tant il y a de contradiction et d’erreur. Ce que nous trouvons faveur et rigueur en la justice, et y en trouvons tant que je ne sçay si l’entredeux s’y trouve si souvent, ce sont parties maladives et membres injustes du corps mesmes et essence de la justice59 ». La jouissance, par opposition à la seule conservation, définit donc bien l’horizon strictement éthique de l’entreprise de Montaigne.
La mort et le cheval échappé
Cependant, les lecteurs augustiniens de Montaigne – et Pascal le premier – récusent l’idée que cette jouissance humaine puisse être saine hors de la foi, pareille thèse étant incompatible avec leur rigoureuse interprétation du péché originel. Dans l’Entretien avec M. de Sacy, Pascal réduit ainsi les Essais à leur versant sceptique ; ils échoueraient à déboucher sur une saine éthique, car « éprouvant la misère présente et ignorant la première dignité » de l’homme, Montaigne « traite la nature comme nécessairement infirme, et irréparable, ce qui le précipite dans le désespoir d’arriver à un véritable bien, et de là dans une extrême lâcheté60 ». Ce que conteste en fait Pascal, c’est l’idée que la règle de vie de l’éthique de Montaigne soit qualitativement distincte de celle propre à un état pathologique. Comme la coutume, cette règle de vie serait prise dans un « renversement continuel du pour au contre61 » : elle serait
bonne en ce qu’elle tend à conserver l’existence humaine en bornant la force qui la dissout, mais tout aussi bien malsaine, car symptomatique de la maladie et négative par certains effets. C’est que, pour Pascal, sans le secours de la foi, le regard de l’homme sur sa condition lui rend insupportable son existence, car sentant alors « son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide », « il sortira du fond de son âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir » (Fr. 622 [131]). Au-delà de la question théologique, l’enjeu est en fait le suivant : la jouissance recherchée par Montaigne est-elle compatible avec la connaissance de notre condition ? Or, « si notre condition était véritablement heureuse il ne faudrait pas nous divertir d’y penser » (Fr. 70 [165bis]) : le divertissement est bien ce remède courant, naturel et humain à l’ennui, mais ce remède est aussi bien le symptôme de la pathologie. Montaigne jouit, mais il ne peut le faire loyalement, et supporter la vue de sa condition sans s’en détourner. C’est ce que révéleraient « ses sentiments tout païens sur la mort » « qu’on ne peut excuser ». Parce qu’il veut « mourir lâchement et mollement par tout son livre » (Fr. 680 [63]) son attitude serait au fond pareille à celle de cet « homme dans un cachot, ne sachant si son arrêt est donné, n’ayant plus qu’une heure pour l’apprendre » qui emploierait ce temps « non à s’informer si l’arrêt est donné, mais à jouer au piquet » (Fr. 63 [200]). Pour Pascal, notre connaissance de la différence qualitative entre santé et dérèglement n’aurait pas pour origine l’expérience d’une jouissance de notre être dans notre condition, mais le ressouvenir, ranimé par le don de la foi, de notre première nature – avant le péché. La seule vraie thérapeutique62 serait chrétienne, et celle de Montaigne fausse, parce que païenne.
Ce reproche de vouloir « mourir lâchement et mollement par tout son livre » peut surprendre le lecteur des Essais. Cela s’applique certes bien en apparence à cette méthode que Montaigne appelle « diversion63 », qui consiste à détourner l’imagination de l’objet qui jette l’esprit dans un état de torpeur, et peut, lorsqu’elle trouve appui en la religion substituer
à la terreur de certains devant l’échafaud, une « ardente dévotion » : « ils destournent de la mort leur consideration, comme on amuse les enfans pendant qu’on leur veut donner le coup de lancette64 ». Mais à l’opposé de cette méthode inconstante (« On les doit louer de religion, mais non proprement de constance »), Montaigne ne défend-il pas ailleurs une préparation à la mort qui, à l’opposé du « remède du vulgaire » qui est « de n’y penser pas », fait d’une pensée incessante du « but de nostre carriere » « le refrein de la souvenance de notre condition65 » ? C’est oublier qu’un « des principaux bienfaicts » de cette préparation pour Montaigne est « le mepris de la mort, moyen qui fournit nostre vie d’une molle tranquillité, nous en donne le goust pur et amiable, sans qui toute autre volupté est esteinte66 ». Aussi est-ce déjà par un mouvement interne à la préparation à la mort que celle-ci n’apparaît plus tant comme le but de la vie, que comme son « bout », et qu’une fois la mort méprisée, il cesse d’être utile de « l’avoir tousjours devant les yeux67 ». La préparation du philosophe paraît ainsi revenir circulairement à celle du vulgaire qu’il critiquait. Faut-il cependant conclure de l’instabilité même des manières dont Montaigne approche la question de sa mort, selon les états et les circonstances variables de la vie, que précisément son entreprise ne parvient jamais qu’à tourner autour du problème qui l’occupe, qu’à s’en détourner au moment où elle se concentre dessus ? Est-ce l’indice que Montaigne, comme le veut Pascal, se trouve pris malgré lui dans le vain jeu du divertissement et de l’ennui ?
Nous aimerions suggérer le contraire à partir d’une expérience décisive dont Montaigne fait le récit et qui, selon lui, apprend au « cheval échappé68 » de son esprit à jouir de son être sans se détourner de sa condition. Une violente chute de cheval69, raconte Montaigne, le jeta dans un état d’inconscience, puis de semi-conscience qu’il peint comme une
approximation de la mort. Dans cet état de « défaillance des sens » où « l’âme ne peut maintenir aucune force au-dedans pour se reconnoistre » (375), « je me vy tout sanglant » et « la premiere pensée qui me vint, ce fut que j’avoy une harquebusade en la teste » (374). La violence de cette image ne s’accompagne cependant ici d’aucune sensation de douleur ou de répulsion, mais au contraire par le sentiment doux et languissant d’une vie prête à expirer : « Il me sembloit que ma vie ne me tenoit plus qu’au bout des lèvres : je fermois les yeux pour ayder, ce me sembloit, à la pousser hors, et prenois plaisir à m’alanguir et à me laisser aller. C’estoit une imagination qui ne faisoit que nager superficiellement en mon ame, aussi tendre et aussi foible que tout le reste, mais à la verité non seulement exempte de desplaisir, ains meslée à cette douceur que sentent ceux qui se laissent glisser au sommeil ». (374). Montaigne décrit ainsi son âme « en songe, touchée bien legierement, et comme lechée seulement et arrosée par la molle impression des sens. Cependant mon assiete estoit à la vérité tres-douce et paisible ; je n’avoy affliction ny pour autruy ny pour moy : c’estoit une langueur et une extreme foiblesse, sans aucune douleur. […] Je me laissoy couler si doucement et d’une façon si douce et si aisée que je ne sens guiere autre action moins poisante que celle-là estoit » (376-377).
Ce sentiment d’une vie qui ne tient qu’au bout des lèvres de Montaigne est donc tout à fait sans douleur et sans trouble. Le champ lexical de la liquidité et de la légèreté du contact entre l’âme et le monde (l’écoulement lent, doux et paisible de l’âme, la fine bruine de la molle impression des sens qui la touche légèrement, la lèche etc.) exprime une durée sans heurt, une tranquillité dont aucun événement, pas même la vue d’une « harquebusade en la teste » ou l’agitation des proches tout autour, ne vient troubler la continuité. L’expérience de cet écoulement70 de la vie est « moins poisante » que toute autre action, comme si justement la « forme entière de l’humaine condition » ne pesait pas en elle. La douceur propre à ce sentiment est inséparable d’une étrange passivité du sujet de cette affection. Le discernement de ses sens évoque un songe, un flottement de l’imagination (« une imagination qui ne faisoit que nager superficiellement en mon ame ») dans lequel l’âme n’a pas encore la force de
se reconnaître, non plus que de s’affliger, de s’opposer en elle-même un véritable objet, ou de se constituer véritablement comme volonté. Elle est un laisser-être qui s’apparente à une rêverie. Mais qu’est-ce justement que ce sentiment qui se tient entre la vie et la mort, et où l’âme est encore trop faible pour se subjectiver, tout en demeurant dans le flottement de son imagination ? Si l’âme ici sent, sans avoir cependant la force de se subjectiver, de se reconnaître – c’est-à-dire de se regarder comme au point de vue d’un autre, de se représenter à soi –, c’est qu’en elle une nature s’affecte qui est ce que Friedrich a appelé « la couche profonde, prévolitive, de l’individualité71 ». Cette nature s’affecte ici dans un flottement de l’imagination : elle subjective déjà l’esprit sans qu’il se subjective activement, par sa volonté, en propre. Il s’agit bien en quelque sorte d’un « moi », mais d’un moi passif, incapable de se constituer comme une volonté, de véritablement s’opposer à des représentations extérieures. Cette expérience d’approximation de la mort met ainsi au jour que la constitution de l’esprit en sujet actif est elle-même un phénomène de surface par rapport à cette auto-affection singulière d’une nature en « moi », dans ce flottement de l’imagination.
Convoquons ici un éminent lecteur des Essais. Dans la « Deuxième Promenade » des Rêveries, Rousseau raconte ainsi comment, revenant de Ménilmontant, après une après-midi passée à herboriser sur les hauteurs, à se promener en s’abandonnant à une rêverie automnale, contemplative et mélancolique sur sa vie, il vit fondre sur lui un gros chien danois qui le renversa violemment. L’état de semi-conscience qu’il décrit à l’éveil de sa chute rappelle intimement les descriptions de Montaigne72 malgré sa singularité73. On retrouve la même perte
de mémoire et d’identité ; la même complète absence de trouble et de douleur ; le même calme détaché de cette âme que n’alarme pas la vue de son sang ; la même continuité sans heurts de l’écoulement de la durée ; la même idée enfin qu’il n’existe aucun sentiment plus agréable que cette langueur : « Tout entier au moment présent je ne me souvenais de rien ; je n’avais nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de m’arriver ; je ne savais ni qui j’étais ni où j’étais ; je ne sentais ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je voyais couler mon sang comme j’aurais vu couler un ruisseau, sans songer seulement que ce sang m’appartînt en aucune sorte. Je sentais dans tout mon être un calme ravissant, auquel chaque fois que je me le rappelle, je ne trouve rien de comparable dans toute l’activité des plaisirs connus74. »
Toutefois, Rousseau ne peint pas cet état de rêverie comme une approximation de la mort, mais comme une naissance à la vie : « La nuit s’avançait. J’aperçus le ciel, quelques étoiles, et un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais encore que par-là. Je naissais dans cet instant à la vie, et il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que j’apercevais75. » Le texte exprime bien la même dimension de songe que celui de Montaigne, la même passivité flottante et délicieuse d’un moi qui se donne et se confond avec une auto-affection de la vie, la même in-séparation première d’avec une quelconque extériorité (s’il y a des objets aperçus, ils sont immédiatement remplis de ma légère existence). En chacune de ses phrases, l’opposition entre le « je » (« je remplissais ») et la vie, « ma légère existence », paraît s’être effacée. « Je naissais dans cet instant à la vie » peut aussi bien s’inverser ici en « la vie dans cet instant me faisait naître à moi ». Il y a une passivité originaire donatrice de la singularité de ce « je », mais d’un « je » qui est incapable de s’auto-subjectiver, de s’opposer à lui-même un quelconque dehors ou de se représenter à lui-même. Cette passivité n’est pas celle de l’âme en tant qu’elle serait affectée par les objets extérieurs, mais celle du moi dans la durée de cette auto-affection de la vie à laquelle il naît76. Rousseau,
après Montaigne, y situe la jouissance d’un « moi » sans amour-propre. Le jouir de son être de Montaigne se traduit chez lui par l’expression : « sentiment de l’existence ».
Au regard de cette expérience où l’auto-affection de la vie me fait naître avant que je ne me constitue en propre, l’esprit apercevrait sa propre activité sur le fond de cette jouissance première de son être. L’essai consisterait à faire sentir à l’esprit – en mettant « en rolle » ce « cheval échappé », en lui faisant honte – ce que, à être hors de soi, il ne goûte plus : cette auto-affection de la vie. Si la pensée de la mort fait toujours naturellement horreur à l’esprit (l’esprit se sentant exister au moment où il s’efforce de prendre pour objet la suppression même de ce sentiment) en l’arrimant à cette auto-affection de la vie, ce qui lui donne à présent sa règle n’est pas en lui-même conditionné par cette angoisse. L’esprit n’est pas en lui-même complètement guéri de son angoisse, mais le principe qui le règle, à mesure qu’il se « contre rolle » sur le registre des Essais, la jouissance même de la vie peut bien être dit sain.
Rousseau a peut-être consigné en une dense formule ce qui lie ainsi l’art de « jouir loyalement de son être » et la peinture de soi, l’entreprise de « tenir un registre fidèle de mes promenades solitaires et des rêveries qui les remplissent quand je laisse ma tête libre, et mes idées suivre leur pente sans résistance et sans gêne », de laisser son cœur se « nourrir de sa propre substance », et « chercher sa pâture au-dedans de moi77 » :
Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je sois pleinement moi et à moi sans diversion, sans obstacle, et où je puisse véritablement dire être ce que la nature a voulu78.
Être pleinement moi, c’est-à-dire tout entier à la vie, sans extériorité ; être pleinement à moi sans diversion, c’est-à-dire aussi bien sans divertissement, mais aussi sans ennui, sans m’aliéner en quelque manière dans le on d’une autre conscience qui jetterait la distance infranchissable de la représentation entre moi et moi-même. Etre ce que la nature a voulu, c’est-à-dire non pas d’abord ce que, de façon active, le moi veut,
mais ressaisir mon être à partir du sentiment de l’existence et de ses modifications, à partir de la manière dont la vie, en s’auto-affectant, me subjective. Tel serait, relu avec Rousseau, le principe de l’éthique des Essais, le principe sain capable de tenir la bride au cheval échappé de l’esprit, rappelé dans sa rêverie au service de la vie.
Christophe Litwin
EHESS-NYU
1 E, II, XII, 452.
2 E, II, XVII, 634.
3 E, I, I, 9.
4 E, II, XVI, 634.
5 A. Tournon, « L’humaine condition : Que sais-je ? Qui suis-je ? » (in M.-L. Demonet (dir.), Montaigne et la question de l’homme, PUF, 1999, p. 20).
6 E, III, II, 804.
7 E, II, XII, 603
8 E, III, II, 809.
9 Cf. E, III, XIII, 1115. Sur le scepticisme de Montaigne, cf. F. Brahami, Le scepticisme de Montaigne, Paris, PUF, 1997 et Le travail du scepticisme. Montaigne, Bayle, Hume, Paris, PUF, 2003.
10 E, II, XII, 603.
11 E, II, XII, 601. Sur ce point, cf. F. Brahami, « Pourquoi prenons-nous titre d’être ? Pensée de soi et pensée de Dieu chez Montaigne et Descartes » in Revue de métaphysique et de morale, 1/2006, p. 21-39.
12 Cf. Platon, Phédon, 105a-e.
13 E, III, II, 805.
14 E, II, XII, 603-604.
15 E, III, II, 809.
16 J.-Y. Pouilloux, dans « La forme maîtresse » [in M.-L. Demonet (dir.), Montaigne et la question de l’homme, PUF, 1999, p. 37] fait un point critique sur ces interprétations. Nous souscrivons à l’ensemble des conclusions de cet article. Le mot forme ne peut renvoyer à l’ousia aristotélicienne en son sens générique. J.-L Marion dans « Qui suis-je pour ne pas dire ego sum, ego existo ? » (in V. Carraud et J.-L. Marion (dir.), Montaigne : scepticisme, métaphysique, théologie, PUF, 2004, p. 248-255) tente en revanche de rapprocher le sens de cette « forme entière » d’une ousia au sens premier, c’est-à-dire rapportée à l’individu.
17 E, II, XII, 601.
18 Lorsqu’il décrit la « science » de Socrate qui consiste à « mener l’humaine vie conformément à sa naturelle condition », Montaigne la qualifie de « générale », « poisante », « legitime » (E, III, II, 809 ; nos italiques).
19 Voir le mot de Pantagruel dans le Tiers Livre (in Rabelais, Les Cinq Livres, éd. J. Céard et ali, La pochothèque, 1994, 29, 9) : « Philautie et amour de soy vous deçoit ».
20 E, II, XII, 449.
21 Peu avant de décrire la présomption comme « notre maladie naturelle et originelle », Montaigne appuyait sa méthode pour rabattre la raison des athées sur le modèle de l’évêque d’Hippone : Cf. E, II, XII, p. 449 : « [C] Car Sainct Augustin, plaidant contre ces gens icy, a occasion de reprocher leur injustice ».
22 Cf. Pierre Charron, Traité de la sagesse (1601) : « Mais sur toutes passions se faut très soigneusement garder et deslivrer de cette philautie, présomption et folle amour de soy-mesme ; peste de l’homme, ennemy capital de la sagesse, vraye gangrene et corruption de l’ame, par laquelle nous nous adorons et demeurons tant contens de nous, nous nous escoutons et nous croyons nous-mesmes. » (Texte cité dans H.-J. Fuchs, Entfremdung und Narzissmus, Stuttgart, 1977, p. 128).
23 E, I, L, 303.
24 E, III, II, 806.
25 Cf. « Les origines grecques de la notion d’amour-propre » et « Sur le terme et la notion de ‘‘philautie’’ » in J. Mesnard, La culture au xviie siècle, PUF, 1992. On consultera aussi P. Force, Self-Interest before Adam Smith. A Genealogy of Economic Science, Cambridge UP, 2003 (en particulier le chapitre 2 : “Epicurean vs. Stoic Schemes”, p. 48 sq.) et D. Weber, Hobbes et le désir des fous, Paris, 2007 (en particulier le chapitre 1, « Le désir et le calcul de la puissance », p. 25 sq.).
26 E, II, XVII, 634.
27 E, III, II, 806.
28 Sur le repentir (ou la repentance) chez Montaigne, cf. F. Rigolot, L’Erreur de la Renaissance, Paris, 2002, p. 79sq. ; F. Rigolot, « La pente du repentir », in D. Frame et M. McKinley (dir.) Columbia Montaigne Conference Papers, 1981, p. 119-134 ; D. Frame, « Observation sur le chapitre Du Repentir », in C. Blum & F. Moureau (dir.), Études montaignistes en hommage à P. Michel, Genève, 1984, p. 103-110.
29 E, III, II, 808.
30 E, III, XIII, 1110.
31 E, III, II, 804-805.
32 E, III, II, 805.
33 E, III, XIII, 1072.
34 E, II, XVIII, 665.
35 Cf. E, III, XIII, 1070 où Montaigne parle des « loix ethiques, qui regardent le devoir particulier de chacun en soy. » Nous revenons sur ce texte plus bas.
36 E, III, II, 807.
37 E, III, XIII, 1072.
38 E, III, XIII, 1115.
39 J-L. Marion a bien cerné cette difficulté dans « Qui suis-je pour ne pas dire ego sum, ego existo ? » (in Montaigne : scepticisme, métaphysique, théologie, Op. cit., p. 259-260).
40 E, I, III, p. 17 (nos italiques).
41 E, II, XXX, 713.
42 G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, PUF, 1966. Nous emploierons dorénavant l’abréviation NP.
43 Sur cette question de la différence entre anomalie et pathologie, voir en particulier NP, p. 81.
44 NP, p. 81.
45 Cf. NP, p. 77 : « Par normatif, on entend en philosophie tout jugement qui apprécie ou qualifie un fait relativement à une norme, mais ce mode de jugement est fond subordonné à celui qui institue des normes. Au sens plein du mot, normatif est ce qui institue des normes ».
46 NP, p. 153.
47 On notera que cette « activité d’assimilation et d’information de la matière » correspond exactement à la description de l’action des Essais sur la matière « consubstantielle » de leur auteur.
48 NP, p. 80.
49 NP, p. 150.
50 Cf. NP, p. 85 : « L’anormal ce n’est pas le pathologique. Pathologique implique pathos, sentiment direct et concret de souffrance et d’impuissance, sentiment de vie contrariée. Mais le pathologique c’est bien l’anormal » (nous soulignons).
51 NP, p. 119-120.
52 NP, p. 122.
53 NP, p. 129.
54 La métaphore médicale appliquée au politique est aussi omniprésente chez La Boétie. Cf. De la servitude volontaire, Droz, 1987, p. 40, 55, 68, 70. Sur le discours politique de Montaigne, on consultera à profit l’ouvrage sous la direction de Ph. Desan, Montaigne politique, Champion, 2006. On consultera aussi les articles suivants de F. Brahami, « Montaigne et la politique » in Bulletin de la Société des amis de Montaigne, VIII/33-34, janvier-juin 2004, p. 15-37 et « Théories sceptiques de la politique : Montaigne et Bayle », dans The Return of Scepticism. From Hobbes and Descartes to Bayle, (sous la dir. de G. Paganini) in International Archives of the History of Ideas, Kluwer Academic Publishers, 2003, p. 377-392.
55 E, III, XIII, 1073.
56 E, III, XIII, 1072.
57 Nous empruntons cette idée que les lois, coutumes, religions, croyances sociales sont des « règles supplétives externes » à B. Sève (Montaigne. Des règles pour l’esprit, PUF, 2007, p. 179 sq.).
58 E, III, II, 808-809 pour toutes ces dernières citations.
59 E, III, XIII, 1070.
60 Entretien avec M. de Saci, in Pascal, Œuvres complètes, Seuil, 1963, p. 296b.
61 Pensées, Fr. 93 [328]. Le premier numéro suit la classification Lafuma, le second celle de Brunschvicg.
62 P. Magnard (cf. Pascal. La clé du chiffre, La Table Ronde, rééd. 2007, p. 170) a parfaitement raison d’interpréter le problème de Pascal non pas comme un questionnement sur l’existence de Dieu, mais comme la recherche d’une « thérapeutique » et d’une « grande santé » pour l’homme.
63 J. Mesnard a montré l’importance de la diversion dans l’élaboration du concept de divertissement chez Pascal. Cf. « De la diversion au divertissement » in La culture du xviie siècle, op. cit.
64 Montaigne, Les Essais, III, 4, p. 833.
65 E, I, 20, 84-86 pour ces dernières citations.
66 E, I, 20,86.
67 E, III, 12, 1051. L’instabilité des positions de Montaigne face à la mort dans les Essais reflète moins une contradiction qu’un mouvement naturel de sa pensée déjà perceptible dans la préparation.
68 E, I, 8, 33.
69 E, II, 6, p. 370 sq. Le récit de la chute de Montaigne dans « De l’exercitation » occupe les pages 373-377. Cette chute est provoquée par l’échappée d’un autre cheval, « à toute bride », ce qui est la métaphore courante de l’esprit dans les Essais.
70 Le contraste avec Pascal est saisissant quand on lit le Fr. 757 [212] intitulé « L’écoulement » : « C’est une chose horrible de sentir s’écouler tout ce qu’on possède ».
71 H. Friedrich, Montaigne, trad. R. Rovini, Gallimard, 1968, p. 292.
72 Cf. Rousseau, Rêveries, OC I, Gallimard, 1957, p. 1003-1007. Plusieurs commentateurs ont fait remarquer après R. Osmont l’écho manifeste de ces deux textes (cf. OC I, p. 1005, n. 2). Cf. Laurent Jenny, L’expérience de la chute de Montaigne à Michaux, p. 55-62. Pour un commentaire minutieux de la chute de Rousseau, voir aussi P. Audi, Rousseau : une philosophie de l’âme, Verdier, 2007, p. 94-104. Sur l’importance de la lecture de Montaigne dans la maturation de l’œuvre de Rousseau, et les nombreux échos qu’on y retrouve, on pourra aussi consulter les entrées « Rousseau » du Dictionnaire de Michel de Montaigne coordonné par Ph. Desan et « Montaigne » du Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau sous la direction de R. Trousson et F. Eigeldinger. Nous utilisons par la suite l’abréviation R pour faire référence aux Rêveries dans l’édition de la Pléiade.
73 Cf. R, p. 1005 : « L’état auquel je me trouvai encore lorsque je revins à moi est trop singulier pour n’en pas faire ici la description ».
74 R, p. 1005.
75 R, p. 1005
76 Cf. P. Audi, Rousseau : une philosophie de l’âme, Op. cit., p. 84 : « Non seulement l’âme est passible par essence, mais les affections qu’il arrive à tout moment à cette âme d’éprouver tirent d’elles-mêmes leur substance d’une passivité encore plus fondamentale que la passivité éprouvée par l’âme qui reçoit (ou subit) une affection extérieure. »
77 R, p. 1002.
78 R, p. 1002.