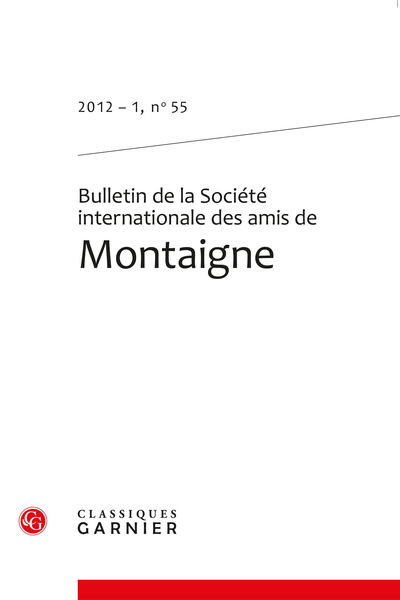
La palinodie de Montaigne : « De l’yvrongnerie »
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 1, n° 55. varia - Auteur : McKinley (Mary B.)
- Pages : 211 à 220
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439766
- ISBN : 978-2-8124-3976-6
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3976-6.p.0211
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/07/2012
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
La palinodie de Montaigne :
« De l’yvrongnerie »
Au début de l’essai « De l’yvrongerie » Montaigne prolonge l’argument de l’essai précédent, « De l’inconstance de nos actions », premier chapitre du Livre II. En observant les êtres humains, il y avait constaté qu’il « se trouve autant de différence de nous à nous mesmes, que de nous à autruy. » (II,1,337a) Par sa première phrase, « De l’yvrongnerie » semble continuer ce discours : « Le monde n’est que variété et dissemblance » (339a. Mais dans cet essai Montaigne va plus loin. Il met en scène sa propre inconstance. Le Montaigne de la fin est différent de celui du début ; il fait volte-face sur son sujet. Mais si ce revirement a l’air d’être provoqué par « le vent des occasions » (333a), ce n’est pas le cas. L’auteur retrace un chemin défini depuis l’Antiquité.
Après l’observation générale de la première phrase, Montaigne choisit le vice pour focaliser le problème de l’inconstance. « Les vices sont tous pareils », mais il y en a qui sont plus graves que les autres. Pour avancer une hiérarchie des vices, il invoque l’autorité d’Horace et répète la leçon des Satires : « Il n’est pas croyable… que le sacrilege ne soient pire que le larrecin d’un chou de nostre jardin » (II,2,339a). La distinction entre le sacrilège et le chou volé introduit la polarité entre le sacré et le profane, le céleste et le terrestre. En passant au sujet annoncé par le titre, Montaigne reste carrément au niveau terrestre ; pour décrire l’ivrognerie il se sert d’un lexique qui ne peut être plus profane :
Or l’yvrongnerie, entre les autres, me semble un vice grossier et brutal. L’esprit a plus de part ailleurs ; et il y a des vices qui ont je ne sçay quoy de genereux, s’il le faut ainsi dire. Il y en a où la science se mesle, la diligence, la vaillance, la prudence, l’adresse et la finesse ; cettuy-cy est tout corporel et terreste. Aussi la plus grossière nation de celles qui sont aujourd’huy, est celle là seule qui le tient en credit. Les autres vices alterent l’entendement ; cettuy-cy le renverse, [B] et estonne le corps :
cum vinis vis penetravit,
Consequitur gravitas membrorum, praepediuntur
Crura vacillanti, tardescit linqua, madet mens,
Nant oculi ; clamor, singultus, jurgia, gliscunt. (II,2,340a-b)
Montaigne offre une hiérarchie des vices qui excuse ou diminue la sévérité de certains vices de l’esprit. Sans préciser quels sont ces vices (« ailleurs », « je ne sçay quoy », « il y en a ») il les associe à des vertus. L’ivrognerie est, par contre, un vice « grossier et brutal ». Si l’esprit n’y agit pas, il en reçoit les effets nocifs ; l’entendement est altéré et renversé. Comme un chou enraciné dans le jardin, l’ivrogne, « tout corporel et terreste, » est pris dans la terre. Montaigne n’a pas adouci cette position dans ses ajouts à ce début du chapitre. Il a ajouté les mots « et estonne le corps » après 1580 avec les quatre vers de Lucrèce (III, 475) qui affirment l’effet nocif du vin sur le corps. Le même ton péremptoire marque la phrase ajoutée après 1588 : « Le pire estat de l’homme, c’est quand il pert la connoissance et gouvernement de soy » (340c).
Montaigne fait un inventaire des effets nuisibles de l’ivrognerie : le vin délie la langue : « le vin faict desbonder les plus intimes secrets à ceux qui en ont pris outre mesure » (340a). Après 1588 il ajoute une série d’anecdotes qui soulignent le pouvoir destructeur d’un excès de vin : Pausanias, qui, ayant trop bu, s’est abandonné « aux muletiers et au nombre d’abjects serviteurs de sa maison » ; et la veuve connue pour sa chasteté qui, suite d’avoir trop bu et à son insu, devient enceinte d’un de ses laboureurs.
Vers le milieu de l’essai de 1580, Montaigne reconnaît que sa position est plus sévère que celle des Anciens.
Il est certain que l’antiquité n’a pas fort descrié ce vice. Les escris mesmes de plusieurs Philosophes en parlent bien mollement ; et, jusques aux Stoyciens, il y en a qui conseillent de se dispenser quelque fois à boire d’autant et de s’enyvrer pour relâcher l’ame. (342a)
En invoquant l’autorité des Anciens, il commence à parler plus mollement de l’ivrognerie. Il reconnaît que même Caton, « la vraye image de la vertu stoïque, » avait la réputation « de bien boire » (342), et il admet que dans les sociétés les plus réglées, les festins étaient « fort en usage. »
« Mon goust et ma complexion est plus ennemie de ce vice que mon discours. Car, outre ce que je captive aysément mes creances soubs l’authorité des
opinions anciennes, je le trouve bien un vice lâche et stupide, mais moins malicieux et dommageable que les autres, qui choquent quasi tous de plus droit fil la societé publique. Et si nous ne nous pouvons donner du plaisir, qu’il ne nous couste quelque chose, comme ils tiennent, je trouve que ce vice coute moins à nostre conscience que les autres ; outre ce qu’il n’est point de difficile apprest, et malaisé à trouver, considération non mesprisable » (342a).
C’est ici – à peu près au milieu de l’essai – que Montaigne donne l’ajout le plus long du chapitre. Il y a de l’inattendu, même de l’étonnant, dans ce passage qui vire loin du sujet de l’ivrognerie. Montaigne montre qu’il en reconnaît le caractère digressif en le terminant par les mots : « Revenons à noz bouteilles. » Je reviendrai à ce passage, mais pour le moment je suivrai Montaigne au retour à son sujet. À partir de ce retour il ne s’agit plus de l’ivrognerie ni de vice. L’ivrognerie cède à l’ivresse. La deuxième moitié de l’essai devient d’abord une défense modérée du vin pour aboutir à une exaltation du délire.
Montaigne constate que le vin est une des rares consolations de la vieillesse.
Les incommoditez de la vieillesse, qui ont besoing de quelque appuy et refrechissement, pourroyent m’engendrer avecq raison desir de cette faculté : car c’est quasi le dernier plaisir que le cours des ans nous dérobe. La chaleur naturelle, disent les bons compagnons, se prent premierement aux pieds : celle là touche l’enfance. De là elle monte à la moyenne region, où elle se plante long temps et y produit, selon moy, les seuls vrais plaisirs de la vie corporelle : [c] les autres voluptez dorment au pris. [a] Sur la fin, à la mode d’une vapeur qui va montant et s’exhalant, ell’ arrive au gosier, où elle faict sa derniere pose. (344a-c)
Ce passage trace un mouvement de la jeunesse à la vieillesse, mais en même temps un mouvement du bas en haut du corps, partant des pieds et s’arrêtant à la gorge, le lieu du plaisir qu’offre le vin aux vieux. Il rappelle ainsi la distinction au début du chapitre entre les vices de l’esprit et ceux qui sont, comme l’ivrognerie, corporels et terrestres. L’ivrognerie de la vieillesse, installée ici au gosier, est toujours un phénomène du corps ; mais si la montée en haut s’arrête ici, on est au moins arrivé à la tête, et l’esprit n’est pas loin.
Ce n’est pas surprenant si ces observations sur la vieillesse inspirent des réflexions personnelles chez Montaigne, qui exprime ailleurs dans les Essais le sentiment d’être sur sa propre fin et le regret de la chaleur
« de la moyenne région ». Ici il remarque que son estomac ne lui permet pas de boire « outre la soif » ; il ne boit qu’après avoir mangé ; et, comme les Grecs et les Allemands, son dernier coup est le plus grand. Ces révélations de sa propre expérience l’amènent à Platon, et la défense du vin commence à se transformer en éloge.
Platon defend aux enfans de boire vin avant dix-huict ans, et avant quarante de s’enyvrer ; mais à ceux qui ont passé les quarante, il ordonne de s’y plaire ; et mesler largement en leurs convives l’influence de Dionysius, ce bon dieu qui redonne aux hommes la gayeté, et la jeunesse aux vieillards, qui adoucit et amollit les passions de l’ame, comme le fer s’amollit par le feu. Et en ses loix trouve telles assemblées à boire (pourveu qu’il y aie un chef de bande à les contenir et regler) utiles, l’yvresse estant une bonne espreuve et certaine de la nature d’un chascun, et quand et quand propre à donner aux personnes d’aage le courage de s’esbaudir en danses et en la musique, choses utiles et qu’ils n’osent entreprendre en sens rassis. Que le vin est capable de fournir à l’ame de la temperance, au corps de la santé. (345c)
Dans les Lois, Livre II, l’Athénien prescrit l’usage réglé des banquets dans la société.
L’essai « De l’yvrongnerie » s’inscrit dans la tradition littéraire du banquet humaniste, ce symposium d’œuvres dans lesquelles les convives mangent, boivent et discutent ensemble, explorant et élaborant leurs idées tout en évoquant des modèles de l’Antiquité classique1. Par des citations et des allusions, directes ou obliques, l’essai de Montaigne devient un banquet auquel il invite Sénèque, Lucrèce, Horace, Virgile, Juvénal et d’autres Anciens qui ont fait du vin un sujet de leurs écrits. Son modèle principal est Platon, le Platon du Banquet, mais aussi celui des Lois et, au fur et à mesure qu’il avance vers la fin de son essai, de l’Ion et surtout du Phèdre.
Montaigne offre quelques exemples de conduite extraordinaire face à la douleur, d’abord celle des martyrs qui se moquent de leurs bourreaux, et il y voit un transport de l’esprit qu’il appelle une fureur : « certes il faut confesser qu’en ces ames là il y a quelque alteration et quelque fureur, tant sainte soit elle. » Il les associe aux Stoïques qui se vantent de préférer la douleur à la volupté : « qui ne juge que ce sont boutées d’un courage eslancé hors de son giste ? Nostre ame ne sçauroit de
son siege atteindre si haut. Il faut qu’elle le quitte et s’esleve, et, prenant le frein aux dents, qu’elle emporte et ravisse son homme si loing qu’apres il s’estonne luy-mesme de son faict … » Il voit un phénomène pareil dans la conduite de certains soldats : « comme, aux exploits de la guerre, la chaleur du combat pousse les soldats genereux souvent à franchir des pas si hazardeux, qu’estant revenuz à eux ils en transissent d’estonnement les premiers » (347a). Le lexique de ces exemples ultimes fait écho du lexique de Platon quand il parle des furor, ces transports d’inspiration divine qui ravissent l’esprit hors du corps, « son siège ». La voix de Platon devient plus claire dans les deux derniers exemples et la conclusion de l’essai :
comme aussi les poëtes sont espris souvent d’admiration de leurs propres ouvrages et ne reconnoissoient plus la trace par où ils ont passé une si belle carrière. C’est ce qu’on appelle aussi en eux ardeur et manie. Et comme Platon dict que pour neant hurte à la porte de la poësie un homme rassis, aussi dit Aristote que aucune ame excellente n’est exempte de meslange de folie. Et a raison d’appeler folie tout eslancement, tant loüable soit-il, qui surpasse nostre propre jugement et discours. D’autant que la sagesse c’est un maniment reglé de nostre ame, et qu’elle conduit avec mesure et proportion, et s’en respond. [c] Platon argumente ainsi, que la faculté de prophetizer est au dessus de nous ; qu’il nous faut estre hors de nous quand nous la traittons : il faut que nostre prudence soit offusquée ou par le sommeil ou par quelque maladie, ou enlevée de sa place par un ravissement céleste.
L’essai se termine par une évocation de l’extase, la condition qui dépasse la raison et la sagesse, où l’esprit est ravi du corps, « hors de nous », ek stasis. C’est ce que Socrate appelle le délire.
Par la structure de son essai, Montaigne invite le lecteur à suivre une trajectoire familière aux lecteurs de Platon. Il commence par le « corporel et terrestre », le vice « grossier et brutal », pour aboutir à « un ravissement céleste », les derniers mots de l’essai. Il évoque ainsi le récit de Diotime qui raconte le mouvement de l’âme qui monte l’échelle de l’amour dans le Banquet. La structure de l’essai rappelle surtout celle du Phèdre avec la fameuse palinodie de Socrate2. Sur les bords du fleuve Ilyssos, Phèdre raconte à Socrate le discours qu’il vient d’entendre de l’orateur Lysias, discours paradoxal sur le thème de l’amour. Socrate
répond au rapport enthousiaste de Phèdre en critiquant le discours de Lysias. Il offre à son tour un discours qui accuse l’amant parce que sa raison a été vaincue par la folie. Son discours, comme celui de Lysias, n’est qu’un exercice de rhétorique sophistique qui ne traite que de l’amour « corporel et terrestre ». Ces deux discours sont un prétexte pour ouvrir la discussion du vrai amour et de la bonne rhétorique, la raison d’être du dialogue. À midi, ayant terminé son discours, Socrate est sur le point de partir, quand son démon, cette voix divine qui intervient pour le tirer de l’erreur, le saisit et lui fait reconnaître que par son discours il a offensé Eros. Socrate évoque Stésichore, le poète aveuglé pour avoir diffamé Hélène. Pour recouvrer sa vue, instruit par les Muses, il a écrit une palinodie qui commence ainsi : « ce récit n’est pas vrai3 ». Socrate dit à Phèdre : « avant qu’Eros me punisse de l’avoir diffamé, je vais lui offrir ma palinodie4 ». Pour expier sa faute, il fait un nouveau discours dans lequel il loue l’Amour. Il commence par défendre le délire : « le délire est pour nous la source des plus grands biens, quand il est l’effet d’une faveur divine. » (Phèdre, 244a ; 122-23) Socrate décrit plusieurs genres de délire, dont le premier est le don de prophétie, celui que cite Montaigne à la fin de son essai : « C’est dans le délire, en effet, que la prophétesse de Delphes et les prêtresses de Dodone ont rendu maints éminents services à la Grèce, tant aux États qu’aux particuliers ; de sang froid, elles n’ont guère, ou n’ont point été utiles. » Il souligne la supériorité du délire par rapport à la sagesse : « au témoignage des anciens, le délire l’emporte en noblesse sur la sagesse, le don qui vient des dieux sur le talent qui vient de l’homme. » Le troisième délire est le furor poeticus, le délire essentiel à l’inspiration poétique que Platon défend dans l’Ion. « Il y a une troisième espèce de possession et de délire, celui qui vient des Muses. Quand il s’empare d’une âme tendre et pure, il l’éveille, la transporte, lui inspire des odes et des poèmes de toute sorte. » Socrate insiste sur la nécessité de ce transport : « Mais quiconque approche des portes de la poésie sans que les Muses lui aient soufflé le délire, persuadé que l’art suffit pour faire de lui un bon poète, celui-là
reste loin de la perfection, et la poésie du bon sens est éclipsée par la poésie de l’inspiration. » ([245a], 123). Quand dans la conclusion de son essai Montaigne écrit, « Platon dict que pour neant hurte à la porte de la poësie un homme rassis », et quand il évoque l’extase des prophètes, il invite ses lecteurs à reconnaître dans « De l’yvrongnerie » son imitation du dialogue de Platon et de la palinodie de Socrate. Montaigne retrace le mouvement de l’esprit de Socrate, son point de départ une condamnation, sa conclusion un éloge. Socrate le fait par la voie de l’amour ; Montaigne par la voie du vin. Montaigne part d’une attaque de l’ivrognerie pour arriver à un hymne à l’ivresse. D’un homme rassis il devient un homme ravi.
Je retourne au milieu de l’essai, au long passage que Montaigne a ajouté après 1588. Il y encourage une consommation voluptueuse du vin, sans restreintes. « La delicatesse y est à fuyr et le soingneux triage du vin… Il faut avoir le goust plus láche et plus libre. Pour estre bon beuveur, il ne faut le palais si tendre ». Boire en abondance n’est plus grossier et dégoûtant. C’est une voie au plaisir. « Le plaisir, duquel nous voulons tenir compte au cours de nostre vie, doit en employer plus d’espace. Il faudroit, comme des garçons de boutique et gents de travail, ne refuser nulle occasion de boire et avoir ce desir tousjours en teste ». Ces réflexions l’amènent à une nostalgie du passé avec le regret que sa génération à présent a moins de festins que celle de son enfance. « Mais c’est que nous nous sommes beaucoup plus jettez à la paillardise que noz peres. Ce sont deux occupations qui s’entrepeschent en leur vigueur » (343c). Cette juxtaposition incompatible de l’ivrognerie et de la paillardise lui inspire un souvenir de son père.
C’est merveille des comptes que j’ay ouy faire à mon pere de la chasteté de son siecle. C’estoit à luy d’en dire, estant tresadvenant, et par art et par nature, à l’usage des dames. Il parloit peu et bien ; et si mesloit son langage de quelque ornement des livres vulgaires, sur tout Espaignols, luy estoit ordinaire celuy qu’ils nomment Marc Aurelle. La contenance, il avoit d’une gravité douce, humble et tres-modeste. Singulier soing de l’honnesteté et decence de sa personne et de ses habits, soit à pied, soit à cheval. Monstrueuse foy en ses parolles, et une conscience et religion en general penchant plustost vers la superstition que vers l’autre bout. Pour un homme de petit taille, plein de vigueur et d’une stature droitte et bien proportionnée. D’un visage aggreable, tirant sur le brun. Adroit et exquis en tous nobles exercices. J’ay veu encore des cannes farcies de plomb, desquelles on dict qu’il exerçoit ses bras pour
se preparer à ruer la barre ou la pierre, ou à l’escrime, et des souliers aux semelles plombées pour s’alleger au courir et à sauter. Du primsaut il a laissé en memoire des petits miracles. Je l’ai veu, par delà soixante ans, se moquer de noz alaigresses, se jetter avec sa robbe fourrée sur un cheval, faire le tour de la table sur son puce, ne monter guere en sa chambre sans s’eslancer trois ou quatre degrez à la fois. Sur mon propos, il disoit qu’en toute une province à peine y avoit-il une femme de qualité qui fut mal nommé ; recitoit des estranges privautez, nommeement siennes, aveq des honnestes femmes sans soupçon quelconque. Et de soy, juroit sainctement estre venu vierge à son mariage ; et si avoit eu fort longue part aux guerres delà les monts, desquelles il nous a laissé, de sa main, un papier journal suyvant poinct par poinct ce qui s’y passa, et pour le publicq et pour son privé.
Aussi se maria-il bien avant en aage, l’an 1528 – qui estoit son trente-troisiesme – retournant d’Italie. Revenons à noz bouteilles. (343-344c)
Cette introduction du père ici est étonnante. Le fils commence sur un ton de respect sinon de révérence en énumérant ses qualités de caractère : douceur, gravité, humilité, honnêteté, réserve dans sa parole – pour passer à un témoignage d’adresse « en tous nobles exercices » et terminer par une suite étourdissante d’images de dextérité, « de petits miracles ». Le châtelain se transforme en saltimbanque. Le portrait de Pierre d’Eyquem est une épreuve de la crédulité du lecteur. Est-ce que le lecteur est censé croire qu’un homme de trente-trois ans, « estant tresadvenant, et par art et par nature, à l’usage des dames » et admis aux « estranges privautez » avec elles, est arrivé vierge à son mariage ? Le père, que vient-il faire dans « De l’yvrongnerie » ?
Pierre Eyquem arrive à la charnière des deux parties de l’essai, à l’endroit où la sobriété commence à laisser sa place au délire. Dans la structure de l’essai il occupe le même endroit que celui du démon de Socrate dans le Phèdre. À la fin de son premier discours, celui contre l’amour, Socrate explique à Phèdre, « Au moment où j’allais passer la rivière, mon bon ami, j’ai senti le signal divin qui m’est familier et qui m’arrête toujours au moment où je prends une résolution, et j’ai cru entendre une voix qui me défendait de partir avant d’avoir fait une expiation, comme si j’avais commis quelque faute envers la divinité » (242b-c ; 120-21). Montaigne a introduit le passage avec Pierre juste après avoir avoué que « Mon goust et ma complexion est plus ennemie de ce vice que mon discours, » et que l’ivrognerie, en tant que vice est « moins malicieux et dommageable que les autres » (342a). Il commençait
à comprendre que son discours, sa raison, étaient trop sévères, et qu’il avait été injuste envers l’ivrognerie. Socrate précise que, juste avant de reconnaître son démon, pendant qu’il faisait son discours, il avait le vague sentiment d’avoir fait une faute : « quelque chose me troublait depuis un moment ». Le démon s’étant déclaré, Socrate peut avouer : « Je me rends compte à présent de ma faute » (242c ; 120). L’apparition de Pierre Eyquem marque le moment où Montaigne reconnaît son erreur et où il voit qu’il pourra « avecq raison » louer l’ivresse (344a).
Montaigne déclare ailleurs son admiration pour le Phèdre et, en particulier, pour sa structure. « J’ay passé les yeux sur tel dialogue de Platon mi party d’une fantastique bigarrure, le devant à l’amour, tout le bas à la rhetorique » (III,9,994c). C’était peut-être au moment qu’il raconte ici, quand il lisait le Phédre, que Montaigne a eu l’inspiration de faire intervenir son père entre les deux parties de son essai. Ce qu’il admire dans le dialogue rappelle ce qu’il a admiré chez son père : « J’ayme l’alleure poetique, à sauts et à gambades. [c] C’est une art, comme dict Platon, legere, volage, demoniacle » (994b-c). Il y a, en effet, quelque chose de léger, de volage, et même de démoniaque dans les sauts et gambades que fait Pierre Eyquem : « Du primsaut il a laissé en memoire des petits miracles » (344). D’après ce que dit son fils, malgré ses soixante ans passés, il ne semble pas avoir perdu « la chaleur naturelle » qui anime les pieds des jeunes. Montaigne fait une analogie entre de tels mouvements imprévus et la forme d’une œuvre écrite :
Il est des ouvrages en Plutarque où il oublie son theme, où le propos de son argument ne se trouve que par incident, tout estouffé en matiere estrangere ; voyez ses alleures au Daemon de Socrate. O Dieu, que ces gaillardes escapades, que cette variation a de beauté, et plus lors que plus elle retire au nonchalant et fortuite (994c).
Il allègue l’ouvrage de Plutarque comme un exemple d’une œuvre où l’unité et la cohérence ne sont pas évidentes5. Mais si cet exemple sert à décrire et surtout à défendre la dispositio d’un bon nombre de ses essais, y compris « De la vanité », il ne décrit pas celle de son essai « De l’yvrongnerie. » Celui-là suit fidèlement le modèle des deux discours de Socrate.
Cette manière de voir « De l’yvrongnerie » nous oblige à retourner au début de l’essai et au début de notre discussion. Il y faut revenir sur l’idée que le Montaigne de cet essai est inconstant. Car si Montaigne ouvre son essai sous le signe de l’inconstance, et s’il se met en scène comme en étant un exemple, ce n’est pas la faute du « vent des occasions ». C’est pour bien jouer le rôle de Socrate. Montaigne reste constant dans son dessein. Par ces ajouts après 1588, Montaigne fait tout pour accentuer la structure palinodique de son essai, son revirement d’une condamnation de l’ivrognerie au début à un éloge de l’ivresse à la fin. Il ajoute la phrase « Le pire estat de l’homme, c’est quand il pert la connoissance et gouvernement de soy » (340c) vers le début pour renforcer le négatif. Cette phrase contredit l’affirmation du délire à la fin, affirmation qu’il souligne en ajoutant au délire des poètes, fin de l’essai en 1580, le délire de la prophétie et l’image finale du ravissement céleste (348c). Et c’est après 1588 qu’il a eu l’idée géniale d’introduire Pierre Eyquem au point tournant de son essai, afin d’y installer le démon de Montaigne.
Mary McKinley
Université de Virginie
1 Dans Les Mets et les Mots, banquets et propos de table à la Renaissance, Paris, Corti, 1987, Michel Jeanneret présente cette tradition comme elle se manifeste en France au xvie siècle.
2 Voir Olivier Guerrier, Quand « les poètes feignent » : « fantasie » et fiction dans les Essais de Montaigne, Paris, Champion, 2002, 96-98.
3 D’où le titre de l’excellente étude de Martha C. Nussbaum sur ce dialogue, « “This Story Isn’t True” : Poetry, Goodness and Understanding in Plato’s Phaedrus », in Plato on Beauty, Wisdom and the Arts, ed. J. Marancsik and P. Timko, Roaman and Littlefield, 1982, 79-124.
4 Platon, Le Banquet et Phèdre, [243b], trad. Emile Chambry, Paris, Garnier-Flammarion, 1964, 121.
5 Mais voir O. Guerrier, 91-93 ; et André Tournon, Montaigne, la glose et l’essai, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1983, 143-44.