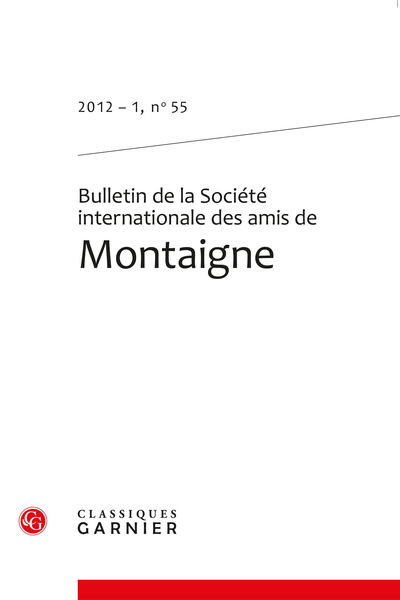
La mort de La Boétie
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 1, n° 55. varia - Auteur : Casals Pons (Jaume)
- Pages : 37 à 42
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439766
- ISBN : 978-2-8124-3976-6
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3976-6.p.0037
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/07/2012
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
La mort de La Boétie1
La mort soudaine de La Boétie, due probablement à quelque sorte de dysenterie, laisse une empreinte indélébile sur l’auteur des Essais. Montaigne fait sentir l’inutilité d’un projet littéraire comme son livre, si ce n’était que ce livre, bien que mauvais remplaçant, lui rappelle la parole singulière et commune, parole sans fin, qu’il aurait bien voulu continuer à entretenir avec son ami. Montaigne travaille sur la mort de l’ami de la même façon qu’Achille tue des Troyens, traîne avec envie le cadavre d’Hector, ou invite aux jeux autour du bûcher de Patrocle. Le deuil réclame ce « ne pas pouvoir rester impassible » devant la mort de l’être aimé. Dans le cas de La Boétie, l’héroïcité suggérée par ses 33 ans (l’âge de la mort de Jésus, ou de l’empereur Julien, comme l’ont souligné plusieurs biographes, n’est pas indifférent à l’auteur des Essais) trouve un écho dans la description détaillée et complexe que Michel, qui accompagne le moribond pendant les derniers jours, fait juste après dans une lettre très complète à son père, Pierre Eyquem2.
Le texte de la lettre réfléchit, à la mode des textes épistolaires entre notables ou savants, l’idée d’une narration adressée à un public intéressé, parmi lequel monsieur le père n’était que le premier lecteur et, en même temps, la seule épaule consolatrice que Montaigne avait à portée. Ce qui a intéressé d’abord les lecteurs de ce formidable document n’appartient pas pourtant à la partie plus émotive et singulière de son contenu. Car l’objet principal et plus apparent de son récit (à une époque où, pour Montaigne, les Essais ne pouvaient pas se concevoir ni même comme un projet imaginaire) semble être la présentation de certaine attitude robuste de La Boétie vis-à-vis de la peur d’une mort imminente. De telle façon que le tremblement craintif qui flotte sur le fond de la lettre s’abîme tout-de-suite, aux yeux du lecteur, sous le poids de l’instinct stoïcien que l’auteur veut nous signaler comme principale vertu du cœur de son ami.
Nous avons signalé ailleurs, essayant de pénétrer les différences entre la commentatio mortis chez Platon et Cicéron, le sujet du modèle socratique et de l’évangile chrétien comme, en quelque sorte, des figures antithétiques au moment d’envisager vraisemblablement la mort. Pour nous, il n’y a pas de doute que Montaigne cherche, dans cette lettre, l’acheminement de La Boétie vers la figure de l’imitatio Socratis. Pendant qu’ils conservent l’intelligence suffisante pour maîtriser leurs paroles, ni Montaigne ni La Boétie ne souhaitent une mort résignée et un transit docile vers la nouvelle vie. Ils cherchent au contraire une image qui reste. Ils veulent s’assurer une âme bien fixée comme « concept de la vie d’un grand homme ». Bref, ils sont concernés par la raison, le renom, ce qui reste du mort. Ce qui s’en va, en supposant que quelque chose s’en aille, ne semble pas beaucoup les concerner.
Il est bien évident que La Boétie et Montaigne ne pensent ni se comportent en termes d’une antiquité pure. Ils appartiennent au temps de la religio et supposent une autre vie après la mort, la transcendance. Ils n’ont même pas l’intuition d’une issue contraire à celle du discours de la mort chrétienne dessiné sur le plafond d’un au-delà qui assure la continuité de la justice divine. Mais, dans la lettre, cet au-delà brille par son absence : on le suppose presque trop évidemment, on le néglige3.
Le courant qui les emporte est, au contraire, le fondement du monde, la raison commune, ce qui peut être sollicité ou appris à ceux qui restent. Et le plus grave c’est la constatation que le cœur de leur foi réside dans ce qui se rapporte aux autres qui doivent rester : c’est celle-là toute la divinité qu’ils sont intéressés à considérer dans l’événement critique, singulier, irrévocable dont ils s’occupent.
Une bonne partie du récit de Montaigne parle des leçons et conseils de son ami pour la direction de la vie des jeunes de sa famille, le remerciement gentil de ses proches et la volonté de consolation qu’il exprime pour le difficile confort de sa femme et de son oncle. Les moments qu’ils passent seuls ensemble ont quelques notes d’évocation de la philosophie et la culture comme assaisonnement du sentiment amical, maintenant aiguisé par la menace de la séparation définitive. Ici luit une grande sérénité, l’auto-contrôle, même quelque sens de l’humour et de la distance. La Boétie est oint bien sûr par un pathos classique, et Montaigne se consacre habilement à faire coïncider tout cela avec l’image d’une mort héroïque à la Socrate. Mais, même à la limite de l’agonie, le sujet de la lettre ne s’écarte point de l’apprentissage de la mort caractéristique du Phédon platonicien.
Estant desja bien voisin de sa mort, & oyant les pleurs de Madamoiselle de la Boëtie, il l’appella, & luy dit ainsi : « Ma semblance, vous vous tourmentez avant le temps : voulez-vous pas avoir pitié de moy ? Prenez courage. Certes je porte plus la moitié de peine, pour le mal que je vous vois souffrir, que pour le mien : & avec raison : par ce que les maux que nous sentons en nous, ce n’est pas nous proprement qui les sentons, mais certains sens que Dieu a mis en nou : mais ce que nous sentons pour les autres, c’est par certain jugement & par discours de raison, que nous le sentons. Mais je m’en vais ». Cela disoit il, par ce que le cueur luy failloit. Or ayant eu peur d’avoir estonné sa femme, il se reprint & dist : « Je m’en vais dormir, bon soir ma Femme, allez vous en ». Voila le dernier congé qu’il print d’elle. Apres qu’elle fut partie : « Mon frere, me dit-il, tenez vous au pres de moy, s’il vous plaist ». Et puis, ou sentant les poinctes de la mort plus pressentes & poignantes, ou bien la force de quelque medicament chaud qu’on luy avoit fait avaller, il print une voix plus esclatante & plus forte, & donnoit des tours dans son lict avec tout plein de violence : de sorte que toute la compagnie commença à avoir quelque esperance, par ce que jusques lors la seule foiblesse nous l’avait fait
perdre. Lors entre autres choses il se print à me prier & et reprier avecques une extreme affection, de luy donner une place : de sorte que j’eus peur que son jugement fust esbranlé. Mesmes que luy ayant bien doucement remonstré, qu’il se laissoit emporter au mal, & que ces mots n’estoient pas d’homme bien rassis, il ne se rendit point au premier coup, & redoubla encores plus for : « Mon frere, mon frere, me refusez-vous doncques une place ? ». Jusques à ce qu’il me contraignit de le convaincre par raison, & et de lui dire, que puis qu’il respiroit & parloit, & qu’il avoit corps, il avoit par consequent son lieu. « Voire, voire, me respondit-il lors, j’en ay, mais ce n’est pas celuy qu’il me faut : & puis quand tout est dit, je n’ay plus d’estre. – Dieu vous en donnera un meilleur bien tost, luy fis-je. – Y fusse-je desja, mon frere, me respondit-il, il y a trois jours que j’ahanne pour partir ». Estant sur ces destresses il m’appella souvent pour s’informer seulement si j’estois pres de luy. (loc. cit., p. 1360).
Montaigne prend en charge sa confusion devant ce qui semble délirant. Dans cette lettre il laisse à La Boétie une place, bien qu’il la camoufle par son paternalisme dans ce délire final. Il ne s’agit pas exactement de la place qu’il lui réclame, mais d’une place parfois différente dans laquelle se tenir en dehors du conventionnel, comme cela convient à un héros. « Le discours de la consolation de Dieu… Bien sûr, semble accorder Étienne, il y a déjà trois jours que je gémis pour en finir ; je voudrais pourtant rester à côté de toi. » La Boétie demande d’être âme dans le sens platonicien du terme amplement connu : forme, image complète, renom, mémoire, amitié, semence, forment un continu sémantique proche à la psykhe des philosophes athéniens classiques. Il demande donc une présence de son imminente absence, que l’ami lui offre dorénavant une place dans sa vie.
L’amitié baigne sans doute ce livre singulier dont le titre n’est pas encore celui d’un genre littéraire, mais un appel au labeur de la pensée comme un ensemble de lectures et intentions sans limite invitant à la connaissance de soi : prolongations de l’expérience vers un usage fantastique qui retombent dans la vie, on pourrait dire. Largement connue et étudiée est l’absence flagrante du Discours de la servitude volontaire au milieu du premier livre des Essais. Flagrante l’est aussi bien par la présence dans les éditions en vie de Montaigne des sonnets de son ami que par le programme de l’absence de ces vers dans les annotations de l’exemplaire de Bordeaux. Vingt-neuf poèmes (après rayés) à la place du chapitre 29 (marqué par erreur 28 dans la première édition) signalent quelque anomalie, et les explications du chapitre contigu « De l’amitié »
sont assez explicites pour donner quelque vraisemblance à tout ce qu’on a pu écrire (même dans le bêtisier) sur cette importance formidable que les Essais offrent à la présence de l’absence de l’ami, c’est-à-dire, à l’amitié et au deuil. De quelle façon ils en sont imbibés est, au contraire, beaucoup moins évident. On devrait probablement faire encore une fois recours au style et au jeu de Montaigne avec son œuvre, à ce style qui est concept, à cette forme qui est contenu, à cette littérature qui est vie.
(c) Et quand personne ne me lira, ay-je perdu mon temps de m’estre entretenu tant d’heures oisifves à pensements si utiles et agreables ? Moulant sur moy cette figure, il m’a fallu si souvent dresser et composer pour m’extraire, que le patron s’en est fermy et aucunement formé soy-mesme. Me peignant pour autruy, je me suis peint en moy de couleurs plus nettes que n’estoyent les miennes premieres. Je n’ay pas plus faict mon livre que mon livre m’a faict, livre consubstantiel à son auteur, d’une occupation propre, membre de la vie ; non d’une occupation et fin tierce et estrangere comme tous autres livres. (II, 18, 648, ed. Villey).
Il est encore licite de se demander, en contemplant la taille de ce livre, quels sont les concepts qui pourraient être partagés par les deux amis. Appelons « théologie », à l’ancienne manière, la recherche sur ce qui donne du relief aux choses. Alors, on devrait aussi se demander quelle est la théologie qu’ils pratiquent dans leur poursuite de ce qui a du relief. Car, si on relisait la déclaration finale du Discours de la servitude volontaire, on écouterait une certaine confirmation du principe que l’amitié n’aurait pas de sens sans une sorte de sacre à l’ensemble, de sacre à deux de cette recherche ultime. Il nous apparait de nouveau ici, dans une autre perspective, le sujet de la religio comme celui de l’impensé et, par conséquent, insurmontable, qui s’affaiblit pourtant dans sa puissance face à une certaine religiosité, une religiosité à première vue molle et un peu conventionnelle. Cette religiosité simple, attribuée souvent à Montaigne depuis le commencement des études montaigniennes modernes, serait normalement presque négligeable au moment de la mort de La Boétie. La lettre de Montaigne à son père en est la preuve.
Mais beaucoup moins négligeable se montre le constat que cette religiosité est radicalement différente de celle qui devrait dominer dans l’empire moderne de la religio. Cet empire, celui de la salvation ou la damnation après la mort et celui de la falsification du monde de la vie, est en effet mollement exclu dans le récit de la mort de La Boétie
par Montaigne. Supposons que la place réclamée par La Boétie ait été accordé par Montaigne dans sa vie et ses Essais. Supposons-le avec toutes les conséquences, c’est-à-dire, avec la reconnaissance d’une recherche intellectuelle ultime nécessairement impliquée dans le registre de l’amitié, voire le registre de la « certaine religiosité commune aux amis ». Bref, supposons que le Discours de la servitude volontaire et les Essais font véritablement son jeu : le jeu des prolongations de l’expérience vers un usage fantastique qui retombent dans la vie, si notre formule est acceptable. Quelque sorte de foi signalée par les deux amis vient creuser intempestivement sous les fondements de toute une époque commencée avec la fin de l’antiquité et encore virulemment présente en nos temps d’aujourd’hui. On ne renonce pas à la théologie en résistant à la religio, on fait passer la théologie du côté de la vie, et aussi le problème de la mort avec elle. Cette résistance à la religio que le regard mort de l’ami illumine dans le fond des Essais mérite d’être mise à l’épreuve.
Jaume Casals
Université Pompeu Fabra, Barcelone
1 Cet article trouve son plein sens dans le contexte de notre étude El aprendizaje de la muerte en la historia de las ideas (Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2010).
2 La lettre semble rédigée (ou peut-être seulement commencée) le jour suivant la mort de l’ami, c’est-à-dire pendant les derniers jours d’août 1563. Montaigne la publia lui-même dans son édition d’Œuvres de La Boétie, le 1570. La vieille édition Thibaudet-Rat de La Pléiade (Montaigne, Œuvres, Gallimard, Paris, 1962), moins déterminée par la supposition d’une extrême professionnalité littéraire et d’une religiosité intégriste avant la lettre plus ou moins cachées par Montaigne que celle de la nouvelle Pléiade remaniée à partir de l’édition posthume des Essais par Marie de Gournay (1595) et assumée par J. Balsamo et autres (Montaigne, Les Essais, Gallimard, Paris, 2007), reproduit sagement un long fragment de cette lettre. Tout se passe comme si l’éternelle polémique sur comment éditer les Essais de Montaigne pouvait se formuler aujourd’hui en termes d’une bataille entre l’éthos républicain et chrétien de La Boétie et le caractère catholique de Marie de Gournay. En lecteurs amateurs nous sommes ainsi en train de voyager de la joie et du festin critique de l’exemplaire de Bordeaux à la sévérité et à l’étude minutieuse de chaque détail propre de cet éditer selon Gournay les dernières volontés de l’auteur. On le fait presque sans s’en rendre compte. La Boétie disparaît dans ce commencement du montanisme du xxie siècle et, à sa place, se rehaussent les notes de lecture de Montaigne sur les marges de ses livres. Mais, en supposant que la discussion sur tout cela vaudrait un jour la peine, ce n’est pas ici le lieu de l’aborder, sauf pour sympathiser encore une fois avec l’éthos de La Boétie.
3 Sera probablement inutile de souligner ici que c’est précisément l’oubli facile par Montaigne de ce sous-entendu (l’excès de confiance théologique, pour dire ainsi) qui se fait insupportable pour Gournay et, même si le phénomène est dérisoire, nous étonne le manque de cette problématique dans les théologies plus denses du groupe des actuels éditeurs canoniques de Montaigne déjà mentionnés.