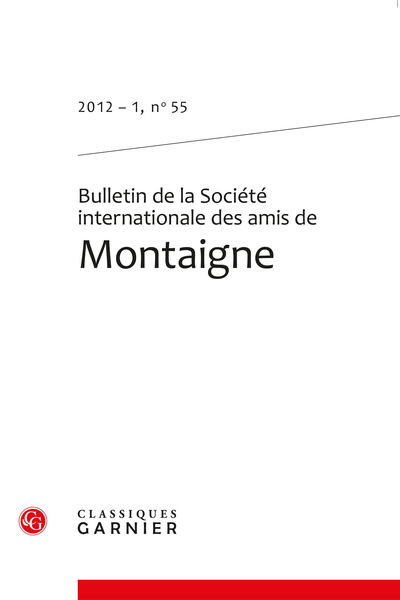
Éthique de la peur
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 1, n° 55. varia - Auteur : Lyons (John D.)
- Pages : 197 à 209
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439766
- ISBN : 978-2-8124-3976-6
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3976-6.p.0197
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/07/2012
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Éthique de la peur
La peur est un sujet qui traverse les Essais d’un bout à l’autre, paraissant dans « Nos affections s’emportent au delà de nous » où nous lisons que « La crainte, le desir, l’esperance nous eslancent vers l’advenir » (I, 3, p. 15) et dans « De l’expérience », où Montaigne décrit la crainte d’une rechute dans la maladie (III, 13, p. 1093)1. Les objets que nous craignons sont variés, allant de la souffrance physique à la pauvreté et de l’impuissance sexuelle à la mort. Mais de toutes ces choses « Nous tenons la mort, la pauvreté et la douleur pour nos principales parties ». Dans cette trinité c’est la mort qui domine, « cette mort que les uns appellent des choses horribles la plus horrible ». La peur, et surtout la peur de la mort, est tellement présente dans les Essais qu’elle risque d’être à la fois pléthorique et banale. Comment peut-on rendre compte de la peur en tant que trait distinctif et dynamique de l’écriture de Montaigne ?
L’évolution des idées de Montaigne sur la peur de la mort au cours des années est un sujet prometteur. Nous pourrions identifier ses remarques sur la peur à des étapes de sa vie et dans les différentes éditions de son livre. Il ne serait pas difficile de dépister et de décrire des mutations dans sa pensée entre les premières couches de « Que philosopher c’est apprendre à mourir », par exemple, et « De la phisionomie ». Une autre approche, et celle que nous adopterons ici, serait plutôt de considérer les Essais comme un tout, sans une attention particulière pour les strates textuelles ou pour l’âge présumé de l’auteur au moment de la composition, dans l’effort de donner une image d’un système à l’intérieur duquel les variations chronologiques elles-mêmes prendraient sens. Autrement dit, on supposera que toute transformation du thème de la peur ne sera visible que par référence à un cadre, dans lequel les différents degrés
d’importance donnés à tel aspect et dans lequel les décisions concernant les choix d’un mode de vie se feront lisibles.
Un tel système, ou mieux, une telle problématique, se forme tôt dans les Essais et persiste. Il y a deux pôles qui orientent la perception de la mort et de la crainte qu’on peut éprouver devant celle-ci. Le premier consiste à être conscient de la mort et de la peur qu’elle inspire, quitte à raisonner là-dessus et à ménager cette crainte. L’autre pôle est constitué par un manque de conscience de la mort et donc, par conséquent, une absence totale de crainte. Ces pôles sont manifestés dans de nombreux chapitres. Dans « Que le goust des biens et des maux depend en bonne partie de l’opinion que nous en avons » Montaigne écrit « Combien voit-on de personnes populaires, conduictes à la mort, et non à une mort simple, mais meslée de honte et quelque fois de griefs tourmens, y apporter une telle asseurance, qui par opiniatreté, qui par simplesse naturelle, qu’on n’y apperçoit rien de changé de leur estat ordinaire : establissans leurs affaires domestiques, se recommandans à leurs amis, chantans, preschans et entretenans le peuple : voire y meslans quelque-fois des mots pour rire, et beuvans à leurs cognoissans » (I, 14, p. 51). Et dans « Que philosopher c’est apprendre à mourir », il mentionne la « nonchalance bestiale » de bien des gens qui vont bientôt mourir.
Or, l’adhésion à l’un ou à l’autre de ces pôles concernant la pensée de la mort constitue un trait d’une importance primordiale dans le caractère de quelqu’un, de son identité. On peut décrire un homme, dire qui il est, sur la base de son rapport à la mort. C’est ce qui révèle le caractère et qui nous assigne un rôle dans le scénario de la vie. Comme Montaigne le dit, en parlant des hommes en tant que philosophes, « quelque personnage que l’homme entrepraigne, il joue tousjours le sien parmy » (I, 20, p. 81).
Il y a une éthique de la peur dans la mesure où la peur forme et révèle le caractère, c’est-à-dire l’èthos. « Éthique » ici est à prendre plutôt comme concept rhétorique que comme doctrine religieuse ou moralité normative, plus comme représentation d’un type de personnalité que dans le sens moderne et dérivé de prescriptions de conduite, distinctions entre le bien et le mal, ou, pour les croyants, manière de vivre sans péché, qu’on pourrait dénommer « moralité »2. Montaigne, le long
de son livre, témoigne de l’influence de Plutarque, dont les écrits sont centrés sur le caractère des chefs militaires et politiques. Montaigne décrit la philosophie en termes de caractère, comme lorsqu’il écrit « Je veux qu’on agisse, et qu’on allonge les offices de la vie tant qu’on peut, et que la mort me treuve plantant mes chous, mais nonchalant d’elle, et encore plus de mon jardin imparfait » (I, 20, p. 89). L’éthique de caractère, tout autant que la moralité prescriptive, s’occupe cependant de la vertu, conçue comme une chose profondément ancrée dans l’individu. L’attitude d’un homme envers la peur de la mort nous permet de prononcer sur sa vertu ou sur le manque de celle-ci : « Or des principaux bienfaicts de la vertu est le mepris de la mort, moyen qui fournit nostre vie d’une molle tranquillité… » (I, 20, p. 82). Du dehors l’èthos est lié à la réputation et en même temps, il est enraciné dans des qualités internes à la personne.
Le titre de « Que philosopher c’est apprendre à mourir » annonce un problème à résoudre. Pourquoi avons-nous besoin d’apprendre à mourir ? Nous allons tous le faire de toute façon, et ceux qui n’apprennent pas vont mourir tout autant que ceux qui apprennent. La mort est inévitable, « Elle est toujours telle », écrit-il d’une « condemnation universelle et inévitable » (III, 12, p. 1048-49). En proposant comme but de la philosophie d’apprendre à mourir, Montaigne reconnaît qu’il y a quelque chose qui l’empêche – lui, et implicitement, ses lecteurs, nous –d’accepter l’ultime nécessité, la mort, immédiatement, sans pensée et sans peur. Il y a un écart que la philosophie devra transcender, qui sépare Montaigne et ses lecteurs des gens ordinaires, ceux qu’il désigne par des termes tels que « le commun peuple » (II, 37, p. 766), « les ames du vulgaire » (I, xxi, 99) et simplement « le vulgaire » (I, 25, p. 133). Si Montaigne et les philosophes étaient comme ces gens ordinaires il n’y aurait aucune peur et aucun besoin d’apprendre à mourir.
Mourir sans penser
Cette chose qui pose problème pour la minorité pensante n’en constitue apparemment pas un pour la majorité sans peur, le vulgaire. Le vulgaire pense peu à la mort, et la « brutale stupidité » de ces personnes leur permet de vivre dans un état de « grossier aveuglement ». Il y a une telle multitude de ces personnes que le nombre est « infiny ». À cet égard la majorité ressemble aux animaux. Le pourceau de Pyrrho en offre l’exemple le plus mémorable :
Pyrrho le Philosophe, se trouvant un jour de grande tourmente dans un batteau, montroit à ceux qu’il voyoit les plus effrayez autour de luy, et les encourageoit par l’exemple d’un pourceau, qui y estoit, nullement soucieux de cet orage. (I, 14, p. 54-55)
Est-ce que Montaigne présente le pourceau sans peur comme un modèle de conduite, comme un exemple à imiter ? Ou encore le lièvre de « De la vertu » dont il écrit :
Quelque jour, estant à la chasse, dict-il, je descouvry un lievre en forme […] Je commençay à descocher mes fleches, et jusques à quarante qu’il y en avoit en ma trousse, non sans l’assener seulement, mais sans l’esveiller. Apres tout, je descoupplay mes levriers apres, qui n’y peurent non plus. J’apprins par là qu’il avoit esté couvert par sa destinée. (II, 29, p. 710).
Ces animaux ressemblent de près au paysan de « De la phisionomie » : « Je ne vy jamais paysan de mes voisins entrer en cogitation de quelle contenance et asseurance il passeroit cette heure derniere. Nature luy apprend à ne songer à la mort que quand il se meurt » (III, 12, p. 1052). Il semble que dans chaque cas Montaigne admire le résultat, l’absence de peur, qui est un composant majeur du caractère qu’il souhaite pour lui-même, mais qu’il est incapable, tout le long de son livre, de sacrifier cet autre élément de son caractère qui est la pensée et l’attention en éveil. Il ne cesse jamais de se distinguer du vulgaire : « Oserons-nous donc dire que cet avantage de la raison, dequoy nous faisons tant de feste, et pour le respect duquel nous nous tenons maistres et empereurs du reste des creatures, ait esté mis en nous pour nostre tourment ? » (I, 14, p. 55).
Penser sans mourir
Le problème n’est pas, au fond, la mort mais la pensée de la mort, et plus précisément le fait de penser à la mort à l’avance quand il n’y a pas de menace pressante. Pour Montaigne, le temps est la dimension dans laquelle existe la peur, et la peur ne fonctionne que par rapport à l’avenir, non pas par rapport au passé. Il n’y a que ceux qui pensent à ce qui vient qui peuvent ressentir la peur. C’est ainsi que, selon Montaigne, des gens comme lui diffèrent du vulgaire, et à leur désavantage. Dans les premiers chapitres des Essais penser à la mort paraît d’abord comme une force, comme un facteur de supériorité – y penser non seulement dans l’abstrait, comme concept, mais l’imaginer concrètement dans ses aspects les plus physiques. Dans « Que philosopher c’est apprendre à mourir », Montaigne écrit du besoin d’être prêt à mourir à tout moment : « il faut estre tousjours boté et prest à partir » (I, 20, p. 88) et à cette fin, écrit-il, « le premediter donne sans doubte grand avantage » (p. 90). Le but visé c’est de rendre l’idée de la mort tellement banale qu’elle s’intègre dans la vie quotidienne. On l’accepterait alors dans une nonchalance acquise, venant donc à un état proche de celui du vulgaire mais avec et par la pensée, non sans celle-ci. Montaigne imagine la mort comme si elle était un adversaire armé :
aprenons à le soutenir de pied ferme, et à le combattre. Et pour commencer à luy oster son plus grand avantage contre nous, prenons voie toute contraire à la commune. Ostons luy l’estrangeté, pratiquons le, accoustumons le. N’ayons rien si souvent en la teste que la mort. (p. 86)
Pour que la mort ne survienne pas en nous surprenant, le philosophe-combattant doit anticiper le moment de la mort par l’imagination, le rendant donc présent. Cette approche est basée sur l’aperçu que la peur n’existe que dans le temps futur. Priver la pensée de la mort de cette dimension essentielle c’est comme enlever l’oxygène à un incendie. Dans le temps présent, quand on est vraiment dans une situation où la mort est imminente, on peut, pense l’auteur, éprouver de la douleur mais non pas la mort : « il est croyable que nous avons naturellement crainte de la douleur, mais non de la mort à cause d’elle mesmes » (III, 12, p. 1055).
Le philosophe, tel qu’il est évoqué par Montaigne, dans « Que philosopher c’est apprendre à mourir », se rapproche de la vérité. Si la mort est présente elle ne se fait plus craindre : « Si c’est une mort courte et violente, nous n’avons pas loisir de la craindre ; si elle est autre, je m’apperçois qu’à mesure que je m’engage dans la maladie, j’entre naturellement en quelque desdein de la vie. Je trouve que j’ay bien plus affaire à digerer cette resolution de mourir quand je suis en santé, que quand je suis en fiévre » (I, 20, p. 90). Mais cette méthode de la pré-méditation ne s’avère pas efficace pour une simple raison qui ne peut s’exprimer que d’une manière tautologique : la mort n’est vraiment présente que quand elle est vraiment présente. Pour cette raison l’approche par la préméditation ne comble pas l’abîme séparant le penseur du vulgaire et ne résout pas le problème central de la philosophie de la vie.
« La premeditation de la mort est premeditation de la liberté » (p. 87) – peut-être. Mais nous voyons bien dans cette formulation le préfixe qui marque la séparation, cette fissure qui laisse entrer le temps futur qui alimente la peur. Préméditer la mort ce n’est pas mourir et préméditer la liberté n’est pas être libre. L’approche initialement recommandée dans les plus anciens passages de « Que philosopher c’est apprendre à mourir » ne fait qu’augmenter l’étendue de la peur plutôt que de la limiter, car on y pense pendant des années et non pas pendant les quelques heures ou quelques minutes ultimes. Toute la vie est donc offerte en sacrifice à la mort – on pense au jeune Montaigne à un bal, se détournant des belles dames pour penser à « je ne sçay qui, surpris les jours precedens d’une fievre chaude et de sa fin, au partir d’une feste pareille » (I, 20, p. 87) – sinon dans la peur du moins dans un combat acharné contre celle-ci. Ce sont donc le temps et la pensée qui séparent Montaigne du pourceau de Pyrrho. Y a-t-il un moyen pour un être conscient – un philosophe de l’èthos qui veut faire davantage que de discourir sur le caractère – d’acquérir de la liberté dans cette confrontation avec la nécessité ? Est-ce qu’on peut même raisonnablement parler de la « liberté » dans notre rapport à quelque chose d’inévitable ?
Il y a dans les Essais une approche à la mort qui diffère à la fois de l’insensibilité des gens du commun et des animaux et de cette pratique purement imaginative d’une mort vraiment absente. Si la mort peut devenir volontaire plutôt que nécessaire, autrement dit, si la nécessité peut être vécue comme un choix libre, notre rapport à la mort se transforme
alors d’une manière significative, et ce à deux égards. Tout d’abord, puisque la peur ne vit que dans la dimension du temps futur, se mettre effectivement et réellement en présence de la mort est un moyen de diminuer et même d’éliminer la peur. En second lieu, si l’insensibilité des gens du commun (même si elle est enviable) est marquée d’un côté « bestial » et donc inférieur, confronter la mort volontairement sans ignorer l’horreur qui s’y rattache par la pensée est une manière de vivre supérieure et généreuse.
Penser, agir, mourir
Si à un pôle il y a le pourceau sans peur et sans pensée de Pyrrho et à l’autre pôle il y a le Montaigne de « Que philosopher c’est apprendre à mourir » qui s’empoisonne la vie et qui sacrifie la joie du présent à force d’imaginer la mort future, en quoi pourrait consister cette troisième voie ? Et Montaigne propose-t-il vraiment une alternative systématique à l’insensibilité et à la préoccupation ? En fait, oui. Il y a, disséminés tout le long des Essais des passages où l’auteur loue ceux et celles qui se lancent volontairement dans des situations dangereuses en toute connaissance de l’issue mortelle probable ou certaine. Ce sont des cas entièrement distincts des exemples de la nonchalance vulgaire, et Montaigne paraît regarder les personnes concernées comme exemplaires d’un idéal éthique. Le concept charnière est celui de la supériorité de la combinaison de l’action avec la pensée sur la pensée seule. Une telle approche est esquissée dans les premières phrases de « De l’exercitation » :
Il est malaisé que le discours et l’instruction, encore que nostre creance s’y applique volontiers, soient assez puissantes pour nous acheminer jusques à l’action, si outre cela nous n’exerçons et formons nostre ame par experience au train auquel nous la voulons renger : autrement, quand elle sera au propre des effets, elle s’y trouvera sans doute empeschée. Voylà pourquoy, parmy les philosophes, ceux qui ont voulu atteindre à quelque plus grande excellence, ne se sont pas contentez d’attendre à couvert et en repos les rigueurs de la fortune, de peur qu’elle ne les surprint inexperimentez et nouveaux au combat ; ains ils luy sont allez au devant, et se sont jettez à escient à la preuve des difficultez (II, 6, p. 370).
L’éthique constituée par cette combinaison de pensée et d’action peut être comparée à un idéal sportif, une acceptation consciente de l’effort et du risque souvent sans la possibilité d’un gain autre que celui de l’honneur. L’exercice militaire et le sport sont, dans la tradition classique épousée par Montaigne, essentiellement identiques, comme il nous le rappelle. « N’as tu pas veu tuer un de nos roys en se jouant ? » demande-t-il, en parlant d’Henri II, mort dans un tournoi. La mort du propre frère de Montaigne des suites d’un incident au cours d’un jeu de paume est un autre exemple de la mort résultant d’un simple jeu (I, 20, p. 85). Mais même dans des situations graves et qui n’ont pas à priori un aspect « sportif », Montaigne montre que notre rapport aux dangers dépend de notre disposition mentale qui, elle, est susceptible d’être infléchie dans le sens du plaisir pris dans le défi, dans l’épreuve des forces. Ainsi, quand la mort est inévitable, on peut choisir de prendre les devants et de reformuler cette nécessité comme une pratique de liberté. Ce n’est plus s’exercer à la mort à la manière purement mentale, mais de s’ouvrir dans l’action à cet événement qu’est la réalité de la mort, celle que « nous ne […] pouvons essayer qu’une fois » (I, 2, p. 371). Dans la mesure où il s’agit d’un sport, c’est un jeu auquel on ne peut gagner, comme Mallarmé réfléchissant sur le coup de dés qui « jamais n’abolira le hasard », mais pour Montaigne il ne s’agit pas de gagner mais simplement de s’engager dans l’action en méprisant la défaite. Le caractère ainsi révélé est celui d’un homme vertueux fondé sur « le mespris de la mort » (p. 82). La différence est claire entre cette tranquillité obtenue par un choix délibéré et celle du pourceau, même si dans les deux cas on arrive « par divers moyens… à pareille fin ». Il y a donc le chemin par les hauteurs et le chemin par en bas. C’est celui-là qu’on choisit et qui mène à l’honneur : « Si l’action n’a quelque splendeur de liberté, elle n’a point de grace ni d’honneur » (III, 11, p. 967).
La conscience de la peur de la mort et la résolution de vaincre cette peur paraît dans bon nombre d’exemples de mort volontaire dans les Essais. Parmi ces cas, de ceux qui ne sont pas ignorants des enjeux de la mort et qui pourtant vont à sa rencontre, il y a celui d’Arria, femme de Cæcinna Pætus, qui vivant en captivité avait essayé plus d’une fois de prendre sa vie et qui parlait du suicide en termes de la responsabilité pour la mort, c’est-à-dire en termes d’un passage de la passivité vers l’activité. « Vous avez beau faire », dit-elle selon Montaigne, « vous me
pouvez bien faire plus mal mourir, mais de me garder de mourir, vous ne sçauriez » (II, 35, p. 746). Loin d’être insensible à la douleur qui accompagna son suicide, elle envisage la mort en termes d’un choix à faire et en termes d’une distinction pensée entre des types de mort à sa disposition. La mort d’Arria, racontée dans « De trois bonnes femmes », est une victoire sur ceux qui la surveillaient et qui ont essayé en vain de l’empêcher d’assumer la maîtrise de sa propre vie, mais c’est une victoire aussi sur la crainte de la souffrance. Les dernières paroles d’Arria concernent la peur, non pas dans une forme théorique mais dans une référence précise à l’objet de la peur :
son mary Pætus n’ayant pas le cœur assez ferme de soy-mesme pour se donner la mort, à laquelle la cruauté de l’Empereur le rengeoit, un jour entre autres, apres avoir premierement emploié les discours et enhortements propres au conseil qu’elle luy donnoit à ce faire, elle print le poignart que son mary portoit, et le tenant trait en sa main, pour la conclusion de son exhortation : Fais ainsi, Pætus, luy dit-elle. Et en mesme instant, s’en estant donné un coup mortel dans l’estomach, et puis l’arrachant de sa playe, elle le luy presenta, finissant quant et quant sa vie avec cette noble, genereuse et immortelle parole : Pæte, non dolet. Elle n’eust loisir que de dire ces trois paroles d’une si belle substance : Tien, Pætus, il ne m’a poinct faict mal (II, 35, p. 746-47).
L’exemple d’Arria et celui de Sénèque et de sa femme Pauline évoqué dans le même chapitre montre une manière de conquérir la peur de la mort différente de celle décrite dans « Que philosopher c’est apprendre à mourir » mais basée au fond sur ce même aperçu : que la peur de la mort disparaît dans la présence de la mort et disparaît donc quand la pensée ne s’élance plus vers l’avenir mais reste entièrement prise et ancrée dans le moment présent. La pensée de la mort n’est pas abolie – comme c’est le cas dans la « nonchalance bestiale » – mais en envisageant la mort les héros de Montaigne courent vers elle, comme on le voit dans l’exemple de Théoxène qui tue ses neveux. Elle n’a pas attendu que la mort leur arrive, inévitablement, en captivité, mais elle en a assumé la responsabilité et a ainsi transformé le nécessaire en acte volontaire (II, 37, p. 700).
Au lieu de créer une pseudo-présence de la mort en projetant sur d’autres moments de la vie la pensée d’une mort passive, comme celle occasionnée par la chute d’une tuile (I, 20, 86), les héros de Montaigne défient la mort par l’action, comme les deux religieux florentins qui ont
décidé de se jeter dans le feu pour prouver la vérité de leurs assertions doctrinales et de le faire devant témoins (II, 29, p. 709). C’est un des multiples cas de mort pensée et activement acceptée – même si dans le cas des deux religieux des assistants sont intervenus pour les empêcher de réaliser leur audacieuse intention. La mort ainsi entreprise ne les guette pas dans des circonstances incertaines mais c’est un adversaire présent auquel ils ont enlevé l’initiative. La mort se trouve contrainte et comprimé en un seul instant de danger immédiat. C’est une idée qui apparaît dans des assertions telles que « Nous sommes nés pour agir : Cum moriar, medium solvar et inter opus. Je veux qu’on agisse, et qu’on allonge les offices de la vie tant qu’on peut » (I, 20, p. 89).
La noblesse de caractère consiste à manifester la volonté non pas dans l’idée de mesurer la réussite par le changement imposé au monde extérieur mais de saisir l’initiative pour être non plus patient mais agent. Il ne faut pas vivre dans une attente passive. L’exemple du Romain anonyme mentionné dans « Divers événemens de mesme conseil » le montre clairement :
Il advint un jour, qu’une troupe de gens de cheval, qui avoit charge de le prendre, passa tout joignant un halier où il s’estoit tapy, et faillit de le descouvrir ; mais luy, sur ce point là, considerant la peine et les difficultez ausquelles il avoit desjà si long temps duré, pour se sauver des continuelles et curieuses recherches qu’on faisoit de luy par tout, le peu de plaisir qu’il pouvoit esperer d’une telle vie, et combien il luy valoit mieux passer une fois le pas que demeurer tousjours en cette transe, luy mesme les r’apella et leur trahit sa cachete, s’abandonnant volontairement à leur cruauté, pour oster eux et luy d’une plus longue peine. D’appeller les mains ennemies, c’est un conseil un peu gaillard ; si croy-je qu’encore vaudroit-il mieux le prendre que de demeurer en la fievre continuelle d’un accident qui n’a point de remede. (I, 24, p. 132)
On pourrait, certes, contester cette interprétation de la générosité montaignienne en faisant valoir que les héros décrits dans les Essais sont des gens qui ne connaissent pas la peur. Il serait peu exact, dira-t-on, de parler d’une « Éthique de la peur » à propos d’hommes et de femmes qui n’éprouvent pas cette émotion et qui peuvent ainsi se jeter dans des situations risquées ou même désespérées dans un état de tranquillité proche, en effet, de celui du pourceau de Pyrrho. Cette objection n’est pas sans un certain poids. Montaigne n’entre pas en détail dans
l’état d’âme de ses personnages vaillants. On ne sait pas exactement ce qu’ils éprouvent dans ces situations limites ; on pourrait même parier sur l’exaltation, sur l’ivresse de l’action qui exclut toute arrière-pensée. Pourtant, les exemples que Montaigne nous donne autorisent à dire que ces personnages ne sont pas inconscients du danger de la mort ni de la crainte que la mort peut inspirer. Tout se passe comme s’ils avaient vaincu la peur après l’avoir reconnue et même comme s’ils étaient stimulés par la peur initialement perçue. Dans le chapitre « Couardise mère de la cruauté » on lit que la vaillance a besoin du danger et de la résistance pour se manifester : « La vaillance (de qui c’est l’effect de s’exercer seulement contre la résistance…) s’arreste à voir l’ennemy à sa mercy » (II, 27, p. 693). Sans une situation capable de provoquer la peur, la vaillance s’éteint. Par contre, et comme pour confirmer la pensée systématique de Montaigne sur les rapports entre la peur et le caractère, l’auteur dit que c’est précisément la catégorie des gens qui n’éprouvent pas la peur qui exerce la cruauté la plus barbare : « Les meurtres des victoires s’exercent ordinairement par le peuple et par les officiers du bagage : et ce qui fait voir tant de cruautez inouies aux guerres populaires, c’est que cette canaille de vulgaire s’aguerrit et se gendarme à s’ensanglanter jusques aux coudes » (p. 693-94).
Un des exemples les plus remarquables de la confrontation héroïque avec la mort, une confrontation qui transforme la nécessité en liberté par le choix fait du risque, c’est l’anecdote racontée dans « Divers événemens de mesme conseil » de l’homme qui est sorti d’une place de sûreté pour s’exposer sans défense parmi une population en émeute. Ce gentilhomme représenta dans son caractère l’idéal de l’assurance :
il est bien vray que cette forte asseurance ne se peut representer entiere et naifve, que par ceus ausquels l’imagination de la mort et du pis qui peut advenir apres tout, ne donne point d’effroy : car de la presenter tremblante, encore doubteuse et incertaine, pour le service d’une importante reconciliation, ce n’est rien faire qui vaille. C’est un excellent moyen de gaigner le cœur et volonté d’autruy, de s’y aller soubsmettre et fier, pourveu que ce soit librement et sans contrainte d’aucune necessité (I, 24, p. 130).
Si cet homme était sorti sans percevoir le danger et sans avoir dû surmonter une crainte raisonnable, son acte aurait été un exemple de bêtise. En l’occurrence, dit Montaigne, il fut tué, mais l’auteur approuve sa
décision de sortir et de s’exposer, comme étant la chose honorable, et critique l’homme seulement de ne pas avoir été suffisamment ferme dans son procédé avec la foule.
S’exposer au danger est un geste intimement lié au caractère. Essayer de manipuler la situation pour diminuer son potentiel de générer la peur paraît à Montaigne réduire en même temps le potentiel de gloire. On pourrait presque dire que Montaigne juge du caractère plus du côté affectif que du côté rationnel. Ceci se voit dans « L’heure des parlemens dangereuse », où l’enjeu central c’est de décider s’il faut estimer davantage la franchise ou la ruse. Ces deux approches de la négociation pendant des sièges militaires sont inextricablement liées, dans le texte de Montaigne, à sa valorisation du courage affectif et physique. Dans la tradition qu’il évoque et qu’il préfère – la tradition romaine – ceux qui paraissent les plus glorieux sont ceux qui n’attaquent pas par surprise mais qui annoncent à l’avance leurs intentions agressives. Il faut plus de courage pour agir ainsi ouvertement, mais en agissant ainsi on doit traverser la peur, puisqu’on s’expose au risque plutôt que d’agir en sûreté dans l’ombre. L’analogie du sport peut être pertinente ici encore, dans la mesure où l’avantage matériel – gagner – n’est pas le seul but de l’homme noble mais plutôt la satisfaction et peut-être la renommée d’avoir bien fait à l’intérieur d’un ensemble de règles. Dans « Si le chef d’une place assiegée doit sortir pour parlementer », Montaigne approuve le choix glorieux et dangereux d’oser faire ce qui expose le plus à la peur et au danger. Ce sont les valeurs romaines qu’il estime qui consistent à « combattre de vertu, non de finesse, ni par surprinses » plutôt que « la Grecque subtilité et astuce Punique, où le vaincre par force est moins glorieux que par fraude » (I, 5, p. 25).
Dans « L’heure des parlemens dangereuse » le caractère des adversaires s’évalue dans une dialectique structurée par la franchise et la peur, une dialectique qui s’exprime dans un nombre de questions que la personne assiégée doit se poser : Quel est le caractère de l’homme qui m’invite à sortir de ma place ? Est-ce le caractère de quelqu’un qui va essayer de triompher par surprise (par ruse) ou de quelqu’un qui accepte de combattre ouvertement ? Et moi-même, suis-je quelqu’un qui souhaite vivre le plus longtemps possible, quitte à périr patiemment, par maladie ou accident ? Veux-je paraître aussi comme un homme dominé par le soupçon et la peur de l’adversaire ? En somme, lorsqu’on parlera
de nous deux, qui paraîtra l’homme de la peur et qui, l’homme de la confiance ? Ces questions ne sont pas purement théoriques, comme nous voyons dans l’exemple du « quidam » qui avait envahi la maison de Montaigne, lui qui, par caractère « penche volontiers vers l’excuse et l’interprétation plus douce » (III, 12, p. 1060). Cela ne veut pas dire que Montaigne avait la « sotte simplicité » (p. 1049) d’être insensible au danger, puisqu’il savait « en quel siecle » il vivait, mais il avait poursuivi calmement en face du danger.
Dans l’éthique de Montaigne le degré suprême est donc une combinaison de la reconnaissance du danger par la pensée et dans les actions une assurance qui ressemble à la nonchalance du vulgaire. Dans cette perfection du caractère la pensée ne se déplace pas vers des dangers futurs subis passivement mais vers un danger présent qu’on accepte dans une paradoxale et savante tranquillité.
John D. Lyons
Université de Virginie
1 Toutes les citations des Essais proviennent de l’édition Villey-Saulnier (Paris : Presses Universitaires de France, 1965).
2 La distinction entre la morale et l’honneur qu’Alexis de Tocqueville fait dans De la démocratie en Amérique est utile à comprendre l’èthos dans ce sens, dans la mesure où l’honneur pour de Tocqueville spécifie le caractère d’un groupe, c’est-à-dire les normes de conduite qui le distinguent de l’humanité en général, alors que la morale n’identifie personne et ne concerne nullement ce qui pour nous serait aujourd’hui une « identité ». Voir de Tocqueville, Œuvres, éd. dirigée par André Jardin (Paris : Gallimard, “La Pléiade”, vol. 2, p. 745-58). Voir aussi François Cornilliat et Richard Lockwood, Èthos et pathos : Le Statut du sujet rhétorique (Paris : Honoré Champion, 2000).