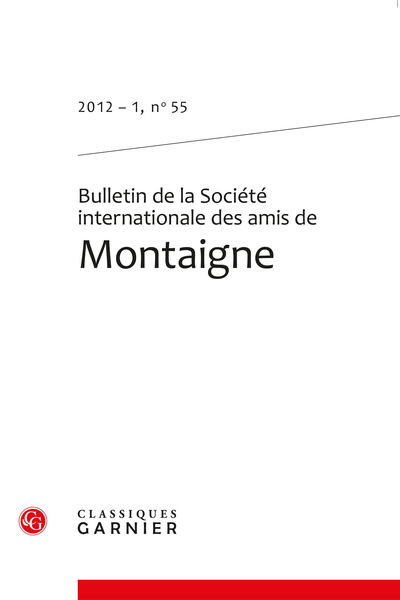
« Désapprendre le mal »
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 1, n° 55. varia - Auteur : Roussel (François)
- Pages : 257 à 273
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439766
- ISBN : 978-2-8124-3976-6
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3976-6.p.0257
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/07/2012
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Enigmatique ou équivoque, l’apophtegme qui sert ici de pierre de touche incite à se pencher une nouvelle fois sur l’enquête constamment relancée dans les Essais relativement à la nature de la cruauté, ce « vice si dénaturé1 » à l’encontre duquel Montaigne n’a de cesse de dire sa répugnance “instinctive” et réfléchie, tout en estimant nécessaire d’y revenir à de nombreuses reprises pour tenter d’en approcher certains ressorts plus obscurs : « Je hais entre autres vices cruellement la cruauté, et par nature et par jugement, comme l’extrême de tous les vices. Mais c’est jusques à telle mollesse que je ne vois pas égorger un poulet sans déplaisir, et ois impatiemment gémir un lièvre sous les dents de mes chiens – Quoi que ce soit un plaisir violent que la chasse » (De la cruauté, II, 11, p. 158/429)2. De fait, c’est dans ce chapitre que l’apophtegme est cité ou plutôt réinterprété par Montaigne dans un ajout manuscrit au texte initial : « Mais tant y a que la plupart des vices, je les ai de moi-même en horreur – La réponse d’Antisthène à celui qui lui demandait le meilleur apprentissage : “désapprendre le mal”, semble s’arrêter à cette image » (II, 11, p. 155/428). Même si elle peut paraître de prime
abord un peu étrange, la référence n’a ici rien de vraiment surprenant : Antisthène est le philosophe qui ouvre le livre VI des Vies et doctrines des philosophes illustres de Diogène Laërce, livre consacré au cynisme et à son injonction de « vivre selon la nature », à l’encontre de tous les artifices humains ramenés à une « dénaturation » généralisée.
À vrai dire, le trait rapporté par Diogène Laërce est assez différent, si l’on se reporte par exemple à la récente traduction du texte par M.O. Goulet-Cazé ; en réponse à la question de savoir quelle connaissance lui paraissait la plus indispensable, Antisthène répondit : « celle qui évite de désapprendre » (Pochothèque). Une autre traduction plus ancienne (éd. Garnier-Flammarion) joue explicitement sur la structure paradoxale du propos : « apprendre à ne pas désapprendre ». Par sa reformulation interprétative très libre contraire à la lettre, sinon à l’esprit de l’apophtegme, Montaigne semble laconiquement ramener l’exercice philosophique à cet effort, à cette « ascèse » cynique cherchant à retrouver ou à conserver une « naïveté », c’est-à-dire une « forme » ou une « complexion » naturelle considérée comme bonne, au rebours d’une accoutumance négative et corrosive qui serait celle d’une déformation, d’une « dénaturation » de l’homme – ce que l’on pourrait également appeler sa « désanimalisation3 ». Cela ne signifie pas pour autant que Montaigne identifie purement et simplement sa propre démarche à celle des cyniques puisque lui-même caractérise sa « complexion » naturelle comme étrangère à tout effort soutenu, comme le souligne la suite du passage : « Ma vertu, c’est une vertu, ou innocence, pour mieux dire, accidentelle et fortuite » (II, 11, p. 154/427). Et les points de contact ou de recoupement avec l’attitude cynique ne se font pas sans la plus expresse conscience des difficultés conceptuelles et morales concernant les rapports entre nature et coutume, comme on va le voir à propos de l’examen de la cruauté amorcé dans le cours du chapitre par ce trait personnel : « Pour dire un mot de moi-même… ».
On pourrait dire ici, sans trop s’embarrasser de subtilités, que le « motif » cynique : « vivre selon la nature », traverse les Essais dans une incessante et productive confrontation avec un “motif” sophistique ou sceptique concernant la reconnaissance de la puissance et de l’étendue du nomos : coutumes, lois, habitudes et aptitudes acquises par « art » ou
par « expérience » et devenues cette « seconde nature » qui, en l’homme, supplante la première4. En dépit d’un schéma interprétatif venu du Discours de la servitude volontaire et qui semble assimiler la cruauté à une « accoutumance » maladive et délétère, l’analyse par Montaigne des formes et des mouvements de ce « vice si dénaturé » se situe bien davantage dans un entre-deux qu’il incite à examiner plus attentivement. Le cheminement suivi ici va donc procéder en trois temps, selon des modalités de lecture qui sont toujours en lutte dans la façon d’entendre la démarche philosophique des Essais : 1) en procédant partiellement par prélèvements et digressions de lecture autour de la cruauté, prolongeant un mouvement que Montaigne dit être celui de son écriture ; 2) en reprenant le fil plus continu du chapitre De la cruauté qui n’aborde expressément la « matière » de son intitulé que dans la deuxième moitié du texte ; 3) en risquant une hypothèse de lecture suggérant une articulation du texte plus subtile ou plus retorse que l’apparente opposition frontale entre le développement initial consacré à la « vertu » et l’analyse ultérieure de « l’extrême de tous les vices ».
Ce parcours tente de mieux cerner la manière dont Montaigne essaie de penser la cruauté à travers les descriptions attentives qu’il ne cesse d’en produire jusque dans de nombreux ajouts manuscrits5. Ce qui amène, chemin faisant, à se confronter à d’autres analyses sur le même sujet : soit que, comme la jouissance érotique à laquelle elle se trouve entrelacée, la cruauté excède ou désarme tout « discours » (c’est la thèse de F. Brahami dans l’article « cruauté » du Dictionnaire de Michel de Montaigne, H. Champion, 2007) ; soit qu’elle se trouve « conjurée » ou refoulée comme un « vertige » intérieur qu’il faut impérativement neutraliser (c’est l’interprétation de F. Garavini dans Monstres et chimères, chap. 6 : « Le vertige sadique ») ; soit enfin qu’elle mette la pensée au défi d’en identifier et d’en comprendre certains de ses replis les plus obscurs ou les plus aporétiques – ceux qui par ailleurs ne cessent de faire retour dans notre présent le plus immédiat, comme le souligne
E. Balibar dans un texte éclairant à plusieurs titres : « retourner aux énigmes de la cruauté, de façon à bien circonscrire les raisons qui nous interdisent de considérer aujourd’hui la question comme marginale ou secondaire6 ».
la cruauté « accoutumée »
On connait l’horizon historique dans lequel s’inscrivent les réflexions de Montaigne sur cette forme extrême de violence : la férocité des guerres civiles de religion d’une part, celle de la conquête et de la destruction du « nouveau monde » d’autre part7, et les liens multiples qu’on peut établir entre ces deux séquences d’événements de grande portée en dépit de leur écart chronologique et géographique8. À quoi il faut ajouter une dimension plus spécifique puisque la cruauté est souvent évoquée par Montaigne à l’occasion d’une réflexion critique sur les procédures judiciaires impliquant la codification de la torture sous la double forme de la « question » (qui cherche à produire l’aveu) et des supplices (qui
suivent un jugement de culpabilité pour en exécuter la sentence). Dans cet entremêlement d’événements historiques majeurs et de dispositifs inquisitoriaux, les modalités passionnelles de la cruauté semblent bien relever d’une « accoutumance » à la jouissance du mal infligé. Et cette accoutumance se trouve liée à la réalité institutionnelle de pouvoirs théologico-politiques qui s’exercent jusque dans les comportements individuels les plus apparemment « déréglés », manifestant et même exhibant une extrême férocité. Mais dans l’attention singulière que Montaigne porte à la cruauté, on peut aussi percevoir la nécessité d’un questionnement plus général de nature anthropologique qui incite à mieux identifier ce qui revient aux « mouvements » de la nature et ce qui revient à la force de la coutume, ce « breuvage de Circé » qui peut faire prendre aux hommes une infinité de formes puisqu’il « diversifie notre nature comme bon lui semble9 ». Car l’accumulation des descriptions de la férocité humaine en vient finalement à évoquer une disposition naturelle « vicieuse », ce qui ne peut que perturber le régime ordinaire du couple conceptuel nature-coutume et le partage assuré que Montaigne reconduit au bénéfice de la première, la constituant en « idéalité » – si l’on s’autorise à reprendre ici un terme avancé par E. Balibar10. C’est bien l’une des apories inquiétantes que la multiplication des formes de la cruauté oblige à affronter : « Nature, à ce crains-je, elle-même attache à l’homme quelque instinct à l’inhumanité » (II, 11, p. 164/433). On se trouve alors devant l’effacement ou le brouillage des différenciations structurantes, jusqu’au point où « l’idéalité » de la nature semble se renverser dans la factualité nettement plus problématique et ambivalente de la coutume.
Toutes ces dimensions sont présentes, à des degrés divers, dans le chapitre De la cruauté, même si elles n’apparaissent explicitement que dans le deuxième mouvement du texte : « Je vis en une saison en laquelle
nous foisonnons en exemples incroyables de ce vice, par la licence de nos guerres civiles ; Et ne voit-on rien aux histoires anciennes de plus extrême que ce que nous en essayons tous les jours. Mais cela ne m’y a nullement apprivoisé. À peine me pouvais-je persuader, avant que je l’eusse vu, qu’il se fut trouvé des âmes si monstrueuses qui, pour le seul plaisir du meurtre, le voulussent commettre ; hacher et détrancher les membres d’autrui ; aiguiser leur esprit à inventer des tourments inusités et des morts nouvelles ; sans inimitié ; sans profit ; et pour cette seule fin de jouir du plaisant spectacle des gestes et mouvements pitoyables, des gémissements et voix lamentables d’un homme mourant en angoisse. Car voilà l’extrême point où la cruauté puisse atteindre » (II, 11, p. 162-163/432).
Cette dernière notation introduit brièvement à l’un des passages du chapitre souvent sollicité dans les lectures « thématiques » des Essais : au delà de la violence des guerres civiles de religion qui ouvrent la voie aux dérèglements les plus extrêmes des âmes et aux accusations en miroir d’une férocité sans limite (meurtres collectifs légitimés, supplices généralisés sous couvert d’une piété « intraitable11 »), Montaigne esquisse l’évocation d’une forme plus expressément institutionnelle de cruauté, celle de la justice pénale. D’autres chapitres où se trouvent quasi littéralement les mêmes formulations condamnent la « barbarie » inhérente au rituel judiciaire qui, héritier de pratiques venues de la Rome impériale et de l’Inquisition chrétienne, a reconduit les formes codifiées de la torture sous le double aspect des interrogatoires et des châtiments12. Tout en distinguant ces deux formes et leurs soubassements théologico-juridiques respectifs, Montaigne ne manque jamais de souligner la cruauté de telles pratiques, signe d’un pouvoir qui croit pouvoir mimer une toute-puissance illusoire – et par ailleurs vaine en un triple sens : présomptueuse, inutile, inefficace. Dans ce registre, le chapitre De la cruauté se limite à l’évocation des supplices, autrement
dit à une forme réglée et strictement codifiée de souffrance corporelle qui légitime les peines infligées à un être humain à des fins d’expiation.
On connaît ordinairement les raisons de cette critique, explicitées notamment dans le passage suivant : « Les morts, je ne les plains guère ; et les envierais plutôt ; mais je plains bien fort les mourants. Les sauvages ne m’offensent pas tant de rôtir et manger les corps des trépassés que ceux qui les tourmentent et persécutent vivants. (…) Quant à moi, en la justice même, tout ce qui est au delà de la mort simple me semble pure cruauté – Et notamment à nous qui devrions avoir respect d’en envoyer les âmes en bon état ; Ce qui ne se peut, les ayant agitées et désespérées par tourments insupportables » (II, 11, p. 161/431). ll y a donc une barbarie à « tourmenter » des âmes en exerçant sur elles, du fait de leur indissoluble « jointure » avec le corps, un pouvoir extrême de souffrance. Dans cette mise en regard de deux férocités dont les soubassements imaginaires ou symboliques ne sont pas équivalents, le trait est analogue à celui qu’on trouve formulé dans le chapitre Des cannibales : « Je pense qu’il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu’à le manger mort, à déchirer, par tourments et par géhennes, un corps encore plein de sentiment, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux (comme nous l’avons, non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et, qui pis est, sous prétexte de piété et de religion), que de le rôtir et manger après qu’il est trépassé » (I, 31, p. 209/350-351). Il faut d’ailleurs souligner ici que la description de la violence cannibale amène Montaigne à identifier un fonctionnement symbolique très construit – jusque dans les paroles rituelles de défi de celui qui va lui-même être mangé et dont Montaigne dit expressément : « Invention qui ne sent aucunement la barbarie » (I, 31, p. 212/355)13.
La position de Montaigne à l’égard de la cruauté judiciaire est bien connue, l’inscrivant dans une lignée critique qui court du xvie au
xixe siècle. Mais si on suit attentivement le fil du propos, elle ne se réduit pas à une dénonciation sans appel au nom d’un sentiment naturel d’humanité et de commisération. Dans l’affirmation de sa répugnance « instinctive » à cette cruauté d’institution, Montaigne suggère de délier la punition de la douleur corporelle, privilégiant un imaginaire « incorporel » ou plutôt « dévitalisé » car séparé de ce qui est encore vivant afin de ne considérer le « corps » que comme cadavre – imaginaire qui garderait pour autant une certaine efficacité dissuasive : « Je conseillerais que ces exemples de rigueur, par le moyen desquels on veut tenir le peuple en office, s’exerçassent contre les corps des criminels : Car de les voir priver de sépulture, de les voir bouillir et mettre à quartiers, cela toucherait quasi autant le vulgaire que les peines qu’on fait souffrir aux vivants (…) Il faut exercer ces inhumains excès contre l’écorce, non contre le vif » (II, 11, p. 161-162/431-432). Les divers exemples par lesquels Montaigne a nourri et précisé ultérieurement son analyse vont tous dans le même sens : il s’agit d’imaginer une justice qui neutralise – autant que c’est possible – la dimension proprement corporelle de son pouvoir, comme le montre l’interprétation reprise à Plutarque de certains rituels sacrificiels : « Les Égyptiens, si dévotieux, estimaient bien satisfaire à la justice divine, lui sacrifiant des pourceaux en figure et représentés : invention hardie de vouloir payer en peinture et en ombrage Dieu, substance si essentielle » (II, 11, p. 162/432). On peut entendre là, pour reprendre un terme de Montaigne, comme l’esquisse d’une politique de « diversion » qui vise à détourner ou à convertir la part de cruauté de l’inévitable violence de la justice (et même de tout pouvoir institué), sans prétendre pour autant la résorber entièrement14.
C’est d’ailleurs la réflexion sur les manières de se représenter l’économie symbolique des châtiments qui amorce la digression finale sur la communauté des hommes et des autres vivants puisque certaines de ces représentations consistent à faire retomber les âmes humaines jugées coupables dans des corps animaux (versant punitif de la « métempsycose ») : « La Religion de nos anciens Gaulois portait que les âmes, étant éternelles, ne cessaient de se remuer et changer de place d’un corps à un autre – Mêlant en outre à cette fantaisie quelque considération de
la justice divine ; car, selon les déportements de l’âme, pendant qu’elle avait été chez Alexandre, ils disaient que Dieu lui ordonnait un autre corps à habiter, plus ou moins pénible, et rapportant à sa condition (…) Si elle avait été vaillante, la logeaient au corps d’un Lion ; si voluptueuse, en celui d’un pourceau ; si lâche, en celui d’un cerf ou d’un lièvre ; si malicieuse, en celui d’un renard ; ainsi du reste ; jusques à ce que, purifiée par ce châtiment, elle reprenait le corps de quelque autre homme » (II, 11, p. 165/433-434). En citant le passage d’un auteur latin, Claudien, qui explicite cette distribution des châtiments (les « cruels » tombant dans des corps d’ours), Montaigne éclaire latéralement le sens de son propos : la condamnation de la cruauté des supplices ne renvoie pas simplement à une sensibilité ou un naturel plus « tendre » qui serait le sien et dont il fait l’analyse dans les passages qui précèdent cette évocation ; elle suscite une réflexion sans concession sur la manière dont les institutions humaines (éducation, mœurs, lois) forment et déforment la sensibilité jusque dans ses dimensions les plus erratiques. Mais le propos explicite de la fin du chapitre fait apparaître une autre dimension à laquelle il faut prêter une attention particulière.
une commune sensibilité de nature
L’une des thématiques les plus connues et sollicitée se trouve en effet concentrée dans le dernier mouvement du texte : Montaigne y évoque, pour la faire sienne, l’opinion d’une étroite « ressemblance » que les hommes sont dits avoir avec les bêtes, signe d’une commune appartenance. Et ce faisant, il l’élargit à l’ensemble des êtres vivants, de même que le sentiment de « respect » qui en découle : « Mais quand je rencontre parmi les opinions les plus modérées les discours qui essayent à montrer la prochaine ressemblance de nous aux animaux, et combien ils ont de part à nos plus grands privilèges ; et avec combien de vraisemblance on nous les apparie ; certes j’en rabats beaucoup de notre présomption ; et me démets volontiers de cette royauté imaginaire qu’on nous donne sur les autres créatures. Quand tout cela en serait à dire, si y a-il un certain respect qui nous attache, et un général devoir d’humanité, non
aux bêtes seulement qui ont vie et sentiment, mais aux arbres mêmes et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes, et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables. Il y a quelque commerce entre elles et nous, et quelque obligation mutuelle » (II, 11, p. 166-167/435)
Toute cette analyse trouve de nombreux échos dans d’autres chapitres, notamment les longs développements de l’Apologie de Raimond Sebond consacrés à ce « cousinage » des bêtes et des hommes ; et le passage final du chapitre De la cruauté vient confirmer que la confrontation homme-animaux fonctionne pour l’essentiel, dans les Essais, sur un registre d’évaluation morale pris entre continuité et étrangeté. L’évocation d’un « commerce » et d’une « obligation mutuelle » entre tous les vivants est ici présentée comme le refus d’une « royauté imaginaire » qui ferait des hommes les maîtres régnant sans conteste sur toutes les autres créatures15. C’est pourquoi Montaigne reformule en passant une singulière proposition théologique qu’il feint de présenter comme l’interprétation la plus commune et la plus communément reçue à propos des « bêtes » : « Et afin qu’on ne se moque de cette sympathie que j’ai avec elles, la Théologie même nous ordonne quelque faveur en leur endroit ; et, considérant que un même maître nous a logés en ce palais pour son service et qu’elles sont, comme nous, de sa famille, elle a raison de nous enjoindre quelque respect et affection envers elles » (II, 11, p. 164/433). Malgré ses prudentes modulations, la proposition est audacieuse sinon hérétique – bien qu’elle ne semble pas avoir suscité l’attention des lecteurs/censeurs vaticans plus soucieux de marquer leur désapprobation expresse à l’endroit de la critique de la torture judiciaire16. Quoiqu’il en soit, si « privilège » il y a, il est dit par Montaigne commun à tous les vivants, au moins dans la reconnaissance d’une communauté d’expérience sensible qui implique cette « obligation mutuelle » – même si on peut établir des gradations dans le respect : « justice », « grâce », « bénignité », autrement dit bienveillance et protection.
Cette reconnaissance exprime l’expérience d’une « compassion » qui est un « sentir » commun ; mais cette compassion ne devient pas pour autant une indifférenciation pure et simple, une sorte de pitié indistincte et généralisée. Dans son attention à l’expérience la plus sensible, Montaigne maintient toujours l’importance de la forme corporelle ; l’étroite « couture » entre corps et âme le rend ainsi plutôt étranger sinon hostile à la conception pythagoricienne de la métempsychose, évoquée juste avant dans le chapitre pour être mise à distance et « allégorisée », à la manière de Plutarque : « Pythagore emprunta la Métempsychose des Egyptiens ; mais depuis elle a été reçue par plusieurs nations, et notamment par nos Druides (…) Quant à ce cousinage là d’entre nous et les bêtes, je n’en fais pas grand recette. Ni de ce aussi que plusieurs nations, et notamment des plus anciennes et plus nobles, ont non seulement reçu des bêtes à leur société et compagnie, mais leur ont donné un rang bien loin au dessus d’eux, les estimant tantôt familières et favorites de leurs dieux ; et les ayant en respect et révérence plus qu’humaine ; et d’autres ne reconnaissant autre Dieu ni autre divinité qu’elles (…) Et l’interprétation même que Plutarque donne à cette erreur, qui est très bien prise, leur est encore honorable ; Car il dit que ce n’était le chat, ou le bœuf (pour exemple) que les Egyptiens adoraient, mais qu’ils adoraient en ces bêtes là quelque image des facultés divines ; En cette-ci la patience et l’utilité, en cette-là la vivacité » (II, 11, p. 165-166/434).
Même si Montaigne rappelle ici l’interprétation allégorique bienveillante de Plutarque à l’endroit d’une certaine représentation de ces châtiments divins, ce qui retient vraiment son attention est d’un autre ordre qui ramène au sujet indiqué par le titre du chapitre : si la cruauté peut être plus précisément identifiée et dénoncée, c’est en raison de la communauté sensible effective (et non pas symbolique) qui relie hommes, animaux et même végétaux. Elle se révèle tout particulièrement dans le refus ou le déni de reconnaissance et de respect de cette communauté sensible des vivants ou, plus exactement, lorsque cette communauté sensible se retourne en jouissance mauvaise. Telle est l’expérience attestée du pouvoir de faire souffrir, manifestant un mouvement qui ne peut alors être ramené à une pure et simple « dénaturation » mais semble prendre naissance à même la nature : « Les naturels sanguinaires à l’endroit des bêtes témoignent une propension naturelle à la cruauté. Après qu’on se fut apprivoisé à Rome aux spectacles des meurtres des animaux, on vint
aux hommes et aux gladiateurs. Nature, à ce crains-je, elle-même attache à l’homme quelque instinct à l’inhumanité. Nul ne prend son ébat à voir des bêtes s’entrejouer et caresser ; et nul ne faut de le prendre à les voir s’entredéchirer et démembrer » (II, 11, p. 164/433). Le propos initial, assez court, a été augmenté ultérieurement par Montaigne pour souligner un trait qui deviendra un lieu commun de très nombreuses réflexions modernes sur ce thème : ce que les hommes infligent aux « bêtes » est à l’image de ce qu’ils sont capables de s’infliger entre eux17. Mais l’ajout de 1588 va plus loin : il identifie du même coup une partie de l’aporie à laquelle se confronte l’examen de la cruauté puisque celle-ci apparaît alors non pas comme un écart totalement « contre-nature », une « accoutumance » passée en nature et signant négativement l’errance humaine, mais comme l’écho de mouvements « naturels » plus ambivalents qu’il ne semble puisqu’ils entremêlent la compassion et la cruauté comme deux versants d’une même expérience sensible, indissolublement liés.
Comment comprendre ou entendre cette « propension naturelle à la cruauté » ? Le texte reste en suspens sur cet ajout qui se borne à identifier l’énigme et à ouvrir sur un éventuel vertige de pensée que Montaigne semble ici neutraliser, ou dont il suspend du moins l’examen. Pour en avoir une formulation plus précise, il faut se reporter à d’autres passages, notamment dans le chapitre De l’utile et de l’honnête où la cruauté est intégrée à la figure plus familière, sinon plus rassurante, de l’harmonie dissonante des contraires qui inclut l’ordre politique : « Notre bâtiment, et public et privé, est plein d’imperfection. Mais il n’y a rien d’inutile en nature. Non pas l’inutilité même. Rien ne s’est ingéré en cet univers, qui n’y tienne place opportune. Notre être est cimenté de qualités maladives. L’ambition, la jalousie, l’envie, la vengeance, la superstition, le désespoir, logent en nous d’une si naturelle possession que l’image s’en reconnaît aussi aux bêtes – Voire et la cruauté, vice si dénaturé ; Car, au milieu de la compassion, nous sentons au dedans je ne sais quelle aigre-douce pointe de volupté maligne à voir souffrir autrui ; Et les enfants le sentent (…). Desquelles qualités qui ôterait les semences en l’homme, détruirait les fondamentales conditions de notre vie » (III, 1, p. 22/790-791). Là encore, malgré la référence à ce lieu commun de la Concordia-discors, la
difficulté surgit comme un écart persistant et inquiétant à la positivité ordinairement accordée sans réserve par Montaigne aux mouvements et « impulsions » de la nature.
retour à l’ordre du chapitre
L’équivocité ou l’instabilité qui perturbe le régime ordinaire des significations du couple nature-coutume dans les Essais n’est cependant pas traitée pour elle-même dans De la cruauté. Sans prétendre résoudre ou dissoudre la difficulté conceptuelle et morale que ces différents passages soulignent expressément, on peut simplement pressentir qu’elle informe en partie le mouvement général du chapitre, en dépit de son apparente contexture de « pièces décousues18 ». Elle donne à tout le moins une clé pour saisir le fil du raisonnement qui court de manière plus continue tout au long du texte. Car c’est bien à une difficulté analogue que, dans le premier long développement initial, se confronte l’examen de ce que recouvre le terme de « vertu », lui aussi finalement plus obscur et retors qu’il ne semble. Le rappel des significations philosophiques ordinaires du terme est conduit non pas au sens de, et selon une démarche socratique ou platonicienne, mais en reprenant le questionnement lexical venu d’une certaine idée de la force contraignante ou « obligeante » contenue dans cette notion de « vertu ». Les premiers mots du chapitre sont en ce sens très clairs et ils informent l’ensemble du développement qui ne fait qu’en déployer, sérieusement et ironiquement, tous les attendus : « Il me semble que la vertu est chose autre et plus noble que les inclinations à la bonté qui naissent en nous. Les âmes réglées d’elles mêmes et bien nées, elles suivent même train, et représentent en leurs actions même visage que les vertueuses ; Mais la vertu sonne je ne sais quoi de plus grand et de plus actif que de se laisser, par une heureuse complexion, doucement et paisiblement conduire à la suite de la raison. Celui qui, d’une douceur et facilité naturelle, mépriserait les offenses reçues, ferait
chose très belle et digne de louange ; Mais celui qui, piqué et outré jusques au vif d’une offense, s’armerait des armes de la raison contre ce furieux appétit de vengeance, et après un grand conflit s’en rendrait enfin maître, ferait sans doute beaucoup plus : Celui-là ferait bien, et cettui-ci vertueusement : L’une action se pourrait dire bonté, et l’autre vertu : Car il semble que le nom de la vertu présuppose de la difficulté et du contraste » (II, 11, p. 145/422).
Ce premier développement se rattache implicitement à la lecture de certains traités moraux de Plutarque, notamment De la vertu morale qui reprend et infléchit certaines analyses platoniciennes : la vertu consiste t-elle à affronter l’adversité et la douleur sans broncher, voire à la solliciter pour mieux s’y endurcir, comme le soutiennent épicuriens et stoïciens ici d’accord19 ?. Si la démarche de Montaigne, pas plus que sa position, n’est ici d’inspiration strictement socratique, Socrate est néanmoins très présent dès l’ouverture de cet essai, même si c’est en mode mineur puisque sa « vertu », reliée à une certaine forme d’« essai » au double sens d’exercice et d’épreuve, est ironiquement rapportée à son endurance à supporter la complexion peu amène de sa femme : « Socrate s’essayait, ce me semble, encore plus rudement, conservant pour son exercice la malignité de sa femme : qui est un essai à fer émoulu » (ibid., p. 147/423). Mais un peu plus loin, cette même vertu est rendue plus énigmatique du fait même du « naturel » spontanément réglé de Socrate : « il me tombe en fantaisie que l’âme de Socrate, qui est la plus parfaite qui soit venue à ma connaissance, serait à ce compte une âme de peu de recommandation (…) Au train de sa vertu, je n’y puis imaginer aucune difficulté ni aucune contrainte » (II, 11, p. 148/423-424). Le questionnement est d’ailleurs finalement relancé dans l’autre sens lorsque Montaigne ajoute ultérieurement cette remarque qui le conduit à démarquer de la vertu socratique sa propre « complexion » naturelle : « Socrate avouait à ceux qui reconnaissaient en sa physionomie quelque inclination au vice, que c’était à la vérité sa propension naturelle, mais qu’il l’avait corrigée par discipline » (II, 11, p. 157/429)20. La perplexité maintenue et même renforcée à cet égard
peut donc se formuler ainsi : qu’est-ce qu’une vertu sans « vertu21 » ?. Car c’est bien de cette manière que Montaigne se présente lui-même dans le passage déjà cité : « Ma vertu, c’est une vertu, ou innocence, pour mieux dire, accidentelle et fortuite (…) Ainsi, je ne me puis dire nul grand’merci de quoi je me trouve exempt de plusieurs vices (…) je le dois plus à ma fortune qu’à ma raison. Elle m’a fait naître d’une race fameuse en prud’homie et d’un très bon père ; je ne sais s’il a écoulé en moi partie de ses humeurs, ou bien si les exemples domestiques et la bonne institution de mon enfance y ont insensiblement aidé ; ou si je suis autrement ainsi né » (II, 11, p. 154/427)
À partir du choix du titre retenu pour ce chapitre, on peut alors suggérer une hypothèse de lecture qui essaie d’en saisir une continuité plus souterraine : si la cruauté surgit au détour de cette analyse initiale de la vertu et si on ne peut se contenter de suivre le seul mouvement de démarcation par lequel Montaigne la fait apparaître comme répugnant à sa propre « complexion », ne faut-il pas entrevoir une obscure communauté entre vertu et cruauté, ou du moins entre certaines « pointes » de vertu et certaines « pointes » de cruauté – même si ce lien n’est pas expressément thématisé dans le cheminement du chapitre22 ? Tout en s’en démarquant, cette hypothèse fait écho à la lecture par ailleurs stimulante de F. Garavini sur « le vertige sadique » (Monstres et chimères, chap. 6). Pratiquant une lecture du « soupçon », elle perçoit le chapitre De la cruauté comme une tentative pour conjurer l’identification subjective d’un tel vertige sadique, autrement dit la reconnaissance (par dénégation) de la cruauté dans la « complexion » même de Montaigne, avouée notamment au détour de l’allusion à la chasse : « – Quoi que ce soit un plaisir violent que la chasse ». Et l’on peut en effet se rapporter à cet égard, comme le fait également F. Brahami23, à l’analyse du mélange entre volupté et violence qui amène Montaigne à rapprocher la volupté amoureuse et celle la chasse pour insister sur l’intensité de cette dernière, plus impérieuse encore selon lui, et moins apte à la « diversion » que les flèches d’Eros.
Ce type de lecture n’a rien d’illégitime et il insiste sur un motif expressément souligné par Montaigne dans l’effort de déchiffrement de soi. Mais il a le défaut de rabattre trop vite l’analyse sur un discours, voire sur un lieu commun, autrement dit une « thèse » plutôt qu’une conviction subjectivement affirmée jusque dans sa formulation paradoxale : la cruauté est tapie en nous, elle n’est au mieux que conjurée, refoulée, y compris lorsqu’on prétend se rassurer ou « s’innocenter » en lui opposant un « naturel » sensible. Cette thèse n’a évidemment rien d’extravagant, elle est même assez ordinairement reçue et trouve dans les analyses des Essais de quoi être étayée ; mais elle reste en surplomb du cheminement du chapitre qui cherche une forme d’élucidation moins convenue. De fait, comme Montaigne le suggère en de nombreuses formulations évoquées ci-dessus, la cruauté n’est pas le contraire de la sensibilité, son extrême « dénaturation », mais bien l’une de ses modalités énigmatiques – même si on est tenté de la ramener par « discours » à la figure familière, déjà relevée, d’une opposition des contraires qui contribue à l’harmonie du tout. Pour ne pas en rester à cette interprétation en surplomb, il semble plus judicieux de soutenir l’hypothèse que F. Garavini néglige un peu trop vite en gommant tout le premier mouvement du chapitre : il y a bien une obscure communauté entre vertu et cruauté, cette dernière ne pouvant être totalement résorbée dans une « accoutumance » à l’inhumanité produite et renforcée par diverses institutions (dont celle de la justice pénale), pas plus que la vertu ne peut être assignée à un strict « naturel » exclusif de tout apprentissage ou « institution ».
Et cette hypothèse n’a finalement rien d’étrange eu égard aux cheminements divers du chapitre : on y retrouve le paradoxe du mode de vie cynique qui fait de l’ascèse, autrement dit d’un apprentissage des plus constants et exigeants, le moyen d’un retour vers la « voix » ou « loi » de la nature. Mais il faut justement en maintenir la dimension paradoxale, sans prétendre la résorber dans un rapport enfin stable entre ce qui reviendrait à la nature et ce qui reviendrait à la coutume24. L’allusion de Montaigne à la formule d’Antisthène – dont l’orientation philosophique est traditionnellement identifiée à la pratique même de la vertu – recoupe en ce sens une difficulté reconnue de longue date : comment s’accoutumer
à la vertu, comment la faire se constituer en « nature », sinon par une certaine forme de « cruauté » exercée sur soi dont il faut bien constater l’ambivalence structurelle et structurante, et qui ne peut donc se réduire à une pure accoutumance qu’il faudrait apprendre à « désapprendre » ?
On pourrait alors suggérer un autre titre pour ce chapitre : « De l’accointance de la vertu et de la cruauté ». Car c’est bien ce que suggère le mouvement d’analyse suivi par Montaigne, au-delà de ses apparentes digressions. Tel semble être notamment le sens de la comparaison esquissée entre la mort de Socrate et le suicide de Caton le Jeune, suicide exemplaire dans son refus d’allégeance à César, mais redoutable dans l’effrayante beauté de son accomplissement sanglant que Montaigne retranscrit à la suite de Plutarque : « Quand je le vois mourir et se déchirer les entrailles, je ne puis me contenter de croire simplement qu’il eût lors son âme exempte de trouble et d’effroi (…) Je crois sans doute qu’il sentit du plaisir et de la volupté en une si noble action : et qu’il s’y agréa plus qu’en autre de celles de sa vie (…) Il me semble lire en cette action je ne sais quelle éjouissance de son âme, et une émotion de plaisir extraordinaire, et d’une volupté virile » (II, 11, p. 149-150/4424). L’exhibition fortement soulignée de ce suicide grandiose montre, dans les termes précisément choisis par Montaigne, qu’il y a bien une certaine accointance entre les pointes de vertu et les pointes de cruauté, même si les secondes sont à l’évidence plus communes, plus ordinaires et plus répandues que les premières. La vertu serait ici, dans son intensification redoublée, une forme singulière de cruauté, sa forme la plus philosophique – et à coup sûr moins « vicieuse » ou inhumaine que toutes celles qui sont expressément décrites dans le chapitre, puisqu’elle porte sur soi25. C’est probablement là une des nombreuses pointes à travers lesquelles Nietzsche a pu se reconnaître en Montaigne.
François Roussel
1 De l’utile et de l’honnête (III, 1, p. 22/790-791). Les références entre parenthèses renvoient à l’édition des Essais par A. Tournon en 3 volumes (Imprimerie nationale, 1999) ; pour faciliter les renvois de lecture, est également indiquée à la suite la pagination de l’édition Villey-Saulnier récemment regroupée en un seul volume (PUF, 2004).
2 Dans un livre récent, Montaigne. Des règles pour l’esprit (PUF, 2007), qui conteste l’assignation exclusive des Essais à un “pur pyrrhonisme”, B. Sève souligne que Montaigne soutient des « thèses » fortes, notamment éthiques ; et il prend à titre exemplaire (chap. x) les descriptions et la condamnation de la cruauté réitérées dans de nombreux passages des Essais. Tenant l’essentiel de ses analyses pour acquis sur ce point, on propose ici d’autres inflexions de lecture du chapitre De la cruauté, tout en suggérant que le terme de « conviction » conviendrait mieux que celui de « thèse ». La structure délibérément paradoxale de l’affirmation « Je hais entre autres vices cruellement la cruauté » montre à tout le moins un écart réfléchi et même intensifié entre le contenu de l’énoncé et la position subjective d’énonciation ; il est difficile de ne pas en tenir compte, si l’on veut du moins en mesurer toute la portée.
3 Sur ce thème constamment relancé dans les Essais, cf. notamment De la physionomie (III, 12, p. 402/1049-1050).
4 Cf. sur ce point le passage du chapitre De ménager sa volonté : « L’accoutumance est une seconde nature, et non moins puissante. Ce qui manque à ma coutume, je tiens qu’il me manque » (III, 10, p. 344/1010).
5 Sur cet aspect, cf. notamment les analyses de G. Nakam dans Le dernier Montaigne (H. Champion, 2002), ainsi que son récent article à visée synthétique : « Enquête de Montaigne sur la cruauté », Nouveau bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, no 49, 2009.
6 Cf. « Violence : idéalité et cruauté », in De la violence (O. Jacob, 1996, p. 72). L’analyse très dense de ce texte incite notamment à rapprocher certaines formulations de Montaigne de celles de K. Popper dans le chapitre « Utopie et violence » de Conjectures et réfutations (Payot, 1985) : « Je hais la violence », ou encore « Ceux qui, comme moi, haïssent la violence… ». Je remercie E. Balibar d’avoir attiré l’attention sur ces formulations aporétiques produites en toute conscience et qu’il analyse à juste titre comme « un extraordinaire court-circuit du discours et du métadiscours ». On peut par ailleurs constater la multiplication d’études récentes sur le thème de la cruauté, même si nombre d’entre elles, telle celle de M. Erman, La cruauté. Essai sur la passion du mal (PUF, 2009), ont tendance à mélanger toutes les formes de violence en s’en tenant à un discours anthropologique très général et plutôt convenu sur le « mal » ou la « perversité » inhérents à la nature humaine. On pourra faire une exception pour le livre incisif de S. Margel, Critique de la cruauté (Belin, 2010).
7 Cf. « Des coches » : « Notre monde vient d’en trouver un autre » (III, 6, p. 197/908).
8 Parmi les nombreuses analyses portant sur ces séquences historiques de longue durée et sur leur entrelacement, on peut notamment renvoyer aux travaux de G. Nakam, Les Essais de Montaigne. Miroir et procès de leur temps (Nizet, 1984), de F. Lestringant, Le Huguenot et le sauvage (Aux amateurs du livre, 1990), Une sainte horreur ou le voyage en Eucharistie (PUF, 1996), ou encore de D. Quint, Montaigne and the Quality of Mercy (Princeton University Press, 1998) qui propose une interprétation sociologisante des valeurs morales de clémence et de compassion défendues par Montaigne comme alternative nobiliaire au modèle de la bravoure guerrière et de la vengeance d’honneur.
9 De l’expérience (III, 13, p. 448/1080)
10 Dans le texte déjà cité (note supra), E. Balibar avance cette notion d’« idéalité » qui englobe de manière large « tout le cycle des idées, idéaux, idéalisations » ; et il soutient que la cruauté, même si elle en apparaît plutôt comme un résidu énigmatique et privé de centre, ne peut être pensée ou appréhendée qu’en lien avec l’inévitable part de violence contenue dans les matérialisations diverses de ces « idéalités » – qui se nomment ordinairement « Dieu », « Nation », « Marché »… C’est bien dans cet horizon de sens qu’on peut dire que la nature est constituée par Montaigne (comme par nombre d’autres philosophes) en « idéalité », impliquant alors sa part obscure de violence, voire de cruauté.
11 Cf. cette remarque dans De la physionomie : « l’ambition, l’avarice, la cruauté, la vengeance n’ont point assez de propre et naturelle impétuosité : amorçons les et les attisons par le glorieux titre de justice et dévotion » (III, 12, p. 393/1043). Sur cette notion d’« intraitable » qui a évidemment des résonances diverses et notamment psychanalytiques, on peut renvoyer aux analyses de J. Hassoun, Les passions intraitables (Aubier, 1989) et La cruauté mélancolique (Aubier, 1995), et à celles de S. Zizek, L’intraitable. Psychanalyse, politique et culture de masse (Anthropos, 1993).
12 De la conscience (II, 5), Couardise mère de la cruauté (II, 27), Des boiteux (III, 11).
13 Sur cet aspect, cf. G. Palayret et F. Roussel, L’échange entre réciprocité et transaction, chap. ii (Belin, 2002). On peut rappeler en passant que C. Lévi-Strauss fait écho à ces analyses de Montaigne dans quelques-unes des pages les plus connues de Tristes tropiques et qu’il y revient à plusieurs reprises dans d’autres textes, reliant la question de la cruauté à celle de la présomption humaine exigeant des privilèges indus, une sorte de « royauté » usurpée sur l’ensemble de la création – ce que le chapitre De la cruauté développe également dans son dernier mouvement sur lequel on va revenir.
14 Dans les termes avancés par E. Balibar, on pourrait voir dans cette politique de « diversion » l’effort pour réinscrire la férocité ou le sadisme de la cruauté pénale dans une violence institutionnelle plus réglée, à défaut d’être entièrement maîtrisable.
15 A contrario, on pense inévitablement au fameux précepte cartésien concernant la science pratique capable de « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » (Discours de la méthode, 6ème partie), qui semble la démarcation presque explicite de la formulation de Montaigne.
16 On peut notamment se reporter à cet égard aux précisions apportées par P. Desan : « Apologie de Sebond ou justification de Montaigne ? », in Montaigne et la théologie (Droz, 2008).
17 Cf. E. de Fontenay, Le silence des bêtes (Fayard, 1998) dont l’amplitude de vue restitue les analyses et remarques d’E. Canetti, Adorno et Horkheimer, Kafka, Musil, Derrida.
18 Montaigne avait expressément signalé la dimension bigarrée de ce chapitre : « c’est ici un fagotage de pièces décousues » ; mais dans les corrections manuscrites, il a finalement barré cette remarque, suggérant peut-être un fil argumentatif plus continu quoique non explicite.
19 Sur cet aspect, cf. notamment J.-Y. Pouilloux, « De la vertu morale », in Des signes au sens (H. Champion, 2003).
20 La même difficulté est longuement analysée dans « De la physionomie » où la « vertu » socratique balance entre un bon « naturel » et une longue accoutumance venant contraindre une nature plus « vicieuse ».
21 Cf. le même registre ambivalent concernant la justice : « la justice que nous exerçons lors n’est aucunement une vertu : Il y a autre fin proposé, autre cause mouvante. Or la vertu n’avoue rien que ce qui se fait par elle et pour elle seule » (I, 37, p. 230)
22 L’hypothèse recoupe sur ce point, mais sur ce point seulement, les analyses de D. Quint (cf. livre cité note 8), notamment dans le chapitre 2 : « Cruaulty and Noblesse ».
23 Cf. l’article « cruauté » du Dictionnaire de Michel de Montaigne (H. Champion, 2007)
24 Malgré tout l’intérêt de ses analyses, c’est ce qu’a tendance à faire Michèle Clément dans le chapitre consacré à ce qu’elle nomme le « massif cynique » présent, quoique voilé, dans les Essais ; cf. Le Cynisme à la Renaissance, chap. viii (Droz, 2005)
25 On pourrait là encore faire résonner certains échos par rapport aux remarques d’E. Balibar à propos de la non-violence et de sa part de « sacrifice » de soi, voire de « mutilation » : « la non-violence ne met pas nécessairement fin à toute interrogation, car elle a partie liée avec un effort que nous faisons pour haïr l’instinct de violence en nous-mêmes (ce qu’en d’autres temps on aurait appelé notre élément diabolique, le “mal” en nous) » ; cf. « Violence : idéalité et cruauté », in De la violence (O. Jacob, 1996, p. 61).