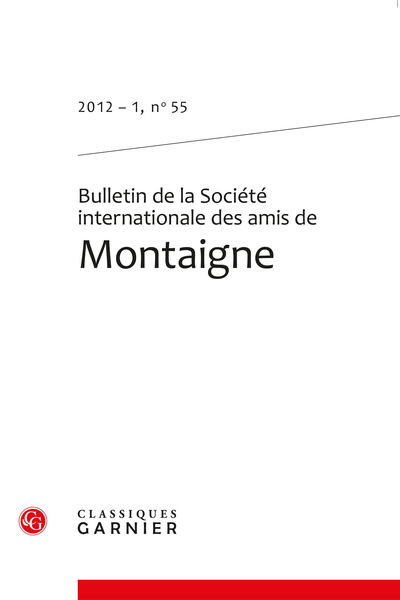
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2012 – 1, n° 55. varia - Auteurs : Royé (Jocelyn), Foglia (Marc)
- Pages : 305 à 312
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439766
- ISBN : 978-2-8124-3976-6
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3976-6.p.0305
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/07/2012
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Guillaume Navaud, Persona, le théâtre comme métaphore théorique de Socrate à Shakespeare, Travaux d’Humanisme et Renaissance, no 478, Genève, Droz, 2011, 544 p.
Souvent la justesse et la profondeur d’un essai se fondent sur l’étude d’un sujet qui repose jusque là sur l’évidence naturelle d’un axiome ou sur l’unanimité inscrite dans un lieu commun. Il en est ainsi de « L’homme joue dans la vie comme un acteur » ; « la vie est un drame » ou « le monde est un théâtre ». De même, l’étymologie offre parfois un élan décisif pour explorer ce sujet et donner la pleine mesure de son intérêt. Guillaume Navaud, s’appuie, dès son introduction sur ces deux assises pour présenter le cœur de son livre. Persona en latin signifie d’abord le masque pour ensuite, par extension sémantique et métaphorique, désigner le personnage puis la personne. Il s’agit donc pour l’auteur de mettre en lumière et d’examiner ce lien, ce rapport consubstantiel sur le plan lexical entre le paraître et l’être, entre la représentation et l’essence, pour apporter ainsi un éclairage nouveau sur la relation entre le monde du théâtre et celui de la philosophie puisque « le théâtre serait alors au cœur même de la formalisation de la notion de personne » (p. 19).
Dans une première partie (p. 23-104), consacrée aux origines, G. Navaud aborde précisément la « Théâtralité antique » dans ses trois composantes fondamentales : le chœur, le personnage, l’acteur. Selon Antisthène, Platon et Démocrite, le chœur est prédominant sur l’acteur. Ces trois penseurs en font un élément central d’une réflexion d’ordre politique, théologique et épistémologique. Mais, peu à peu, son importance décroit au bénéfice d’une seule entité, le personnage-acteur, propre à caractériser, notamment pour les rhétoriciens, l’individu. Le théâtre antique fait dès lors l’objet d’une véritable typologie des personnages attribuant à chacun, selon son masque et selon son discours, un rôle précis. Il revient à Cicéron, au nom de la rhétorique, et à Aristote, sur le plan de la philosophie morale, de cerner précisément la pertinence métaphorique du personnage, comique pour le premier, et tragique pour le second, comme étant la plus propice à représenter la condition humaine. À la figure du personnage-acteur vient se superposer celle d’un acteur-orateur amener à confondre le temps de la représentation le domaine esthétique et l’espace politique. Le débat qui s’est engagé
alors (et qui visiblement se poursuit toujours) consiste à distinguer totalement l’univers théâtral et le monde politique ou au contraire à fondamentalement les réunir. Très convaincant, notre auteur défend la deuxième position en insistant sur la similitude entre la théâtralité d’un orateur devant paraître le plus sincère et le plus naturel possible devant son public (éthopée) et la posture oratoire d’un acteur qui incarne avec le même naturel un autre (le personnage), récitant avec la même sincérité le discours d’un auteur (prosopopée). C’est la persona qui « permet de penser un masque énonciatif caractérisé par sa plasticité et son artificialité » (p. 103) réconciliant donc l’orateur, l’acteur et le sage dans une optique morale.
C’est à la « morale de l’acteur » que l’auteur s’attache dans un second temps (p. 107-337). Une morale qui se fonde sur des critères théoriques précis attachés à la notion de persona : la bienséance, la distanciation et la faculté de jouer plusieurs rôles (polythropie). Les pages consacrées à la bienséance dans le monde antique sont des plus stimulantes tant cette notion irrigue également la réflexion théâtrale de l’époque moderne. La persona y joue un rôle central en tant que modélisation esthétique d’une action éthique, elle engage l’hypokrisis, « l’art grâce auquel l’acteur, l’orateur ou le philosophe s’adaptent aux circonstances internes et externes qui régissent leur interprétation » (p. 110). Esthétique, car elle tend donc à interroger aussi bien le jeu de l’acteur que l’art du poète, éthique par la portée morale du discours proposé. Cicéron ne sépare pas l’une de l’autre mais insiste au contraire sur leur interaction. La bienséance demande une grande faculté d’adaptation de l’acteur au rôle qu’il joue. Il doit convenir. G. Navaud consacre quelques pages à la « postérité de la bienséance », marquée par l’influence, au Moyen Age et à la Renaissance, de la pensée cicéronienne, et bien sensible chez Jean de Salisbury ou chez Erasme. Cette adéquation bienséante de l’acteur à son personnage appelle toutefois à considérer l’idée a priori faussement anachronique (selon les bornes historiques fixées par l’auteur lui-même) de la distanciation. Au concept d’un acteur empathique que Platon théorise, s’oppose celui des philosophes cyniques et stoïciens d’un acteur nécessairement distancié pour qui « la sottise du mauvais acteur consiste à croire qu’il est son personnage, et que ces deux versants de la persona n’en forment qu’un » (p. 167). À la
Renaissance, Montaigne a été l’un des rares à reprendre cette idée en particulier dans l’essai « De mesnager sa volonté » (III, 10) où il prône la distanciation non seulement dans les questions religieuses ou politiques mais aussi dans « la comédie sociale » jouée par les puissants. L’extrait cité est des plus éloquents « Le Maire et Montaigne ont tousjours esté deux, d’une separation bien claire » (p. 175) et se poursuit par une analyse originale sur l’emploi du verbe « transubstancier » par le magistrat bordelais. Pour ce dernier, devenir totalement autre que soi est illusoire mais la distanciation lucide entre le public et le privé est nécessaire. La dialectique entre le masque et le rôle est plus équivoque. À la fois condamnable dans la sphère privé, il devient nécessaire dans l’espace public mais soumis à une nécessaire maîtrise, un « contrerolle », comme l’écrit Montaigne, afin de s’assurer de la justesse de son attitude. G. Navaud écrit des pages fécondes sur l’écrivain qui a tant insisté dans ses Essais sur la distinction morale du vrai et du faux mais aussi sur la plus délicate différence entre l’être et le paraître. On peut éventuellement regretter que le dialogue fertile instauré principalement avec Jean Starobinski ne se prolonge pas avec d’autres réflexions plus récentes menées, par exemple, par Gisèle Mathieu-Castellani dans son ouvrage, Montaigne ou la vérité du mensonge (2000) ou encore par Jean-Yves Pouilloux dans son article « La forme maîtresse » paru dans Montaigne et la question de l’homme (1999). La question du scepticisme de Montaigne, qui a été approfondie dans les études d’Emmanuel Naya et dans celles de Frédéric Brahami, aurait également permis de nourrir la perspective envisagée par G. Navaud. « Tomber le masque » devient la dernière expression de cette distanciation en œuvre dès l’antiquité et revivifiée à la Renaissance. Dernière posture morale, examinée par l’auteur, celle de l’acteur jouant plusieurs rôles, la polythropie. Elle permet de « remettre en cause l’équation platonicienne posant une équivalence entre univocité et sincérité » (p. 297), donnant toute sa persona à l’acteur. Ce dernier prend toute sa dimension grâce à son talent et la justesse de ses représentations. Le quatrième chapitre de cette partie se propose de réunir, sous la figure du philosophe de cour, les trois précédentes postures morales jusqu’alors étudiées séparément. Coriolan illustre un débat portant sur le rôle de conseiller du prince
opposant la vision de Thomas More et celle d’Erasme. La pièce de Shakespeare dénonce la mascarade d’un pouvoir gesticulant sur une scène devenue politique.
« Le monde est un théâtre » disions-nous. La dernière partie de l’essai examine véritablement le topos baroque mais en le renversant puisqu’il a pour titre « La Métaphysique du théâtre » (p. 341-487). L’étude se consacre d’abord au poète et à la métaphore de l’homme-acteur dans l’antiquité mais aussi à la Renaissance notamment sur la scène anglaise (on lira quelques pages décapantes à propos de Macbeth). Dans les chapitres qui suivent il est question d’observer précisément le monde du théâtre dans sa relation à l’acteur (distribution des rôles, incarnation du personnage, interprétation, désincarnation puis rétribution) se posant comme le théâtre du monde. Il s’agit, avec Cicéron, de mettre en lumière la relation entre autor et actor mais aussi le rapport entre homo et persona invitant le spectateur à considérer ce qu’il voit comme un moment de vie, « La persona est donc l’instrument conceptuel qui permet de donner une actualité, fut-ce sous la forme d’un masque à l’idée abstraite de l’homme […] » (p. 425). Mise en abime nécessaire, c’est Le Grand Théâtre du Monde de Calderón qui définit un homme (acteur) pris entre les préceptes du souffle divin (direction de jeu) et son libre arbitre (autonomie de l’interprétation). La rétribution de l’acteur, action au combien nécessaire, prend une valeur allégorique car elle tend à se porter davantage, grâce au dénouement heureux, sur le personnage que sur l’acteur, « normalisant » ainsi, selon G. Navaud, la tragédie en tragi-comédie.
La conclusion est l’occasion de donner un élan aux analyses d’ensemble qui pouvaient, malgré les transitions toujours amenées avec pertinence, paraître animées de mouvements centrifuges. G. Navaud donne ainsi une cohérence et une logique à une étude singulière portant sur des textes, sur des dramaturgies et sur des auteurs apparemment divers et différents. Il lui revient également d’avoir donné une signification remarquable de profondeur et de précision à ce verbe « être » qui se place si naturellement entre les deux mots que sont le monde et le théâtre. L’érudition du travail est impressionnante notamment parce qu’elle est toujours modestement présentée et qu’elle apparaît toujours nécessaire. On ne peut que féliciter son auteur de la parution de cet essai qui,
plongeant dans les sources antiques du théâtre et se prolongeant dans notre modernité nous donne des clés pour saisir aujourd’hui la place et l’influence de l’illusion mais aussi de l’illusoire.
Jocelyn Royé
Carlo Cappa, L’Educazione nella torre. La formazione dell’individuo nel Rinascimento e gli Essais di Montaigne, Milano, FrancoAngeli, 2011.
L’Italie maintient les études montaignistes à un niveau toujours élevé de production et d’érudition. En quelques mois à peine viennent de paraître trois ouvrages, de Nicola Panichi, que les membres de la SIAM connaissent de longue date (Montaigne, Roma, Carocci, 2010), de Carlo Montaleone (Oro, cannibali, carrozze. Il Nuovo Mondo nei Saggi di Montaigne, Roma, Bollati Boringhieri, 2011), de Giancarlo Pizzi (Saggio sulla biblioteca di Montaigne, Qualecultura, Vibo Valenzia, 2011), et de Carlo Cappa. Nous lirons ce dernier ouvrage, paru dans la collection « scienze della formazione » chez FrancoAngeli, éditeur transalpin réputé pour les sciences humaines, dans la perspective d’une contribution aux études montaignistes, même si l’ouvrage admet d’autres types de lecture en vertu de sa richesse intrinsèque. L’auteur, enseignant en sciences de l’éducation à l’université Tor Vergata de Rome, a commencé à travailler sur le problème de la diversité dans la pensée de Montaigne en 1998. Il focalise ici sa réflexion sur la place légitime que peut occuper l’auteur des Essais dans l’histoire de l’éducation, histoire qu’il ne considère jamais seulement comme fin en soi, mais toujours aussi comme un moyen de rendre plus vivante et plus rigoureuse l’actualité de la réflexion pédagogique. Montaigne nous permet d’affiner notre compréhension de la « formation de l’individu », réactivée ici avec maestria comme le principe directeur de l’humanisme renaissant.
Dans son contexte historique, et avec les Essais en ligne de mire, que l’auteur cite volontiers en français avant de donner la traduction en italien, l’ouvrage aborde successivement les thématiques du voyage (chap. 1), de l’animalité (chap. 2), du père et de la famille (chap. 3), de l’art des grotesques (chap. 4), avant de s’interroger sur le sens du geste pédagogique de Montaigne (chap. 5). Le traitement thématique présente l’inconvénient de refuser à l’ouvrage un sens global immédiatement clair, mais l’avantage de pouvoir mettre en œuvre avec une grande souplesse les apports de disciplines et des références variées. L’auteur est alors en mesure d’apporter de remarquables contributions à la lecture de Essais ; à titre d’exemple, la connaissance du texte et de son contexte permet à Carlo Cappa de pointer une erreur d’interprétation persistante : la « tête bien faite » a été attribuée à l’élève et non, comme le fait Montaigne, à
son « conducteur » (« je voudrois aussi qu’on fut soigneux de luy choisir un conducteur qui eust plustost la teste bien faicte que bien pleine », éd. Villey, p. 150). Dans quelques pages richement documentées, l’auteur montre que l’origine de cette erreur d’interprétation, chez Edgar Morin comme chez Emile Durkheim, vient de la radicalisation de la pédagogie montanienne chez Rousseau.
Contrairement à une idée reçue, Montaigne ne rejette pas l’instruction, ce qui n’enlève rien à la « vigueur du corps à corps contre le système d’instruction » (L’educazione, p. 243) en vigueur à l’époque, ni à l’insistance avec laquelle le Bordelais réclame une ouverture de l’éducation sur le monde. Carlo Cappa saisit l’occasion pour inclure le chapitre iii, 13 dans les chapitres de la réflexion pédagogique de Montaigne : la diversité de l’expérience apparaît comme une vaste objection dirigée contre un système intellectuel qui tourne en rond. Montaigne porte alors le fer contre chacune des trois « facultés » dominantes, le droit, la médecine et, à mots plus ou moins couverts, la théologie. Le vocabulaire, les modalités et les finalités de la pédagogie montanienne ne sont pourtant guère originales en leur temps. Même lorsque la réflexion prend un tour radical – la remise en question de l’humanisme comme commentaire indéfini des œuvres classiques –, il puise dans un riche matériau antique et renaissant. Carlo Cappa en vient à contester le positionnement de Montaigne comme « pédagogue » : l’auteur des Essais aborde plutôt la question de l’éducation « en noble et en intellectuel fin de siècle » (p. 242). Montaigne s’abstient de rêver d’une réforme des écoles, comme le faisait Érasme ; il confie l’éducation à une personne, non à une institution. Il s’agit d’un « guide » et non d’un maître, l’essentiel du processus éducatif reposant par ailleurs sur la confrontation du jugement personnel avec l’expérience. L’ouvrage situe l’apport philosophique de Montaigne à l’histoire de l’éducation dans le désir de fonder une éducation efficace, adaptée à l’expérience, et dont le mot clé est sans doute « l’adaptabilité » (p. 258). Alcibiade en est la figure de proue, bien davantage que Socrate, ce qui n’est pas sans susciter chez Montaigne lui-même quelque inquiétude morale, à l’égard de la multiplicité des possibilités humaines. Dans un monde devenu immanent, Montaigne s’abstient d’évoquer le rôle éducatif de la religion : sans doute faut-il y voir un trait de modernité, mais aussi un signe de prudence, alors que la religion est devenue source majeure de conflit. Mais, demandera-t-on, l’éducation peut-elle se passer
de normes et de valeurs, dont l’existence serait au moins implicite ? Érasme opposait encore, et de manière assez schématique, l’aspiration à l’enrichissement matériel ou au pouvoir politique d’un côté, la conquête de biens intérieurs de l’autre, pour mieux condamner les premiers et valoriser les seconds. La perspective de Montaigne est celle de l’action dans le monde sans finalité préexistante.
L’éducation montanienne est préparation à mener une vie épanouie dans le monde, mais aussi à cultiver ses distances avec celui-ci. L’éducation a aussi pour cadre le studiolo, à travers la lecture des œuvres classiques. Loin d’y voir une contradiction, nous pouvons penser avec Carlo Cappa que Montaigne fonde le paradoxe de l’éducation moderne, celui d’une formation de l’individu orientée vers l’action et la vie en société, et en même temps, d’une formation au libre usage de la pensée personnelle. L’individu moderne se définit-il pas, à travers l’antécédent que représente Montaigne, par l’indépendance de son jugement ? La « formation de l’individu », tout particulièrement dans les Essais, donne à l’ouvrage de Carlo Cappa son sous-titre, et son puissant fil directeur.
Marc Foglia