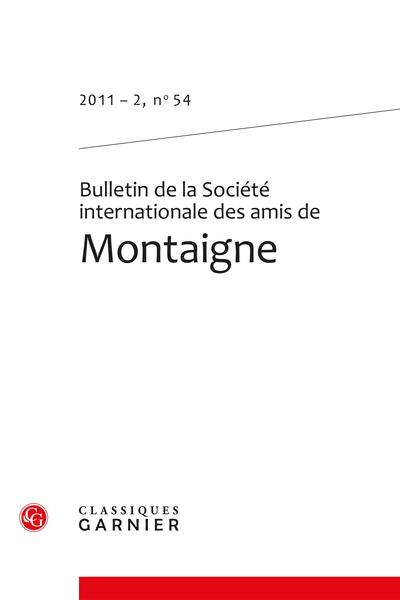
« Mon miroir ne m’estonne pas… » Montaigne sonde le corps et provoque les médecins
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2011 – 2, n° 54. varia - Auteur : Montaleone (Carlo)
- Pages : 91 à 107
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439759
- ISBN : 978-2-8124-3975-9
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3975-9.p.0091
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 14/10/2011
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
« Mon miroir ne m’estonne pas… »
Montaigne sonde le corps et provoque les médecins
Lotus nobiscum est hilaris, cænavit et idem,
Inventus mane est mortuus Andragoras.
Tam subitæ mortis causam, Faustine, requiris ?
In somnis medicum viderat Hermocratem
Martial
Nous n’allons pas ; on nous emporte, comme les choses qui flottent, ores doucement, ores avecques violence, selon que l’eau est ireuse ou bonasse. (II, 1)
Cháque jour nouvelle fantasie, et se meuvent nos humeurs avecques les mouvemens du temps. (II, 1)
Nous flottons entre divers advis : nous ne voulons rien librement, rien absoluëment, rien constamment. (II, 1)
Nous sommes tous de lopins, et d’une contexture si informe et diverse, que chaque piece, chaque momant, faict son jeu. (II, 1)
1. Pour Montaigne, le détail essentiel consiste dans le fait que l’individu rassemble et accumule des idiosyncrasies, des hypersensibilités, des rejets, des souvenirs humoraux, enfin tout cet enchevêtrement d’hyperesthésies que le langage commun restitue en en répartissant les effets entre le corps et l’âme, les deux théâtres qui voyagent merveilleusement ensemble, et avec l’âme qui toutefois semble exhiber quelque « force au dedans pour se reconnoistre1 » même dans la totale défaillance des sens (remarquez la lourdeur du verbe semble, de Montaigne). De fait, le corps est une portion de nature pleine de qualités et de propriétés incompréhensibles et prodigieuses ; la goutte de semence d’où nous provenons, la goutte
d’eau qui porte en elle non seulement les traces de la forme corporelle, mais aussi des pensées et des dispositions de nos pères… Qu’y a-t-il de plus fantastique2 ? Montaigne se débarrasse aussi de l’humilité subtile des présomptueux qui acceptent la frontière de l’incompréhensible pour n’être crû que sur ce qu’ils déclarent comprendre3. Qui peut dire pourquoi on guérit ? La maladie pourrait avoir suivi son cours, un effet du hasard, quelque chose que l’on aurait mangé ou bu ou goûté ce jour là, « les prieres de sa mere grand ». Où est la preuve ? « Davantage, quand cette preuve auroit esté parfaicte, combien de fois fut elle reiterée ? et cette longue cordée de fortunes et de r’encrontres, r’enfilée, pour en conclurre une regle ? ». Et, même en admettant que cela puisse être déduit, « par qui est ce4 ? ». Il suffit de ces deux questions et l’image qui paraissait correcte se peuple d’indices monstrueux ; les faisceaux de nerfs noués entre eux en lignes sinueuses mystérieuses sont vraiment trop nombreux, ils sont trop incontrôlables ces caillots de sang, ainsi que les clapotis des humores aperçus par Hippocrate comme régulateurs de nos équilibres internes et, surtout, ils sont très gênants ces petits cailloux roulant sans trop de hâte sur le chemin reins-urètre-vessie, toujours prêts à se réfugier bien au chaud d’un quelconque repli gélatineux, avec d’horribles phénomènes de rétention, avec des coliques et des fièvres et des vomissements innommables qui altèrent le cours régulier des pensées. Parce que, et tout le monde le sait, il suffit d’un mal de ventre pour interdire la pensée. Mais si les choses en sont là, c’est assurément de la mauvaise foi de réitérer que derrière le rideau qui sépare la pensée de ses miracles, il y a encore la pensée. Comme les naturistes, que Sainte-Beuve accusait d’avoir élevés, Montaigne raisonnait en suivant la voie des proximalités. Le récit a donc ce noyau : que la pensée n’est pas dissociable des mouvements du corps. Tout est là, tout est dans le gargouillement des déterminismes qui arment le corps. C’est là que se produit la manipulation suprême qui nous rend un ramassis de pauvres emportés. Nous sommes des emportés parce que notre formelle égoïté est un flatus vocis, un label, une plaquette pas plus épaisse qu’un souffle, les hommes étant véritablement faits de « petits morceaux » disjoints ; emportés parce qu’il suffit d’un petit caillou pour éteindre la lumière de
la remarquable unité supérieure appelée moi. Il n’y a rien à dire, si on est appelé à concevoir un blason, avec l’idée d’en faire l’emblème d’un homme cloué au sol, il serait opportun d’éviter les ornements et les devises rappelant les ailes des oiseaux.
2. Attention toutefois. Quand il écrit les mots que nous commentons, Montaigne n’entend pas attiser des séditions ou des récriminations. Proposer des schismes, cela ne lui a jamais plu, ni, d’autre part, notre homme s’est laissé tenter par des crises identitaires. Il s’abandonne plutôt aux prises d’acte intellectuelles (parfois même géométriques et redoutables) et, dans ce cas, la prise d’acte de II, 1, « De l’inconstance de nos actions », est vraiment ancienne. Michel avait accompli trente et un ans lorsque – après avoir lu le De rerum matura à peine sorti des mains bienveillantes de l’humaniste Lambin – il écrivit sur une feuille de commentaires joints à ce livre immortel les mots suivants : « Coniunctissima sunt corpus & anima ergo eiusdem naturae, Falsum est corpus non sentire, sed solam animam5 ». On était en 1564, l’année horrible qui suivit la mort d’Étienne La Boétie, son ami, l’amour, que Montaigne commémore en dégelant dans les éblouissements lucrétiens un tourment dont il n’aurait plus éprouvé de pareil. Dans ces pages, Michel cherchait les caresses lénifiantes de la courtisane la plus habile et, probablement, il les trouva. Toutefois, des éblouissements et de la démesure du grand poète, il reçut bien autre chose. En quelques mots, il reçut l’idée d’une barrière naturelle qui envahit les vivants, sans frein et dans toutes les directions. Toutes, sans aucun respect pour les frontières que nos mots irresponsables, se joignant aux radotages du monde, continuent à construire tout autour du corps et de l’âme en tant qu’éléments séparés « irréductibles ». Or, des essais tel que « De l’inconstance de nos actions » confirme que cette barrière naturelle, Montaigne ne s’est pas limité à la repérer. Indécomposable et chaste, elle devient chez lui méthode et expérience, expérience et soin de soi-même. Je sais où est mon corps, je le vois, je le touche, je l’interprète, je me sens, je le dis. Et l’âme ? Le registre historique des opinions était impressionnant et aucune réponse n’avait atteint la cible. Où est l’âme ? dans tout le corps ? dans la poitrine ? dans le sang ? dans le ventricule du cerveau, comme
le prétendent Hippocrate et Hérophile6 ? Lire les réponses des Anciens, d’ailleurs, ne servaient qu’à la prolifération chaotique d’absurdités. Opinions. Montaigne soupçonne que l’âme, quelle qu’elle soit, côtoie des arrières obscurs.
C’est toutefois là le soupçon que notre homme remâche alors qu’il assiste au spectacle de l’esprit – « grand ouvrier de miracles », comme cela lui arrive d’écrire7. Mais à exciter sa curiosité ce n’est pas les questions sur la pensée, c’est la diversité du spectacle. Ce qui le frappe c’est le différent qui se génère et que l’esprit poursuit en conjuguant des ressemblances et des affinités, des différences et des discordances, par vagues de réactions et de rétroactions, de heurts et d’ébahissements aveugles qui se produisent grâce à des accélérations incontrôlables. Ce n’est pas pour rien que la loi des « corps naturels » – qui domine chez nous, les humains, comme dans les fleuves et dans les océans8 – réside dans l’élargissement de l’incontrôlable. Est-ce une autre manière de comprendre que tout se meut au hasard, que tout est incertain ? Il semblerait que oui, et c’est là une raison supplémentaire pour réfléchir sur le corps non seulement comme espace vécu, mais aussi comme espace abstrait, obtenu grâce à la création d’un langage. Il serait impossible de concevoir les « petits morceaux » qui composent le corps ou la « texture » informe et bizarre qui le rend vivant sans activer un « comme si » non déductible ; choisi au départ, ce « comme si » établit les lois d’un univers. Le reste du discours – les lieux dont on parle, les événements qui se produisent – sera fait par les lois de cet univers. Quand il écrit qu’il se voit comme une contexture si informe et diverse, que chaque piece, chaque momant, faict son jeu, Montaigne accepte les règles qui l’ont inventé tel qu’il est. Il les observe avec une grande attention, cela va de soi. Après, une fois mort, notre corps sera une autre chose. Ce sera un « résidu » qu’aucune déduction de l’anatomiste le plus génial ne pourra jamais associer aux coups de
griffe et à la douceur avec laquelle l’insaisissable didactique de la vie avait veillé à nous instruire.
La clarté avec laquelle Montaigne voit le problème ressort dans un célèbre passage de l’« Apologie de Raymond Sebond ». Là, en désignant « les dieux de la médecine » qui vainement discute sur notre anatomie, il nous fait comprendre que les estafilades de lumière sur le labyrinthe anatomique, la carcasse ouverte, n’en démêleront jamais l’obscurité substantielle9.
3. On ne compte pas moins de trente-cinq ans entre l’idée, qui se précise au fur et à mesure du « sujet corporel », mûrie tout de suite grâce aux bons offices de Lucrèce, et 1588, date de publication du IIIe livre des Essais. Mais, malgré tout, écoutons Montaigne dans « De l’expérience », le dernier essai du IIIe Livre :
« Mon miroir ne m’estonne pas, car, en la jeunesse mesme, il m’est advenu plus d’une fois de chausser ainsin un teinct et un port trouble et de mauvais prognostique sans grand accident ; en manière que le medicins, qui ne trouvoient au-dedans cause qui respondit à cette alteration externe, l’attribuoient à l’esprit et à quelque passion secrete qui me rongeast au-dedans ; il se trompoient. Si le corps se gouvernoit autant selon moy que faict l’ame, nous marcherions un peu plus à nostre aise. Je l’avois lors, non seulement exempte de trouble, mais ancore pleine de satisfaction et de feste, comme elle est le plus ordinairement, moytié de sa complexion, moytié de son dessein10 ».
En calibrant les rapports entre le « corps » et l’« âme » comme des séries causales « non homogènes », Montaigne récrit le sens de mots qu’il avait rédigé sur l’un des flyleaves qui enrichissent sa copie du De rerum natura : « Nam laborat sæpe corpus sana mente & è diuerso/sic pes dolet non caput/æquè enim diuersæ sunt partes11 ». L’acoustique du temps donne une intensité toute spéciale à la dénonciation actuelle de la tromperie. Parce que, et c’est évident, les médecins ne font que ça : ils trompent en affirmant que le teint, le dehors, est le signe de quelque chose d’autre placé dedans. En réalité, celui de Montaigne est un point d’orgue d’un
discours/vision dans lequel ce qui est mis en marge c’est l’étiologie d’un Gardien Prévoyant. En résumer les termes cela signifie comprendre (i) que le dedans (âme > jubilation, joie ou quelque chose d’autre) et le dehors (corps > teint du visage et aspect troublé ou quelque chose d’autre) se lancent des défis sémiotiques diversifiés ; (ii) que la sémiose du sujet corporel, c’est-à-dire l’ensemble des transformations qui rend l’individu ce qu’il est, totalise des effets que le jugement empirique n’enregistre pas comme mutuellement conformes ; et enfin que (iii) le dedans et le dehors, qui s’affrontent comme données hétérogènes et inconciliables, peuvent être manipulés par le jugement qui tend à les réunir comme effets d’un espace causal fictif.
Si nous devions tirer une première conclusion, nous dirions que Montaigne nous invite à affronter la panique des contiguïtés corporelles sans courir le risque de se faire emporter. L’idée que certaines affaires de notre corps peuvent servir de signes pour d’autres affaires s’appuie sur une harmonie de la création qui ne peut qu’être prétendue, mais qui va bien au-delà de l’expérience. Y a-t-il des symptômes de séries causales que le jugement certifie comme discordants ? Et bien, il n’y a pas une seule raison suffisante pour chercher à les rendre concordants. Comme répondrait le diagnostiqueur contemporain devant un cas de compliance manquée vis-à-vis de symptômes, nous le savons parfaitement. Ce serait un motif pour d’ultérieurs approfondissements et de coûteuses analyses cliniques. Mais hier ? C’est justement par rapport à hier que la réponse de Montaigne prend tout son sens. La question, hier, était métaphysique. Pour un médecin métaphysique songer qu’à un mauvais teint ne correspond rien d’inquiétant dedans c’était un comportement de troglodytes. Est-ce pensable qu’au sein de l’individu l’unité des causes entre elles ne travaille pas ? Voilà, dans l’épisode du miroir, Montaigne évoque la réponse des médecins à cette crux de l’ancienne métaphysique que lui, au contraire, n’est absolument pas intéressé à dégrossir. De la querelle, si amoureusement cultivée par les épicuriens et stoïciens, il capte – pour s’y complaire à son aise – ce que nous appellerons la classe des conséquences. De l’unité des causes entre elles, les stoïciens voyaient bourgeonner l’enchaînement nécessaire des effets, puis le fantôme d’un destin ; du manque d’unité des causes entre elles les épicuriens voyaient naître le hasard. Montaigne ne discute ni du destin, ni du hasard, toutefois son penchant est plus qu’évident. Ses dieux son Épicure et Lucrèce. Être
transportés, osciller, céder chaque jour à de nouvelles fantaisies, ce sont des locutions (comme des milliers d’autres des Essais) qui visent à attester le champ de l’incontrôlable. Contrôlable, avec les moyens du pur esprit et dans l’abstrait, c’est uniquement le rapport entre le mouvement et la cause, dans le sens qu’il n’y a pas un mouvement sans sa cause. Ou pour le moins, c’est le cas chez Montaigne, qui en effet retrouve ce rapport dans le tourbillonnement des petits lopins dont nous sommes faits, comme le reporte « De l’inconstance de nos actions » (alors que souvent la même main a écrit le mot atomes). Toutefois, il y a d’autres explications qui nécessitent une évaluation. À la suite de ses propos sur la « contexture si informe et diverse que chaque pièce, chaque moment, faict son jeu », nous devinons que notre homme avait en tête la lex atomi annoncée dans le De rerum natura.
Toutefois, au lieu de voir le clinamen comme un angle qui, à un certain moment, modifie une chute verticale, Montaigne l’interprète comme la direction d’origine de l’atome à tout moment. C’est le turning point. À tout moment les atomes ouvrent de nouveaux angles de contingences en fonction des séquences qui changent instantanément la sommation. Pour Montaigne, c’était une manière pour dire que les choses comme on les voit, à cause de la loi qui les domine, ne sont jamais scellées dans les valves d’un Tout, d’une Unité, d’un Destin que la pensée puisse concevoir définitivement. Bref, la leçon serait la suivante : la Nature est tout bonnement la simple production de « la diversité et variété12 » : diversité des espèces, diversité des individus de la même espèce, diversité des parties du même individu.
Il en résulte une constatation évidente : l’élan de dissociation qui œuvre dans le couple conceptuel dedans/dehors, ainsi que le vieil adage « Coniunctissima sunt corpus & anima ergo eiusdem naturae… » rejaillissent des motivations de la lex atomi. La réticence de Montaigne à accepter « l’unité des causes entre elles » nous l’interprétons comme le renoncement à triompher des fatalités inexpliquées, derrière lesquelles l’étiologie capture quelque chose de plus intelligible d’une recépée de puissances obscures en action. D’ailleurs, que le dedans et le dehors ne soient pas des miroirs réfléchissants cela ne signifie pas que le sujet corporel ne dure pas dans le temps grâce à l’enchevêtrement chiasmatique de nombreuses séries
causales ; ce sont, tout au plus, les attentes des médecins (ou les nôtres ou des uns et des autres) à mettre en scène des plaintes impropres. Pour ne pas se tromper, il faudrait ne pas avoir d’attentes, être ataraxiques, mais ce serait insensé.
Comme, d’autre part, il est insensé de parler des intentions de l’âme. Montaigne le savait-il ? Nous soupçonnons fortement que oui, bien que parfois cela n’apparaisse pas. Quand il parle des intentions que nous poursuivons, et qui nous induisent à concevoir et à décider cette chose, il n’oublie jamais de les reconduire à la nature de la volonté : qui, il est vrai, ne peut pas ne pas vouloir ce qu’elle veut, mais seulement parce que, étant gouvernée par « mousches et atomes13 », elle ne sait pas ce qu’elle veut. « Nos conseils fourvoyent, par ce qu’ils n’ont pas d’adresse et de but14 », écrit Montaigne avec un exploit déconstructif où il est prévu que la liberté de choix pourrait même disparaître. Mais, et c’est là le point, cette destruction innocente compense-t-elle le fait que céder à la nature mater ait une valeur émolliente rien que pour faire semblant ? Manipulation, extrêmement bizarre, d’atomes et de vide, la chose humaine absorbe un tel flux de non sequitur, de mousses fantasmatiques, de disjonctions, de lancements d’alternatives, de décollages imprévus, à en avoir terriblement peur. Et Montaigne le sait. Bien au contraire, la crainte de ne pas réussir à « mesnager sa volonté » l’obsède au point de lui extirper une question que personne n’imaginerait : notre esprit – « grand ouvrier de miracles », comme nous l’avons déjà rappelé – ne pourrait-il pas faire de nos agissements un autre rêve et de notre veille « quelque espece de dormir15 » ?
Quelques siècles plus tard – considérons l’outrance de l’inattendu – on retrouve le même problème et presque les mêmes mots dans une lettre de Ludwig Wittgenstein à Paul Engelmann. Wittgenstein sature habilement l’interrogation en remarquant que, oui, peut-être nous rêvons, mais que, de temps en temps, nous nous réveillons juste ce qu’il faut pour nous apercevoir que nous sommes en train de rêver16. C’est une réponse dans laquelle notre nobilhomme retrouverait cet élan à démystifier qui l’avait conduit
devant la fonction des médecins avec la sensation d’effleurer l’abîme. Le corps abyssal et les médecins, voilà ce à quoi les « transportés » devraient prêter attention pour ne pas devenir victimes de radotages.
4. Mais retombons aux flyleaves annexés au livre de Lucrèce. Avant la phrase « Coniunctissima sunt corpus & anima ergo eiusdem naturae » nous lisons « Accidit sæpe ut & animus doleat se non ægra anima & è diuerso17 », qui est le pendant de l’autre phrase déjà citée, « Nam laborat sæpe corpus sana mente & è diuerso/sic pes dolet non caput/æquè enim diuerse sunt partes18 ». Or, ces dernières bribes de commentaire – enim diuerse sunt partes/en effet, ce sont des parties différentes – confirme ce que nous savions déjà : le naturalisme de Montaigne se fonde sur une mantique du manque qui doit forcément être reconnue par celui qui n’aime pas le mystère. Car, s’il est à « croire qu’il ne s’engendre rien en un corps que par la conspiration et communication de toutes les parties », où « la masse agit tout’entiere », on ne peut même pas éviter de penser que « l’une piece y contribue plus que l’autre, selon la diversité des operations19 ». Certes, il apparaît singulier qu’on parle de mantique du manque à propos d’un auteur qui s’inspire d’un des chefs-d’œuvre de la poésie qu’à la Renaissance on définit scientifique, et c’est encore plus singulier que cela ne soit pas une donnée incongrue. Mais c’est ainsi. La non-homogénéité des parties du corps, qui féconde le tumulte diagnostique, autour duquel les médecins tissent leurs irresponsables danses de mort, c’est l’interface de l’impossible discernement de l’unité parmi les causes, à la racine desquels il y a les insolubles angles de contingence avec lesquels la lex atomi engendre le monde. Qu’on doive donc, pour être fidèle aux signes, les vider de tous les messages à l’exception d’un seul, celui pour lequel chaque signe trouve une espèce de glaciale intelligence passive dans le principe même de la causalité différenciatrice ? Montaigne augmente ce suspect paralysant. Dans « De l’exercitation », un Montaigne dur, sans même un fil d’attachement serein pour l’objet corporel vivant, sentant, discoureur qu’il est habituellement, en arrive à dire que le fait de se montrer aux autres est un ensemble d’actes extérieurs, qui ne disent rien de lui. Et il ajoute que son dehors d’individu connaît la brutalité d’événements que
ses actions cherchent à contrecarrer, mais dont il serait déplacé pour quiconque d’avancer des conclusions véridiques sur lui, sur son dedans. On ne sait pas où on en est. Montaigne, qui ne veut pas être reconnu coupable de partialité sceptique, répond toutefois en plaisantant, que son champ de retombée non apparent est celui d’une momie – skeletos c’est le terme qu’il utilise20 – « où, d’une veuë, les veines, les muscles, les tendons paroissent, chaque piece en son siege21 ». Ici, rejaillit aussi la croix des séries causales différenciées (tousser, pâlir, avoir des palpitations etc.) accompagné toutefois par le phantasme impatient et entier d’une matérialité sans issue. Et, en effet, quelle est la momie sur laquelle soudain apparaissent des veines, des muscles et des tendons ? L’antiphrastique Montaigne, avec son habituel talent mimétique, n’a en tête aucun cadaver assiccatum, il est plus probable qu’il voulait nous faire savoir qu’il a doublé la mise par rapport aux normales dissections des théâtres anatomiques. La dissection qu’il vise – chaude et rapide, insaturable et inouïe – retombe sur cet entier qui n’est autre que le corps des propres pensées. C’est son défi, celui pour lequel il n’entend pas renoncer, bien qu’il connaisse parfaitement les difficultés à glisser les pensées « en ce corps aërée de la voix22 ». Ici, Montaigne réussit à engager le discours sur la voie qui l’intéresse, c’est-à-dire sur la voie du manque. Il dissèque ses pensées, en cherchant de les sauver dans la chaîne humaine de la voix, parce que ce sont des événements non mensongers par rapport à l’initiale coaction atomique, mais nous ne savons rien à propos de la relation des pensées vis-à-vis des morceaux et des parties du corps. C’est une relation clouée à la stérile effronterie avec laquelle nous nous engageons dans la caverne de nos sottises étiologiques. Dans lesquelles, si l’on y prend bien garde, stationne immobile le problème.
5. Mille fois Montaigne est revenu sur les mystifications des médecins. Hier comme aujourd’hui, leur but c’était l’argent et lui, débrouillard
et mondain, il n’a de cesse de le rappeler tout en continuant à débattre le faible statut de leurs impostures les plus enracinées. Incidemment, Platon aussi avait souligné l’étrange phénomène qu’il était permis aux médecins de mentir « en toute liberté23 ». Comment la médecine pouvait-elle, battue dès l’antiquité par « tant de vents contraires24 », faire cas de diagnostics et de remèdes qui ne soient pas de simples supercheries ?
Hippocrates la mit en credit. Tout ce que cettuy-cy avoit estably, Chrysippus le renversa ; dépuis, Erasistratus, petit-fils d’Aristote, tout ce que Chrysippus en avoit escrit. Apres ceux–cy survindrent les Empiriques, qui prindent une voye toute diverse des anciens au manierment de cet art. Quand le credit de ces derniers commença à s’enviellir, Herophilus mit en usage une autre sorte de medecine, que Asclepiades vint à combattre et aneantir à son tour. A leur reng vindrent aussi en authorité les opinions de Themison, et dépuis de Musa et, encore apres, celles de Vexius Valens… L’Empire de la medecine tomba du temps de Neron à Tessalus, qui abolit et condamna tout ce qui en avoit esté tenu jusques à luy. La doctrine de cettuy-cy fut abbatue par25…
Et ainsi de suite, au fil d’une histoire sans fin, de démolition et de retournement et de renversement – immanquablement « entieres et universelles » – qui parvenait jusqu’à son époque, avec « Paracelse, Fioravanti et Argenterius », qui – écrit le nobilhomme – ne changent pas « seulement une recepte, mais, à ce qu’on me dict, toute la contexture et police du corps de la medecine, accusant d’ignorance et de piperie ceux qui en ont faict profession jusques à eux ». La fin – « Je vous laisse à penser où en est le pauvre patient26 ! » – reflète le découragement cautérisé, pathétique et irrité de celui qui s’est habitué aux assauts imprévisibles d’une maladie qu’aucun Hippocrate n’a jamais su soigner. Le mal de gravelle, focalisons-nous sur ce point. Ce mal, qui tourmente Montaigne depuis la fin des années soixante-dix et qui le fait pisser du sable et parfois des pierres de grandes dimensions, ne lui démontre-t-il pas la réticence de son corps à être contrôlé et apprivoisé ? Alors, Montaigne le laisse faire. « Je – écrit-il – suis de l’advis de Crantor, qu’il ne faut ny obstinéement s’opposer aux maus, et à l’estourdi, ny leur soccomber de mollesse, mais qu’il leur faut ceder naturellement, selon leur condition
et la nostre27 ». Donc, laisser faire et, tout au plus, amorcer des techniques de renforcement psychologique à entreprendre en autonomie, une sorte de training autogène, fondés sur des arguments dont la vérité serait toutefois directement contrôlable. Toujours sur la gravelle : « C’est un mal qui te bat les membres par lesquelles tu as le plus failly » et encore « regarde sa tardivité : il n’incommode et occupe que la saison de ta vie qui, ainsi comme ainsi, est mes-huy perdu et sterile28 ». Par ailleurs, c’est une maladie commode, la gravelle ; elle permet de longue pause de tranquillité et, enfin, elle permet aussi de prendre conscience de sa condition, en bien comme en mal. « Si tu n’accoles la mort, au moins tu luy touches en paume une fois le moys29 » : c’est la dernière de ses réflexions, peut-être la plus déplorablement sublime, par laquelle Montaigne expose l’utilité de ses souffrances. En bref, disons-le sans crainte d’apparaître excessivement original, si l’on pense au fait que la vie semble plus belle après la crise, pisser de temps en temps des pierres c’est une espèce de médicament.
D’ailleurs, il y a un lien viscéral entre le plaisir et la douleur. Montaigne l’assure en concomitance de l’envoi final : de la gravelle, l’âme « on ne l’attaque point, S’il luy va mal, à sa coulpe ; elle se trahit elle mesme, s’abandonne et se desmonte30 ».
Une fois là, quel effort pour ne pas succomber sous des illusionnismes aussi monstrueux ! Dépouillé de toute qualité effective, le mal de gravelle est devenu un pur signe, un feu de Bengale qui éclaire les vertus morales de celui qui en est affligé. Montaigne en arrive au point d’exhiber la mièvrerie de la question suivante : songez un peu ! s’apercevoir d’être capable « de dire, de penser, de respondre aussi sainement qu’une autre heure31 » durant une crise ? C’était pourtant lui qui avait écrit que, « si le corps se soulage en se plaignant, qu’il le face32 » ; évidemment, il n’ignorait pas que simuler le visage inaltéré c’est un pieux mensonge qui se retourne rapidement sur soi-même, sans même un brin de delectatio. Mais alors pourquoi monter cette hallucinante sarabande, où tout le monde – ceux qui se plaignent et
ceux qui serrent les dents – a parfaitement raison de faire ce qu’il fait ? Il n’y a pas de réponse structurale : parce que, dans les bras du hasard, tout s’effiloche, tout devient ambigu. Le coup final – l’âme qui n’est pas attaqué par la gravelle, qui si elle est malade c’est de sa faute etc. – porte à l’apogée cette farandole délirante. Ou mieux encore, une farandole qui serait délirante, si elle ne rendait pas encore plus brûlant la cognition qu’aucune conscience peut s’imposer à l’impersonnalité d’un procès chaotique. Certes, vu que la lex atomi est un mouvement de perpétuelle catastrophe, au lieu d’un « jeu », on pourrait utiliser d’autres noms si ce n’était que, grâce à la lex atomi, Montaigne désormais s’amuse ouvertement. Et, en effet, il arrive à se demander : « Pourquoy ne pourra estre, à certaine revolution, affoiblie pareillement la chaleur de mes reins, si qu’ils ne puissent plus petrifier mon flegme, et nature s’acheminer à prendre quelque autre voye de purgation ? Les ans m’ont evidemment faict tarir aucuns reumes. Pourquoy non ces excremens, qui fournissent de matiere à la grave33 ? ». Et oui, dans les combinaisons bizarres des corps, des myriades de causes accidentelles s’amusent. Pourquoi alors une d’entre-elles ne pourrait-elle pas se mêler dans le réseau du mal de gravelle en le démantelant ? Il est remarquable qu’ici les inspirations épigénétiques de Montaigne ne se consacrent pas au dépouillement oblique de prétextes téléologico-naturelles ; ce qui est étonnant parce qu’il ne savait pas que pour Aristote aussi on peut constituer quelque chose « convenablement », comme si les choses s’étaient produites en vue de quelque chose, malgré que la visée soit absente et la production totalement accidentelle34. La personnalité trop connue, que Montaigne n’a pas même besoin de citer, le personnage qui s’acquitte du rôle de protagoniste absolu, reste en effet La-Piece-Qui-Chaque-Momant-Faict-Son-Jeu, l’atome et ses dispositions. Ces dernières, s’ouvrant à n’importe quelle surprise conjecturale, permettent même de rêvasser sur la récession de la gravelle. Il ne faut pas s’étonner si le corps est alors une architecture captieuse, absurde et à la fois merveilleusement incompréhensible qui empêche de connaître la maladie. « Autrement d’où viendroit cette altercation continuelle que nous voyons entr’eux sur la connoisance du mal35 ? ».
6. Montaigne se fout horriblement des médecins qui ne comprennent pas de n’avoir aucun pouvoir sur le jeu des atomes. Certes, l’œil du chirurgien qui devient couteau voit beaucoup mieux que les autres. Mais l’incontournable inutilité de la chirurgie anatomique était confirmée par l’esclavage des médecins à l’encontre du paradigme du corps sain que les prospections sur la carcasse ouverte auraient dû étayer. Mais qu’y a-t-il de plus ridicule à vouloir attribuer à ce malade en chair et os un katà physin36 abstrait qui renverse la proximalité recherchée du diagnostic en une distalité sinistre, insensée et absurde ?
Pour l’ondoyant Montaigne, cette maladroite contrefaçon surgit en réalité du refus d’accepter notre existence comme la succession d’instants dissemblables. Alors que nous devrions comprendre, et le comprendre en profondeur, que notre durée est discontinue et non remédiable, un segment temporel où chaque bit de temps inaugure un nouveau moi qui exempte le moi précédent. Le marteau de Montaigne bat le métal de la discontinuité parce que rien comme l’erreur de transformer une telle suite d’instants dissemblables dans l’idée d’un corps continu37 ne ressemble à la vérité. Montaigne est explicite : il faut accepter la discontinuité, tout en sachant que l’accepter signifie laisser faire son corps. C’est ce que dit Montaigne, non sans une magnifique précision qu’il ne pourrait pas omettre sans renier la plus-value obtenue à la suite de la critique de la médecine : « La santé, je l’ay libre et entiere, sans regle et sans autre discipline que de ma coustume et de mon plaisir38 ». Or, il est intéressant de comprendre que « consentir à son corps », pour employer l’expression sur laquelle a travaillé Thierry Gontier39, n’est pas simplement « dire oui ». Consentir à son corps est aussi l’astucieuse coaction par laquelle « dire non » aux conjectures qui devraient harponner avec une valeur
de vérité ce lieu qui est le corps mais que l’expérience du corps refuse. Oui, Montaigne assume le corps comme un dispositif de falsification.
Prenons « Des coches », l’essai où il revient sur un « deffaut » qui lui a procuré beaucoup de tribulations. En effet, il ne supporte « ny coche, ny littiere, ny bateau40 » ; les secousses légères – quelles soient rythmées comme les coups de rames ou bien d’un autre genre, comme celles procurée par une chaise cahotante – lui remuent la tête et l’estomac. Quel est le remède fantastique prescrit par les médecins ? Serrer et faire pression sur le bas ventre avec une serviette. Naturellement, bien qu’il n’ait aucune idée sur la manière de contrôler le mal de mer dans certaines conditions, Montaigne ne songe en aucun cas à observer l’ignoble prescription. Toutefois, il est sûr d’une chose, il ne fera appel à aucun remède pour son mal de mer, si jamais il en trouvait un, sans que ce soit l’expérience de son corps à en mesurer l’avantage. Jusqu’ici, en restant sur le plan des hyperesthésies, rien de nouveau : elles étaient connues d’Hippocrate. Le fait de vomir change de peau quand on régresse de la surface malodorante des déjections évacuées à l’obscurité causale du pourquoi on évacue. Montaigne sait qu’il est sujet à cette manifestation dans certaines conditions ; il a même dit lesquelles. Dans d’autres conditions, fort semblables, le fait de vomir ne se manifeste pas. Que révèle donc cette situation, en plus de l’évidente défaite du raisonnement par analogie ? La didactique cryptée de Montaigne s’éclaircit relativement à un grand interlocuteur, Plutarque qu’il admire tant. Comment diable avait-il réussi, le susdit, à comprendre que les êtres humains et les cochons surpris en train de vomir s’amusaient dans cette activité parce qu’ils avaient peur ? Ce n’était pas un rebondissement rationnel. Plutarque était resté pris dans l’usage du quantificateur tous, alors qu’il aurait dû se contenter d’un certains relatif aux cas qu’il connaissait bien. Pourquoi ce choix ? Réponse tranchante : seulement parce que Plutarque trouvait consolateur que le monde présentât des comportements conforment aux lois. Et c’est le point de rupture ; le platonique Plutarque n’avait pas compris que le succès des lois dépend toujours de leur vérification à travers l’aléa des cas particuliers. La preuve ? Mon Dieu, c’était lui la preuve vivante. Il n’aurait jamais réussi à vomir par peur, comme au contraire – selon Plutarque – il aurait dû. Ce que Gérard Defaux a défini « un discours
vivant41 » dévoile ici l’impossibilité de surmonter la logique fondée sur les détails. Est-il consenti de croire que cela coïncide avec la logique popperienne des contre-exemples.
Comme l’affirme Philippe Desan, il est difficile d’écarter l’hypothèse42 ; il m’apparaît, à moi aussi, téméraire de l’écarter en pensant à la circonstance, historiquement vérifiée, que le pyrrhonisme (sous toutes ses formes) n’a jamais cessé d’adopter des schémas sauvagement contrefactuels. Avec l’asservité simple et absolue des propositions existentielles, comme celles qui sont déterminantes dans le schéma des falsifications connu comme modus ponendo tollens, Montaigne observe qu’il est vrai que les cochons vomissent, mais comment être certain que c’est la peur qui les fait vomir, si – et il nous le rappelle avec un sourire – une de ses connaissances cessent de vomir à l’instant même où il prend peur pour quelque chose ?
Quels sont les effets de cette conclusion ? Il y en a au moins deux. Le premier, que l’on peut résumer en deux mots, affirme que le « contre-factuel », qui se reflète dans le nom de Montaigne, dégage l’un des « sur-sens » philosophiquement les plus stables des Essais. Le second a un lien avec la science possédée par le corps, que Starobinski rattache à Montaigne la rapprochant à l’anti-médicine43. L’idée de Starobinski qu’une science possédée par le corps, en admettant que l’on puisse parler de cela chez Montaigne, vise « à restituer une fonction poétique à ce dont la science parle nécessairement sans poésie44 », ne me persuade pas. Bien au contraire, je pense que les pages contra medicos présupposent une critique féroce de l’usage féerique de la logique et de la raison. Ce n’est pas un hasard si des organes, des faits ou des circonstances corporelles sont par Montaigne décentrés par rapport à tout diktat essentialiste selon l’usage de raison que Gilles Deleuze a défini distributive, conjonctive et
non (comme l’appréciait Spinoza) attributive45. La ressemblance, instrument obligé et trompeuse, ne permet rien de plus. Disons-le ouvertement, ce qui passionne chez Montaigne est bien là, dans le calme pyrrhonien avec lequel il a cherché à dribbler les infirmités des raisonnements menés sur la base des ressemblances en se laissant contaminer par l’utile, par le pratique, par le contingent. S’appliquer aux détails, s’y attarder. Après tout, il n’y a pas un meilleur moyen pour exploiter intensivement toutes les marges de variation et d’écart à travers lesquelles les individus, bien qu’ils soient prisonniers d’eux-mêmes, cherchent à correspondre au pouvoir extraordinaire de la vie d’enseigner un ordre.
Carlo Montaleone
Università degli Studi, Milano
1 Essais, II, 6, p. 375 [A]. Nous citons Montaigne dans l’édition Villey-Saulnier des Essais, préface de Marcel Conche, publiée par les Presses Universitaires de France, Quadrige 2004. Nous donnons dans le texte les numéros de livre, de chapitre et de page.
2 Essais, II, 37, p. 763.
3 Ibidem.
4 Essais, II, 37, p. 782 [A].
5 Michael Screech, Montaigne’s Annotated Copy of Lucretius. A transcription and study of the manuscript, with a Foreword by Gilbert de Botton, Droz, Genève 1998, p. 125.
6 Essais, II, 12, p. 543 [A].
7 Essais, II, 12, p. 573 [C].
8 C’est le sens d’un passage des plus énigmatiques de Des cannibales : « Il semble qu’il y aye des mouvemens, naturels les uns, les autres fievreux, en ces grands corps comme aux nostres. Quand je considere l’impression que ma riviere de Dordoigne faict de mon temps vers la rive droicte de sa descente …. je vois bien que c’est une agitation extraordinaire : car, si elle fut tousjours allée ce train, ou deut aller à l’advenir, la figure du monde seroit renversée… » (Essais, I, 31, p. 204 [B et C]). Sur ce point, j’ai fourni une interprétation plus détaillée dans Oro, cannibali, carrozze. Il Nuovo Mondo nei Saggi di Montaigne, Bollati Boringhieri, Torino 2011, p. 136-138.
9 Essais, II, 12, p. 561 [A].
10 Essais, III, 13, p. 1096-1097 [B].
11 Screech, op. cit., p. 121. Dans ses notes, Screech relève toutes les abrasions, les superpositions, les hésitations et les suppressions mises en acte par le « latiniste » Montaigne.
12 Essais, III, 13, p. 1065 [B].
13 Essais, III, 2, p. 814 [B].
14 Essais, II, 1, p. 337 [A].
15 Essais, II, 12, p. 596 [C].
16 Paul Engelmann, Letters from Ludwig Wittgenstein, Blackwell, Oxford 1967, p. 6 : « We are asleep… Our life is a dream. But in our better hours we wake up just enough to realise that we are dreaming ».
17 Screech, Montaigne’s Annotated Copy of Lucretius, cit. p. 122.
18 Screech, Montaigne’s Annotated Copy of Lucretius, cit. p. 121.
19 Essais, II, 37, p. 780 [A].
20 Essais, II, 6, p. 379 [C]. Dans un bel essai sur « Montaigne anatomiste » (Cahiers de l’Association internationale des études françaises, 2003, no 55, p. 313) Jean Céard note que « en usant du terme grec, alors que squelette existe déjà en français, même s’il n’est pas encore tout à fait acclimaté, Montaigne veut qu’on l’entende en son sens propre », c’est-à-dire – sur la base de ce que l’on lit chez Charles Estienne, De dissectione partium corporis humani libri tres, Simon de Colines, Paris 1545, p. 11 – comme cadaver assiccatum.
21 Essais, II, 6, p. 379 [C].
22 Ibidem.
23 Essais, II, 37, p. 769 [B].
24 Ibidem, p. 771 [A].
25 Ibidem.
26 Ibidem, p. 772 [A].
27 Essais, III, 13, 1088 [C].
28 Ibidem, p. 1091 [B].
29 Ibidem, p. 1092 [B].
30 Essais, p. III, 13, 1094 [B].
31 Essais, II, 37, p. 762 [C].
32 Ibidem, p. 761 [A].
33 Essais, III, 13, p. 1093 [B].
34 Physique, II (B), 8, 198 b20-32) ; notons que Montaigne ne connaissait pas la Physique d’Aristote.
35 Essais, II, 37, p. 773 [A].
36 Sur le katà physin chez Hippocrate comme relation qui se distribue différemment dans les corps individuels grâce aux habitudes des individus et aux buts de leurs actions, c’est-à-dire à une histoire et à un contexte, la bibliographie est très vaste. Le lecteur intéressé à ce thème pourra lire les actes du Xème colloque International hippocratique, Nice, 6-8 Octobre 1999, sur Le normal et le pathologique dans la Collection hippocratique, édition préparée par A. Thivet & A. Zucker, Publications de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de Nice-Sophia Antipolis, 2002.
37 Montaigne écrit : « Et, à cette cause, voulans de toute cette suite continuer un corps, nous nous trompons » (Essais, I, 38, p. 236 [A]).
38 Essais, II, 37, p. 766 [A].
39 Thierry Gontier, De l’homme à l’animal : paradoxes sur la nature des animaux. Montaigne et Descartes, Paris, Vrin, 1998, p. 141.
40 Essais, III, 6, p. 900 [B].
41 Gérard Defaux, « Contre Derrida et la ‘lettre morte’ : Érasme, Montaigne et la valorisation de l’écriture au xvie siècle », in Saggi e ricerche di letteratura francese, XXXX, 1990, p. 276.
42 On trouvera une position se rapprochant de la mienne chez Philippe Desan : « “Pratique et négociation de science” : la réfutabilité chez Montaigne », in L’umanesimo scientifico dal Rinascimento all’Illuminismo, a cura di L. Bianchi e G. Paganini, Liguori editore, Napoli 2010, p. 5-15.
43 Anti-médicine, ce terme est utilisé par Starobinski pour signaler l’attention de Montaigne pour les résultats que tout le monde peut obtenir en observant les signes de son corps comme science possédée ; Cf. Jean Starobinski, Montaigne en mouvement, Paris, Gallimard, 1982, p. 197.
44 Starobinski, op. cit., p. 199.
45 Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Les Éditions du Minuit, 1969, p. 308.