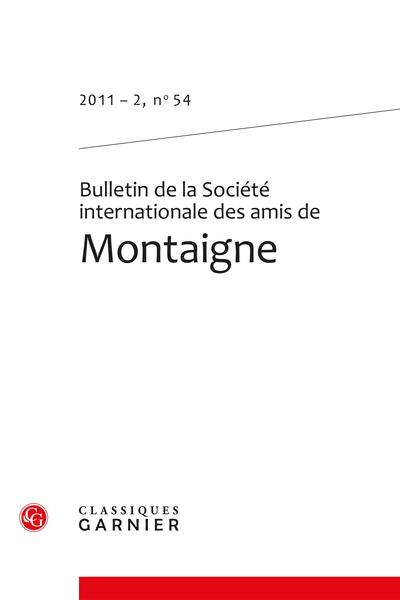
L’amitié, entre sentiment et discours philosophiques
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2011 – 2, n° 54. varia - Auteur : Gontier (Thierry)
- Pages : 43 à 59
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439759
- ISBN : 978-2-8124-3975-9
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3975-9.p.0043
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 14/10/2011
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
L’amitié, entre sentiment
et discours philosophiques
« Une amitié seule et parfaite »
Parler de l’amitié chez Montaigne, c’est avant tout parler d’une amitié, celle qui l’a lié durant quatre années à Étienne de La Boétie. Le chapitre i, 28, « De l’amitié », n’avait au départ d’autre objet que de servir de préface à l’insertion, au milieu du livre I des Essais, du Discours de la servitude volontaire de La Boétie1. Dans les éditions du vivant de Montaigne, ce chapitre sert encore de préface aux 28 sonnets de La Boétie. Ce n’est qu’après 1588, les sonnets ayant fait l’objet d’une publication séparée, que le chapitre prend une valeur autonome et se présente comme un essai sur l’amitié. Même alors, on ne saurait parler de « traité » sur l’amitié : celle-ci reste pour Montaigne une expérience personnelle, irréductible à toute forme de théorisation, un sentiment dont « les effects surpassent les preceptes mesmes de la philosophie2 ». Cette amitié, écrit Montaigne, « n’a point d’autre idée que d’elle mesme, et ne se peut rapporter qu’à soy3 ».
Il reste que Montaigne construit son essai I, 28 à travers une confrontation permanente aux textes canoniques de la philosophie sur l’amitié. Dans les premières rédactions du chapitre, Montaigne emprunte
surtout au De amicitia (ou Lælius) de Cicéron4. Après 1588, la place de l’Éthique à Nicomaque d’Aristote (ici les livres VIII et IX) devient plus importante5, comme c’est plus généralement le cas dans l’ensemble des Essais. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que Montaigne veuille faire entrer son expérience personnelle dans un cadre conceptuel préfixé : le chapitre i, 28 doit plutôt être compris comme une analyse de cette expérience à la lumière des textes canoniques. Ici même, il s’agit moins de repérer les analogies que de vérifier a posteriori le caractère incommensurable de cette expérience, et irréductible à toute forme de rationalisation : « les discours mesmes que l’antiquité nous a laissé sur ce subject, me semblent laches au pris du sentiment que j’en ay6 » : la fonction des discours philosophiques est donc moins dans ce chapitre d’illustrer le propos de Montaigne que de définir en négatif son sentiment de l’amitié.
La dette de Montaigne vis-à-vis des textes antiques consiste tout d’abord en la reprise d’un certain nombre de topos communs, cités par Aristote et Cicéron, auxquels il insuffle une nouvelle vigueur. En voici quelques-uns :
1. L’amitié est le plus précieux des biens. Elle est, pour Aristote, ce qui est « le plus nécessaire pour vivre », et « sans amis, personne ne choisirait de vivre7 ». Pour le Lælius de Cicéron, elle doit être « préférée à tous les biens », et, en dehors de la sagesse, « l’homme n’a rien reçu de meilleur de la part des dieux8 ». Montaigne reprend ce thème en l’amplifiant :
L’ancien Menander disoit celuy-là heureux, qui avoit peu rencontrer seulement l’ombre d’un amy […]. A la verité, si je compare tout le reste de ma vie […] aux
quatre années qu’il m’a esté donné de jouyr de la douce compagnie et société de ce personnage, ce n’est que fumée, ce n’est qu’une nuit obscure et ennuyeuse9.
2. L’amitié est rare. La rareté des amitiés parfaites est un thème plusieurs fois exploité par Aristote10 ; Cicéron écrivait pour sa part qu’il n’y avait eu dans le passé que trois ou quatre amitiés, au sens parfait du terme11. Montaigne renchérit. Pour lui, l’amitié présente le caractère d’un événement unique dans une vie, voire quasi unique dans l’histoire :
Il ne s’en lit guiere de pareilles, et, entre nos hommes, il ne s’en voit aucune trace en usage. Il faut tant de rencontres à la bastir, que c’est beaucoup si la fortune y arrive une fois en trois siecles12.
3. L’amitié est désintéressée : toute considération d’utilité affaiblit l’amitié pour Aristote13, la pervertit dans ses fondements pour les stoïciens14. On retrouve ce thème chez Montaigne :
En general, toutes celles que la volupté ou le profit, le besoin publique ou privé forge et nourrit, en sont d’autant moins belles et genereuses, et d’autant moins amitiez, qu’elles meslent autre cause et but et fruit en l’amitié, qu’elle mesme15.
4. L’amitié implique une communauté et un partage de vie : « Entre amis, tout est commun », dit l’adage, revisité par Platon et par Aristote16. Pour Cicéron, l’amitié implique la mise en commun de tous les biens, projets et volontés (omnium rerum, consiliorum, voluntatum)17. Cette communauté
s’achève dans une parfaite union des âmes : l’ami est un autre moi-même, écrit Aristote18, et après lui Cicéron19, pour qui, dans l’amitié, les âmes se mélangent au point de ne presque faire qu’une seule (paene unum ex duobus)20. Montaigne amplifie ces thèmes :
Tout estant par effect commun entre eux [i.e. entre amis], volontez, pensemens, jugemens, biens, femmes, enfans, honneur et vie, et leur convenance n’estant qu’un’ame en deux corps selon la tres-propre definition d’Aristote, ils ne se peuvent ny prester ny donner rien […]. Car cette parfaicte amitié, dequoy je parle, est indivisible : chacun se donne si entier à son amy, qu’il ne luy reste rien à departir ailleurs21.
Devant cette quantité d’emprunts et de citations, on pourra se demander ce que vaut la protestation de Montaigne. Mais les procédés d’amplification et les hyperboles dont use celui-ci de façon quasi systématique doivent déjà nous faire soupçonner qu’aucun de ces topos classiques ne traduit adéquatement son « sentiment » de l’amitié. Le chapitre i, 28 ne montre pas seulement, selon l’expression de Jean-Claude Fraisse, une « résurgence de la pensée antique22 » : sur certains points, la pensée montaigniste de l’amitié se situe plutôt en rupture par rapport à cette littérature antique. Ce sont les points de rupture qui retiendront ici mon attention, dans la mesure où ils révèlent un déplacement profond dans la pensée de la nature et des fondements de l’amitié.
Les amitiés imparfaites
Une grande partie du chapitre i, 28 est consacrée non à une glorification de l’amitié parfaite, mais à une dépréciation des amitiés nommées « imparfaites » par les Anciens. On peut ramener à trois grands critères les traits qui opposent pour Aristote l’amitié parfaite
aux autres formes d’amitié : 1 / le caractère immanent ou extrinsèque du fondement (vertu, utilité ou plaisir) ; 2 / l’inscription dans une durée plus ou moins longue ; 3 / la plus ou moins grande égalité des partenaires. Ces traits distinctifs ne sont pas absents chez Montaigne, mais ils sont subordonnés à un critère plus fondamental qu’il nomme la « liberté volontaire23 ». Il est vrai qu’Aristote faisait déjà de l’élection mutuelle (antiprohairèsis) un critère de l’amitié. Il ne s’agit cependant pas pour Aristote d’un critère exclusif, ni même central : les formes naturelles et non volontaires d’association (amour maternel ou fraternel par exemple – pour ne pas parler ici du cas plus complexe de la philia politikè) sont aussi pour Aristote des espèces de philiai, dans la mesure où elles conservent certains des caractères de la philia parfaite. Par ailleurs, Aristote ne souligne pas le caractère « libre » de l’antiprohairèsis, au sens où elle échapperait à toute forme de déterminisme : celle-ci part de l’attraction de la volonté pour ce qui est représenté comme un bien (la vertu pour les hommes de bien), pour s’étendre à l’autre homme qui poursuit le même bien. Pour n’être pas un déterminisme d’ordre « biologique ou social », l’antiprohairèsis n’appartient pas moins, en tant que désir raisonnable, à l’ordre la causalité naturelle.
Ce qui, pour Montaigne, fait défaut aux amitiés dites imparfaites, c’est principalement leur origine involontaire. Montaigne évoque ainsi, au début du chapitre i, 28, quatre formes d’amitiés imparfaites24 :
1. La relation entre père et enfant. Pour Aristote, c’est avant tout l’inégalité des personnes qui rend imparfaite une telle amitié. Pour Montaigne, c’est bien plutôt le fait qu’elle repose sur une détermination naturelle (et la même chose peut être dite de l’amitié fraternelle) :
À mesure que ce sont amitiez que la loy et l’obligation naturelle nous commande, il y a d’autant moins de nostre chois et liberté volontaire. Et nostre liberté volontaire n’a point de production qui soit plus proprement sienne que celle de l’affection et amitié25.
Le chapitre ii, 8, « De l’affection des pères aux enfants », envisagera qu’une relation d’amitié puisse naître entre pères et enfants, mais ce ne sera justement que si ce lien naturel fait place à un autre, différent, fondé sur l’estime réciproque, abstraction faite des liens de respect, de révérence et d’affection naturelle. On peut donc dire qu’une telle amitié ne nait ainsi pas du fait même du lien de parenté, mais à côté d’elle.
2. On retrouve ce schéma dans l’évocation de « l’affection envers les femmes ». Celle-ci, pourtant, naît bien de « nostre choix ». Ce qui cependant distingue la relation amoureuse de l’amitié parfaite est moins l’instabilité de toute relation fondée sur la recherche du plaisir, que le fait que ce plaisir passionnel fait obstacle au libre exercice de la volonté. Si, avec le temps, passion et volupté disparaissent, alors il y aura peut-être bien amitié, mais il n’y aura plus amour, comme si les deux termes étaient exclusifs l’un de l’autre :
Aussi tost qu’il entre aux termes de l’amitié, c’est à dire en la convenance des volontez, il [i.e. l’amour] s’esvanouist et s’alanguist26.
3. On ne saurait en revanche nier que le mariage soit le fruit d’un accord volontaire et réciproque. Ce que Montaigne met ici en avant, c’est moins l’inégalité des partenaires (principal critère d’imperfection pour Aristote) que l’intrusion de fins extrinsèques liées à l’utilité. L’utilité est ici mentionnée comme un obstacle à l’amitié non parce qu’elle représente, comme chez Aristote, une qualité accidentelle et contingente de l’être aimé, mais seulement parce qu’elle restreint cette liberté de la volonté :
Quant aux mariages, outre ce que c’est un marché qui n’a que l’entrée libre (sa durée estant contrainte et forcée, dependant d’ailleurs que de nostre vouloir), et marché qui ordinairement se fait à autres fins, il y survient mille fusées estrangeres à desmeler parmy, suffisantes à rompre le fil et troubler le cours d’une vive affection ; là où, en l’amitié, il n’y a affaire ny commerce, que d’elle mesme27.
Le mariage a pour fin principale la génération28. S’il est, écrit ailleurs Montaigne, « la plus necessaire et plus utile de l’humaine societé29 », de par la relation de confiance qui s’instaure entre les époux, le mariage n’est pas pour autant un lien d’amitié – ou, s’il l’est, ce n’est pas en tant que mariage, mais en plus – et nous retrouvons dès lors le schéma que nous avons vu pour les relations entre père et enfant30.
4. L’amour homosexuel masculin était considéré dans la tradition grecque comme la forme libérale par excellence de l’amour. Dans la première édition des Essais, Montaigne se contente d’une simple et lapidaire condamnation morale : « cet’ autre licence grecque est justement abhorrée par nos mœurs31 ». Sous entendu : l’homosexualité ne serait pas amitié du fait de son caractère non vertueux. Mais est-ce bien là la vraie raison ? Montaigne revient sur ce texte après 1588, en ajoutant un long paragraphe, nourri de références aux discours de Phèdre et de Pausanias du Banquet de Platon : ce n’est plus cette fois l’atteinte à la pudeur qui est invoquée, mais une nouvelle fois le défaut du fondement libre de l’association. L’amour homosexuel des Grecs est avant tout considéré par Montaigne comme un amour pédophile : tant qu’il s’attache à un enfant qui n’a pas encore fait montre des qualités de son esprit, il ne repose pas sur une estime réciproque – on retrouve donc, mutatis mutandis, le caractère déficient de l’amour paternel ou filial. Il est cependant possible que cet amour perdure une fois la personne aimée devenue adulte : l’attrait physique fait alors place à une accointance spirituelle. Il s’agit alors, écrit Montaigne, d’un « amour se terminant en
amitié32 » : il n’y a pas pour autant continuité entre amour homosexuel pédophile et amitié, mais bien plutôt substitution d’un fondement nouveau à l’ancien – comme c’était déjà le cas pour l’« affection envers les femmes ».
Il ne saurait ainsi y avoir de continuité entre la contrainte naturelle et l’amitié. De façon plus générale, malgré l’ambiguïté de quelques textes épars, il n’y a pas chez Montaigne de reprise de la théorie stoïcienne de l’oikéiôsis33. L’amitié ne saurait être définie selon la définition du Lælius, comme l’« assistance des hommes de bien pour les hommes de bien » (bonos boni), « comme s’ils étaient liés par la parenté et par la nature » (quasi propinquitate coniuctos atque natura)34. On ne saurait non plus en rendre compte en disant, comme le fait Aristote (qui ne fait ici que reprendre un lieu commun pour le revisiter lui-même), que « les individus de même race ressentent une amitié mutuelle », et « l’homme ressent toujours de l’affinité (oikéion) et de l’amitié pour l’homme35 ». Peut-être existe-t-il pour Montaigne une sorte d’altruisme naturel chez les animaux ou chez les cannibales – même cela est en réalité douteux. Mais, à supposer que cette amitié naturelle existe, l’amitié dont Montaigne fait lui-même l’expérience ne saurait en être un simple prolongement. Notre liberté à l’égard de la nature est bien souvent chez Montaigne synonyme de dépravation : elle trouve au moins une forme de compensation dans la possibilité de l’amitié parfaite.
Cette réorganisation des critères traditionnels autour de la notion de « liberté volontaire » conduit à redessiner ce que l’on pourrait nommer la « cartographie » de l’amitié. Le trait le plus manifeste en est la disparition des rapports aristotéliciens d’analogie entre les formes naturelles et les formes volontaires de l’amitié. La distinction aristotélicienne s’opère au sein d’un tissu continu : les amitiés imparfaites ne répondent pas pleinement à tous les critères de la protè philia ; elles
restent des amitiés dès lors qu’elles répondent à certains d’entre eux. C’est cette continuité qui est rompue avec Montaigne. Ce qui ressort de ses développements sur les formes involontaires de l’amitié, c’est bien le divorce entre les « amitiés communes » et l’amitié véritable. Ce n’est ainsi qu’équivoquement (et non analogiquement) que l’on peut encore parler d’amitié pour désigner les relations familiales ou amoureuses. Cette rupture se traduit aussi, comme c’est souvent le cas chez Montaigne, en une expérience plus personnelle. Citons un extrait de l’essai « Des trois commerces » :
Je suis tres-capable d’acquerir et maintenir des amitiez rares et exquises […]. Aux amitiez communes je suis aucunement stérile et froid, car mon aller n’est pas naturel s’il n’est à pleine voile […]36.
Montaigne est entier dans l’amitié parfaite ; il est négligent dans les autres, c’est-à-dire celles qui sont non choisies. C’est à ces amitiés imparfaites que convient l’adage, attribuée à Aristote par Diogène Laërce, « O mes amis, il n’y a nul amy » : comme Cicéron, Montaigne trouve cet adage « abominable » en ce qui concerne la « souveraine et maistresse amitié » – mais, ajoute-t-il, celui-ci est « salubre en l’usage des amitiez ordinaires et coustumières37 ».
Peut-on dire pour autant qu’en amitié, c’est le « tout ou rien », et que Montaigne ne reconnaît aucun statut aux autres formes d’amitié que la seule et unique qui l’a lié à La Boétie ? Il existe au moins une autre forme qui, quoique inférieure, peut de bon droit être nommée amitié : il s’agit de la « société mutuelle » entre gens d’esprit qui n’ont d’autre but que se rencontrer pour converser entre eux. En celle-ci, écrit Montaigne, « consiste le plus parfait et doux fruict de la vie humaine38 ». Il s’agit bien ici d’une « amitié », même si elle n’est pas l’amitié « dequoy je parle » du chapitre i, 28, qui implique de plus une fusion des âmes. Et si elle reste une amitié, c’est parce que, précisément, l’association n’est entachée d’aucune hétéronomie du fait de motifs étrangers à la seule rencontre et au plaisir qu’elle suscite : « La fin de ce commerce, c’est simplement la privauté, frequentation et conférence : l’exercice des ames, sans autre
fruit39 ». Le libre choix apparaît ainsi comme une condition sine qua non, qui n’avait pas été considérée à sa juste valeur par les Anciens. Autour de ce critère se redéfinissent les frontières entre un sens absolu de l’amitié, un sens analogique et un sens équivoque.
La langue des mystères
Libre à l’égard de la nature, l’amitié l’est aussi en un autre sens à l’égard de la vertu. Ici encore, Montaigne se situe en rupture vis-à-vis de la tradition antique. Pour Aristote, l’amitié sert avant tout à exercer ses habitus de vertu, qui, sans cela, resteraient à l’état de veille. Pour Cicéron, héritier d’une conception stoïcienne et profondément dynamique de la vertu, ce lien est plus explicite encore :
L’amitié nous a été donnée par la nature en aide aux vertus, et non pour tenir compagnie à nos vices, afin que la vertu, puisqu’elle ne peut à elle seule parvenir à sa perfection (non possest ad ea, quae summa sunt pervenire), y parvienne en s’adjoignant et en s’associant à autrui (conjuncta et consociata cum altera)40.
L’amitié a assurément chez Montaigne, comme chez les Anciens, une valeur morale. Montaigne présente La Boétie comme un esprit « moulé au patron d’autres siecles que ceux-cy41 ». Dans le chapitre « De la præsumtion », La Boétie est décrit comme le vestige unique de la vertu antique en un siècle dépravé : l’homme le « mieux né », « un’ ame pleine et qui montroit un beau visage à tout sens », une âme « à la vieille marque42 ». La vertu est un accompagnement peut-être nécessaire de l’amitié, et il est « du tout impossible », concède Montaigne à Aristote et Cicéron, d’atteler le « harnois » de l’inclination mutuelle sans « vertu et conduitte de la raison43 ». L’amitié n’est pas pour autant subordonnée à la vertu. Pour Montaigne, comme l’avait justement remarqué Hugo Friedrich,
l’amitié ne repose sur aucune qualité objective assignable aux amis44. L’exception parle mieux ici que la règle. On la trouve dans la reprise que fait Montaigne de l’histoire de Caius Blossius du De amicitia de Cicéron. A Lælius, qui lui demandait ce qu’il eût fait si son ami Tibère Gracques lui eût demandé d’incendier le Capitole, Caius Blosius répondait qu’il eût obéi. « Videtis quam nefaria vox ! », s’indigne Cicéron. Montaigne, qui n’est sans doute pas moins sensible que Cicéron aux dangers que les factions font encourir à l’ordre social, répond ici à Cicéron :
Ceux qui accusent cette responce comme seditieuse, n’entendent pas bien ce mystere [de l’amitié] […]. La responce de Blossius est telle qu’elle devoit estre45.
Cette référence au « mystere » de l’amitié nous introduit dans un registre, perpétuellement présent dans le chapitre i, 28 : la langue mystérique, empruntée à un registre pythagoricien et platonicien, voire épicurien46, bien plus qu’aristotélicien et stoïcien47. On peut rattacher à ce registre l’emphase de ton caractéristique de l’écriture montaigniste, alors même qu’il emprunte son matériau argumentatif à Aristote ou Cicéron, qui exprime le débordement d’une expérience hors des cadres rationnels de la philosophie. C’est aussi à ce registre platonisant de la mystique amoureuse, qu’il convient de rattacher certains thèmes caractéristiques comme celui de l’indivisibilité de l’unité formée par l’amitié, du caractère irremplaçable et exclusif des amis, du fait que l’amitié ne saurait lier que deux êtres, et pas plus (Montaigne parle du « miracle de se doubler48 »), de la conjonction astrale exceptionnelle qui permet la formation de
l’amitié parfaite, ou encore la « force inexplicable et fatale, médiatrice de cette union49 ». Montaigne prolonge ici le commentaire du Banquet de Marsile Ficin50 et le courant littéraire qu’il initie51 – à la différence, bien entendu, qu’il ne s’agit plus pour lui d’érôs, mais bien de philia.
Ce « mystère » de l’amitié que la philosophie morale antique n’a pas entendu est celui d’une unité non médiée par une valeur plus élevée qui apparaîtra toujours entacher l’amitié d’une forme d’hétéronomie. Ce que veut mon ami, je le veux – ou alors, les volontés ne sont pas vraiment unes. Dès lors, la question de Laelius ne fait guère de sens :
Cette réponse ne sonne non plus que feroit la mienne, à qui s’enquerroit à moy de cette façon : Si vostre volonté vous commandoit de tuer vostre fille, la tueriez-vous52 ?
Cicéron disait pourtant lui-même que l’amitié impliquait la communauté « omnium rerum, consiliorum, voluntatum » (de tous les biens, projets et volonté)53. Il n’entendait cependant par là qu’une volonté ordonnée à la valeur suprême de la vertu. C’est aussi du fait de cette ordination que les offices d’amitié peuvent se trouver en conflit avec d’autres devoirs. Faute d’une telle ordination, la casuistique de l’amitié apparaît chez Montaigne tout simplement vidée de son sens. Il est vrai qu’Aristote reprenait lui aussi à son compte le lieu commun selon lequel « entre amis, pas besoin de justice54 » : c’est que l’amitié parfaite repose sur une égalité parfaite, supérieure à l’égalité proportionnelle qui constitue la base de la justice (et qui règle les amitiés imparfaites) ; comme l’équité dans le livre V de l’Éthique à Nicomaque, l’amitié est juste par éminence. Pour Montaigne, il est vrai plus pessimiste quant à la valeur du lien
social et de la justice humaine, l’amitié en quelque sorte destitue l’ordre des devoirs. C’est en ce sens qu’il faut entendre l’expression :
L’union de tels amis estant veritablement parfaicte, elle leur faict perdre le sentiment de tels devoirs, et haïr et chasser d’entre eux ces mots de division et de différence : bien faict, obligation, reconnoissance, priere, remerciement, et leurs pareils […]. L’unique et principale amitié descoust toutes autres obligations55.
Ce mystère de l’unité trouve son prolongement dans le mystère de l’instantanéité. Pour Cicéron (mais ce serait aussi bien vrai pour Plutarque), il faut du temps pour construire une amitié : l’amitié doit être soumise au jugement, et le jugement ne doit pas être précipité. Montaigne en est d’accord en ce qui concerne les « amitiez molles et regulieres, ausquelles il faut tant de precautions de longue et preallable conversation56 ». Mais il insiste sur le caractère instantané et imprévisible de son amitié pour La Boétie, qui s’est faite dès la « premiere rencontre », par je « ne sçay quelle force inexplicable et fatale57 ». Le choix de l’ami n’est pas une affaire de délibération sur les fins et les moyens : l’ami surgit, pour ainsi dire, dans notre existence sans considération téléologique.
Un « allongeail » postérieur à l’édition de 1588 donne un nouvel éclairage sur cette « force inexplicable et fatale » :
« Si on me presse de dire pourquoy je l’aymois, je sens que cela ne se peut exprimer, qu’en respondant : Par ce que c’estoit luy ; parce que c’estoit moy58 ».
On a quelquefois voulu voir dans cet alexandrin un écho à la formule aristotélicienne selon laquelle l’ami est aimé kath’héauton59. Mais Montaigne et Aristote entendent deux choses bien différentes. Ce qu’Aristote voulait dire, c’est que l’amitié parfaite se fonde non sur accidents liés à la personne aimée, mais sur son essence. Aristote n’entend pas par cette
essence une quelconque intimité singulière de l’ami, mais plutôt ce qu’il y a de plus universel en lui, à savoir la vertu de son âme : même si les bienfaits de l’amitié s’adressent au composé humain, et non à sa seule âme (c’est Socrate que j’invite à dîner, non sa vertu, même si c’est pour sa vertu que j’invite Socrate), l’amitié n’est pas fondamentalement, pour Aristote, une affaire personnelle. Il est vrai que Montaigne fait à l’occasion référence à son « estre universel » ou à sa « forme essentielle » : il ne s’agit cependant nullement du « kath’héauton » aristotélicien, mais bien de cette part irréductible du privé qui, souvent, doit être défendue contre les prétentions de l’universel60. Le contraste avec les stoïciens est encore plus clair. Comme le chapitre « De l’amitié », le De amicitia de Cicéron est construit, à la façon d’une consolation, autour d’une amitié « unique » pour un être disparu (Scipion, l’ami défunt de Lælius). Mais Lælius ne pleure nullement la mort de son ami Scipion : ce serait une trahison de l’amitié que de s’affliger de la perte de l’ami. Montaigne, quant à lui, construit toute sa vie et toute son œuvre comme des obsèques perpétuées61 : l’ami a un caractère proprement irremplaçable, et ne peut, en ce sens, être subsumé sous quelque catégorie que ce soit, même celle de la vertu. La mystique platonicienne fait ainsi place à une forme de
nominalisme éthique, qui prolonge de façon originale le nominalisme épistémologique de certains chapitres des Essais.
Conclusions
On retrouve la langue des mystères à un autre endroit significatif des Essais, dans le chapitre « De mesnager sa volonté », sorte de prolongement du traité de La servitude volontaire de La Boétie en un temps de troubles où se protéger de la tyrannie est moins protéger son pays des tyrans que se protéger soi-même de la tyrannie des charges et offices publics :
J’estime qu’au temple de Pallas, comme nous en voyons en toutes autres religions, il y avoit des mysteres apparens pour estre montrez au peuple, et d’autres mysteres plus secrets et plus hauts, pour estre montrés seulement à ceux qui en estoyent profez [i.e. initiés]. Il est vray-semblable que en ceux icy se trouve le vray point de l’amitié que chacun se doibt […]. Qui en sçait les devoirs et les exerce, il est vrayement du cabinet des muses ; il a attaint le sommet de la sagesse humaine et de nostre bon heur. Cettuy-ci, sçachant exactement ce qu’il se doibt, trouve dans son rolle qu’il doibt appliquer à soy l’usage des autres hommes et du monde, et, pour ce faire, contribuer à la société publique des devoirs et offices qui le touchent62.
Ici, le discours ésotérique est opposé à un discours exotérique, pour lequel l’homme se doit aux autres et au public, qu’il ne doit pas penser seulement à lui-même, qu’il ne doit pas être égoïste, etc. L’initié, lui, sait que rien n’est au-dessus de l’amitié pour soi-même, et que celle-ci fournit la mesure des officia pour les autres. Cette protection d’un « quant à soi » contre les sollicitations d’un soi-disant « altruisme » fait l’objet d’une série de formules sonores :
Il faut se prester à autrui et ne se donner qu’à soy-mesme […]. Il faut mesnager la liberté de nostre ame et ne l’hypothéquer qu’aux occasions justes ; lesquelles sont en bien petit nombre, si nous jugeons sainement63.
Qui abandonne en son propre le sainement et gayement vivre pour en servir autruy, prent à mon gré un mauvais et desnaturé parti. Je ne veux pas qu’on refuse aux charges qu’on prend l’attention, les pas, les parolles, et la sueur et le sang au besoin […]. Mais c’est par emprunt et accidentalement […]. J’ay peu me mesler des charges publiques sans me despartir de moy de la largeur d’une ongle, et me donner à autrui sans m’oster à moy64.
Cette stricte séparation des domaines public et privé prend valeur de médication dans un siècle moribond et un monde condamné à une ruine inéluctable, à laquelle il nous faut assister sans plaisir certes, mais aussi sans « s’en ulcerer ou maigrir65 ».
Le mystère de « l’amitié que chacun se doibt » éclaire en retour le mystère de l’amitié « unique et principale ». L’engagement dans l’amitié du chapitre i, 28 ne saurait être dit « par emprunt et accidentalement ». C’est que l’amitié est hors de proportion avec les offices publics, et même ce que nous nommons d’ordinaire « altruisme ». Elle n’est pas plus médiée par une ouverture de l’esprit à l’universel (au sens d’une tradition idéaliste de la philosophie), que par une ouverture à la dimension de l’altérité (au sens d’une tradition rosenzweigienne et lévinassienne). L’amitié est bien plutôt comprise comme le prolongement nécessaire de l’amour de soi66, et ce même si chacun se « donne » entier à son ami.
L’amitié est ainsi à la fois le produit de notre « liberté volontaire » (laquelle « n’a point de production qui soit plus proprement sienne que celle de l’affection et amitié ») et un affect, et un affect particulièrement puissant : Montaigne décrit son expérience comme celle d’un saisissement de la volonté, l’amenant « à se plonger et se perdre » dans celle de l’ami67. Cependant, la « chaleur » de l’amitié, contrairement au « feu téméraire » de l’amour, est impérieuse tout en n’ayant « rien d’aspre et de poignant68 ». Le mystère de l’amitié se tient dans cette possibilité d’un affect qui ne destitue pas la liberté, mais se fonde paradoxalement sur elle. C’est ce mystère que révèle la confrontation de l’expérience à la
rationalité philosophique : celui de l’unité d’un affect et d’un acte libre, d’un affect qui saisit l’âme sans l’aliéner, et d’un acte libre, si libre en un sens qu’il n’est ordonné à aucune fin sinon à lui-même.
Thierry Gontier
Université Jean-Moulin, Lyon 3
Institut universitaire de France
1 On sait que les Essais sont présentés par Montaigne comme des grotesques (Essais, I, 28, p. 183 [A]) destinées à orner cette œuvre, finalement absente. Toutes les citations des Essais de Montaigne proviennent de l’édition de Pierre Villey, Paris, PUF, 1924, rééd. 1988 en trois volumes. Nous indiquons successivement le livre, le numéro de l’essai, la page et, au besoin, la couche de rédaction (A = édition de 1580 ; B = ajout pour l’édition de 1588 ; C = ajouts manuscrits postérieurs à 1588 sur l’exemplaire de Bordeaux).
2 Essais, I, 28, p. 192 [A].
3 Ibidem, p. 188 [C].
4 Abrévié « Lælius » dans la suite de l’article. Nous utilisons l’édition bilingue de Robert Combès aux Belles Lettres (1975).
5 C’est d’ailleurs dans la couche [C] des Essais que se trouvent les trois mentions explicites d’Aristote dans ce chapitre : 1 / Éthique à Nicomaque (noté par la suite « EN » – nous utilisons la traduction de J. Tricot chez Vrin, 1re éd. 1958), VIII, 1155 a 23-24 (« les bons legislateurs ont eu plus de soing de l’amitié que de la justice », Essais, I, 28, p. 183 [C]) ; 2 / Diogène Laèrce, Vies et doctrines des philosophes illustres, V, 21 (trad. sous la dir. De M.-O. Goulet-Cazé, Paris, Livre de poche, 1999, p. 574), qui cite « le mot qu’Aristote avoit tres-familier : O mes amis, il n’y a nul amy » (Essais, I, 28, p. 190 [C]) ; 3 / une interpolation de EN, IX, 81168 b 8 (« leur convenance [i.e. des amis] n’estant qu’un’ame en deux corps », Ibidem).
6 Essais, I, 28, p. 192 [A].
7 EN, VIII, 1, 1155 a 3-4.
8 Lælius, IV, 17, p. 12 ; VI, 20, p. 14 ; XXVII, 104, p. 62.
9 Essais, I, 28, p. 193.
10 L’amitié parfaite (entre gens vertueux) est rare (spanios) (EN, VIII, 4, 1156 b 24-25). Le thème du petit nombre d’amis que chacun peut avoir peut être en partie rattaché à ce propos : ainsi, l’amitié solide ne s’adresse « qu’à un petit nombre (pros oligous) » (EN, IX, 10, 1171 a 12-13 ; cf. aussi VIII, 7, 1158 a 11-17).
11 « De tous les siècles passés, on cite à peine trois ou quatre groupes d’amis » (Lælius, IV, 15, p. 11). Cf. aussi Ibidem, XVII, 62, p. 40.
12 Essais, I, 28, p. 184.
13 Cf. en particulier EN, VIII, 3, 1156 a 11-12.
14 Un thème développé contre l’épicurisme en Lælius VIII, 26-32 (l’utilité n’est pas la source de l’amitié, même si elle en est un accompagnement), pour être repris en XIII, 45-48. L’amitié « la plus belle (pulcherrima) et la plus conforme à la nature (maxime naturali) » est recherchée « pour elle-même et à cause d’elle-même » (Ibidem, XXI, 80, p. 49).
15 Essais, I, 28, p. 184.
16 Platon, Lysis, 207 c ; Aristote, EN, VIII, 11, 1159 b 32 ; VIII, 14, 1161 b 11 ; IX, 12, 1171 b 32-33.
17 Lælius, XVII, 61, p. 38-39.
18 EN, IX, 9, 1170 b 7.
19 Lælius, XXI, 80, p. 49.
20 Lælius, XXI, 81, p. 49-50.
21 Essais, I, 28, p. 190-191 [A].
22 J.-C. Fraisse, Philia : la notion d’amitié dans la philosophie antique. Essai sur un problème perdu et retrouvé, Paris, Vrin, 1974, p. 472.
23 Essais, I, 28, p. 185 [A].
24 Dans un ajout postérieur à 1588, Montaigne fait état de quatre formes inférieures de l’amitié, selon une division qu’il reprend à la tradition aristotélicienne : l’amitié « naturelle, sociale, hospitaliere, venerienne ». Il est difficile de parler, comme le fait Jean-Claude Fraisse (Philia, op. cit., p. 471), de « distinctions bien développées », dès lors que cette partition est opérée après 1588, le texte du chapitre étant fixé dans ses grandes articulations, dès l’édition de 1580. De fait, le texte ne suit guère cet ordre. Les formes « naturelles » et « veneriennes » sont traitées indistinctement. Montaigne, ensuite, s’intéresse très indirectement à « ce que nous appellons ordinairement amis et amitiez » (Essais, I, 28, p. 188 [A]), qu’il nomme aussi « des « amitiez molles et regulières » (p. 188-189 [C]), ou encore de « superficielle accointance » (p. 192 [C]), désignant par là généralement toutes les formes d’amitiés imparfaites. Il n’y a rien sur la philia politikè aristotélicienne, ni non plus sur l’amitié hospitalière.
25 Essais, I, 28, p. 185 [A].
26 Essais, I, 28, p. 186 [A]. Sur les relations entre amitié et sexualité, Cf. G. Ferguson, « Perfecting friendship. Montaigne’s Itch », Montaigne Studies, IX/1-2, 1997, p. 105-120.
27 Essais, I, 28, p. 186 [A].
28 Cf. Essais, I, 30, p. 199.
29 Essais, III, 1, p. 803 [B].
30 Et pourtant Montaigne rêve d’une amitié qui engagerait non seulement les âmes des amis, mais aussi leur corps : « S’il se pouvait dresser une telle accointance, libre et volontaire, où, non seulement les ames eussent cette entière jouyssance, mais encores où les corps eussent part à l’alliance, où l’homme fust engagé tout entier : il est certain que l’amitié en seroit plus pleine et plus comble » (Essais, I, 28, p. 186 [A et C]). Mais les femmes, explique Montaigne, n’ont pas une âme « assez ferme pour soustenir l’estreinte d’un neud si pressé et si durable ». Au-delà du propos quelque peu misogyne, il importe de remarquer que ce n’est pas par défaut de vertu ni du fait de l’inégalité des sexes que ne peut s’établir un lien d’amitié entre des sexes opposés, mais à cause du défaut de la volonté d’un des partenaires. Le mariage moderne, tel que nous le connaissons, fondé sur une libre décision permanente (ce que Stanley Cavell nommerait une disposition au remariage) et la reconnaissance d’égalité des partenaires, pourrait peut-être être dès lors compris comme répondant aux critères montaignistes de l’amitié parfaite.
31 Essais, I, 28, p. 187 [A].
32 Ibidem, p. 188 [C].
33 Je ne développe pas ici ce point que j’ai abordé ailleurs. Cf. en particulier mes études suivantes : Th. Gontier, « Intelligence et vertus animales : Montaigne lecteur de la zoologie antique », Rursus - Revue en ligne du LALIA, Université de Nice, no 2, 2007 (http://revel.unice.fr/rursus/personne.html ?type=auteur&id=109), ainsi que : « Le “vicieux ply” de Socrate. Nature et vertu dans le chapitre “De la phisionomie” », Th. Gontier et S. Mayer (dir.), Le Socratisme de Montaigne, Paris, Classiques Garnier, 2010, p. 203-218.
34 Lælius, XIV, 50, p. 33.
35 EN, VIII, 1, 1155 a 17-23.
36 Essais, III, 3, p. 820-821 [B].
37 Essais, I, 28, p. 190 [B et C].
38 Essais, I, 42, p. 266 [A].
39 Essais, III, 3, p. 824 [B].
40 Lælius, XXII, 83 (p. 50).
41 Essais, I, 28, p. 194 [A].
42 Essais, II, 17, p. 659 [A].
43 Essais, I, 28, p. 189 [C].
44 Cf. H. Friedrich, Montaigne, trad. R. Rovini, Paris, Gallimard, 1968, p. 257.
45 Essais, I, 28, p. 189.
46 Sur la mystique épicurienne de l’amitié, cf. la mise au point claire de Jean-Luc Périllé (« Colotès et la béatification épicurienne de l’amitié », Les Études philosophiques, Paris, no 2, 2005, p. 229-259), qui marque les points de rapprochements entre pythagorisme, platonisme et épicurisme : « Entre le pythagorisme et l’épicurisme, nous passons d’une philosophie principalement ésotérique à une philosophie principalement exotérique […] et Platon peut être considéré comme étant à mi-chemin entre les deux » (p. 250). On notera par ailleurs certains points de rapprochement entre Montaigne et l’épicurisme, tels la distance affichée vis-à-vis des officia publics, la dévalorisation de l’éros au profit de la philia, ou encore la « personnalisation » de l’ami.
47 Ces références sont bien mises en valeur dans l’article de Lambros Couloubaritsis : « L’amitié selon Montaigne et les philosophes grecs », dans K. Kristodoulou (dir.), Montaigne et la Grèce. Actes du colloque de Calamata et de Messène, du 23 au 26 septembre 1988, Paris, Aux amateurs de livres, 1990, p. 164-178.
48 Essais, I, 28, p. 191 [C].
49 Ibid., p. 188 [A].
50 Cf. par exemple le commentaire du discours de Pausanias l. II, ch. 8 : « Chaque fois que deux êtres s’entourent d’une mutuelle affection (benevolentia), l’un vit en l’autre et l’autre en l’un […]. Ils se donnent en s’oubliant eux-mêmes […] Chacun d’eux se possède et possède l’autre. Celui-ci se possède, mais en l’autre ; l’autre aussi, mais en celui-ci […]. Je n’adhère à moi-même que par ton intermédiaire » (Marsile Ficin, Commentaire sur Le Banquet de Platon : De l’amour, texte établi, traduit, présenté et annoté par P. Laurens, Paris, Les Belles Lettres, 2002, p. 44).
51 Cf. sur ce point l’ouvrage d’André-Jean Festugière : La Philosophie de l’amour de Marsile Ficin et son influence sur la littérature française du xvie siècle, Paris, Vrin, 1941.
52 Essais, I, 28, p. 189 [A].
53 Lælius, XVII, 61 (p. 39).
54 EN, VIII, 1, 1155 a 26-29.
55 Essais, I, 28, p. 190-191 [A-C].
56 Ibidem, p. 188-189 [C].
57 Ibidem, p. 188 [A et C].
58 Ibidem.
59 EN, VIII, 3, 1156 a 11. Cf. aussi EN, IX, 4, 1165 a 3-4. Sur ce rapprochement : Cf. J.-C. Fraisse, Philia, op. cit., p. 202. Sur le sens de ce « kath’héautous », voir en particulier l’article classique de J.M. Cooper : « The Forms of Friendship », Reason and Emotions. Essays on Ancient Moral Psychology and Ethical Theory, Princeton, Princeton University Press, 1998, p. 312-335, en particulier p. 320 sq.
60 Je ne m’accorde pas avec l’interprétation aristotélisante de Michael Screech de la formule : « Chaque homme porte la forme entiere de l’humaine condition » (Essais, III, 2, p. 805 [B]). Selon Screech, Montaigne ferait référence à une forme générale (une sorte de to ti èn éinai aristotélicien) de l’homme pour réhabiliter l’idée d’une nature ou une race humaines : « Si on admet uniquement l’existence d’un nombre infini de gens isolés, si la race humaine n’est qu’un ensemble infini de particuliers et d’individus singuliers, alors on ne peut rien savoir sur l’homme en général, et l’on ne peut tirer aucune sagesse de l’étude de ces nombreux cas particuliers. Aristote dépassa cette difficulté en enseignant, comme Montaigne plus tard, que, dans le cas d’individus appartenant à une espèce, la forme de l’espèce se trouve tout entière contenue dans chaque individu » (Montaigne et la mélancolie. La sagesse des Essais, trad. F. Bourgne, Paris, PUF, 1992, p. 139) ; et Screech conclut : « en peignant son être tout entier, son ‘être universel’ en sa qualité de Michel de Montaigne, il avait ainsi accès à l’homme universel, au sens philosophique du terme […]. Aussi, Montaigne n’étudie pas sa forme ou sa matière seule ; il étudie Michel de Montaigne, une personne constituée d’une forme mariée à un corps, et dont l’essence est humaine » (Ibid., p. 140-141, je souligne). Par cette formule, je ne crois pas que Montaigne veuille réhabiliter une ontologie de l’universel de type aristotélicien : il veut plutôt dire que l’universel « homme » n’est rien d’autre, et rien de plus, que l’individu lui-même pris dans sa singularité (essence et accidents, pour reprendre la dichotomie aristotélicienne). « Mon estre universel », ajoutera Montaigne après 1588, ce n’est pas « grammairien, poëte ou jurisconsulte », mais simplement et exclusivement « Michel de Montaigne » (Essais, III, 2, p. 805 [C]).
61 « Est-ce pas un pieux et plaisant office de ma vie, d’en faire à tout jamais les obsèques ? » (Essais, II, 8, texte de l’édition de 1595, en note de l’édition Villey, p. 396).
62 Essais, III, 10, p. 1006 [B et C].
63 Ibidem, p. 1003-1004 [B].
64 Ibidem, p. 1006-1007 [B et C].
65 Ibidem, p. 1016 [B].
66 « Tout ainsi que l’amitié que je me porte, ne reçoit point augmentation pour le secours que je me donne au besoin […] et comme je ne me sçay aucun gré du service que je me fay : aussi l’union de tels amis estant veritablement parfaicte, elle leur faict perdre le sentiment de tels devoirs, etc. » (Essais, I, 28, p. 190 [A]).
67 Ibidem, p. 189 [A].
68 Ibidem, p. 186 [A].