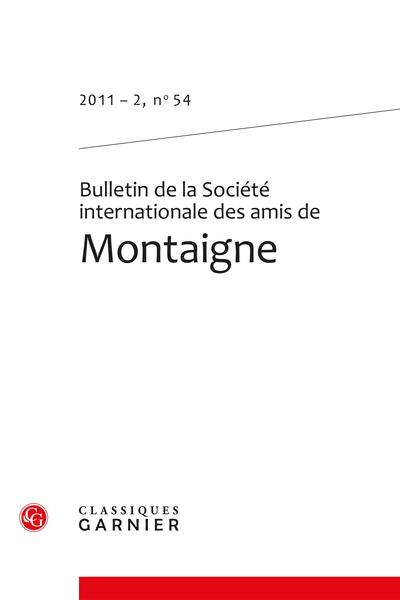
« Ce nombre infiny des passions » : Montaigne et la diversité des affects Avant-propos
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2011 – 2, n° 54. varia - Auteur : Ferrari (Emiliano)
- Pages : 11 à 21
- Revue : Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812439759
- ISBN : 978-2-8124-3975-9
- ISSN : 2261-897X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3975-9.p.0011
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 14/10/2011
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
« Ce nombre infiny des passions » : Montaigne et la diversité
des affects1
Avant-propos
Quelle passion ne nous y exerce ?
Essais, I, 50
Les mutations conceptuelles s’annoncent souvent dans les détails des textes, où l’on rencontre « des sens et des visages plus riches », des « perfections autres que celles que l’autheur y a mises et apperceües ». Inspirés par cette herméneutique de l’involontaire et de l’inaperçu « és escrits d’autruy », qui caractérise selon Montaigne le « suffisant lecteur2 », nous avons choisi de mettre au centre de notre Journée d’études – « en place marchande3 » – l’affirmation de l’« Apologie », selon laquelle « nous
sommes incessamment en prise » à un « nombre infiny des passions4 ». Pourquoi ce choix ? Pourquoi serait-elle si importante, finalement, cette idée d’une incommensurabilité des passions individuelles ? De quoi serait-elle la manifestation ?
Si Montaigne s’accommode, à la fin des Essais, de l’opinion de Platon que « la douleur, la volupté, l’amour, la haine sont les premieres choses que sent un enfant5 », c’est ici l’unique trace présente dans les Essais d’un intérêt tant soit peu manifeste pour l’énumération et le classement des passions humaines, selon leur ordre d’apparition par exemple. En effet, l’attitude de Montaigne, celle que nous reconnaissons comme la sienne propre, emphatise la « diversité de nos passions » et leur multitude – « mille passions et agitations d’esprit6 ».
Toutefois, introduire ordre et mesure dans le champ des phénomènes passionnels a été, depuis l’Antiquité, la préoccupation plus ou moins manifeste de la réflexion morale : Platon, Aristote, les stoïques, la pensé médicale7… À titre d’exemple, arrêtons-nous sur deux grandes traditions qui, au siècle de Montaigne, concourent pour la plupart à définir les conditions de pensabilité des phénomènes passionnels : l’aristotélisme thomiste et le courant stoïcien8. Ces deux écoles de pensée manifestent au mieux – à notre avis – comment le dénombrement des passions est solidaire de la construction d’un rigoureux champ conceptuel et discursif, qui rend le désordre passionnel intelligible et gouvernable : définir la passion signifie constituer sa nature, établir une étiologie et une taxonomie, rendre possible une maîtrise. Cet ordonnancement, par ailleurs, présuppose une certaine théorie de l’âme et de ses facultés, ainsi qu’une pensée du corps et de l’interaction psychosomatique.
Mettant de côté la complexité des contenus doctrinaux respectifs – qui ne pourraient ici qu’être trop simplifiés –, nous voulons pourtant en souligner le résultat quant au classement des passions : pour
Thomas, les passions fondamentales sont au nombre de « onze9 » ; pour le Portique, elles sont au nombre de « quatre10 ». À présupposés différents suivent différents classements.
De ce fait, quand Montaigne affirme que le nombre des passions humaines est « infiny », cela n’est pas une simple boutade : si cette affirmation est devenue possible, c’est que dans les Essais sont en acte une profonde révision et une violente désagrégation des prémisses somatologiques et psychologiques qui avaient ordonné et défini l’univers passionnel, et qui trouvent, dans un dénombrement accompli, la vérification de leur opérativité.
Or, cette idée de l’irréductible diversité des passions nous est apparue comme une marque emblématique de l’originalité de la philosophie morale de Montaigne11, si l’on pense qu’à l’âge classique des philosophes plus soucieux d’ordre et d’exhaustivité l’assimileront dans leur pensée sans crainte d’aporie. Descartes, dans ses Passions de l’âme, parlera seulement des principales passions car, quant aux particulières, « leur nombre est indéfini12 ». Malebranche, plus fidèle à la lettre des Essais, écrira que « le nombre des passions qui se font de l’assemblage des autres [les primitives] est nécessairement infini13 ». Chez ces penseurs, mais aussi chez Hobbes et Spinoza, la démarche déductive et rationnelle dans l’étude de passions devra, dorénavant, essayer de comprendre les dynamiques
de leur différenciation et diversité, et la caractérisation générale de la nature des passions s’accompagnera d’une réflexion sur la complexion passionnelle individuelle, qui donne à chaque phénomène affectif sa propre et unique singularité.
Dans les Essais, donc, les passions échappent à toute entreprise d’ordonnancement et classement, car elles sont soumises, comme toutes choses, à la « qualité universelle » de « la diversité et varieté14 ». Mais néanmoins, Montaigne, se jugeant « par vray sentiment, non par discours15 », reconnaît à la passion amoureuse une place prioritaire dans sa « complexion » : « Je n’ay point autre passion qui me tienne en haleine16 ». Comme le montre Nicola Panichi, l’amour est une passion principale car il est capable de renouveler le « désir de vie ». Les Essais récupèrent ainsi la caractérisation dynamisante de l’eros platonicien, ainsi que sa qualité ambiguë, double, car l’amour est chose aigre et douce (Philèbe). Dans son Commentaire sur le Banquet de Platon, Ficin aussi développera ce thème, avec celui du risque, toujours présent, de l’aliénation amoureuse. Mais Montaigne transforme cette tradition platonisante et redonne à l’amour son visage naturel. Cette transformation s’opère surtout dans l’essai III, 5, « Sur de vers de Virgile », véritable « théorie de l’amour » que Nicola Panichi nous invite à découvrir dans ses multiples facettes.
L’amour dans les Essais ouvre d’abord un espace sémiotique où prend forme une poétique érotique du « contact ». Montaigne connaît bien les stratégies du discours amoureux, il sait que l’eros transforme le corps de l’autre dans un texte qui brûle de sens. Si le corps se fait langage, le langage se fait corps – et versus digitos habet. Mais l’eros a aussi, pour Montaigne, une force thérapeutique salutaire pour l’individualité concrète, corps et âme. Il n’est pas ennemi de la sagesse ! Au contraire, l’amour, cette « agitation esveillée, vive et gaye17 », peut donner à l’être humain la force de renouveler sa vie et son rapport intime à lui-même.
Or, cette revitalisation du rapport à soi doit, nécessairement, passer par une ouverture à l’autre, car l’amour demande réciprocité (charis). L’amour-désir témoigne ainsi d’une faille naturelle de l’être humain,
d’un vide et d’une aspiration à la plénitude. C’est sa limite, car animé par le désir de l’autre, l’amour se perd dans sa « jouyssance ». Serait-ce alors l’amitié – que Montaigne distingue de l’amour –, la figure d’une plénitude retrouvée ? On pourrait le penser, car elle seule semble s’échapper à la dialectique du vide/plein, et nous faire éprouver une jouissance qui s’accroît à mesure qu’on la désire18. L’amitié serait alors le destin de l’amour ? Nicola Panichi nous montre ici une tension interne au texte et nous indique, à l’horizon de la réflexion montaignienne, la possibilité de l’« amitié amoureuse ».
Les passions ont une thermodynamique qui leur est propre, et dans le continuum des émotions chaudes, faisant varier la température, du « feu » cuisant de l’amour, nous passons à la « chaleur » douce de l’amitié, affect que Montaigne analyse surtout dans l’homonyme essai I, 28, pour conclure, comme le montre Thierry Gontier, à sa nature absolument individuelle et irréductible à toute théorisation. Pour Montaigne, parler de l’amitié, c’est surtout parler d’une amitié « seule et parfaite », celle qui l’a lié à Etienne de La Boétie, et c’est à la lumière de cette expérience affective personnelle – « du sentiment que j’en ay19 » – que les discours classiques de l’amitié révèlent toutes leurs limites. Le ressenti personnel devient donc le critère qui conduit l’analyse des énoncés classiques et qui permet aussi de les critiquer. En effet, Montaigne construit son essai dans une confrontation permanente aux textes canoniques (le De amicitia de Cicéron et l’Éthique à Nicomaque d’Aristote), mais sa pensée sur l’amitié se situe en rupture par rapport à cette tradition.
La physionomie de cette rupture, selon Thierry Gontier, se caractérise pour deux aspects essentiels. D’une part, Montaigne ruine les rapports analogiques entre les formes naturelles (amour fraternel, maternel, etc.) et les formes volontaires d’associations, qui caractérisaient la pensée aristotélicienne de l’amitié. L’expérience affective de l’amitié, pour Montaigne, n’est pas un prolongement de la contrainte naturelle, car elle se fonde sur notre « liberté volontaire20 ». D’autre part, si l’amitié a certainement une valeur morale, elle ne se fonde pas sur une qualité morale qui serait présente dans l’ami. Pour cela, la nature de l’amitié
ne peut qu’être « éclaircie » par le recours à la langue mystérique, empruntée à un registre pythagoricien et platonicien, voire épicurien : le « mystere » de l’amitié est celui d’une expérience d’unité avec l’ami qui se réalise instantanément, sans la médiation d’autre valeur que celle de sa singularité irréductible. L’amitié demeure ainsi une expérience paradoxale : celle d’un affect puissant qui saisit notre libre volonté et qui, en même temps, se fonde sur elle.
Si la compréhension montaignienne de l’amitié dépasse les doctrines philosophiques traditionnelles, ce qui confirme la rupture anthropologique que nous avons signalée plus haut, il en va de même pour une autre expérience affective fondamentale, celle de la compassion. Comme nous le montre Giambattista Gori, la réflexion de Montaigne sur la compassion, tout en se développant à l’intérieur du cadre théorique des débats hellénistiques entre stoïciens et aristotéliciens, manifeste une originalité propre qui nous présente une image nuancée et non univoque de cette passion.
En fait Montaigne, qui avoue sa propre nature compatissante – « je me compassionne fort tendrement21 » – montre aussi, face à la force naturelle de cet affect, une exigence de distance qui est bien manifestée, par exemple, dans l’épisode de sa rencontre avec le Tasse à Ferrare. Ce besoin, selon Giambattista Gori, ressortit à une nécessité d’évaluation des individus et des situations qui sont dignes ou non de compassion, et à la recherche des critères et des qualités requises à l’exercice de cette passion. De ce fait, la compassion « naturelle » et spontanée demande d’être toujours accompagnée par l’exercice du « discours » et du « jugement ».
C’est dans cette perspective que Montaigne emploie ses sources sur la compassion, parmi lesquelles le De clementia de Sénèque, le Tusculanae Disputationes de Cicéron, l’Éthique à Nicomaque et la Rhétorique d’Aristote. Dans cette riche tradition philosophique, Montaigne trouvait représentées des positions très différentes, qui allaient de la condamnation stoïcienne à l’acceptation péripatéticienne de la compassion, mais ce contraste, dans les Essais, perd sa nature d’opposition doctrinale pour devenir la manifestation du caractère ambigu de cette passion. Dépassant les critères qu’Aristote avait établis dans sa Rhétorique (livre II) pour définir et délimiter la compassion, Montaigne peut ainsi faire ressortir, avec ses
aspects éthiquement salutaires – par exemple l’extension du compatir à tous les êtres vivants et la condamnation de la cruauté –, ses possibilités négatives et même son aspect destructeur, surtout quand elle se lie avec d’autres passions. L’épisode des persécutions des juifs portugais, où des parents poussés « par amour et compassion22 », choisissent d’assassiner leurs enfants plutôt que d’accepter l’idée que leur vie future puisse être celle des juifs convertis, montre bien comment la force de cet affect, combinée ici à celle de l’« opinion », peut arriver même à étouffer les affections les plus naturelles en s’exprimant, finalement, dans la forme paradoxale d’une compassion qui tue.
La réflexion sur la compassion, sur sa nature et ses effets équivoques, interdit donc les clivages trop nets et de fait brouille les frontières entre les affects. Néanmoins la compassion connaît, dans les Essais, une passion qui lui est antithétique : la vengeance. Dans son article sur la vengeance, Gianfranco Mormino, considérant la réflexion montaignienne, montre comment celle-ci arrive, malgré son caractère non systématique, à inscrire dans les Essais une véritable « thèse morale ». Si l’Iliade s’ouvrait sur la colère vengeresse d’Achille, les Essais s’ouvrent, quant à eux, sur une situation de vengeance. Dans l’essai I, 1, « Par divers moyens on arrive à pareille fin », Montaigne nous présente la structure asymétrique qui organise l’exercice de cette passion : une victime sans défense se trouve exposée à la colère vengeresse du plus fort. Les acteurs de la vengeance peuvent changer – les juges qui se vengent contre Socrate, le mari contre la femme adultère, etc. –, mais non la situation où la vengeance est réalisée. Cette configuration montre déjà que la force destructrice de cette passion sera à rechercher dans les dynamiques sociales et culturelles qui organisent la vie humaine.
Pour Montaigne en fait, la vengeance est comprise en dehors de tout horizon théologique : s’il la condamne, c’est parce qu’il y voit un manque d’humanité, non un péché. La vengeance a d’ailleurs un caractère naturel : la réaction vindicative est un réflexe involontaire propre aux enfants et aux animaux, et il n’a pas, en soi, le caractère des violences interminables et des haines inconciliables qui troublent les sociétés. Où gît alors sa force ? Il est nécessaire, souligne Gianfranco Mormino, que la passion naturelle soit transformée par des processus culturels dans
un « devoir social », qui vise à défendre certaines valeurs publiquement reconnues, comme l’honneur ou la justice. De là naît le cercle vicieux des vendettas, qui impose cette passion comme une dette pour l’individu. Face à ce « furieux appetit de vengeance23 », les stratégies traditionnelles ne sont pas suffisantes : si Montaigne reprend le registre aristotélicien de la modération et des degrés de la vengeance (La Rhétorique), cela n’est pas son dernier mot. La modération, comme la raison, ne change pas la nature de la vengeance, qui implique la souffrance de l’autre. Il faut rompre le cercle. Montaigne prône ainsi la valeur de la compassion et surtout le refus de l’imitation, de la pratique servile qui nous oblige à nous venger. C’est dans ce geste de liberté que Montaigne affirme son excellence morale.
De l’amour à l’amitié, de la compassion à la vengeance : les quatre premiers articles proposés au lecteur se concentrent sur une série de passions très importantes dans les Essais, passions qui ont une valeur individuelle et sociale à la fois, qui engagent le singulier et le pluriel, de la plus stricte relation d’amour ou d’amitié jusqu’à la plus ample intersubjectivité des mouvements compassionnels ou vindicatifs. Bien évidemment, cela n’est qu’un aperçu d’un plus vaste continent passionnel, mais il nous montre déjà comment les passions sont devenues, pour Montaigne, des composantes constitutives de l’« humaine condition » et, pour cela, de sa propre enquête anthropologique. Si l’on pense à la place fondamentale que les passions prendront, en général, dans la pensée moderne (Descartes, Malebranche, Hobbes, Spinoza, Hume, Rousseau…), et à la floraison de « traités sur les passions » dans la première moitié du xviie siècle, en particulier en France, avec Camus, Coëffeteau, Le Moyne, Senault, etc., il ne fait pas de doute qu’il faudra un jour se demander dans quelle mesure l’immense materia affectiva présente dans les Essais a pu être reprise, transformée, employée à l’intérieur de cette réflexion hétérogène qui a conduit à la naissance d’un nouvel « espace passionnel24 ».
Contrairement à ce que l’on pense couramment, les passions dans les Essais sont aussi objet d’une attention gnoséologique qui concerne, en dernier ressort, les modalités et les possibilités de la connaissance de leur dynamisme, mais aussi les rapports entre « raison » et « passion ».
Les trois derniers articles présentent des points de vue différents autour de cette problématique.
Le texte de Carlo Montaleone interroge le statut épistémologique du rapport psychosomatique qui peut être considéré, à plusieurs égards, comme le lieu génétique des passions. Dans les échanges continus entre « corps » et « ame », les Essais dessinent les contours d’une individualité complexe, un mélange des sensations, sentiments, imaginations, souvenirs, dont il semble impossible d’établir l’étiologie : effets du corps ou effets de l’âme ?
Montaigne a certainement une vive conscience de l’unité intime du corps et de l’âme, mais ce qui fait problème, c’est l’idée que cette unité puisse être pensée dans la forme d’une homogénéité causale, qui réglerait l’interaction entre le « dehors » et le « dedans ». La multiplicité des causes agentes, l’instabilité des rapports de cause-effet, la prolifération des contre-exemples, tout cela rend impossible la fondation d’une quelconque généralisation. Si la pâleur de son visage, réfléchie dans le miroir, n’« estonne » pas Montaigne, c’est qu’il ne croit pas – comme ses médecins – qu’elle doive nécessairement signifier quelque pathologie « au-dedans ». L’interaction psychosomatique est ainsi comprise à l’intérieur d’une radicalisation de la contingence naturelle : comme le souligne Carlo Montaleone, Montaigne est ici très proche de l’idée épicurienne d’un écart (clinamen) intrinsèque aux séries causales. Derrière l’emphase sur l’oscillation et la variation des choses, des fantaisies et des humeurs, il faut donc entrevoir la lex atomi de Lucrèce, que Montaigne récupère pour affirmer la puissance de l’incontrôlable, qui affecte aussi bien les mouvements de notre corps que ceux de notre âme.
C’est par conséquent toute une conception de l’homme qui bascule, comme le montre aussi la contribution de Marco Sgattoni, qui voit dans la réflexion sur la sensibilité et les passions dans les Essais, la mise en discussion d’une image rassurante de l’individu comme agent libre et rationnel, et l’ouverture d’autres domaines d’expérience inexplorés. On pourrait alors lire, derrière les pages sur l’« inconstance » humaine (II, 1), toute une problématique renaissante qui concerne le statut de la volition, de son rapport avec l’appétition sensible et l’intellection, que nous retrouvons, par exemple, chez Pietro Pomponazzi dans son De fato (livre III).
Reprenant une suggestion spinoziste, Marco Sgattoni voit ainsi dans la prétention illusoire à la liberté et à la maîtrise, l’ignorance de l’homme quant aux réelles circonstances qui conditionnent et déterminent son agir : la raison, loin d’être l’instance qui contrôle et neutralise la passion, en est profondément affectée. Il s’agit de reconnaître, d’abord, cette condition naturelle dans toute sa vérité, comme le fait Montaigne : « la passion nous commande bien plus vivement que la raison25 ». Raison, jugement et volonté ne sont finalement que des « compromis de la conscience », eux-mêmes pris dans un mouvement vital dont la racine est passionnelle. La liberté humaine semble ainsi avoir un statut imaginaire (ficta), car l’homme n’est pas – comme le voulaient les stoïciens – un « empire » autonome dans le royaume de la nécessité naturelle.
Cette nécessité complètement naturelle et vitale, qui fait que l’homme n’est jamais sans passions – et qui inévitablement relègue l’idéal stoïcien de l’apathie au rang des absurdités philosophiques – nous fait aussi comprendre pourquoi dans les Essais, grâce à l’entrecroisement entre pensée de soi et écriture de soi, les passions nous sont présentées comme un objet de connaissance et d’expérience directe et immédiate, accessible à tout homme. La contribution d’Emiliano Ferrari vise à mettre en évidence, à la fois, comment la pratique introspective de Montaigne rend possible une connaissance des passions humaines dans les Essais, et comment elle pourrait avoir été reprise et valorisée, en sa fonction anthropologique, par la pensée de Thomas Hobbes.
Dans l’Introduction du Leviathan, Hobbes juge que le précepte delphique « nosce te ipsum » nous apprend à connaître non seulement nous-mêmes mais aussi, par cela, l’« humanité » (mankind) des hommes. Cette connaissance, essentielle pour la science politique, se fonde sur l’observation directe de ses propres pensées et passions, pour aboutir à la reconnaissance d’un principe de similitude entre les pensées et les passions des hommes. Dans cette valeur universelle de l’introspection et dans l’accès privilégié qu’elle donne aux dynamiques passionnelles, Emiliano Ferrari nous propose de lire l’écho des énoncés sur la « forme entiere de l’humaine condition » et sur « la forme maistresse » de l’essai III, 2, « Du repentir ». Ces formules ne sont en fait que la cristallisation d’une conviction, exprimée à plusieurs reprises et de façons différentes dans
les Essais, selon laquelle ce que Montaigne a pu observer en lui-même, « quiconque » le peut découvrir en soi, à condition de refaire le même geste introspectif. Il s’agit ainsi de signaler, grâce à une confrontation des concepts, une autre filiation historique possible entre la pensée de Montaigne et celle du philosophe de Malmesbury, à l’intérieur d’un réseau d’influences multiples qui attire de plus en plus l’attention de la critique.
Emiliano Ferrari
Università degli Studi, Milano
Université Jean-Moulin, Lyon 3
1 Les articles présentés dans ce numéro du Bulletin de la Société Internationale des Amis de Montaigne constituent l’aboutissement du travail commencé lors de la Journée d’études qui s’est tenue à l’Università degli Studi de Milan (Italie) le 28 octobre 2010 intitulée : « Ce nombre infiny des passions : Montaigne e la diversità degli affetti ». Cette journée a été organisée par Emiliano Ferrari et Gianfranco Mormino, avec le soutien du Département de Philosophie et le parrainage du Centre Culturel Français de Milan. Nous voulons exprimer ici toute notre gratitude à l’égard de M. Jean-Yves Pouilloux pour nous avoir proposé de publier ces textes dans le Bulletin et aussi pour son amabilité et confiance tout au long de la réalisation de ce recueil. Nous remercions tout particulièrement notre directeur italien de thèse M. Gianfranco Mormino, pour son soutien et son accompagnement dans l’organisation de cette journée.
2 Essais, I, 24, p. 127 [A]. Sur l’écriture de Montaigne et son « metodo ‘silenico’ », expression des pensées fortes cachées ou seulement indiquées, notre dette à l’égard des travaux de Nicola Panichi est grande. Nous pensons en particulier à son ouvrage : I vincoli del disinganno : per una nuova interpretazione di Montaigne, Firenze, Olschki, 2004, p. 67-72 et passim (tr. fr. Les liens à renouer : scepticisme, possibilité, imagination politique chez Montaigne, Paris, Champion, 2008).
3 Essais, I, 26, p. 156 [A].
4 Essais, II, 12, p. 486 [A].
5 Essais, III, 13, p. 1111 [C]. Il s’agit d’un emprunt presque littéral au début du Deuxième Livre de Lois de Platon.
6 Essais, II, 12, p. 568 [A] ; III, 13, p. 1098 [B].
7 Dans une immense bibliographie, on pourra voir : M. Vegetti, L’etica degli Antichi, Bari, Laterza, 1989 (Quarta edizione aggiornata, 1996) ; J. Pigeaud, La maladie de l’âme, Paris, Belles-Lettres, 1989.
8 Elles ne sont bien sûr pas les seules : on évoquera aussi la pensée médicale, notamment galénique, et les traditions platonicienne et augustinienne (Cf. Anthony Levi, French Moralists. The theory of the passions : 1585 to 1649, Oxford, Clarendon Press, 1964).
9 « Sunt ergo omnes passiones specie differentes undecim, sex quidem in concupiscibili, et quinque in irascibili ; sub quibus omnes animae passiones continentur » (Thomas D’Aquin, Summa Theologica, Ia IIae, q. 23, art. 4). En dehors de ces onze, donc, il n’y a pas d’autres passions de l’âme, car pour Thomas la différence de degré dans une même passion ne change pas son espèce, autrement il y aurait « un nombre infini d’espèces de passions » (« infinitae species passionum animae », ibidem).
10 Il s’agit des quatre passions principales (plaisir/douleur, crainte/désir) qui se subdivisent en passions spécifiques dont le nombre total varie selon les sources, tout en demeurant un nombre fini. Parmi les différentes versions de la riche taxonomie stoïcienne que nous possédons, on verra celles de Diogène Laërce (Cf. Vies, VII, 111 et suivantes), d’Andronic (Cf. Hans von Arnim, Stoicorum Veterum Fragmenta, III, 397, 401, 409, 414) et de Cicéron (Cf. Tusculanae Disputationes, IV, 17-21).
11 Nous ne pouvons donc que souscrire aux analyses de Thierry Gontier, qui a récemment souligné la qualité éminemment « morale » de la pensée de Montaigne : Cf. T. Gontier, « Les ‘Essais’ : un manuel de sagesse humaine », Montaigne, sous la direction de Pierre Magnard et Thierry Gontier, Paris, CERF, 2010, p. 13-18.
12 Les passions de l’âme, Introduction et notes par G. Rodis-Lewis, Paris, Vrin, 2010, Article 68, p. 148.
13 De la recherche de la vérité (Livres IV-VI), Présentation, édition et notes par J.-C. Bardout, Paris, Vrin, 2006, p. 167.
14 Essais, III, 13, p. 1065 [B], nous soulignons.
15 Ibidem, p. 1095 [B].
16 Essais, III, 5, p. 893 [B].
17 Ibidem, p. 891 [B].
18 Essais, I, 28, p. 186 [A].
19 Ibidem, p. 192 [A].
20 Ibidem, p. 185 [A].
21 Essais, II, 11, p. 329 [A].
22 Essais, I, 14, p. 54 [C]
23 Essais, II, 11, p. 422 [A].
24 L’expression est de Pierre-François Moreau : « Les passions : continuités et tournants », Les passions antiques et médiévales, Paris, PUF, 2003, p. 10.
25 Essais, II, 34, p. 742 [C]