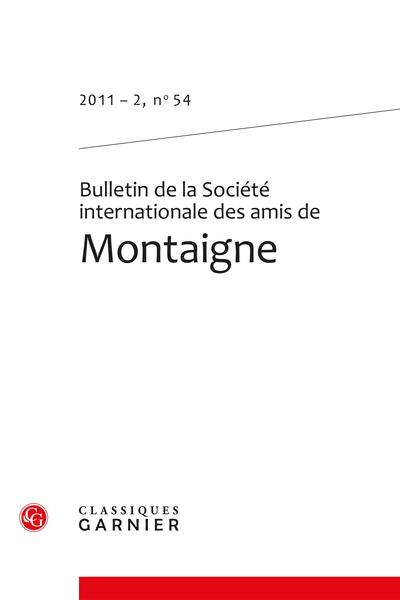
Amor ordinem nescit Amour-passion et désir de vie
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2011 – 2, n° 54. varia - Author: Panichi (Nicola)
- Pages: 23 to 41
- Journal: Bulletin for the International Society of Friends of Montaigne
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782812439759
- ISBN: 978-2-8124-3975-9
- ISSN: 2261-897X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-3975-9.p.0023
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 10-14-2011
- Periodicity: Biannual
- Language: French
Amor ordinem nescit
Amour-passion et désir de vie
Splendeur sacrée de l’été mûr.
Pindare, fr. 153
Chez les belles personnes, beau est aussi l’automne.
Plutarque, Vie d’Alcibiade, I, 5
La « morsure » d’amour
Une fois au moins, Montaigne voit dans les passions les vents joyeux qui, de leur souffle, offrent un « secours » au navire, sans cela abandonné en haute mer, « alleure et mouvement » pour l’âme condamnée à l’inertie1. La passion principale qu’est l’amour, « hominum divumque voluptas », selon l’image de Lucrèce dans l’incipit du De rerum natura, éveille « la vie dans la mer » – gaiement accueillie par « les plaines liquides » – et appellera, des profondeurs, des images marines dont elle se revêtira : éloge du naufrage, ivresse de se perdre, valorisation des saveurs amères.
La passion aigredouce transforme l’amour en abyme qui repense le rivage, l’inconnu en terres connues, le mouvement en immobilité : « la volupté mesme est douloureuse en sa profondeur2 » ; « la supreme volupté » a « du transy et du plaintif comme la douleur3 ». Dans le Philèbe4, Platon
évoque aussi le mélange de plaisir et de douleur dans l’amour, et Ficin insiste sur son caractère double, jusqu’à l’aliénation. Au chapitre vi, Des passions d’amour, du Commentaire sur le Banquet de Platon, De l’amour, il écrit en effet, rappelant le texte de Platon : « Il arrive aussi que pris dans les rets d’Amour l’on soupire et l’on se réjouisse tour à tour. On soupire parce qu’on se quitte soi-même, parce qu’on se perd, parce qu’on se tue. Et l’on se réjouit parce que l’on passe en un meilleur objet. Alternativement aussi on brûle et on frissonne […] on a froid naturellement, étant déserté par sa propre chaleur, et l’on a chaud parce qu’on est embrasé par les étincelles du rayon divin5 ». Et au chapitre viii :
« Cet amant, dit-il, est une âme morte en son propre corps et vivante dans le corps d’un autre » […] Platon [Philèbe 47d-e] appelle l’Amour chose amère. Non à tort, puisque qui aime meurt. Orphée [Orphica, frg. 316], lui aussi, l’appelle glukupikron, c’est-à-dire, doux-amer. C’est que l’Amour est une mort volontaire. En tant que mort, il est chose amère, mais en tant que volontaire, il est doux. J’ai dit que qui aime meurt. En effet, sa pensée, oublieuse de soi, tourne continuellement autour de l’aimé. Mais s’il ne pense pas à lui, il ne pense pas non plus en lui. Par suite, une âme ainsi affectée n’opère pas non plus en elle-même, puisque la principale opération de l’âme est la pensée6.
C’est une mort, pourtant, qui annonce (nous le verrons) la résurrection : « mourant à lui-même et en l’autre ressuscitant ». Giordano Bruno lui aussi suivra cette analyse dans les Fureurs héroïques ; Ficin ira jusqu’à présenter une seule mort et deux résurrections…
L’amour même laisse place à la mort dans les chapitres v et vi du troisième livre des Essais. Mais Montaigne redonne à l’amour sa vérité de nature, son « naturalisme », sa capacité de scandale et de poésie – de tendresse, de volupté, de nostalgie. Sous le signe de l’eros, il métamorphose la tradition platonique, pétrarquisante et courtoise – et il établit, en l’admettant, l’antinomie fondatrice d’une nature hybride : l’amour est une joie intense, mais il est aussi « ardeur inquiète », fureur, âme et corps. Pour désenchanter l’amour, l’homme est le seul des êtres animés à violenter cette passion par des lois qui la contrarient et la détruisent ; il a honte d’aimer et crée des morales austères et ascétiques, se transformant
en ce monstrueux animal « qui se fait horreur à soi mesme, à qui ses plaisirs poisent ; qui se tient à malheur ! » – et, comble de la perversion, qui pense « honorer sa nature en se desnaturant ». Et le voici qui adore les ténèbres et méprise la lumière : « le soleil est abominé, les tenèbres adorées7 ».
Mais des pages de Montaigne émerge aussi un eros thérapeutique, juste, bienveillant, qui ôte toutes les chaînes des préjugés et tous les a priori masculins sur l’autre moitié du ciel, comme en témoigne III, 5, sorte d’anticipation du personnage d’Apollon qui clôt les Essais. Cet Apollon – « protecteur de santé et de sagesse, mais gaye et sociale » – est en particulier capable de mener vers l’autoguérison et l’offre de soi, sans compter l’érotisation de la langue même et de la poésie. C’est ainsi que Montaigne peut répéter, après Juvénal8 : Et versus digitos habet. Le mot possède des doigts, exactement comme le discours amoureux dont Montaigne connaît les stratégies : dialectique (maïeutique) du désir, du contact et de la distance, du secret et de l’intensité…
Dans l’essai Sur des vers de Virgile, consacré entre autres au thème de l’amour-passion, c’est justement à propos de la poétique érotique du « contact » que Montaigne utilise, dans un sens ‘hétérosexuel’, un témoignage de Xénophon9 lu dans la traduction de Castellion – un des textes de la célèbre librairie qui se trouve parmi les livres retrouvés10. Le passage originel fait référence au danger des « baisers des beaux jeunes gens11 ». Dans la leçon retenue par Montaigne, on note quelques variantes significatives. Tandis que dans le texte de Xénophon, le passage entier est construit autour d’un dialogue entre Carmide et Socrate, ici Montaigne rapporte tout l’épisode en l’attribuant à la narration socratique :
Et Socrates, plus vieil que je ne suis, parlant d’un object amoureux : M’estant, dict-il, appuyé contre son espaule de la mienne et approché ma teste à la
sienne, ainsi que nous regardions ensemble dans un livre, je senty, sans mentir soudein une piqueure dans l’espaule comme de quelque morsure de beste, et fus plus de cinq jours depuis qu’elle me fourmilloit, et m’escoula dans le coeur une demangeaison continuelle12.
Montaigne commente : « [B] Un attouchement, et fortuite, et par une espaule, aller eschauffer et alterer une ame rafroidie et esnervée par l’aage, et la premiere de toutes les humaines en reformation ! [C] Pourquoy non dea ? Socrate estoit homme ; et ne vouloit ni estre ni sembler autre chose13 » – même si la philosophie académique véhicule des images de vie austère qui sont inaccessibles, comme nous allons le montrer.
L’épaule qui frôle sans le vouloir celle de Critobule est comme le doigt de Werther qui effleure celui de Charlotte, évoqué par Barthes. Il s’agit surtout de la capacité qu’a l’amour de dessiner une dimension de sens et de s’y plonger : « Werther […] est […] amoureux : il crée du sens, toujours, partout […] et c’est le sens qui le fait frisonner : il est dans le brasier du sens14 ». Ici « sens » équivaut à signification, c’est une herméneutique de l’autre et du corps de l’autre. Socrate et Werther vont maintenant du même pas : « Tout contact, pour l’amoureux », conclut la figure barthésienne, « pose la question de la réponse : il est demandé à la peau de répondre […] c’est la région paradisiaque des signes subtils et clandestins : comme une fête, non des sens, mais du sens15 ».
Il n’est pas difficile de reconnaître ici la scène fondatrice du langage qui donne vie au système de la question et de la réponse, à la dialectique, à l’herméneutique, au discours amoureux – et d’en voir l’affirmation : le moi met en acte une énonciation, parfois des « flambées de langage » sur le corps et son geste pris en mouvement. Un tel acte est à l’origine de tout discours amoureux possible. En mettant en scène l’anecdote socratique, ‘purgée’ de son contexte (la licence Grecque) et indifférent à lui, Montaigne montre qu’il l’a déjà comprise – il a compris que le geste du corps, son théâtre de signes, sa sémiotique sont enfermés dans un système de décodification. Car l’amour-passion, en tant qu’affection de l’âme et du corps, qui arrive à donner vie à la dialectique de la question et de la réponse, est l’équivalent du discours amoureux et ne contrevient
pas à ses codes16. Mais nous sommes revenus ici, peut-être malgré nous, au centre du mythe socratique du Banquet : aimer sert à produire de très beaux discours ; et si, dans le couple maître-élève, la passion met d’autres allusions, par exemple celle du chemin de l’âme guidée par l’amour vers la sagesse, elle sait restituer une image de l’eros qui souligne la tendance de la passion amoureuse à s’affranchir du temps et à le transcender.
Sur des vers de Virgile comporte une bonne partie du lexique amoureux et de ses figures. On présuppose le concept d’unité de l’âme et du corps (que thématise en particulier De la force de l’imagination et typifie De l’institution des enfans) : « il n’y a rien en nous […] purement ny corporel ny spirituel, et […] injurieusement nous dessirons un homme tout vif17 ». L’homme est toujours sujet/objet de plaisirs intellectuellement sensibles, sensiblement intellectuels, en un échange socratique entre corps et esprit (« noble harde Socratique du corps à l’esprit »)18.
C’est la raison pour laquelle on a jugé faux le proverbe selon lequel l’amour rend aveugle : « ce proverbe est faux. L’amour ouvre grand les yeux, il rend clairvoyant19 ». En nous ouvrant les yeux, il fait comprendre comment la seule servitude volontaire non ignominieuse, comme l’atteste le Banquet, est celle qui provient de la vertu amoureuse20 : amour des corps, des âmes, amour de la beauté/sagesse, regard synoptique sur l’échelle d’amour – c’est la leçon de « l’étrangère de Mantinée », Diotime, maîtresse de Socrate, qui lui a enseigné une forme unique d’amour : la trinité indistincte d’amour/aimer/amant21.
Aspirer à cette fin, c’est inspirer la hardiesse des amants22, que Giordano Bruno reprend dans son « aspirer infiniment » des Fureurs héroïques ; tel est le caractère dynamique d’eros, en une dimension d’acquisition jamais au repos. À travers la passion amoureuse, Montaigne relance cette sorte de foi dans la possibilité de commencements renouvelés ; par la vertu d’amour, tout peut redevenir nouveau ; l’antique figure du destin et du fatum personnel semble vaincue grâce à la capacité d’eros d’ouvrir non seulement vers un futur mais aussi vers le passé. Le Bordelais place
l’anecdote socratique (et le personnage de Socrate) dans une dimension de sens apte à faire glisser le discours sur la force roborative et thérapeutique de l’amour, s’éloignant de Platon et du néoplatonisme pour ensuite y revenir de plus belle. Montaigne n’arrive pas à se soustraire complètement aux déclinaisons platoniques de l’amour, affaire humaine (puisque la divinité l’ignore), typique de l’individu qui a besoin du bien, lequel se présente comme désir, privation, apaisement, procréation et accouchement du beau, principe du devenir : eros comme force propulsive de logos. Il ne pouvait non plus ignorer que dans le Phédon23 l’amour est la navette qui tisse et tisse encore la toile infinie des renvois du souvenir, en des allers et retours des yeux de l’amoureux vers l’objet aimé : de la présence à l’absence. Ensuite, dans le Phèdre24, l’amour est une « divine déviation des règles normales de conduite », stupeur d’une révélation à laquelle on parvient en abandonnant la voie de l’habitude et en s’exposant au risque du délire. L’amour ne se calme pas, il est désir d’impossible. Mais ce qui rapproche davantage la position de Montaigne de la conception platonique de l’amour, c’est qu’amour est fils de la raison car la raison ne semble pas, comme pour le stoïque, un instrument qui refroidit le désir mais plutôt un catalysateur des énergies et du désir du bien, et par là même, veritable chemin de la guérison.
Il s’agit toujours de la vis appetendi, comme l’avait indiqué Ficin dans le Commentaire au Banquet de Platon et dans El libro dello amore, II, 6, mais dans ce cas aussi avec une importante correction : si, dans les plaisirs corporels, Montaigne définit comme une « injustice » le fait de refroidir l’âme et trouve juste, « comme ils disent, que le corps ne suyve point ses appetits au dommage de l’esprit », il conclut : « pourquoy n’est-ce pas aussi raison que l’esprit ne suyve pas les siens au dommage du corps25 ? ». Il trouve injuste, parce qu’elle est innaturelle, la séparation entre l’intellectuel et le sensible : une fois le hiatus accompli, l’homme ne sera plus.
Le désordre nécessaire
Nous en savons assez, me semble-t-il, pour dessiner les limites à l’intérieur desquelles se déroule le commentaire de Montaigne sur le discours amoureux. L’idée scolastique du commentaire peut étonner à première vue, mais c’est Montaigne lui-même qui nous renvoie à elle dans l’explicit de l’essai Sur des vers de Virgile : si, dans un premier moment, prévaut le ton ironique (le texte constitue un « notable commentaire26 », échappé d’un fleuve de bavardages, impétueux et parfois nocif), le Bordelais présente ce discours, aussitôt après, dans le style poétique d’une image (d’ailleurs à son tour image de la condition de trouble allusif, mêlé d’innocence, typique de l’amour) qu’il emprunte à Catulle27 : don furtif d’un fruit qu’envoie l’être aimé et qui échappe à la jeune fille au moment où elle se lève à l’arrivée de sa mère, oubliant qu’elle l’a caché sous son vêtement. Le discours/commentaire sur l’amour, son De amore, est le fruit qui tombe et roule rapidement au loin, tandis que la rougeur de la honte envahit le visage virginal. La honte, qui intervient dans les dernières répliques de l’essai/commentaire, révèle (et admet) tout à coup toute la pudeur cachée qui a accompagné la description de l’amour, d’eros, tout au long de l’essai jusqu’à l’épilogue. Au fond, Montaigne n’a-t-il pas défini son mode d’aimer « au prix de l’usage moderne, sottement consciencieux28 » ? Pudeur de l’amour et de l’érotisation du désir. Mais alors, qu’est-ce que l’amour ? Un bon commentaire ne peut laisser de côté la définition de son propre objet.
Montaigne ne doute pas que l’amour soit une passion, « une agitation esveillée, vive et gaye », et de poursuivre : « je n’en estois ni troublé ny affligé, mais j’en estois eschauffé et encore alteré, il s’en faut arrester là ; elle n’est nuisible qu’aux fols29 ». Pour atteindre ce résultat (l’amour n’est pas une passion nocive mais salutaire), il doit débarrasser le champ de quelques résistances conceptuelles et, en particulier, frapper au cœur un lieu commun, alimenté par la théorie de Paenetius selon laquelle amor
ordinem nescit. Celle-ci dessine la passion amoureuse d’un trait inadapté au sage dans la mesure où elle est « esmuë e violente30 », où elle se perd entre la reddition inconditionnelle à l’autre (l’esclavage) et le mépris de soi (la perte de la liberté du vouloir) : sagesse et amour seraient inconciliables. Le Bordelais en reconnaît par endroit le caractère de passion « vaine […], messeante, honteuse et illegitime31 », comme dans I, 28. Cependant lorsqu’il la qualifie d’« agitation esveillée, vive et gaye », il la met au contraire au rang d’un élan vers ce plus haut degré de vitalité et de désir de vie qui, comme le soulignera Nietzsche, devient esjouïssance constante32 et feu de gayeté, aspiration ultime de la sagesse, donc signe d’une énorme santé, apte à réveiller un esprit et un corps endormis : réveil du corps assoupi. Parole, image, idée s’organisent en une sorte de « corps intérieur » barthésien qui se met à vibrer, véritable thérapie de l’âme et du corps, soin et médecine à prescrire même à un homme de ce tempérament (engourdi) plus que tout autre remède : passion qui maintient en forme, redonne de la vigueur, nourrit le corps et l’âme, ralentit les ‘progrès’ de la vieillesse. Eros est désir de la vie, dépassement de la crise physique et intellectuelle. En ce sens, l’essai peut aussi être lu comme l’histoire d’une crise33.
Par cette attitude, Montaigne considère qu’est dépassée la question que posait Bembo au livre IV du Courtisan (dont on trouve de nombreuses traces dans III, 5, comme l’a montré Nakam) à savoir si un homme, vieux, pouvait aimer, comme le pensait Julien de Médicis avec son protoféminisme. Et il peut ainsi relancer l’idée de Ficin exprimée dans le De vita triplici, selon laquelle Vénus favorise les accouchements saturniens de la pensée et leur formulation mercurielle, car il demeure toujours vrai que sans elle rien de beau ni d’aimable n’affleure à la lumière du jour34.
Si c’est une passion capable de procurer de l’« haleine » à l’amoureux, à l’amant (« Je n’ay point autre passion qui me tienne en haleine. Ce que l’avarice, l’ambition, les querelles, les procès, font à l’endroit des autres qui, comme moy, n’ont point de vacation assignée, l’amour le feroit
plus commodéement […]35 »), l’amour produit sans cesse un désordre qui est un ordre renouvelé et plus salutaire. Sa force est en mesure de rendre à Montaigne, c’est-à-dire de lui donner à nouveau, sollicitude, sobriété, grâce, soin de la personne, fermeté. Si bien que les rides de la vieillesse, qui rendent difforme et misérable, ne minent pas sa vigueur et sa santé : c’est là une façon paradigmatique d’affirmer que l’amour rend l’espérance de la vie. Dans la liste des avantages de la vis amoris et de son utilité, Montaigne ne tarde pas, dans un texte C, à en ajouter d’autres : le retour à des études saines et sages, qui à leur tour pourraient augmenter l’estime et l’affection, empêchant l’esprit de désespérer de soi et de sa propre utilité. En le ramenant vers luimême, ce retour l’éloignerait de mille pensées fastidieuses, de mille préoccupations mélancoliques qui sont les dons pervers de l’oisiveté et du mauvais état de santé dû à l’âge… L’amour sait rendre l’individu sainement saturnien et surtout sa vigueur sait réchauffer, en songe au moins, le sang que la nature veut abandonner, il sait détendre les nerfs et prolonger force et allégresse de l’âme. Ordo n’est plus une menace pour l’amor vitalis.
Ici Montaigne, malgré lui peut-être, rencontre un point cardinal de la théorie augustinienne de l’amour : la capacité à dénouer les liens qui paralysent la volonté, à résoudre les conflits, à donner de la légèreté au passé, à permettre de reformuler la vie et de recommencer à vivre. L’amour devient, comme chez Platon, synonyme de renouvellement, nouveau départ, commencement. Un commencement qui peut venir aussi du corps en tant que théâtre des signes de l’amour-passion. Le phénix n’est pas mort et l’effort de la « trinité humaine » – intellect, volonté, amour – peut se perpétuer à l’infini. Avec le Qui suis-je ? et le thème de l’« ontologie perdue » (l’ego absconditus demeurera toujours tel et toujours s’appuiera sur l’insécurité, l’inconstance, le doute…), l’amour aide à comprendre et accepter que nous soyons doubles en nous-mêmes.
Même selon cette optique du redoublement de soi, Montaigne trouve les préceptes philosophiques sur l’amour hypertrophiés et trop « rigoureux » ; trop sévère et exsangue la philosophie qui prescrit de ne pas laisser croître les appétits du corps à côté de ceux de l’esprit tandis qu’elle ordonne de posséder un objet qui satisfasse simplement le besoin physique et ne trouble pas l’âme, laquelle doit être avare d’elle-même et doit
seulement seconder le corps sans rien en retirer pour soi. La référence est ici encore Socrate chez Xénophon (cette fois, dans les Memorabilia36) et Plutarque : c’est dans le De curiositate, que Montaigne prend l’anecdote sur Philippe et Ponéropolis, la cité des méchants avec sa « collection de vices37 ». Mais elle se trouve également chez Platon, dans Phèdre38, et chez Plutarque dans le De Garrulitate39 et les Quaestiones conviviales, que le Bordelais lit dans la traduction d’Amyot.
Relançant et complétant le discours sur le plaisir, qu’il commence en I, 20, dans un texte postérieur, il reconnaît et répète surtout que la philosophie ne combat pas tout court les plaisirs naturels, et il recommande simplement d’user de modération et de mesure, et non de fuir le plaisir.
Charis ou aliénation ?
Mais l’amour est un commerce qui a besoin de relation et de correspondance, de charis ; « les autres plaisirs que nous recevons », coupe court Montaigne, « se peuvent recognoistre par recompences de nature diverses : mais cettuy-cy ne se paye que de mesme espece de monnoye40 ».
Il évoque ici le principe de réciprocité, cette charis sur laquelle Plutarque, dans l’Amatorius41, avait tellement insisté en la soumettant à une condition de caractère ontologique : les amants entrent « dans un étroit commerce de paroles et d’actions, à la condition qu’ils retiennent dans leurs esprits au moins quelque vestige, quelque image de la beauté absolue ». Elle est pleinement réalisée quand l’amant rencontre celui qui aurait en lui « une émanation du divin » et « quelque ressemblance troublante avec lui » ; les amants se font fête l’un l’autre « dans un trans
port de joie, d’admiration et d’enthousiasme ». Autrement, semblables aux abeilles, ils laissent « les fleurs fraîches et éclatantes parce qu’elles ne trouvent rien pour leur miel ».
Dans le Dialogue sur l’amour42 Plutarque, après avoir avancé une observation de nature philologique (le verbe qui désigne l’amour, amour donné et échangé [stergein], ne se distingue que par une seule lettre du verbe qui signifie « garder chez soi » [stegein]) conclut : « Pour moi, la ressemblance […] me paraît montrer dès l’abord que la vie commune, avec le temps, incorpore à la contrainte du lien […] l’affection mutuelle ». La première considération qui en découle est une homologie entre le lexique politico-social et le lexique amoureux et une érotisation du rapport social, ou mieux, une socialisation du rapport amoureux à travers une osmose qui fonde ce que la société a séparé :
Celui que l’Amour envahit et inspire < soudain > commencera tout d’abord par dire, comme dans la Cité de Platon : « Ceci est à moi, cela n’est pas à moi43 », car ce n’est pas d’emblée que « tout est commun entre amis44 » < ou entre amants >, mais seulement entre ceux qui, surmontant par la force de l’amour l’individualité séparée des corps, unissent leurs âmes, les fondent ensemble et ne veulent plus, ni croient plus être deux45.
On voit ici toute l’étendue herméneutique de l’essai De l’amitié, sauf que le champ sémantique s’applique à l’amitié avec La Boétie, point sur lequel nous reviendrons. Toujours sur le thème de la réciprocité, Montaigne continue en III, 5 : « En verité, en ce desduit, le plaisir que je fay chatouille plus doucement mon imagination que celuy que je sens. Or cil n’a rien de genereux qui peut recevoir plaisir où il n’en donne point, c’est une vile ame, qui veut tout devoir, et qui se plaist de nourrir de la conference avec les personnes auxquelles il est en charge46 ».
Sur la scène originelle s’étale alors le concept d’amour fils de l’affection, mais aussi l’idée que tout attachement peut cacher une aliénation. Il ne s’agit pas de se libérer ou de se purger de l’affection naturelle, mais de se libérer de l’altération de jugement qu’elle comporte. La raison est la
condition d’une affection solide. À sa façon, Ficin avait lui aussi préparé le chemin pour un dépassement du concept d’amour comme aliénation :
quand l’aimé répond à l’amour, l’amoureux vit au moins en lui. Et là assurément se produit quelque chose d’admirable. Chaque fois que deux êtres s’entourent d’une mutuelle affection, l’un vit en l’autre et l’autre vit en l’un. De tels êtres s’échangent tour à tour et chacun se donne à l’autre pour recevoir l’autre à son tour. Comment ils se donnent en s’oubliant eux-mêmes, je le vois. Mais comment ils reçoivent l’autre, c’est ce que je ne comprends pas. Car qui ne se possède pas soi-même, encore moins en possédera-t-il un autre47.
Pour franchir cette impasse, Ficin doit postuler le concept d’une réciprocité qui naisse, paradoxalement, d’une aliénation. Et voici comment, du concept d’aliénation, Ficin débouche sur celui de réciprocité :
Or tout au contraire chacun d’eux [les amants] se possède lui-même et possède l’autre. Celui-ci se possède, mais en l’autre ; l’autre aussi se possède, mais en celui-ci. Évidemment, puisque je t’aime, toi qui m’aimes, je me retrouve en toi qui penses à moi et je recouvre en toi, qui le conserve, le moi perdu par moi du fait de ma propre négligence. Et toi tu fais la même chose en moi. Ceci encore paraît une chose merveilleuse. Si, après m’être perdu, je me retrouve en toi, je me possède par toi ; mais si je me possède par toi, je te possède avant et plus que moi-même et je suis plus proche de toi que de moi, puisque je n’adhère à moi-même que par ton intermédiaire48.
C’est pourquoi la mort même devient en amour double résurrection :
il y a dans l’amour réciproque une seule mort et une double résurrection. De fait, celui qui aime meurt une seule fois, parce qu’il s’oublie. Mais il revit aussitôt en l’aimé quand celui-ci s’empare de lui dans une pensée ardente. Et il ressuscite une deuxième fois quand il se reconnaît en l’aimé et ne doute pas qu’il soit aimé. Ô bienheureuse mort, suivie de deux vies ! ô merveilleux échange, dans lequel chacun se livre lui-même à l’autre et possède l’autre sans cesser de se posséder ! ô gain inestimable, quand deux êtres ne font qu’un, au point que chacun des deux, au lieu d’un devient deux et que, comme dédoublé, celui qui n’avait qu’une vie en a désormais deux grâce à cette mort ! Car qui meurt une fois et ressuscite deux fois, au lieu d’une vie en acquiert deux et au lieu de lui seul se retrouve deux49.
« Comme le guy sur un arbre mort »
La théorie de l’amour dans l’essai Sur des vers de Virgile semble naître sous le signe de la rébellion contre les stéréotypes de la senectute : l’âme doit être exercée et soutenue par les règles du bien vivre et bien croire50. Le corps est passé de l’excès et de la gaieté à la sévérité, et la philosophie lui donne des leçons de froideur et de tempérance. Or le corps vieilli doit amener l’esprit à se reprendre et doit se défendre de la tempérance comme autrefois il s’est défendu de la volupté. Montaigne ne peut aimer « la tranquillité sombre et stupide » ; « elle m’endort et enteste : je ne m’en contente pas51 ». L’amour sauve l’esprit de la vieillesse, c’est son privilège, et alors « qu’il verdisse, qu’il fleurisse ce pendant, s’il peut, comme le guy sur un arbre mort52 ».
Un concept est clair : l’amour-passion est le résultat d’élans extraordinaires de l’esprit, fruit de la santé « bouillante, vigoureuse, pleine, oisifve, telle qu’autres fois la verdeur des ans et la securité me la fournissoient par veneuë. Ce feu de gayeté suscite en l’esprit des eloises vives et claires, outre nostre portée naturelle et entre les enthousiasmes les plus gaillards, si non les plus esperdus53 ». Disposition à la sagesse gaye et civile contre la dureté des mœurs et l’austérité. Une telle théorie de l’amour renferme une sorte d’abrégé de la philosophie morale de Montaigne, si la vertu est une qualité agréable et gaie, pour quiconque s’est obligé, comme lui, à tout dire ce qu’il ose faire – au point de regretter même de ne pouvoir publier certaines pensées. Confession et désir de transparence d’un projet éthique : « Qu’il s’obligeroit à tout-dire, s’obligeroit à rien faire de ce qu’on est contraint de se taire54 ».
Montaigne ne cesse de noter le rapport étroit entre sensualité et imagination qui permet aux paroles de signifier plus que ce qu’elles disent par leurs effets et leurs affects rhétoriques. Ici l’art permet de vivre plus intensément la nature. Il ne manque pas de souligner qu’il
trouve la Vénus de Virgile (qu’il mettra à côté de celle de Lucrèce, deux poètes sensuels dont le langage est naturellement vigoureux et capable de ravir les esprits les plus forts …) un peu trop « esmeue » pour une Venus maritale55. Cette réflexion lui permettra d’introduire la distinction entre amour-passion et mariage.
« Laissant les livres à part », l’amour doit être traité « materiellement » et « simplement56 ». Le désir de la vie emporte tout ; la Vénus terrestre n’a rien de dégradant si ce n’est lorsqu’il y a vice, dérèglement ou licence. L’amour « n’est autre chose que la soif de cette jouyssance en un subject desiré, ny Venus autre chose que le plaisir à descharger ses vases, qui devient vicieux ou par immoderation ou indiscretion57 ». Dans le « materiellement » il faut comprendre en réalité pour une large part la reconstruction lucrécienne de la physiologie et de la psychologie de l’amour : de l’acte presque autofondateur de l’amour (de l’homme, seul l’enchantement de l’homme fait jaillir la semence humaine58). Avec Lucrèce la passion d’amour n’est pas différente du plaisir sensuel, propension naturelle à laquelle sont portés aussi bien les hommes que les animaux. Et si, toujours avec Lucrèce, Montaigne incline vers la théorie des simulacra59, dans un texte C, après avoir rappelé les images de Lucrèce, presque en opposition, il évoque à nouveau Socrate pour qui l’amour « est appetit de generation par l’entremise de la beauté60 », concept qui réunit la Vénus céleste à la Vénus terrestre toutes deux évoquées dans le Banquet61, repris par Plutarque dans l’Amatorius comme provenant de la culture égyptienne62. Dans l’homme se mêlent délices et laideurs, tous les contraires s’y rencontrent, la contrarieté caractérise la condition humaine – « Et, considerant […] qu’on aye logé peslemesle nos delices et nos ordures ensemble63… ». Si Platon a raison, si l’homme est le jouet des dieux, il est toujours un homme qui ne veut pas être plus qu’homme, exactement comme le Socrate de Montaigne. L’amour-passion
est fils d’une nature qui « d’un costé […] nous y pousse, ayant attaché à ce desir la plus noble, utile et plaisante de toutes ses operations ; et la nous laisse, d’autre part, de fuyr comme insolence et deshonneste, en rougir et recommander l’abstinence64 ».
La contradiction, s’il en est une, est celle de la nature. La jouissance, la sensualité rappelle ce mot augustinien, « aimer et être aimé », qui serait « plus doux si je pouvais jouir aussi du corps de qui j’aimais » ce qui, au fond, en tant que concupiscientia, est le degré le plus bas d’amour – amour pour une femme, « poids de la passion ». Mais Montaigne s’éloigne vite de Saint Augustin, et ne l’a peut-être jamais rencontré vraiment. La passion n’est pas ce que l’on subit et qui fait rêver, doucement endormi et oppressé, la passion d’amour n’est pas celle dont la marque est l’absence de mesure, que Montaigne cependant, comme Augustin, invoque. Conclusion, d’un parfait style montaignien : l’homme ne peut considérer ni lui-même ni ses plaisirs comme un malheur.
Le présupposé de la triade vérité, liberté, substance est renforcé par la triade symétrique d’une sagesse naturelle, constante, universelle. Au nombre des « vrais devoirs » de l’amour, Montaigne compte le rejet des petites règles artificielles, usuelles, provinciales et la libération des vices de l’apparence, comme résultat de la libération des vices de la substance : « […] n’est par jugement que j’ay choisi cette sorte de parler scandaleux : c’est Nature qui l’a choisi pour moy. […] Il n’y a point de prescription sur les choses volontaires65 ».
… mentis amore ligata
Mais sans doute l’objectif est-il plus élevé. La théorie de l’amour sert à Montaigne à recentrer et relancer la dialectique entre être et non-être, entre plein et vide, dialectique qui parcourt tous les Essais66, à laquelle Montaigne aurait voulu offrir une base, dans ce cas, dé-ontologique,
sur la base d’une querelle avec l’« opinion d’Aristote », le prince de la philosophie moderne et le dieu de la science scolastique. En rappelant comment, dans sa Physique, le Stagirite avait fixé trois éléments clés concernant les principes des choses naturelles (matière, forme et privation), Montaigne se demandait, se souvenant de Lucrèce, ce qu’il y avait de plus vain « que de faire l’inanité mesme cause de la production des choses67 ». Le présupposé montaignien est le suivant : si la privation est négative, « de quelle humeur en a-il pu faire la cause et origine des choses qui sont ? ».
Laissant de côté la problématique aristotélicienne, qui est bien plus complexe et demanderait d’autres précisions, Montaigne, malgré sa polémique avec le Stagirite, pose le concept de vide intérieur du sujet comme valeur génératrice de la passion et du discours amoureux. La découverte du « plein de vide », du rien du tout qui envahit aussi le moi68 va de pair avec l’invitation à rentrer en soi-même – qui est cependant toujours un vide.
Le rappel de la vanité et de l’inanité humaines, au dedans et au dehors, permet de revenir à la métaphore du vent dont nous sommes partis. Mais il ne s’agit pas ici d’un vent « joyeux ». La métaphore (68 occurrences, au pluriel comme au singulier) enseigne que le non être est toujours au cœur de l’être, qu’il est ressenti toujours comme une privation et comme un trait propre à la condition humaine. Comme l’explique bien Tournon, il ne s’agit pas d’un éloge inconditionnel de la vanité (aux dépens des aspirations à la plénitude d’être) que réserve parfois l’amour.
Le fossé ontologique produit, dans ce cas aussi, comme dans la gnoséologie, quelques déchets car nous sommes de nouveau face à un concept paradoxal. Montaigne semble répondre d’un point de vue existentiel aux thèses aristotéliciennes du changement par privation. En se plaçant dans l’optique du changement à cause de l’âge, la vieillesse devient dépossession et goût qui anticipe le rien : « Je ne pense desormais qu’à finir69… », et cette privation dépossède chaque jour70. Mais à présent la privation devient manque. Contre la philosophie stoïque, épicurienne,
sceptique, Montaigne accepte la thèse que tout désir procède d’une privation, d’une frustration et se renforce dans le désir d’amour.
Si, pour les philosophes, le bonheur n’est que la plénitude de l’être dans un absolu contemplé, Montaigne ne peut que répéter : Je ne suis pas philosophe. Sa philosophie de l’amour est ailleurs. Mais l’on ne peut que remarquer, comme l’a fait Tournon, le statut contradictoire du désir amoureux : l’auteur des Essais ne condamne pas l’amour parce qu’il provoque l’ivresse du corps mais parce qu’il ne tient pas ses promesses.
C’est encore plus évident quand Montaigne se met à distinguer amour et amitié, dans I, 28 : « Ces deux passions sont entrées chez moi en connoissance l’une de l’autre ; mais en comparaison, jamais ». Quand on les compare, la passion amoureuse est « feu », « plus actif, plus cuisant, et plus aspre » alors que l’amitié est une passion calme, « chaleur generalle et universelle, temperée au demeurant et égale, une chaleur constante et rassize, toute douceur et pollisseure, qui n’a rien d’aspre et de poignant71 » : « … en l’amour ce n’est qu’un desir forcené apres et qui nous fuit […] Aussitost qu’il entre aux termes de l’amitié, c’est à dire en la convenance de volontez, il s’esvanouit et s’alanguist. La jouissance le perd, comme ayant la fin corporelle et sujette à satieté72 ». De l’amitié, continue Montaigne, on jouit en la désirant, car elle est « spirituelle ». Le résultat, je vais le montrer, est cependant partiel. En attendant, ici le discours est présenté paradoxalement à nouveau sur la base du changement dû à la privation : l’amour se transforme en amitié, en une forme supérieure parce qu’elle est « convenance de volontez ».
Si l’amour est aliénation (et Ficin y avait insisté), l’amitié est une forme supérieure d’identité ; seule l’amitié dérive de la privation et du changement, seule elle peut être vécue dans sa plénitude. Tout se tient ? Il semblerait que non. Le texte présente une tension interne qui est aussi un retour en arrière capable de rouvrir la question : est-il vraiment si sûr que seule l’amitié puisse être vécue dans la plénitude ? Avec son style, Montaigne commence à nuancer : dans ce cas aussi, il s’agit d’une plénitude pas tout à fait entière et qui, par certains côtés, renvoie à l’amour et à la centralité du corps : « […] s’il se pouvait dresser une telle accointance, libre et volontaire, où, non seulement les ames eussent cette entiere jouyssance, mais encore où les corps eussent part à l’alliance, où
l’homme fust engagé tout entier : il est certain que l’amitié en seroit plus pleine et plus comble73 ». Dans l’amitié non plus, par conséquent, l’homme n’est pas engagé dans sa totalité intellectuelle et sensible, il n’est pas tout entier, âme et corps. Et alors ? Le problème se complique-t-il au point de se diriger vers le prélude d’une « amitié amoureuse » ? Montaigne, à sa façon, semble faire cet effort. En effet, on ne peut nier que les accents passionnés de l’essai sur l’amitié appartiennent au lexique amoureux, malgré la distinction précédente. Même la référence au Ficin des deux amants, qui dans la réciprocité « ne font qu’un » et « au lieu d’un deviennent deux […] comme dédoublés », sera reprise dans ces pages de Montaigne. Par un effet de rétrospective narrative, tout va s’organiser comme virtualité de l’amour posthume74.
Sur le présupposé du vide ontologique, Amour naîtra toujours comme désir de l’amour et désir d’une plénitude jamais atteinte, même par l’amitié, à cause de la privation de jouissance charnelle. Mais ce sera quoi qu’il en soit l’amour qui permettra de « jouir loyallement de son estre » en une « perfection absolue et comme divine75 », la seule possible pour l’homme.
À sa façon, ce schéma, même partiellement, semble répéter la théorie de l’androgyne et la nostalgie d’une plénitude perdue. Mais dans cette reprise, peut-être inconsciente, Montaigne fait appel à Augustin – et aussi, tout aussi inconsciemment, à Lucrèce – en actualisant les paroles des Confessions : Amare amabam, j’aimais aimer76.
Comme elle semble éloignée, la « vertu qui donne » à laquelle faisait allusion Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra, en particulier dans le chant Des trois choses mauvaises, effet d’un trop plein de l’amour et du désir, d’une puissance qui déborde et veut s’épancher en création, l’âme est comme « une fontaine jaillissante » d’où naissent d’éternels discours amoureux. Le même motif est repris dans le chant où Nietzsche conclut : « Mon âme, je comprends le sourire de ta mélancolie : ta richesse même surabondante à présent tend ses mains avides ! Ta plénitude regarde au-delà des mers rugissantes, et elle cherche, et elle attend ; le désir ardent de la plénitude débordante regarde du ciel de ton œil souriant77 ».
Montaigne aurait certainement partagé le concept de volupté de Nietzsche : une volupté qui sera « pour les cœurs libres innocente et libre, la joie du jardin terreste, le remerciement débordant du futur pour le présent78 ». Il sera jusqu’au bout persuadé que l’amour est la passion qui sait toujours ouvrir la parole à la parole, la voie royale vers la liberté79.
Nicola Panichi
Università di Urbino « Carlo Bo »
1 Essais, II, 12, p. 567 [A]. Toutes les citations des Essais de Montaigne proviennent de l’édition Villey-Saulnier, 1965.
2 Ibidem, III, 10, p. 1005 [B].
3 Ibidem, III, 5, p. 877 [B].
4 47 d-e.
5 Marsile Ficin, Commentaire sur Le Banquet de Platon, De l’Amour, Paris, Les Belles Lettres, 2002, texte établi, traduit, présenté et annoté par P. Laurens, p. 38 ; El libro dello amore, a cura di Sandra Niccoli, Firenze, Olschki, 1987, p. 35.
6 Ibidem, p. 42 ; p. 40.
7 Essais, III, 5, p. 879, [B et C].
8 Ibidem, p. 849 [B]. Citation d’après Juvénal, Satirae, VI, 196-197.
9 Le Banquet, 4, 27.
10 Xenophontis philosophi et historici clarissimi Opera […] per Seb. Castellionem […], Basileae, apud Isingrinium, 1551. Selon Legros il s’agit d’un exemplaire de la bibliothèque de La Boétie dont a hérité Montaigne (I, 28) : Trois livres annotés par La Boétie et légués à Montaigne, in « Montaigne Studies », XVI, 2004, p. 30. Cf. en outre le Catalogo dei libri ritrovati, a cura di B. Pistilli e M. Sgattoni, in Biblioteche filosofiche private in Età Moderna e Contemporanea (url :http://picus.sns.it), p. 6 ; A. Legros, Montaigne manuscrit, Paris, Classiques Garnier, 2010.
11 « Celui qui entend demeurer maître de lui-même doit se tenir éloigné du baiser des beaux gens » : la phrase est de Socrate et le thème présent aussi dans les Memorabilia, I, 3.
12 Essais, III, 5, p. 892 [B].
13 Ibidem.
14 R. Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Éditions du Seuil, 1977, p. 81.
15 Ibidem.
16 Ibidem, p. 82.
17 Essais, III, 5, p. 892-893 [B].
18 Ibidem, p. 896 [B et C].
19 R. Barthes, op. cit., p. 271.
20 Platon, Le Banquet, 184c.
21 Ibidem, 205d.
22 Ibidem, 179b.
23 73d.
24 265b ; 238d.
25 Essais, III, 5, p. 893 [C].
26 Ibidem, p. 897 [B].
27 LXV, 1924.
28 Essais, III, 5, p. 890 [B].
29 Ibidem, p. 891 [C].
30 Ibidem, p. 891 [B].
31 Ibidem, p. 891 [B].
32 Essais, I, 26, p. 161 [C].
33 Cf. Géralde Nakam, « Erôs et les Muses dans Sur des vers de Virgile ou Les détours d’Erôs », in Montaigne, La manière et la matière, Paris, Klincksieck, 1992, p. 133-144. Le mal est toujours dans le regard de l’autre : ici, Eros est un vrai dieu d’équité.
34 II, 14 et 15.
35 Essais, III, 5, p. 893 [B].
36 I, 3.
37 Plutarque, Œuvres morales, t. VII/I, texte établi et traduit par J. Dumortier, Paris, Les Belles Lettres, 1975, 10, 520 B ; 13, 521 E.
38 66a.
39 Plutarque, Œuvres morales, op. cit., 22, 513 C.
40 Essais, III, 5, p. 894 [B].
41 Plutarque, Œuvres morales, t. X, texte établi et traduit par R. Flacelière, Paris, Les Belles Lettres, 1980, 19, 765 D. De l’Amatorius, Montaigne tire quelques typologies de socialité : « quatre especes anciennes : naturelle, sociale, hospitaliere, venerienne… » (I, 28, p. 184 [C]).
42 Ibidem, 21, 767 D.
43 Platon, Republique, V, 462c.
44 Diogène Laërce, VIII, 10. Maxime d’origine pythagoricienne, selon Cicéron aussi. Cf. Plutarque, Quaestiones convivales, II, 10, 644 B et IX, 14, 743 E.
45 Plutarque, Œuvres morales, t. X, op. cit., 21, 767 D-E.
46 Essais, III, 5, p. 894 [C et B].
47 Ficin, Commentaire sur Le Banquet de Platon, De l’Amour, op. cit., p. 44 ; El libro dello amore, op. cit., p. 41.
48 Ibidem.
49 Ibidem, p. 44-46 ; p. 41-42.
50 Essais, III, 5, p. 841 [B].
51 Ibidem, p. 843 [B].
52 Ibidem, p. 844 [B].
53 Ibidem, p. 844 [C].
54 Ibidem, p. 845 [C].
55 Ibidem, p. 849 [B].
56 Ibidem, p. 877 [B].
57 Ibidem, p. 877 [B et C].
58 De rerum natura, IV, 1048.
59 Ibidem, p. 1091-1096.
60 Essais, III, 5, p. 877 [C].
61 180d-182a.
62 Plutarque, Œuvres morales, t. X, op. cit., 19, 764 B.
63 Essais, III, 5, p. 877 [B et C].
64 Ibidem, p. 878 [B].
65 Ibidem, p. 889 [C].
66 Cf. A. Tournon, « Le principe de privation », in La poétique des passions à la Renaissance : Mélanges offerts à Françoise Charpentier, textes réunis et édités par F. Leclerc et S. Perrier Paris, Champion, 2001, p. 171-184.
67 Essais, II, 12, p. 540 [A].
68 Essais, III, 9, p. 1001 [B].
69 Essais, II, 28, p. 703 [C].
70 Essais, I, 20, p. 90.
71 Essais, I, 28, p. 185-186 [A].
72 Ibidem, p. 186 [A].
73 Ibidem, p. 186 [A et C].
74 A. Tournon, art. cité, p. 182.
75 Essais, III, 13, p. 1115 [C].
76 Les Confessions, III, 1, 1.
77 La traduction est de moi.
78 Nietzsche, Des trois choses mauvaises.
79 Essais, III, 1, p. 794 [C].