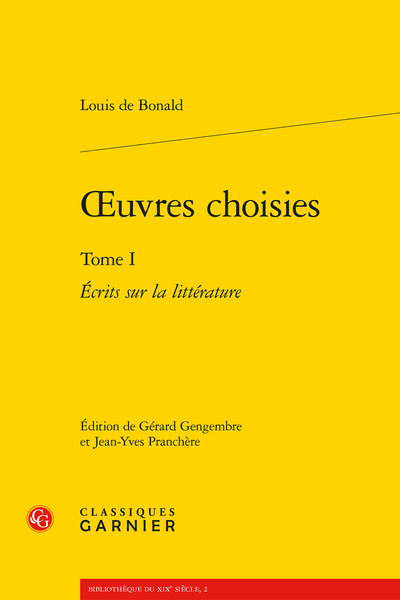
Note sur l’établissement du texte
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Œuvres choisies. Tome I. Écrits sur la littérature
- Pages : 63 à 65
- Collection : Bibliothèque du xixe siècle, n° 2
- Thème CLIL : 3440 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- XIXe siècle
- EAN : 9782812442452
- ISBN : 978-2-8124-4245-2
- ISSN : 2258-8825
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4245-2.p.0063
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 15/02/2011
- Langue : Français
Note sur l’établissement du texte
Dans la préface qu’il écrivit pour l’édition de ses Mélanges littéraires, politiques et philosophiques en 1819, Bonald présente ses articles comme des interventions dans « cette guerre de partisans » que mènent journaux, brochures et feuilletons. Aucune note rétrospective n’accompagne l’édition pour éclairer le contexte et décrire les positions, les alliances ou les lignes de front de la bataille où Bonald n’a cessé de prendre part de façon « stratégique », réagissant aux articles des auteurs libéraux qui pouvaient influencer la politique impériale, investissant autant que possible les journaux officiels qui lui étaient ouverts (notamment le Mercure de France, qui lui fut fermé après sa reprise en main par le pouvoir impérial en 1807).
Cette même préface précise que « l’auteur a laissé ces dissertations sous leur ancienne date et dans leur première forme ». De fait, sauf pour un article (« Questions morales sur la tragédie ») d’où il a retranché une dizaine de pages, Bonald n’a pas changé ses textes ; les très rares retouches qu’il leur a apportées sont infimes.
L’éditeur parisien Le Clère a donné trois différentes éditions des Mélanges : l’édition originale de 1819 ; l’édition de 1838, la dernière parue du vivant de Bonald, augmentée d’un très long article sur Madame de Staël ; l’édition de 1852, en un volume, complétée en 1854 par un second volume d’articles non recueillis par Bonald. (Une réimpression de 1858 assemble en deux tomes le volume de 1852 et celui de 1854.) A ces éditions s’ajoute l’édition Migne des Œuvres complètes en trois volumes (Paris, 1859), qui défait la composition des Mélanges pour regrouper les articles de Bonald sous des rubriques homogènes.
L’édition Le Clère de 1852 et l’édition Migne ne se distinguent des éditions précédentes que par leur orthographe modernisée. Elles n’offrent pas un texte plus fiable. Certes, l’édition Migne se présente comme le résultat d’un minutieux travail de vérification des textes de Bonald : l’éditeur indique dans l’avertissement qu’il a « eu la patience de parcourir, page par page, tous les journaux de France dans lesquels a écrit ce
fécond publiciste, depuis 1804 jusqu’à l’époque de sa mort en 1841 » et que Victor de Bonald, petit-fils de l’auteur, a corrigé les épreuves « pour rétablir le texte authentique de l’auteur partout où il avait été altéré par les premiers éditeurs ». Mais, outre que l’édition Migne ne propose aucun apparat critique, il faut constater, concernant les Mélanges, que le texte ne diffère pas de l’édition Le Clère de 1852 et en reproduit certaines erreurs absentes des précédentes éditions, en particulier dans les citations d’écrivains classiques. Les éditions de 1819 et 1838 doivent donc être préférées.
Le texte suivi ici est celui de l’édition de 1838, augmentée par Bonald. Cette édition, qui modernise l’orthographe de certains noms propres (« Mallebranche » devient « Malebranche ») et noms communs (« poëme » devient « poème »), ne diffère pas de l’édition de 1819 dont elle corrige certaines erreurs manifestes. L’édition de 1819 a cependant été consultée pour permettre la correction de quelques coquilles que l’édition de 1838 a laissé s’introduire.
L’orthographe a été modernisée, sauf pour les majuscules et minuscules (il n’est pas insignifiant que Bonald refuse la majuscule à « révolution »), ainsi que pour les noms propres. On lira donc, conformément à l’usage du temps : Tartufe, Champmêlé, Leibnitz, Linnée – et, plus étrangement : Démosthènes, Xeuxis, Apelles, Froissard, Shakespear.
Les variations de graphies qui font se succéder « xviiie siècle » (forme la plus fréquente) et « dix-huitième siècle » (en de rares occasions) ont été respectées. Ont été également respectées les variations qui conduisent Bonald – qui dit toujours « M. Bossuet », « M. de La Harpe », « M. Rollin » – à utiliser tantôt « M. de Buffon » ou « M. de Voltaire », tantôt « Buffon » ou « Voltaire ». Les italiques mises par Bonald sur certains noms propres ont été conservées en raison des effets de sens qui s’y attachent.
La ponctuation a été respectée, si déroutante qu’elle soit parfois pour nos habitudes. Remarquablement homogène d’une édition à l’autre, cette ponctuation n’a rien d’arbitraire ou de négligé : sa cohérence apparaît dès qu’on prend garde à sa destination, qui est de régler la diction. C’est ainsi que la nécessité de permettre les pauses du souffle induit la virgule entre le sujet et le verbe lorsque le sujet est une expression d’une certaine étendue, et que des points-virgules scandent les énumérations trop longues. La virgule peut indiquer au lecteur que certains groupes de mots ne s’enchaînent pas ; elle sert aussi à marquer l’insistance, la chute de la voix
servant à souligner l’importance de ce qui suit – aussi surgit-elle presque toujours après les expressions « c’est-à-dire » et « je veux dire ». Elle vient parfois s’intercaler entre sujet et copule, ou entre verbe et complément d’objet, comme si elle était l’équivalent d’un double point qui donnerait à l’énoncé la valeur d’une définition de dictionnaire.
La ponctuation de Bonald – tout comme son abus des italiques, qui suscita l’ironie de certains contemporains, – imite une diction magistrale : elle montre que le discours procède posément, méthodiquement, en produisant des définitions qui exigent qu’on s’y arrête. Le grand nombre des points-virgules et des virgules, qui obligent à retenir le souffle sans le couper, accentue le caractère pesé, réfléchi, définitif de la pensée qui s’avance. À la fin de son article « Du tableau littéraire de la France au xviiie siècle », Bonald affirme la supériorité du style « grave et plus lent » du siècle de Louis XIV sur le style « léger et rapide » – donc « sophistique », « violent et moqueur » – des philosophes du xviiie siècle. La ponctuation participe ainsi d’une politique : le discours de l’autorité doit épouser le rythme lent et soutenu qui convient à la majesté de toute autorité digne de ce nom.
Jean-Yves Pranchère