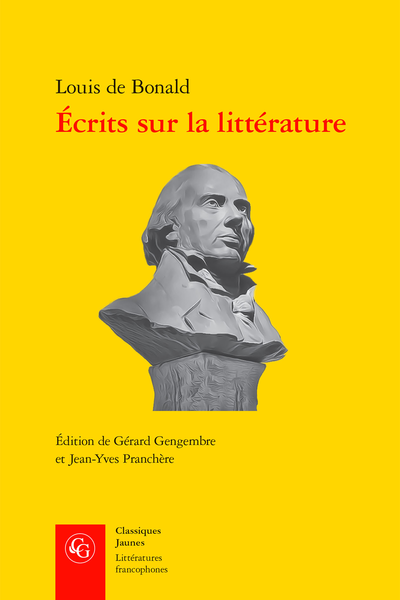
Des jeunes écrivains 1er décembre 1810
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Écrits sur la littérature
- Pages : 343 à 349
- Collection : Classiques Jaunes, n° 750
- Série : Littératures francophones
- Thème CLIL : 3440 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- XIXe siècle
- EAN : 9782406130017
- ISBN : 978-2-406-13001-7
- ISSN : 2417-6400
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-13001-7.p.0343
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 12/10/2022
- Langue : Français
DES JEUNES ÉCRIVAINS
1erdécembre 1810
Gazette de France, repris dans les Mélanges littéraires,
politiques et philosophiques, Paris, Le Clère, 1819,
tome II, p. 527-538.
On se plaint quelquefois que le public juge un auteur sur son âge plutôt que sur son talent, et on l’accuse même de faire du titre de jeune écrivain une sorte de blâme dont la tache subsiste encore longtemps après que l’auteur a cessé de le mériter. Mais on ne fait pas attention que ce n’est jamais qu’une portion du public qui juge du talent d’un écrivain. Ce sont des spectateurs ou des lecteurs en petit nombre, relativement à la masse du public ; et ces mêmes juges, qu’un écrivain décore du nom pompeux du public, s’ils lui sont favorables, il ne manque pas de les regarder comme une poignée d’envieux ou d’ignorants, s’ils n’applaudissent pas ses ouvrages. C’est à peu près ainsi que, dans les troubles civils, chaque faction voit le peuple tout entier dans ses seuls partisans.
Ceux, au contraire, qui même, sans connaître les écrits d’un auteur, le jugent sur son âge, sont bien vraiment le public, le public tout entier, qui prononce, non comme quelques particuliers, sur un aperçu de l’esprit qui peut être faux et erroné ; mais sur un sentiment général des convenances publiques, dont il est, en qualité du public, juge suprême et même juge infaillible.
En effet, tout jeune homme qui publie des ouvrages du genre moral, dit au public : « Écoutez-moi, et instruisez-vous. Je viens vous détromper de vos erreurs, et vous enseigner la vérité. Vous allez apprendre ce que vous ne savez pas, ou réformer vos idées sur ce que vous croyez savoir. » Ce langage, il le tient, non seulement à ses contemporains, mais à la postérité, ou plutôt il l’adresse à la société tout entière, composée d’hommes aussi instruits qu’il peut l’être, et qui joignent, aux connaissances acquises par l’étude, celles que donnent l’âge et l’expérience, et qu’il n’a pu acquérir.
344L’écrivain exerce donc une fonction publique, et même la plus publique de toutes les fonctions, puisque, de son vivant, il peut être lu par un nombre bien plus grand de personnes qu’aucun orateur n’en pourrait rassembler dans un même lieu ; que même, lorsqu’il n’est plus, il continue à parler aux hommes par ses écrits, et que cette instruction, bonne ou mauvaise, peut durer autant que la société.
Et qu’on ne pense pas qu’un ouvrage, quel qu’il soit, puisse jamais être indifférent. Un sot, dit le proverbe, trouve toujours un plus sot qui l’admire ; et il y a beaucoup de sottises qui sont mises en circulation par des gens d’esprit. Un écrit rebuté des savants sera accueilli par ceux qui croient l’être ; et la production la plus ignorée sera peut-être, dans un siècle, une autorité pour quelque lecteur qui y puisera des principes et des règles de jugement et de conduite ; et il n’y a pas jusqu’à l’Almanach de Liège1 qui, avec ses pronostics et ses prédictions, ne trouve créance dans quelques esprits.
C’est donc avec raison que le public désire que la maturité de l’âge lui soit un garant de la maturité du jugement, et qu’il trouve déplacé et contraire aux bienséances publiques qu’un homme s’ingère à lui donner des leçons, à l’âge auquel il en a besoin pour lui-même, et qu’il dispose en quelque sorte de nos esprits, lorsque la loi, cette raison souveraine, lui permet à peine de disposer de ses biens et de ses actions civiles.
La société, la première de toutes les autorités, se gouverne d’après ce principe. La valeur, il est vrai, ni même le talent, n’attendent point le nombre des années2, et cependant les gouvernements ne confient pas le commandement des armées au jeune officier qui a montré le plus de bravoure et de capacité, ni la présidence d’un tribunal à l’avocat imberbe qui a obtenu au barreau les plus brillants succès. Il faut être homme fait pour commander à des hommes, ou pour les instruire, ce qui est une autre manière de leur commander ; et il y a dans la maturité de l’âge une autorité qu’aucune autre ne peut remplacer. Cette autorité, qui préside la société domestique, gouverne encore, quoique d’une autre manière, la société publique, qui, étant composée de familles, comme la famille d’individus, place le pouvoir, suprême ou subordonné, dans les anciennes familles, qui sont les vieillards de l’État.
345Sans doute le public accueille avec indulgence les essais d’un jeune homme dans le genre qui convient à son âge, et il pousse la complaisance jusqu’à recevoir la confidence de toutes les peines ou de tous les plaisirs d’un amour souvent imaginaire, dans des écrits frivoles où quelquefois il n’y a pas plus de passion que de talent. Mais sur des objets plus graves ou dans des genres plus sérieux, pour tout ce qui suppose de longues réflexions, de grandes connaissances, un esprit libre de préjugés et d’illusions, en un mot, l’expérience des hommes et des choses, le public ne juge pas tout à fait avec la même condescendance ; il veut avant tout qu’on le respecte, et qu’on ne lui offre pas comme des chefs-d’œuvre, moins encore comme des leçons, les premières épreuves d’un talent pressé de se montrer, d’un talent qui souvent avorte, et qui, mûri par l’âge et la méditation, aurait dans son temps porté les fruits les plus utiles. On peut même, à cet égard, remarquer une inconséquence frappante dans la conduite des gens de lettres. D’un côté ils font, pour les questions les plus importantes, un appel aux jeunes talents, comme s’ils craignaient qu’ils ne fussent pas assez précoces ; de l’autre, s’ils publient un ouvrage important et qui ait exigé un long travail, ils ne manquent pas de faire valoir auprès du public, comme un titre de recommandation, le temps qu’ils ont mis à le composer. C’est ainsi que le Jury des prix décennaux3, en proposant à notre instruction le Catéchisme universel de M. de Saint-Lambert4, a eu soin de nous prévenir que l’auteur y avait employé soixante ans, que le public même a trouvé qu’il avait perdus ; car le public, qui juge un auteur sur son âge, ne juge pas un écrit sur le temps employé à le composer, et s’inquiète assez peu que l’enfantement en ait été laborieux, pourvu qu’il soit venu à terme.
Ces observations, utiles dans tous les temps, sont aujourd’hui nécessaires pour tenir les jeunes écrivains en garde contre les illusions de leur âge, les séductions de leurs coteries, et surtout contre l’exemple de quelques écrivains du dernier siècle. Les premiers essais philosophiques 346de Voltaire adolescent furent accueillis avec enthousiasme ; les jeunes écrivains qui, au sortir du collège, se lançaient, à son exemple, dans la même carrière, étaient d’avance assurés de bruyants suffrages, à commencer par le sien. Une foule d’écrits philosophiques, aujourd’hui complètement oubliés, furent, à leur apparition, proclamés comme la merveille du siècle, et leurs auteurs désignés par Voltaire pour héritiers de son talent de sa gloire5, qui jamais n’ont eu la moindre part dans cette riche succession. Mais tous ces écrivains, et Voltaire lui-même, et tous les philosophes de cette époque, allaient dans le sens de leur siècle ; ils avaient le vent en poupe, et leur marche n’éprouvait aucun obstacle, parce qu’ils ne faisaient qu’aider au mouvement des esprits et les pousser dans la direction que des doctrines déjà anciennes leur avaient donnée. Le génie qui devance son siècle en est souvent méconnu ; s’il veut le ramener en arrière, il court le risque d’en être persécuté ; mais s’il ne fait que le suivre, il trouve aplanies toutes les routes qui mènent à la gloire et à la fortune ; et nos philosophes, au lieu de devancer leur siècle, ne le suivaient que de loin ; et, dans sa marche impétueuse, il a cruellement déçu leurs espérances, et mis à découvert la vanité de leurs conjectures.
Ces écrivains qui parlaient à leur siècle et pour leur siècle, étaient des courtisans qui flattaient les passions de leur maître, et couvraient de fleurs l’abîme où il allait se précipiter ; et ce maître, faible et vieilli dans la corruption, payait leurs complaisances par des honneurs excessifs, qu’ils se hâtaient de lui ravir, de peur de n’en pas jouir longtemps : Apud senem festinantes6.
Ce siècle a fini, et même, on peut dire, de mort violente ; et son successeur, qui a trouvé les affaires dans le plus grand désordre, a soumis à une révision sévère les fortunes scandaleuses et les dilapidations du règne précédent.
Aussi l’on peut remarquer que les plus beaux esprits du dernier siècle, loin de grandir avec le temps, ce qui est le caractère le moins 347équivoque du génie, perdent tous les jours quelque chose de leur renommée, et autant par les concessions forcées de leurs partisans, que par les attaques de leurs adversaires ; ils ont bâti sur les opinions dominantes de leur temps, comme sur un sable mouvant, pour me servir de la belle comparaison de l’Évangile7, plutôt que sur le fondement inébranlable des vérités universelles qui doivent dominer dans tous les temps ; et déjà l’édifice qu’ils avaient élevé à grands frais menace ruine, et ne pourra résister longtemps à l’effort des vents et des eaux. Je n’entends pas leur contester le génie ; mais le génie, dans les choses qui ont rapport à la société, est une sorte de prescience et de prévision ; et si l’on compare ce qu’ils nous avaient promis avec ce que nous avons vu, on ne peut s’empêcher de convenir qu’ils n’ont été que de faux prophètes.
Les gens intéressés à défendre leur mémoire et leurs opinions, crient sans cesse à l’envie, à la malveillance, et affectent de ne voir qu’un parti de rebelles dans cette insurrection générale de la société contre les hommes qui l’ont trompée et les doctrines qui l’ont ravagée. Un parti peut offusquer la gloire d’un auteur vivant, ou lui créer une réputation bien supérieure à son mérite réel, et nous avons vu des exemples de l’un et de l’autre : mais lorsque l’auteur n’est plus, la cause est plaidée ; les avocats pour et contre, les amis, les ennemis, les indifférents, ont disparu de l’audience ; il ne reste que le juge, la postérité, qui prononce en l’absence des partis et dans le silence des passions. Séparés de ces écrivains par une révolution qui a mis entre eux et nous l’intervalle de plusieurs siècles, nous ne sommes plus leurs contemporains ; nous sommes pour eux la postérité, et nous avons le droit de juger ce siècle, qui a si légèrement condamné tous ceux qui l’avaient précédé.
Ceux qui, sans motifs personnels, n’écrivent que pour l’intérêt de la société, n’ont pas besoin d’étudier l’opinion de leur siècle, et ils ont ailleurs une règle sûre, indépendante des variations des temps et des caprices des hommes, et qui doit, tôt ou tard, tout ramener à son inflexible direction. Mais les jeunes écrivains qui aspirent à la gloire, et qui doivent trouver leur utilité particulière dans un usage 348honorable de leurs talents, courraient le risque de s’égarer, en prenant pour guides leurs prédécesseurs immédiats. Le temps et les esprits, tout est changé ; et les mêmes moyens de succès ne conduiraient plus aux mêmes résultats. Le siècle qui commence, s’il n’a pas encore une marche assurée, ne suit plus du moins la même direction que celui qui l’a précédé ; et il n’y a plus, il ne peut plus même y avoir de talent qui puisse l’y ramener ou l’y retenir. Voltaire lui-même y échouerait, lui surtout dont l’esprit souple, léger et brillant, était plus propre à hâter le mouvement qu’à le donner.
C’est ce que doivent avoir sans cesse devant les yeux les écrivains qui débutent dans la carrière périlleuse des lettres ; et, quelles que soient leurs opinions personnelles, dont le public ne peut leur demander compte, s’ils sont jaloux de leur gloire, prendre bien garde de ne pas écrire aujourd’hui ce qu’ils voudraient un jour n’avoir pas écrit. En vain quelques hommes qu’on peut appeler de l’ancien régime en philosophie, et qui, dans la simplicité de leur foi, croyaient que la révolution tout entière se faisait uniquement au profit de leurs opinions philosophiques, flattent de jeunes écrivains de l’espoir de les substituer à l’opulente succession des philosophes du xviiie siècle, dont ils se prétendent les exécuteurs testamentaires : ces hommes passeront, s’ils ne sont déjà passés ; et les imprudents héritiers, pour prix de leur complaisance, ne recueilleraient que le mépris des honnêtes gens et la juste animadversion de la société, et ces opinions surannées qui ont fait, dans leur temps, la fortune de tant de beaux esprits, ne vaudraient plus à leurs défenseurs, même les tristes honneurs d’une persécution.
Il est commun aujourd’hui d’entendre blâmer les emportements de quelques sages du dernier siècle. Mais, en même temps, on rejette, par forme de compensation, les doctrines opposées, comme un autre extrême qu’il faut éviter. Ces opinions, qu’on décore du nom de modérées, sont commodes, parce qu’elles sont toutes faites, et que, pour trouver le point où il faut s’arrêter, il suffit de se tenir à égale distance de deux autres points. Ces opinions modérées, et qui ne sont que mitoyennes, s’accommodent d’elles-mêmes aux esprits moyens ou médiocres, comme les partis moyens aux caractères faibles. Les bons esprits savent que la vérité est absolue, qu’elle n’est pas, comme une quantité, susceptible de plus ou de moins, qu’elle est ou qu’elle n’est pas, et qu’elle redoute moins les ennemis que les neutres. L’erreur elle-même, qui contrefait tous les 349caractères de la vérité, n’est pas plus indulgente ; elle a son excès, comme la vérité a son extrême ; une fois sur la route de l’une ou de l’autre, les esprits ne peuvent s’arrêter, et sont, malgré eux, entraînés jusqu’aux dernières conséquences de leurs principes ; et Voltaire lui-même a été accusé de timidité et presque de cagoterie par ses élèves, et J.-J. Rousseau, persécuté pour son déisme par les athées.
1 Voir note 1, p. 152.
2 Corneille, Le Cid, Acte II, sc. 2. v. 675.
3 Voir la note 1, p. 287.
4 Jean-François de Saint-Lambert (1716-1803), philosophe et poète (Les Saisons, 1769), collabora à l’Encyclopédie, et publia un Catéchisme universel en 1789, qui annonce la philosophie idéologiste. Dans un article intitulé « Prix décennaux (Catéchisme universel de Saint-Lambert) », complétant celui sur les prix décennaux (voir p. 287-293), Bonald revient sur ce texte et la signification à accorder aux louanges décernées par l’Institut. Voir aussi note 1, p. 187 et note 1, p. 287, sur l’attribution puis le retrait du prix à Saint-Lambert.
5 Sic. Les éditions parues du vivant de Bonald ne portent pas de virgule. Il peut s’agir d’une coquille, mais on ne peut pas exclure que « talent » s’entende à partir du sens ancien de « monnaie de compte équivalant au poids d’un talent » (cf. « talent d’or », « talent d’argent »), de sorte que l’expression de Bonald signifierait « de sa monnaie de sa gloire ».
6 Tacite, Histoires [Historiae], I, 7 : « Praepotentes liberti, seruorum manus subitis auidae et tamquam apud senem festinantes, eademque nouae aulae mala, aeque grauia, non aeque excusata » : « Déjà des affranchis puissants mettaient tout à l’enchère ; d’avides esclaves dévoraient à l’envi une fortune soudaine, et se hâtaient sous un vieillard ».
7 Matthieu, 7, 26 : « Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. »