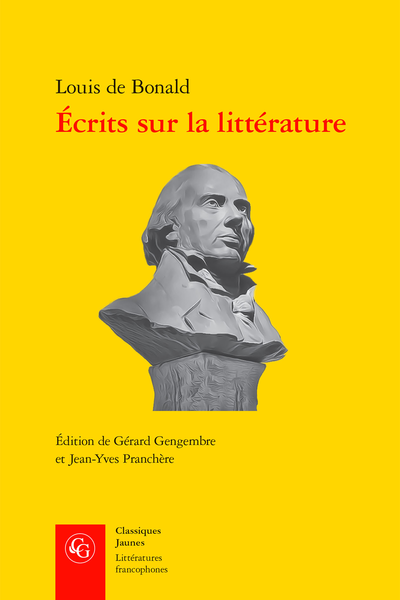
De l'art dramatique et du spectacle
- Publication type: Book chapter
- Book: Écrits sur la littérature
- Pages: 295 to 301
- Collection: Classiques Jaunes (The 'Yellow' Collection), n° 750
- Series: Littératures francophones
- CLIL theme: 3440 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- XIXe siècle
- EAN: 9782406130017
- ISBN: 978-2-406-13001-7
- ISSN: 2417-6400
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-13001-7.p.0295
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 10-12-2022
- Language: French
DE L’ART DRAMATIQUE ET DU SPECTACLE
Mélanges littéraires, politiques et philosophiques,
Paris, Le Clère, 1819, tome II, p. 333-345
Les plaisirs publics peuvent finir par leur excès comme les plaisirs privés ; et peut-être ne sommes-nous pas loin du temps où le spectacle, en France, tuera l’art du théâtre.
À l’époque à laquelle Corneille parut, le spectacle était aussi peu avancé que l’art dramatique ; et même plus tard, et du temps de Racine, les théâtres, ou plutôt les tréteaux du Marais et de l’hôtel de Bourgogne, ne ressemblaient guère mieux à nos salles modernes de spectacles, que le chariot où Thespis promenait ses pièces informes et ses acteurs barbouillés de lie. Au reste, ces pères de notre tragédie pensaient bien moins à faire des œuvres scéniques que des ouvrages littéraires ; ils écrivaient pour le cabinet et les gens de goût, plutôt que pour le théâtre et la multitude ; et il est assez remarquable que dans les dissertations, les examens, les préfaces qui précèdent leurs tragédies, ils n’aient rien dit de la représentation et du matériel de l’art théâtral, pas même parlé des comédiens, ni pour les louer, ni pour s’en plaindre ; quoique sans doute, alors beaucoup plus qu’aujourd’hui, les auteurs ne fussent pas toujours contents des acteurs.
Et que pouvaient être alors ces comédiens élevés à l’école de Mairet ou de Rotrou1, et qu’un parterre novice dans l’art du théâtre ne pouvait applaudir ni blâmer avec connaissance ? Quand on songe à tout ce qu’on demande aujourd’hui d’un acteur, à toutes les études que son art suppose, aux longues épreuves auxquelles il soumet ceux qui s’y dévouent, à tout ce qu’il a dû acquérir par deux siècles d’exercices et de traditions, et qu’on pense en même temps que les dernières pièces de Corneille et les premières de Racine sont contemporaines de celles où Molière a mis 296sur la scène les capitans, les pédants, les précieuses ridicules de son temps, et que ce temps fut aussi celui des raffinements d’une galanterie quintessenciée, on ne peut s’empêcher de croire que les enfants impétueux2 du génie de Corneille furent plus d’une fois défigurés par une exagération de grandeur, ou les héros plus tendres de Racine, furent, malgré ses soins, un peu affadis par un ton doucereux. Le génie particulier des deux poètes prêtait à l’un ou à l’autre excès ; et l’esprit général de ce temps, à ces deux époques, y était assez disposé, si l’on en juge par les romans qui parurent au commencement ou à la fin du siècle. Chose étrange, que le naturel soit en tout la dernière chose à laquelle parvienne notre faible nature ! Quoi qu’il en soit, les spectateurs, à l’exemple de ces grands poètes, attachaient bien moins d’importance qu’on ne le fait de nos jours à tout cet artifice de la représentation. Plus avancés dans le goût des lettres que dans celui des arts, ils demandaient aux acteurs de leur réciter Corneille et Racine, plutôt que de les jouer, et écoutaient avec transport Andromaque et les Horaces représentés quelquefois dans une chambre, derrière des paravents et des tapisseries, par des Grecs à grandes perruques, et des Romaines en engageantes et en falbalas3. Ils n’étaient pas même assez occupés de l’architecture du palais des Césars ou du temple de Jérusalem, pour qu’il fût absolument nécessaire de leur en offrir de mesquines images sur des lambeaux de toile ; et leur imagination agrandissait la majesté de tous ces héros de l’histoire ou de la fable, ou embellissait la dignité modeste des reines et des princesses, plus que n’auraient pu le faire les attitudes compassées d’un garçon de boutique travesti en Achille ou en Pompée, ou les minauderies d’une ouvrière en linge déguisée en Monime ou en Pauline4. En un mot, il semble qu’alors les pièces de théâtre fussent faites pour être lues, et qu’on finit par les jouer, tandis qu’à d’autres époques on commence par les jouer, et l’on essaie ensuite de les lire.
297Voltaire fit révolution dans l’art dramatique ; il voulut être représenté beaucoup plus qu’être lu, et professa même la maxime de frapper fort pour la multitude plutôt que de frapper juste pour les gens instruits5. Il mit dans ses pièces beaucoup plus de machine et de fracas ; et quelquefois il rapprocha des yeux du spectateur des actions matérielles que la morale publique, d’accord avec les préceptes des maîtres de l’art, recommande d’en tenir éloignées. Cet auteur changea même l’acception du mot passions théâtrales, qui, pour Corneille comme pour Aristote, est l’équivalent d’affections même les plus légitimes ; et qui, dans Voltaire, signifie les mouvements du cœur les plus violents, et tels que, pour les traduire sur la scène, il faut, je me sers de ses expressions, avoir le diable au corps6.
Quand le spectacle fut devenu une partie essentielle de l’art dramatique, les comédiens devinrent des personnages presque aussi importants que les auteurs ; et alors, ce me semble, on les appela acteurs, nom que Corneille, d’après les Latins, ne donne jamais qu’au personnage même du drame. Le siècle avait formé Voltaire pour ses mœurs ; Voltaire forma les acteurs pour ses pièces. Il est même permis de douter que ses tragédies eussent fait une si grande fortune, s’il n’eût pas été mieux servi par les acteurs que ne l’avaient été vraisemblablement ses illustres devanciers ; et La Harpe nous apprend que Mahomet, méconnu par les spectateurs aux premières représentations, ne dut le succès qu’il obtint dix ans après, qu’au talent prodigieux de l’acteur qui joua le principal rôle, et révéla au public le secret de son mérite7.
Aujourd’hui, on joue Corneille et Racine avec les acteurs de Voltaire, et dans son esprit ; et peut-être n’avons-nous plus le diapason de ces deux grands maîtres, et nous jouons leur musique dans un autre mode et sur un ton différent.
298Voltaire, le premier, présenta, en quelque sorte, les comédiens au public, et les interposa entre l’auteur et les spectateurs. Il fit imprimer, en tête de ses tragédies, des vers galants adressés aux actrices sur leurs beaux yeux, et des compliments aux acteurs sur leurs talents et leurs vertus. Par là, il les intéressait à ses succès, et se moquait un peu, selon sa coutume, des lois sévères qui flétrissent la profession publique du théâtre. Au reste, il était convenu que le théâtre est une école de morale, dont les comédiens se trouvent naturellement les ministres. Alors, et par une suite nécessaire, on mit une extrême importance à traiter, avec une scrupuleuse fidélité, les accessoires de la représentation, édifices, meubles, armes, vêtements. Le décorateur, le machiniste, le peintre, même le tailleur, devinrent des acteurs presqu’aussi nécessaires que les autres à la fortune d’une œuvre de théâtre ; et sans doute, plus d’une fois, les éloges donnés à la décoration se confondirent, et firent nombre avec ceux qui étaient donnés à la pièce.
Voltaire aurait pu, plus que tout autre, se passer du prestige de la scène ; mais il avait donné l’exemple de parler beaucoup aux sens du spectateur, et cet exemple devint contagieux, parce qu’il est plus aisé de faire une tragédie avec des perspectives et des costumes, qu’avec de la poésie, et qu’on a plus tôt, au théâtre, monté dix machines que tracé un caractère.
D’ailleurs, le spectacle était devenu une institution publique, un besoin de première nécessité, comme le pain. Il avait été mis sous la protection de l’autorité publique. La direction suprême en avait été confiée à des hommes que leur naissance et leurs places approchaient de la personne du souverain ; et en tout les plaisirs avaient été traités par l’administration avec autant d’importance et de gravité que les devoirs. Mais rien ne s’use plus vite au théâtre que le plaisir des yeux. Un homme d’esprit lira et relira sans cesse des tragédies qu’il sait par cœur, et il n’assisterait pas trois fois de suite à des représentations de ces mêmes ouvrages données par les mêmes acteurs. Je ne sais pas même si les chefs-d’œuvre de la scène (je ne parle que de la scène tragique) ne perdent pas, pour un homme de goût, à la représentation, plus qu’ils ne gagnent. La copie reste toujours beaucoup au-dessous du modèle que se forme l’imagination : et lorsqu’on voit ces héros si grands dans la fable et dans l’histoire, et ces héroïnes, d’une vertu si haute ou d’une dignité si modeste, représentés par des hommes si peu importants, et par des femmes d’un accès si facile, toute illusion est détruite, et l’on a plutôt à se défendre de souvenirs plaisants que de sentiments profonds.
299Enfin, de nos jours, les spectacles extrêmement multipliés, suivis par toutes les classes, même par la plus nombreuse, exigent un aliment journalier et proportionné aux goûts et aux sensations du plus grand nombre. Le génie compose par inspiration, la médiocrité travaille par entreprise ; et les comédiens, entrepreneurs en chef des plaisirs du public, sont devenus les juges naturels des fournisseurs, et les arbitres suprêmes de ce qui convient à leurs intérêts particuliers et au goût dominant. Il faut donc toujours du nouveau, n’en fût-il plus au monde8 ; et cette fureur de nouveautés, poussée aux derniers excès, ne permet plus d’attendre les fruits tardifs du talent, ni de rebuter les essais de l’inexpérience, toujours pressée de se montrer. Après l’histoire du cœur, en est venu le roman ; après le grand, vient le gigantesque ; après le beau, le merveilleux, le singulier, le bizarre, le monstrueux… l’art finit, et plus tôt encore si des changements dans les lois, dans les mœurs, dans les croyances, rendent une génération totalement étrangère aux idées et aux sentiments de celles qui l’ont précédée.
Quel est l’homme de goût, quel est même le Français qui puisse lire sans douleur, dans le Mercure du 20 janvier dernier, ces observations si tristes et malheureusement si vraies, sur le peu d’effet que produit aujourd’hui à la représentation Athalie ; Athalie ! ce chef-d’œuvre poétique de l’esprit humain, et le plus beau titre de notre gloire littéraire ! « Nous ne pouvons plus, dit le rédacteur, sympathiser avec les sentiments et les opinions qui dominent dans cette tragédie. Le mérite de Racine n’en est que plus grand d’avoir su se les approprier ; mais plus il a réussi, plus son ouvrage devient admirable, et moins il doit nous toucher… Athalie est plus dans les mœurs des Juifs que Phèdre dans les mœurs des Grecs ; mais elle est moins dans nos mœurs, dans nos opinions, que les tragédies de Sophocle et d’Euripide. M. de La Harpe a réfuté très gravement et très méthodiquement les critiques de Voltaire sur Athalie. Mais ce n’est point par ses bons mots contre cette tragédie que Voltaire a nui le plus à son effet… Cette pièce, qui se rapproche, pour les chœurs, des tragédies grecques, et qui, par son esprit, s’éloigne encore plus de nous, devrait peut-être, comme les chefs-d’œuvre anciens, être laissée dans le cabinet, à l’admiration des connaisseurs, et ne point braver au théâtre un public dont l’esprit est si différent9. »
300Ainsi cette magnifique production du génie poétique et religieux, qui serait accueillie comme elle mérite de l’être dans les plus petites villes de l’empire, ne peut plus, au xixe siècle, paraître sur le premier théâtre du monde policé ! Et voilà donc le dernier résultat du progrès des lumières, des encouragements de toute espèce donnés aux lettres et aux arts, de tant d’académies, d’athénées, de théâtres, d’études, et de cours de littérature ! En quo discordia cives10 !…Polyeucte, par les mêmes raisons, ne pourra se soutenir longtemps sur la scène ; Zaïre même, dans ce qu’elle a de plus noble et de plus touchant, paraîtra bientôt ridicule, et l’on n’en conservera sans doute que les fureurs d’Orosmane. Voltaire recueillera le premier ce qu’il a semé ; et les trois chefs-d’œuvre de nos trois grands tragiques, relégués dans l’ombre des cabinets, n’oseront plus braver au théâtre les mépris ou l’indifférence du public. La morale, je le sais, n’aura pas à déplorer la chute des spectacles, cette grande plaie des mœurs publiques en Europe, et qu’une nation devrait s’interdire, si elle voulait s’élever à une haute perfection ; car le goût des plaisirs retient dans l’enfance les peuples aussi bien que les hommes. Mais en applaudissant à l’effet, on peut gémir sur la cause ; et certes, si l’influence du Génie du christianisme sur les progrès même littéraires d’un peuple avait besoin d’une autre démonstration que le rare talent avec lequel l’a développée, même par son exemple, un écrivain11 qui honore son pays et ses amis, on la trouverait dans les réflexions que je viens de citer, et dans lesquelles on voit la dégénération du goût public suivre l’affaiblissement des croyances religieuses, et la barbarie de l’esprit recommencer avec l’esprit du paganisme. D’autres changements dans les mœurs et les manières rendront bientôt inintelligibles nos plus belles comédies du genre sérieux, et l’on pourra, sans faire de calembour, dire que notre théâtre tombe pièce à pièce.
Nous serons donc réduits aux féeries du théâtre de l’Opéra et du mélodrame. Déjà le spectacle qui en fait le fonds menace de l’envahir tout entier ; et bientôt nous pourrons dire de ces représentations mécaniques, ce qu’Horace disait de celles de son temps :
301Verum equitis quoque jam migravit ab aure voluptas
Omnis ad incertos oculos et gaudia vana
Quatuor aut plures aulœa premuntur in boras,
Dum fugiunt equitum turmæ, peditumque catervæ.
Esseda festinant, pilenta, petorrita, naves, etc12.
« On ne cherche plus au théâtre les plaisirs de l’esprit ; on n’y va plus, et même dans les classes les plus élevées, que pour repaître ses yeux des vains prestiges du spectacle, et voir passer, pendant quatre heures et plus, des troupes d’hommes à pied ou à cheval, des chars, des litières, et jusqu’à des vaisseaux. »
Cependant on finira peut-être par trouver qu’il n’y a pas assez de spectacle, et que les acteurs perdent trop de temps à parler. Un public devenu sourd aux beautés de la poésie ne voudra plus que d’un jeu muet ; et la pantomime, qui fit les délices des derniers Romains, sera seule en possession d’amuser notre oisiveté. Qui sait même, aujourd’hui que la mécanique a fait de si grands progrès, qui sait si quelqu’autre M. Pierre n’imaginera pas des acteurs automates qui joueront sans faute, parce qu’ils joueront par ressort13 ? Je croirais volontiers que nous touchons à cette heureuse invention, au soin que prennent quelques auteurs de dispenser les comédiens de toute intelligence, en notant, dans leurs pièces, avec une minutieuse exactitude, les endroits où ils doivent s’asseoir ou se lever, paraître calmes ou agités, et varier, de telle ou telle manière, les inflexions de la voix, les attitudes du corps, et jusqu’à l’expression de la figure. Quand nous en serons là, nous pourrons mesurer les degrés de notre perfectibilité littéraire, et nous aurons, pour les deux points extrêmes de l’échelle…Athalie et les grandes marionnettes.
1 Jean Mairet (1604-1686) et Jean Rotrou (1609-1650), dramaturges.
2 Rappel d’Émilie dans Cinna : « Impatients désirs d’une illustre vengeance / Dont la mort de mon père a formé la naissance, / Enfants impétueux de mon ressentiment, / Que ma douleur séduite embrasse aveuglément, / Vous prenez sur mon âme un trop puissant empire » (I, 1, v. 1-5).
3 Les engageantes sont une parure de femme, une sorte de manche de toile ou de dentelle qui pend au bout des bras. Les falbalas sont des bandes d’étoffe plissée que l’on met au bas et autour des jupes, autrement dit des volants (Littré).
4 Achille, personnage d’Iphigénie ; Pompée, personnage de la Mort de Pompée de Corneille (1642) ; Monime, personnage de Mithridate ; Pauline, personnage de Polyeucte.
5 Voir la note 2, p. 68.
6 Cette expression figure notamment dans Candide, dans l’article « Possédés » du Dictionnaire philosophique, etc. On cite une anecdote, rapportée dans les pièces justificatives de la Vie de Voltaire de Condorcet (Paris, 1789, p. 249) et dans les Mémoires de Lekain (Paris, 1801, p. 14). « Il faudrait avoir le diable au corps pour arriver au ton que vous voulez me faire prendre » aurait dit Mlle Dumesnil pendant les répétitions de Mérope, et Voltaire aurait répondu : « Eh ! vraiment oui, mademoiselle, c’est le diable au corps qu’il faut avoir pour exceller dans tous les arts ! ». (Cf. Jean Goldzink, Voltaire, coll. « Portraits littéraires », Paris, Hachette, 1994, p. 172.)
7 Il s’agit de Lekain, sociétaire de la Comédie-Française (1728-1778). Voir la note 2, p. 211 et, pour le texte de La Harpe, la note 2, p. 229.
8 Citation de La Fontaine : « Il me faut du nouveau, n’en fût-il point au monde », propos d’Apollon dans « Clymène », Contes de la 3e partie de 1671.
9 Passage extrait de la conclusion d’un compte-rendu, signé V., d’une reprise de La Mère confidente de Marivaux, paru dans le Mercure de France du 20 janvier 1810 (no CCCCXLIV), p. 176-177. Les italiques sont de Bonald.
10 Virgile, Bucoliques, I, 71, « En quo discordia cives / Produxit miseros ! » « Hélas ! de nos discordes / Nos malheurs sont le fruit ! » (traduction de Paul Valéry).
11 Sur les relations de Bonald et de Chateaubriand, voir note 1, p. 303.
12 Horace, Épîtres, II, 1, v. 187-191 : « Verum equitis quoque jam migravit ab aure voluptas / Omnis ad incertos oculos et gaudia vana. / Quatuor aut plures aulœa premuntur in horas, / Dum fugiunt equitum turmæ, peditumque catervæ ; / Mox trahitur manibus regum fortune retortis, / Esseda festinant, pilenta, petorrita, naves, / Captivum portatur ebur, captica Corinthus. » « Il est vrai que, même chez les chevaliers, tout le plaisir du spectacle est passé des oreilles aux yeux : il leur faut des joies changeantes et vaines. Le rideau reste tiré trois ou quatre heures pendant que défilent des escadrons de cavaliers, des bataillons de fantassins, suivis de grands rois vaincus, les mains liées derrière le dos ; puis viennent des chars bretons, étrusques ou gaulois, des navires, des objets d’ivoire pris à l’ennemi, des bronzes de Corinthe » (traduction de François Richard).
13 Il doit s’agir de Pierre Jaquet-Droz (1721-1790), horloger suisse qui mit au point d’ingénieux automates.