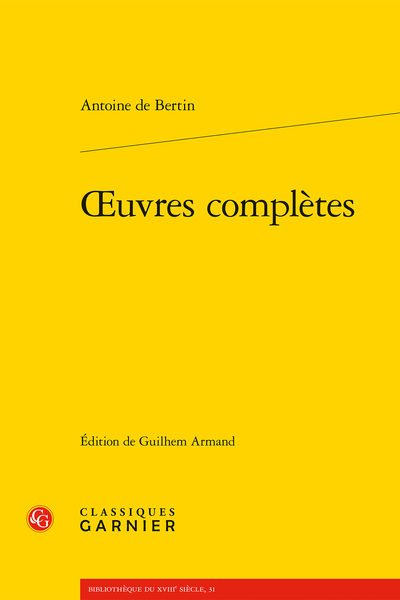
Principes de cette édition
- Publication type: Book chapter
- Book: Œuvres complètes
- Pages: 55 to 57
- Collection: Eighteenth-Century Library, n° 31
- Series: Poetica, n° 1
- CLIL theme: 3439 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moderne (<1799)
- EAN: 9782406059424
- ISBN: 978-2-406-05942-4
- ISSN: 2258-3556
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-05942-4.p.0055
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 10-17-2016
- Language: French
Principes de cette édition
Pour établir le texte de la présente édition, nous nous sommes essentiellement appuyé sur la dernière édition parue du vivant d’Antoine de Bertin et qu’il a pu vérifier et amender : celle des Œuvres de M. le chevalier de Bert**, Londres-Paris, Hardouin et Gattey, 1785, en deux volumes, établie par Carbon Flins des Oliviers1. À l’instar de Boissonade2 et de son édition savante de 1824, nous avons ajouté en appendice les quatre pièces délaissées en 1785. C’est donc l’ordre de l’édition de Boissonade que nous avons suivie dans cet ouvrage – à savoir celui de 1785 avec une addition – et, en en suivant la logique, avons ajouté les œuvres de jeunesse, Mes Rêveries, à la suite.
En ce qui concerne Mes Rêveries, nous avons reproduit le volume de la bibliothèque de Catriona Seth, une amusante contrefaçon qui se donne pour un volume des œuvres de Parny (Œuvres galantes et amoureuses du chevalier de Parny, Liège, Chez Lemarié, 1785) : il s’agit en fait d’une contrefaçon liégeoise qui, aux deux-tiers du volume présente l’intégralité du texte de Bertin dans son édition originale : Mes Rêveries : contenant Érato et l’Amour, Poème ; suivi des Riens, à Londres, 17713.
En revanche, nos recherches nous ont amené à croiser des textes signés « M. Bertin » dans divers périodiques du tout début du xixe siècle. Sans confrontation avec une édition antérieure attestant qu’il s’agissait bien d’Antoine de Bertin, il nous a paru délicat de les faire paraître dans cette édition, d’autant que, bien que s’agissant de poésies légères, ils semblaient d’une facture assez maladroite – on
pourrait, à la rigueur supposer des œuvres de jeunesse, mais nous sommes convaincus qu’il a fait publier dans Mes Rêveries tout ce qu’il avait alors produit. C’est, par exemple, le cas de « L’Embarras » que signale la bibliographie des poètes créoles du xviiie siècle établie par Catriona Seth, ce texte paru dans les Étrennes lyriques en 1803 et signé d’un certain « Bertin ».
Pour établir les notes de cette édition, nous nous sommes appuyé sur l’appareil critique de Boissonade, en particulier pour les références à la poésie latine. Nous n’avons pas reproduit telle quelle l’annotation savante et parfois complaisante de l’éminent latiniste qui reconnaît lui-même être parfois allé trop loin dans ce travail : « si parfois nous avons approché des passages où il n’y avait pas précisément imitation, mais seulement rencontre et ressemblance, c’est un abus de mémoire ; nous le confessons […] » Aussi avons-nous dû opérer un tri des sources principales de Bertin qui nous a permis d’en découvrir d’autres. Les influences, latines ou du xviie et du xviiie siècle, permettent de distinguer ce qui dans la poétique de l’auteur relève de l’imitation ou de l’inspiration plus lointaine. Le lecteur actuel goûtant moins la poésie latine dans le texte que celui des années 1780-1820, il nous a paru important d’en donner une traduction. Nous l’avons voulue au plus près du texte afin que puisse se percevoir nettement la distance entre l’hypotexte et la réécriture bertinienne.
Une dernière partie d’annexes présente des textes qui permettent de mieux comprendre Bertin et de le resituer dans son époque. Nous avons choisi trois poèmes de Parny qui entretiennent une relation dialogique particulière avec les élégies et les épîtres de Bertin. Le quatrième texte proposé en annexe est la « Réponse aux vers précédents par M. Dorat » : Flins des Oliviers et Bertin avaient choisi de faire figurer dans l’édition de 1785 la réponse de Bonnard, mais avaient sciemment oublié celle-ci qui, pourtant, se trouvait à la page suivante dans l’Almanach des Muses. Enfin, il nous a semblé important d’offrir au lecteur la toute première réception – positive, de surcroît – des Amours de Bertin4, que l’on pense être de La Harpe.
S’agissant de poésie, il nous a paru important de signaler la plupart des variantes entre les différentes éditions : principalement celle de l’Almanach des Muses et celle de 1780, sauf celles qui relèvent de différences orthographiques.
Conformément aux principes de l’édition contemporaine, nous avons modernisé l’orthographe mais avons conservé la ponctuation – sauf cas véritablement problématique témoignant d’une erreur probable de l’imprimeur5. Dans certains cas où la rectification nuirait à la versification (nombre de syllabes ou rime pour l’œil), nous avons signalé le maintien de l’ancienne orthographe par le traditionnel sic.
Le système d’annotation est donc double :
–d’une part, des renvois en fin de volume pour les variantes par des appels de note en minuscule alphabétique (parfois avec un commentaire de ces variantes) ;
–d’autre part, des notes explicatives, en bas de page, signalées par des chiffres arabes. Elles concernent aussi bien les emprunts aux hypotextes anciens ou modernes que les explicitations contextuelles ou lexicales.
En fin de volume, un index des noms propres (de personne ou de lieux, réels ou fictifs) permet de les repérer dans le texte.
1 « On veut que Carbon Flins des Oliviers ait eu part à cette édition, mais personne n’a pu déterminer de quelle manière », note prudemment Pierre Riberette, art. cité, p. 44.
2 En revanche, il nous a paru important de ne pas suivre l’édition de Boissonade quant à l’établissement du texte : bien qu’il se fondît sur l’édition de 1785, il se permettait parfois de choisir entre les différentes variantes celle qui lui semblait la plus élégante (à ce sujet, voir l’article de Pierre Riberette).
3 En termes de bibliographie, il s’agit d’un faux volume, conséquence d’une reliure conjointe de deux livres (certainement par un particulier).
4 Mes Rêveries, paru sans nom d’auteur, a subi une critique lapidaire mais qui ne présente guère d’intérêt. Par ailleurs, la réception par Garat des Œuvres parues en 1785 a pour intérêt essentiel de nous donner une idée du goût de l’époque pour la poésie imitative – la présentation générale en a donné les traits principaux.
5 En revanche, concernant le discours direct, nous nous sommes conformé aux règles actuelles.