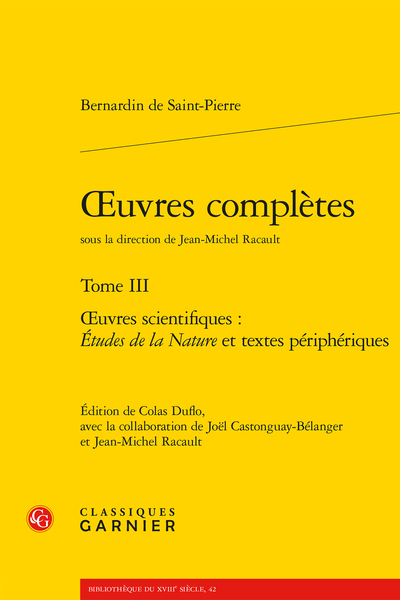
Les sources de Bernardin de Saint-Pierre
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Œuvres complètes. Tome III. Œuvres scientifiques : Études de la Nature et textes périphériques
- Pages : 49 à 50
- Collection : Bibliothèque du xviiie siècle, n° 42
- Thème CLIL : 3439 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moderne (<1799)
- EAN : 9782406087816
- ISBN : 978-2-406-08781-6
- ISSN : 2258-3556
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-08781-6.p.0049
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 16/09/2019
- Langue : Français
Les sources de Bernardin
de Saint-Pierre
Comme la plupart des auteurs du xviiie siècle, Bernardin de Saint-Pierre ne cite pas toujours ses sources. Le lecteur des Études de la Nature aura remarqué en particulier qu’il ne cite jamais nommément les auteurs qu’il réfute. Il faut d’ailleurs se garder d’une illusion créée par cette absence de précision, qui consisterait par opposition à croire que quelqu’un est précisément visé à chaque fois qu’il y a réfutation d’une idée. L’adversaire laissé dans le vague est parfois lui-même un adversaire vague, parfois une tendance générale ou une collectivité (les botanistes, les savants, etc.). En revanche, Saint-Pierre cite volontiers les auteurs sur lesquels il s’appuie, en particulier ceux dont les observations donnent une légitimité à ses hypothèses. Ces sources revendiquées, dont on peut avoir une idée par l’index que nous avons constitué pour cette édition, sont de deux sortes : la culture classique, qui a une fonction d’illustration (à l’exception de Pline), et les textes modernes, qui sont des sources d’informations.
Saint-Pierre fait un usage appuyé des références antiques : Aristophane, Cicéron, Homère, Horace, Lucrèce, Tacite, Virgile, Xénophon, font partie des auteurs qu’il a constamment en mémoire (avec une nette préférence pour les auteurs latins). Ils viennent illustrer un propos, fournir un exemple, etc. Pour la plupart, les passages cités font partie de la culture générale de l’homme de lettres du xviiie siècle. Il est à noter, à propos de cette culture, qu’il y a certainement une baisse de la connaissance du latin dans le dernier tiers du xviiie siècle, car Saint-Pierre prend la peine de traduire pour ses lecteurs tous les passages latins cités, ce que ne faisaient pas systématiquement les auteurs qui publiaient vingt ans auparavant. Il est aussi des auteurs antiques dont Saint-Pierre fait un usage qui suppose une pratique plus assidue. Il s’agit de Plutarque, que Saint-Pierre, comme Rousseau, cite à toute occasion dans les domaines 50moral et politique – il utilise alors, comme tout le monde à l’âge classique, la traduction d’Amyot –, et de Pline, dont l’Histoire naturelle fonctionne comme une véritable source, au même titre que les observations plus récentes, pour tout ce qui concerne la description de la nature et de ses productions.
Les références religieuses ne sont pas très fréquentes. Ce sont essentiellement l’Ancien et le Nouveau Testament et, assez rarement, d’autres textes, comme les Lettres de saint Jérôme.
Enfin, la culture classique de Bernardin de Saint-Pierre est aussi constituée d’ouvrages des siècles précédents : les Essais de Montaigne, les Fables de La Fontaine, Racine et, surtout, Fénelon, qui est cité à plusieurs reprises et toujours avec de grands éloges.
Saint-Pierre cite très peu d’écrivains français de la génération précédant la sienne, essentiellement Voltaire – mais seulement l’auteur des Éléments de la philosophie de Newton – et Rousseau, dont Saint-Pierre revendique la filiation spirituelle.
Les autres références utilisées par Bernardin de Saint-Pierre sont celles qui fonctionnent comme mine d’informations, d’observations et d’expériences. On trouve dans cet ensemble quelques textes de botanique et de savants (les Mémoires de l’Académie sont cités), mais surtout, beaucoup de récits de voyages.
En essayant de préciser les références souvent allusives données dans les Études, comme nous l’avons fait dans les notes de la présente édition, on peut essayer de se faire une idée plus précise de cet ensemble de textes qui nourrissent l’argumentation. Ces références sont récapitulées dans la bibliographie fournie en annexe, qui donne ainsi une image de l’ensemble des sources explicitement mises en œuvre dans les Études. L’édition indiquée n’est bien sûr pas nécessairement celle dont s’est servi Bernardin de Saint-Pierre, puisqu’il ne l’indique jamais. Nous livrons cette indication pour qu’il soit possible de se faire une idée du corpus utilisé, et notamment des dates de ses sources.