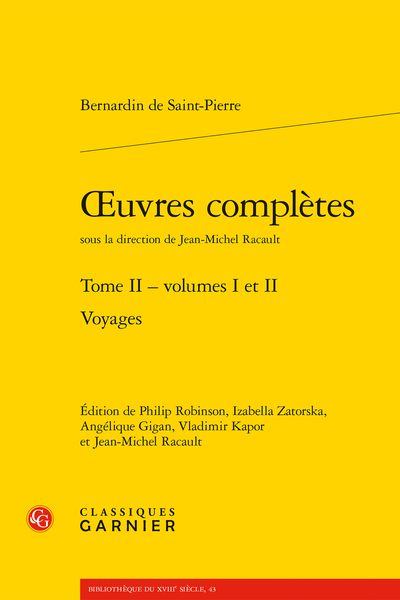
Principes d’établissement et d’édition du texte
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Œuvres complètes. Tome II. Voyages
- Pages : 411 à 415
- Nombre de volumes : 2
- Collection : Bibliothèque du xviiie siècle, n° 43-44
- Thème CLIL : 3439 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moderne (<1799)
- EAN : 9782406098058
- ISBN : 978-2-406-09805-8
- ISSN : 2258-3556
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-09805-8.p.0411
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 16/09/2019
- Langue : Français
Principes d’établissement
et d’édition du texte
Pour le texte de base, nous avons choisi l’édition Merlin de 1773, la seule parue du vivant de l’auteur à l’exception de la contrefaçon de Neuchâtel. L’« Explication de quelques termes de marine à l’usage des lecteurs qui ne sont pas marins » et les « Entretiens sur les arbres, les fleurs et les fruits », relégués en annexe par Aimé-Martin dans son édition des Œuvres complètes de 1818, y retrouvent leur place entre la Lettre XXVII décrivant le retour en France et la Lettre XXVIII et dernière « Sur les voyageurs et les voyages ». Il en est de même des illustrations de l’édition originale, dessinées par Jean-Michel Moreau le Jeune et, pour la « Vue des îles Canaries », par Bernardin de Saint-Pierre lui-même.
Depuis l’édition critique de Robert Chaudenson, il est difficile d’ignorer les prolongements et, dans plusieurs cas, les améliorations que les additions, rédigées par Bernardin de Saint-Pierre dans les années 1790 en vue d’une seconde édition considérablement augmentée du Voyage, apportent au texte de 1773. Impossible, d’ailleurs, de nier le sérieux et l’application avec lesquels l’auteur se consacre à ce projet et l’importance qu’il lui attache. L’intérêt que ces manuscrits autographes présentent pour la compréhension et l’appréciation du premier ouvrage imprimé de Bernardin de Saint-Pierre est donc indéniable.
Le degré d’achèvement de cette seconde édition n’en demeure pas moins douteux. C’est au moins ce que l’état des manuscrits conservés à la bibliothèque municipale du Havre nous a permis de conclure. Car il ne s’agit en aucun cas d’un texte suivi, mais plutôt d’un ensemble confus de feuillets, éparpillés à travers de nombreux dossiers et difficiles à dater. Vraisemblablement rédigés sur une longue période, allant au moins de 1790 jusqu’à 1796, ils ne traduisent pas l’intention de l’écrivain, qui ne s’astreint pas facilement à un plan rigoureux, mais plutôt l’évolution de ses intentions au fil des étapes rédactionnelles. À l’examen de ce corpus, il 412nous est vite apparu qu’une transcription diplomatique et la reproduction de l’ensemble de ces matériaux au sein de la présente édition du Voyage risqueraient de grossir le texte de référence au point de lui faire perdre ses contours et sa cohésion thématique. Bernardin de Saint-Pierre s’en est sans doute rendu compte lui-même, car il songeait, à partir d’un moment qui demeure difficile à dater, à réunir ses idées sur la colonisation et la colonie idéale dans une publication séparée1. On trouvera, au sein du présent volume, une première tentative de reconstruction de cet autre ouvrage à thématique coloniale, effectuée par Jean-Michel Racault sous le titre Sur l’esprit de colonie. Or, la découverte de ce nouvel ouvrage hypothétique simplifie et complique à la fois le rétablissement du texte augmenté du Voyage à l’île de France. D’un côté, de nombreux feuillets portant la mention « Voyage à l’île de France » mais qui ne s’y rattachent pas aisément, trouveront leur place dans ce nouveau regroupement. De l’autre, le besoin s’impose d’autant plus fortement de motiver les choix opérés lors du démarcage des limites des deux ensembles par des critères rigoureux, fidèles à la fois aux intentions de l’auteur et à la cohérence thématique et structurelle des deux ouvrages.
Commençons par les intentions. Pour reconstituer le texte de la seconde édition du Voyage, nous disposons de quelques outils de travail que Bernardin de Saint-Pierre nous a légués dans ses paratextes (les deux versions du « Premier Préambule », le « Préambule » et le « Prospectus d’une nouvelle édition »). Ceux-ci témoignent non seulement des motivations de l’auteur pour revenir sur son premier ouvrage imprimé, mais aussi de la méthode suivie lors de la révision de celui-ci. Or, dans le « Prospectus d’une nouvelle édition », le dernier en date de ces textes, on lit :
Je ne retrancherai rien [- du texte] de l’ancien texte, mais j’y ajouterai des morceaux de littérature qui y ont rapport et qui sont depuis longtemps dans mon secrétaire, des événements qui m’ont été personnels, [- des observations personnelles], des critiques sur les autres et [+ surtout] sur moi-même (Prospectus, voir l’annexe no 1).
Une telle approche rend le travail éditorial plus facile, pour Bernardin de Saint-Pierre comme pour nous, car elle permet d’utiliser comme base le texte de 1773 et ses découpages internes. Les additions doivent donc pouvoir s’insérer dans cette trame sous forme d’amplifications au sein 413d’un paragraphe, de passages plus longs intercalés entre deux paragraphes préexistants, ou de suppléments ajoutés au début ou à la fin des lettres, en guise de post-scriptum. Inspiré par une édition française du récit de la seconde expédition de James Cook2, Bernardin de Saint-Pierre nous signale jusqu’à la présentation matérielle qu’il réserve à ces ajouts : « Les lettres qui faisaient le cours du voyage, son journal, les observations auront des additions considérables, distinguées par une main d’indication3. » Visant à séparer les deux voix qu’on entendra dans l’ouvrage – celle de l’écrivain novice, et celle du Bernardin de Saint-Pierre mûri par l’âge et l’expérience – une telle présentation graphique est d’ailleurs en tout conforme au désir de ne rien retrancher du texte de l’édition originale.
Finalement, les deux versions du « Premier Préambule » que nous reproduisons dans l’Annexe donnent deux plans du nouvel ouvrage, détaillant les additions prévues : le plan archaïque du MS 34, fo 14 et une version plus élaborée dans MS 102, fo 46. Le « Prospectus d’une nouvelle édition » (MS 50, fo 1-2 r-v) qui leur est sans doute postérieur en reprend aussi quelques éléments. C’est armés de ces trois outils de travail, indicatifs des intentions de Bernardin de Saint-Pierre (méthode de révision, présentation des additions et les trois plans), que nous nous sommes attelés au travail de reconstruction de la seconde édition du Voyage à partir du fonds manuscrit de la bibliothèque municipale du Havre.
Ce fonds abrite un très grand nombre de feuillets portant la mention « Voyage à l’île de France ». La qualité inégale de l’encre et du papier et l’écriture changeante donnent à voir une rédaction discontinue. Les feuillets présentent, en outre, un degré d’aboutissement très varié, allant des additions ponctuelles et des fragments plus longs dont le point d’insertion est expressément indiqué par un renvoi à la pagination de l’édition originale4, aux ébauches et premiers jets qui, malgré le titre « Voyage à l’île de France », ne présentent pas de convergences thématiques explicites avec le texte de l’ouvrage imprimé. La diversité de ce corpus a nécessité un traitement modulé de ces différents types d’ajouts. Ainsi, les additions à renvoi retrouvent, sans peine, la place que Bernardin de Saint-Pierre leur a destinée au sein du texte, de même que les fragments plus longs contenant une indication descriptive de 414leur emplacement5. Aussi, dans un certain nombre cas, la thématique du feuillet le rattachait clairement à un passage précis de l’ouvrage6.
Quant aux additions que l’on ne pouvait insérer dans le texte de l’édition originale sans en perturber la lisibilité, nous les avons reproduites en Annexe, en suivant l’ordre du texte de base et la séquence des lettres auxquelles ces ajouts se rapportent7. Dans certains cas, la consultation des deux plans a également permis de déterminer leur place approximative dans la série d’annexes8. Aux côtés de ces additions potentielles, nous avons également reproduit dans l’Annexe quelques brouillons vraisemblablement rédigés lors du séjour de l’auteur à l’île de France9, des variantes10 et le « Prospectus d’une nouvelle édition du Voyage à l’île de France pour servir de suite aux Études de la Nature11 ». L’intérêt que ces Annexes présentent pour suivre le travail du texte étape par étape est multiple, car ils embrassent quelques premiers jets, des renseignements précieux sur le projet de réédition et des prolongements prévus et ébauchés mais inaboutis.
Nous rappelons que, selon les principes de l’édition, nous avons modernisé l’orthographe (à l’exception toutefois de celle des titres et citations d’autres auteurs), tout en conservant la ponctuation de l’édition originale. Au lieu des « mains d’indications » prévues par l’auteur, les additions à la nouvelle édition ont été données en italiques selon le protocole de transcription présenté à la suite de l’Avertissement du volume. Pour rappel, voici le code utilisé :
415–Passage raturé : [-]
–Passage raturé rétabli : [- +]
–Passage raturé illisible : [- ?]
–Surcharge : [+]
–Surcharge raturée : [+ -]
–Surcharge raturée rétablie : [+ - +]
–Lecture conjecturale : [?]
–Passage illisible : [? ?]
–Les paginations indiquées entre crochets sont celles du document.
Dans le cas de quelques passages peu lisibles, la confrontation avec les transcriptions qu’en a données Robert Chaudenson nous a été d’une très grande utilité.
Le texte du Voyage à l’île de France abonde en termes techniques maritimes, botaniques et zoologiques. De surcroît, bon nombre d’entre eux sont devenus archaïques ; d’autres sont des noms vernaculaires qui ne figurent pas dans les dictionnaires de l’époque. Enfin, la consultation d’ouvrages spécialisés modernes a permis d’établir jusqu’à quel point les noms vulgaires des plantes et des animaux étaient susceptibles d’évolution sémantique et de variation diatopique à travers les Mascareignes. Pour éviter de surcharger l’appareil critique, nous avons expliqué ces termes à leur première mention et les avons regroupés au sein d’un glossaire. Ont été exclus de celui-ci, les termes maritimes que l’auteur a expliqués lui-même, non sans une pointe d’humour, dans l’« Explication de quelques termes de marine à l’usage des lecteurs qui ne sont pas marins ». Pour ces termes, nous nous sommes contentés de confronter, en notes infrapaginales, les étymologies fantaisistes de Bernardin de Saint-Pierre à celles proposées par des dictionnaires modernes et de retracer, le cas échéant, les variations diachroniques que tel terme nautique a subies depuis le xviiie siècle.
1 Sur ce point voir Infra l’« Avant-Propos » de Sur l’esprit de colonie.
2 Cf. « Premier préambule », reproduit plus loin dans l’annexe no 2.
3 Ibid.
4 MS 7, fo 3, 8, 11 et 12 ; MS 34, fo 11 ; MS 58, fo 3-4 ; MS 82 fo 81 B29 et fo 88 B36 ; MS 123, fo 80-82 ; MS 147, foA 29 r-v.
5 MS 7, fo 3 « anecdote article lion. Cap de Bonne-Espérance » ; MS 7, fo 11 : « à ajouter à la fin de mon voyage autour de l’île » ; MS fo 13-14 « Premier préambule », « Avis sur cette édition » ; MS 58, fo 12 verso, mention « tout à la fin du 2e volume de mon voyage » ; MS 82, foA 38 : « Supplément aux animaux domestiques » ; MS 82 fo 40 A 40 (« après la table des latitudes » de la Lettre V) ; MS 82 A fo 50 « supplément aux habitants blancs » ; MS 82 fo 89 B 37 « supplément à la lettre 8 » ; MS 146, fo 105 B 24 : « Supplément à la lettre 19 au commencement. »
6 MS 82 A fo 19r « extrait du 2e livre de la navigation des Hollandais aux Indes orientales, relâche à l’île de France » ; MS 58, fo 1 « oiseaux à l’île d’Ascension » ou encore MS 7, fo 10, sans indication.
7 MS 58 fo 4 « arrivée à Lorient » ; MS 58 fo 12 recto « observations nautiques sur le Voyage à l’île de France ; pour le Tome 2 » ; MS 82 foA29 haut « Cet article avec celui des matelots ; Sur la société des gens de mers, après l’arrivée à l’île » ; MS 82 A fo 48v « Prêts d’arriver à l’île de France » ; MS 82, fo 84 B 32 « Lettre pour mettre vers la fin de mon voyage ».
8 MS 82 A fo 48 « Arrivée à l’île de France » ; MS 95 fo 7, « Mon arrivée à l’île de France ».
9 MS 82, foA23-24 ; MS 82, foB 96 B44.
10 MS 28, fo 14 ; MS 192, fo 7.
11 MS 50, fo 1-2r-v.