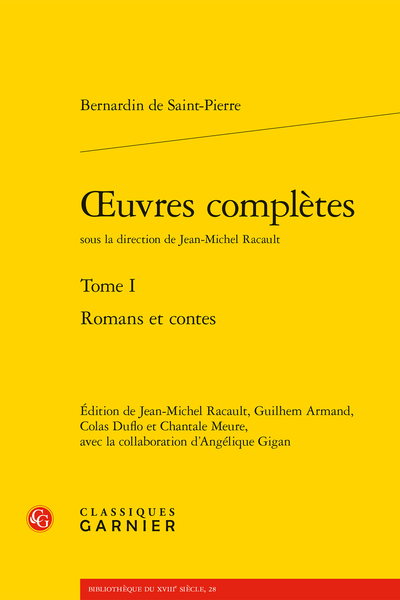
Glossaire
- Publication type: Book chapter
- Book: Œuvres complètes. Tome I. Romans et contes
- Pages: 1025 to 1031
- Collection: Eighteenth-Century Library, n° 28
- CLIL theme: 3439 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moderne (<1799)
- EAN: 9782812430886
- ISBN: 978-2-8124-3088-6
- ISSN: 2258-3556
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-3088-6.p.1025
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 12-16-2014
- Language: French
Glossaire
On trouvera ici tous les termes étrangers susceptibles de poser au lecteur des problèmes de compréhension. Les entrées correspondent aux transcriptions de Bernardin de Saint-Pierre que nous avons maintenues dans notre texte. Nous indiquons les principales variantes du terme ainsi que son origine le cas échéant. Nous citons, pour certains d’entre eux Bernardin de Saint-Pierre lui-même (Voyage à l’île de France) ou d’autres voyageurs (Bernier, Robert Challe, et des voyageurs figurant dans l’anthologie de Guy Deleury).
Arrack (Arak ou arac ou arack) : Nom de diverses eaux-de-vie.
Arecque (du malayalam adakka ; areca catechu (Linné) ; areque, arrec, arec, arek) : La noix de l’arécquier qui sert dans la préparation du bétel. « Espèce de noix muscade ; l’arécquier ressemble assez au cocotier, excepté que la tige est moins forte et les feuilles plus courtes » (La Flotte).
Badamier (Terminalia catappa) : Grand arbre ornemental dont les branches sont insérées par des étages successifs. Il produit un fruit violacé enfermant une amande comestible. Le terme est une francisation d’un emprunt à l’hindi.
Bananier (famille des musacées) : Arbuste vivace rhizomateux, aux très grandes feuilles textiles et fourragères, porteur d’une inflorescence polygame dont la partie femelle fructifie en un régime de bananes.
Bambou (bambula arundinacea) : Graminée gigantesque de l’Inde et d’autres pays chauds
Banian (hindoustānī baniyan, marchand ; ou arbre des banians, figuier des pagodes) : Figuier de l’Inde, remarquable par les racines adventives qui retombent de ses branches et qui contribuent à les soutenir et à les nourrir. Voir war, arbre de, que Bernardin donne comme autre appellation.
Bayadère : Femme indienne dont la profession est de danser devant les temples ou pagodes. « Leur véritable nom est dévédassi : celui de bayadères que nous leur donnons vient du mot balladeiras qui signifie en portugais danseuses » (Sonnerat)
Bazars (bazards) : Marché public en Orient.
Bengalis (Estrilda amandava) : Oiseau passériforme de la famille des Estrilidés, originaire de l’Inde. Le
plumage est rouge carmin chez le mâle, gris beige chez la femelle.
Bétel (du malayalam vettila, via le portugais betle ; Piper betel (Linné) ; betlay, betlé) : Ses feuilles mélangées à de la noix d’arec broyée et de la chaux servent à la confection d’une chique dont l’usage est très répandu et qui provoque une salivation rouge.
Beths (Bernier beths ou beds) : Désignent les quatre Vedas, textes sacrés très anciens, écrits en sanskrit, qui contiennent les Révélations de Brahma.
Bézoard (du persan pâdzehr) : Concrétion pierreuse gastrique des ruminants, réputée antitoxique, que l’on ramenait des Indes.
Brame (du sanskrit brâhmana que les Anglais transcrivirent brahmin ; brahmane, brahme, bramine) : Membre de la caste sacerdotale, première des quatre castes de l’Inde. Le brahmane est, par naissance, un être sacré, seul qualifié pour appliquer le Veda aux sacrifices et en enseigner la tradition. Son insigne est un cordon sacré, qu’il reçoit lors de son initiation.
Bramine ou brahmine : Fille ou épouse d’un brame. Le terme peut aussi être synonyme de brahmane. Bernardin l’emploie dans ce sens dans son Histoire de l’Indien.
Cafre (de l’ar. kafir, païen, infidèle ; Kafer, Kafier) : En principe, le terme désigne les habitants bantous originaires de la Cafrerie, sur la côte orientale du sud de l’Afrique. Le terme a donné en français aussi bien « cafre » que « cafard » (Alain Rey).
Caire : « Écorce du fruit du cacaotier servant à faire des cordes et des écorces » (Littré). Ici, vraisemblablement, la partie fibreuse qui entoure la coque enveloppant la noix de coco. « espèce de bourre qui entoure la noix de coco et qui sert au lieu de chanvre pour faire les cordes » (Cossigny)
Camphre, arbre de (laurus camphora) : Arbre de la Chine et du Japon dont on retire le camphre par distillation.
Caravansérail (de deux mots persans, qayrawān, caravane, et sarāy) : Habitation. En Orient, abri pour les voyageurs, hôtellerie.
Casy (ou casi) : Chef de la religion mahométane dans l’empire du Mogol.
Chitte (chite, du marathe chîte, par le portugais chita) : Toile de coton ornée de motifs. Bernier décrit ainsi l’intérieur d’une tente : « Elle était rouge par le dehors et doublée par le dedans de ces beaux chittes ou toiles peintes au pinceau de Machilipatnam, travaillés et ordonnés tout exprès avec des couleurs si vives et des fleurs si naturelles tirées de cent sortes de façon qu’on eût dit de quelques parterres suspendus. »
Cipaye (pers. sipâhi ou spahi) : Soldat indien au service des Européens dans les Indes.
Cocotier : « Un des arbres les plus utiles du commerce des Indes, cependant il ne sert guère qu’à donner de la mauvaise huile, et de mauvais câbles » (VIF).
Cophte (ou Copte) : Chrétiens monophysites d’Égypte dont le patriarche réside au Caire.
Couli (du tamoul kûli, salaire journalier ; coolie pour les Anglais ; Bernier : koulli, koully ou kuli) : Homme de peine, manœuvre.
Derviche (du persan derouisch, pauvre) :
Espèces de moines musulmans qui se livrent à la prière et aux soins des malades ; ils portent sur eux un chapelet
Deutas (deüta, deva ou devata) : Terme qui désigne les dieux des panthéons brahmaniques, védiques, hindous et bouddhiques. Le terme se trouve chez Bernier
Durion (famille des Bombacacees ou des Malvaceae ; durian, durio) : Grand arbre indonésien dont le fruit épineux, à odeur forte, contient une pulpe savoureuse.
Effendi (du turc efandi) : Maître, seigneur. Titre d’honneur et de dignité en Turquie.
Eunuque : Homme châtré employé à la garde des femmes en Orient. Le mot, anciennement, désignait un serviteur attaché à la chambre d’un prince sans pour cela qu’il fût émasculé.
Factorerie ou factorie (Bernardin écrit factorie) : « Siège des bureaux des facteurs d’une compagnie de commerce à l’étranger. Étym. Facteur, qui donne régulièrement factorie et non factorerie. Factorerie ne mériterait pas d’avoir l’usage pour lui » (Littré).
Faquirs (ou Fakirs ; ar. fakîr, pauvre) : Ascètes musulmans qui vivent d’aumônes. Voir santons.
Frangipanier : arbrisseau originaire d’Amérique, du genre plumeria, famille des apocynées, qui donne des fleurs délicatement parfumées disposées en cymes. En Asie, celles-ci servent d’offrandes aux divinités.
Frangui (Feringui, féringhi, Franguy Farangui ou Prangui) : Européens et Chrétiens. Depuis les croisades, le terme de « Franc » (en arabe Franj) était utilisé pour désigner les Européens occidentaux. Le terme est péjoratif. « Nom que les Indiens donnent à tous les Européens : un frangui est selon eux un homme sans naissance puisqu’il n’est lié par les lois d’aucune caste, sans politesse parce qu’il ne pratique pas le bel usage et la propreté comme le bain fréquent, sans délicatesse parce qu’il mange du bœuf et boit du vin » (La Flotte).
Foulsapatte : Le foulsapate marron ou mahot bâtard (Hibiscus boryanus) est un arbuste ou un petit arbre de la famille des Malvaceae, endémique des Mascareignes, présent à basse et à moyenne altitude, en forêt humide. Ses fleurs peuvent être rouges ou orangées. « Le foulsapatte, mot indien qui signifie fleur de cordonnier : sa fleur frottée sur le cuir le teint en noir. Cet arbrisseau a un feuillage d’un beau vert, plus large que celui du chaume, au milieu duquel brillent ses fleurs semblables à de gros œillets d’un rouge foncé ; on en fait des charmilles. Il y en a plusieurs variétés » (VIF, 130).
Gargoulette (ou gargouillette) : Sorte de vase.
Girofle : Le girofle est un bouton desséché de la fleur du giroflier qui sert de condiment (le fameux « clou de girofle »).
Guèbres (du persan gabr, infidèle) : Nom donné par les Musulmans aux Perses, qui, après la conquête arabe (viie siècle), restèrent fidèles au zoroastrisme. Les Guèbres sont des descendants des Perses dispersés dans toute l’Asie à la suite de l’arrivée des Arabes en Perse sous Omar au viie siècle. Ils sont appelés Parsis en Inde.
L’article de l’Encyclopédie, rédigé par Nicolas-Antoine Boulanger présente ainsi cette diaspora persécutée : « C’est le triste reste de l’ancienne monarchie persane que les califes arabes armés par la religion ont détruite dans le viie siècle, pour faire régner le dieu de Mahomet à la place du dieu de Zoroastre. Cette sanglante mission força le plus grand nombre des Perses à renoncer à la religion de leurs pères : les autres prirent la fuite, & se dispersèrent en différents lieux de l’Asie, où sans patrie et sans roi, méprisés et haïs des autres nations, et invinciblement attachés à leurs usages, ils ont jusqu’à présent conservé la loi de Zoroastre, la doctrine des Mages, et le culte du feu, comme pour servir de monument à l’une des plus anciennes religions du monde » (article « Guèbres »).
Jacquier (jaquier ; Artecarpus integrifolia) : Arbre de la famille des moracées, cultivé dans le Sud-Est asiatique et aux Antilles qui donne un gros fruit à odeur forte
Jaunet : Pièce d’or.
Jonque : Voilier d’Extrême-Orient, dont les voiles de nattes ou de coton sont cousues sur de nombreuses lattes horizontales en bambou.
Kaber-dar ! (khabar-dar !) : Prenez garde ! Cri traditionnel de la garde moghole
Kalmouks : Peuple asiatique qui forma le groupe des Mongols occidentaux, connus également sous le nom d’Oïrat (« confédérés »). À partir de 1435 environ, ils étendirent leur hégémonie sur la Mongolie et constituèrent un vaste empire qui allait du lac Balkach à la Grande Muraille de Chine (Mourre).
Karna : Sorte de cor ou de grande trompette. Bernier le présente comme un haubois « qui est long d’une brasse et demie et qui n’a pas moins d’un pied d’ouverture par le bas » Un concert de ces hautbois et de timbales « de cuivre ou de fer qui n’ont pas moins d’une brasse de diamètre » a lieu à certaines heures dans la grande cour de la forteresse de Delhi : « Jugez de là du tintamarre que cela doit faire » (Bernier).
Kétou : Voir « Ragou »
Korah (korrah, kora, korra) : Fouet.
Lascar (du pers. laskar, mercenaire ; laskar, lascari) : Matelot indien embarqué sur les navires de l’océan Indien.
Latanier (Latania lontaroïde) : Palmier endémique des Mascareignes dont les larges feuilles en éventail étaient parfois utilisées pour la couvertures des cases ou la confection des ajoupas (abris provisoires).
Litchis (letchis, famille des sapindacées) : Arbre chinois dont le fruit comestible rouge renferme une pulpe d’un parfum exquis et dont le bois sert en ébénisterie.
Lingam (du sanskrit linga, « signe ») : Symbole du culte de Shiva, probablement emprunté à un culte naturaliste antérieur, qui a la forme d’une colonne cylindrique ; emblème de la virilité.
Mangoustan ou mangoustanier (origine malaise, genre garcinia, famille des guttiferracées) : Arbre des pays chauds dont le gros fruit rouge est un comestible recherché et dont les graines fournissent le beurre de kokum.
Manguier (famille des Anacardiacées) : Arbre fruitier indien.
Maronites : Disciples de saint Maron, catholiques de rite syrien (jacobite), issu du schisme des monophysites. Ils émigrèrent au Liban dès le viiie siècle.
Masalchi (de l’arabe mash’al, torche ; Bernier : masalchi ou mashalchi ou mussaulchee) : Terme turco-hindi désignant un porte-flambeau.
Mogols : Souverains indiens issus de Tamerlan.
Mollah (arabe mawlā, seigneur ; molha ou mullā ou mullah) : Titre donné, dans les pays musulmans, aux personnes qui exercent des fonctions juridiques ou religieuses.
Mougris : « Le mougris est un jasmin dont la feuille ressemble à celle de l’oranger. Il y en a à fleurs doubles et simples ; son odeur est très agréable » (VIF, 131).
Nabab (ar. nabāb, pluriel de nabib, lieutenant) : Titre des princes de l’Inde musulmane (voir rajah).
Naïre (nayre, neyre, naher) : Caste noble, belliqueuse, de la côte Malabar.
Omrahs (Bernier, omerah ou umara) : Terme arabo-persan (pluriel de l’arabe amir, émir) désignant les nobles de la cour moghole.
Oschitel : Un répétiteur en Russie.
Padre (padry) : Père en portugais ; titre donné aux prêtres membres d’une congrégation religieuse, en particulier aux prêtres catholiques romains.
Pagode : Monnaie d’or des Indiens « de la valeur d’à-peu-près une pistole » (La Flotte) (elle vaut trois roupies ou trois roupies et demie d’après Julien Vinson, op. cit., Glossaire).
Palanquin (Paleky chez Bernier ; de l’Hindi Pâlki, du sanskrit palyanka « lit ») : Sorte de litière pour voyager soutenue par des tiges solides en avant et en arrière et portée par quatre ou six hommes.
Papa : Prêtre chrétien dans le Levant.
Pandect (ou pandit) : Titre honorifique que l’on donne dans l’Inde aux brahmanes érudits, et spécialement à ceux qui sont versés dans l’étude de la littérature sanskrite.
Parias (tamoul parayan, pl. paraiyar « joueur de tambour ») : Hors-castes des Indes considérés comme impurs.
Parsis : Sectateurs de la religion de Zoroastre dans l’Inde. Ce sont d’anciens Perses émigrés pour échapper aux persécutions des musulmans.
Pions (lat. pedo, -onis) : Homme de pied, fantassin. Soldats ou domestiques qui vont à pied en Inde (Littré).
Pois d’Angole (Cajanus cajan, syn. Cajanus indicus) : Espèce de plante vivace de la famille des Fabaceae. On le trouve aussi sous le nom de pois cajan, pois-congo ou ambrevade. Le pois d’Angole est une légumineuse à graine cultivée en agriculture pluviale dans les régions tropicales semi-arides.
Poivrier (famille des pipéracées) : Arbuste grimpant aux fleurs en chatons, dont le fruit séché est le poivre.
Ragou et Kétou : Noms de deux serpents qui se sont révoltés contre Vishnou et ont été décapités. La légende les associe à l’explication des éclipses.
Rajah ou raja (sanscr. rājā, d’un radical qui se retrouve dans le latin regere, d’où rex, roi) : Prince indien (voir nabab).
Rajpoutes : Cavaliers au service des rajas. Voici la définition qu’en donne
Bernier : « Ces rajpoutes, qui tirent ce nom des rajas, comme qui dirait fils de rajas, sont de père en fils des gens qui ne se mêlent que de porter l’épée. Les rajas, dont ils sont sujets, leur assignent des terres pour leur entretien, à condition d’être toujours prêts d’aller à la guerre quand on les mande, si bien qu’on pourrait dire que ce serait une sorte de noblesse gentille, si les rajas leur donnaient les terres en propriété pour eux et pour leurs enfants. »
Reispoutes ou raispoutes : Bernardin le donne comme un équivalent de « naïre » ou encore de « cipaye ». Voir ces mots.
Rotin (rotang) : Genre de la famille des palmiers, composé d’arbrisseaux vivaces, à tige grêle, pouvant acquérir dans le rotang à cordes une longueur de 300 mètres. C’est aussi la partie de la tige qui sert ordinairement de canne : « Leur maître [des nègres] se promenait au milieu d’eux, une pipe à la bouche et un rotin à la main » (Paul et Virginie).
Roupie (du sanskrit roupya, argent) : Unité monétaire principale de l’Inde. « Monnaie d’argent frappée au nom du prince ; la roupie sicca est la plus haute : sicca est proprement le coin pour frapper les roupies » (Law de Lauriston). En 1787, à la côte malabare, la roupie valait 51 sous, soit 2 livres tournois et 11 sous (d’après Deleury, Glossaire).
Salam (ou sâlam ; arabe çalam, hébreu Châlôm) : Salutation signifiant « paix » en arabe. Bernier décrit ainsi ce « salam ou salut à l’indienne » : « mettant trois fois la main sur la tête et l’abaissant autant de fois jusques en terre. »
Sandal (santal ou santalum) : Arbre recherché pour son bois qui contient une substance terpénique odoriférante, d’usage religieux, médicinal ou simplement aromatique, objet d’un commerce important. On s’en sert « pour faire une couleur, une teinture rougeâtre qui porte le même nom » (Trévoux). On l’utilise en cosmétique sous forme de poudre.
Sanskrit ou sanscrit (du sanscrit sāskrta, fait avec art ; samskrit, samskretan, samscrit, samscrutan, samskrita) : Langue indo-aryenne ancienne, dans laquelle sont composés notamment les textes sacrés de l’hindouisme. C’était une langue savante réservée aux prêtres et aux lettrés. On la trouve le plus anciennement dans les Veda. Sa découverte, à la fin du xviiie siècle, a donné naissance à la linguistique indo-européenne. Bernardin écrit « hanscrit », forme courante à l’époque.
Santons (de santo, saint) : Ascètes musulmans qui vivent d’aumônes.
Sati (orthographié « suttee » dans le MS 72) : Ce mot qualifie la veuve qui, en Inde, s’immolait rituellement sur le bûcher de son époux. Ce rite fut aboli en 1829.
Scheics (cheik ou Scheik, ar. scheikh) : Chef de tribu arabe.
Seidre (ou sèdre) : Docteur de la loi mahométane de la secte d’Ali. Bernardin fait suivre le terme indien de son équivalent « ou docteur de la loi ». C’est donc un théologien de la religion persane, une sorte de derviche. Le terme n’est pas passé en français. Kiran Kamath le signale comme un hapax.
Sensa-soulé : « On donne le premier rang au sensoutlé. Cet oiseau joint à l’éclat du plumage un chant si agréable, qu’on n’a pas cru pouvoir mieux le représenter que par son nom, qui
signifie cinq cents voix. Il est un peu moins gros que la grive et d’un cendré très-luisant, avec des taches blanches fort régulières aux ailes et à la queue. » (J. F. de la Harpe, abbé Prévost, Abrégé de l’Histoire générale des voyages, vol. 11, chap. 6, p. 220).
Stuc : Enduit qui imite le marbre utilisé pour orner l’intérieur mais aussi l’extérieur des habitations.
Tecque (du malayalam tekka ; tek, teque ou teck) : « Grand arbre de la famille des verbénacées, teka grandis, Lamk, tectona grandis, L, croissant dans l’Inde ; son bois, très léger, mais très solide, sert à la construction des vaisseaux et des maisons » (Littré).
Vertabiets (ou verbiests, vertabieds, vertabères) : Docteurs de la religion arménienne monophysite.
War, arbre de : Pour ce deuxième nom que Bernardin donne comme synonyme de figuier des banians, nous n’avons pas trouvé d’autres occurrences ailleurs que chez lui. Deleury se réfère à Bernardin en précisant l’origine du terme : « War (du sanskrit vat par le marathe vad) ou figuier des banians. »
Yogis (sansc. yogîn, qui est unifié ; yoguis, joguis) : Ascètes gymnosophistes. Bernier, dans sa « Lettre à Monsieur Chapelain » traite des faquirs, santons et yogis sans véritablement les distinguer. « Espèces de gueux nus comme la main sauf quelques loques qui leur couvrent la tête et dont la religion est le lingam. Leur chef passe parmi ses dévots comme une sorte de demi-dieu » (Anquetil-Duperron).