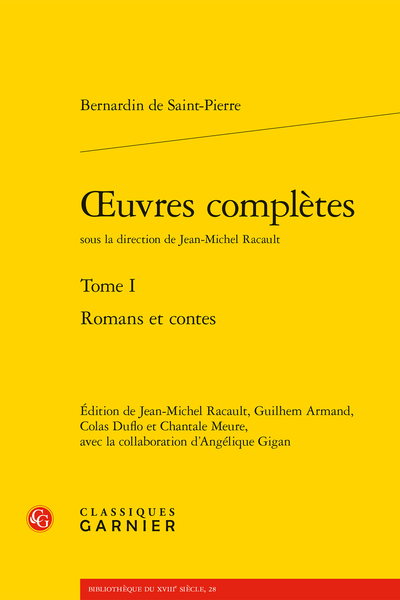
Bio-bibliographie de Bernardin de Saint-Pierre
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Œuvres complètes. Tome I. Romans et contes
- Pages : 19 à 32
- Collection : Bibliothèque du xviiie siècle, n° 28
- Thème CLIL : 3439 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moderne (<1799)
- EAN : 9782812430886
- ISBN : 978-2-8124-3088-6
- ISSN : 2258-3556
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3088-6.p.0019
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 16/12/2014
- Langue : Français
Bio-bibliographie
de Bernardin de Saint-Pierre
1737 : Naissance au Havre, le 17 janvier, de Jacques-Bernardin-Henri de Saint-Pierre. Selon le « Préambule » à l’édition de 1806 de Paul et Virginie, l’ordre originel des prénoms aurait par hasard été altéré sur la page de titre de la première édition des Études de la Nature (1784) : Bernardin, placé en troisième position, aurait été considéré à tort comme un élément du patronyme, devenant ainsi auprès du public le nom de plume de l’écrivain, lequel aurait entériné ce qu’il considère comme une « adoption1 ».
Il est le fils aîné du directeur des Messageries du Havre et de son épouse Catherine Godebout. Deux frères, Dominique (« le Marin »), navigateur (engagé semble-t-il dans la traite des Noirs), et Dutailli (« le Gendarme »), militaire, ainsi qu’une sœur, Catherine, qui restera vieille fille et passera sa vie dans des maisons religieuses à la charge de ses frères. Famille de petite bourgeoisie, mais prétentions nobiliaires : une légende familiale sans fondement la fait descendre d’une lignée aristocratique de Lorraine, voire d’Eustache de Saint-Pierre, l’un des « bourgeois de Calais ». Jusqu’au milieu des années 1780, Bernardin se prévaudra du titre de chevalier, auquel il n’a aucun droit, avant de reconnaître sa naissance « honnête mais commune » et de se faire le porte-parole du Tiers État dans les Vœux d’un solitaire (1789).
1747 [?] : Lecture de Robinson Crusoë et de La vie des Saints. Bernardin, vivement frappé par la biographie légendaire de saint Paul Ermite attribuée à saint Jérôme (il sera le saint patron du héros de Paul et Virginie), fait une fugue après une réprimande, « croyant fermement que Dieu [le] nourrirait dans les bois, en [lui] envoyant un corbeau, comme à un autre saint Paul ».
1749 : Afin de ramener au sens du réel cet enfant nerveux et rêveur, son père le confie à son oncle, le capitaine Godebout, pour un voyage à la Martinique. Échec : « Je déteste la mer […] Je pensai mourir du mal du pays. »
1748-1756 [?] : Études au collège, d’abord à Gisors, puis chez les Jésuites à Rouen et à Caen. « Il m’en resta une haine des prêtres » : Bernardin est frappé par la contradiction entre « la douceur des maximes de la religion » et l’« inhumanité » de ses représentants. L’héritage de ces mauvais traitements sera une inaptitude marquée à l’existence collective et un fond tenace d’anticléricalisme. Mort de sa mère, remariage de son père, mésentente avec sa belle-mère.
1756-1758 : Succès scolaires (prix de mathématiques), entrée à l’université de Caen (études de philosophie et de sciences), admission à l’école des Ponts et Chaussées à Paris, où il reçoit le titre d’élève contrôleur, « ce qui est un degré pour être sous-ingénieur ». Apprend les mathématiques et le dessin des plans.
1758-1759 : La guerre de Sept Ans entraîne le licenciement de sa promotion. Malgré son cursus scolaire inachevé, Bernardin aurait reçu un diplôme d’ingénieur militaire (à la suite d’une erreur des bureaux selon Aimé-Martin). Début d’une douzaine d’années d’errances. Tout à tour officier, agent diplomatique, courtisan, apprenti littérateur, Bernardin s’inscrit dans le modèle des aventuriers des Lumières.
1760 : Première campagne en Allemagne comme ingénieur surnuméraire dans l’armée du comte de Saint-Germain. Assiste à la bataille de Corbach. Une « affaire d’éclat » l’oppose à son chef et entraîne sa radiation, l’obligeant à « renoncer pour toujours à ce corps et à ce genre de service » : les affectations ultérieures de l’intéressé (qui pourtant se prévaut du titre de « Capitaine-ingénieur du Roi » sur la page de titre du Voyage à l’île de France en 1773) se situeront à l’étranger ou dans les colonies. Démarches à Versailles.
1761 : Obtient un poste d’ingénieur à l’île de Malte, menacée par une invasion turque. Querelle avec les ingénieurs ordinaires, qui ne reconnaissent ni son diplôme ni son titre de chevalier. Début du ressentiment contre les « corps », rendus responsables de l’ostracisme dont il estime être victime. Retour à Paris.
1762 : Vaine recherche d’un emploi militaire. Sans ressources, se dirige vers la Hollande avec l’intention de s’engager au service du Portugal, en guerre contre la Russie. À La Haye, secouru par le journaliste Jacques Mustel (1713-1771), directeur de la Gazette d’Amsterdam, qui lui propose un emploi dans son journal et même la main de sa belle-sœur. Bernardin lui rendra hommage en donnant son nom au vieillard narrateur dans la première
version de Paul et Virginie. Rejoint à Lübeck le commandant de la place, le chevalier de Chazot, qui lui a promis un emploi d’ingénieur pour affronter une prochaine invasion russe. Mais la signature de la paix ruine ses projets. Sur le conseil de Chazot et avec ses lettres de recommandation, passe en Russie. Arrivé à Saint-Pétersbourg fin septembre avec trois ducats en poche, apprend que la Cour se trouve à Moscou. Mais le maréchal de Munnich, gouverneur de la ville, et le joaillier de l’Impératrice, le Genevois Duval (futur destinataire des lettres du Voyage à l’île de France), lui viennent en aide.
1763 : À Moscou, Bernardin, qui est recommandé au général du Bosquet, responsable du corps du Génie, et, au Grand Maître de l’Artillerie, Villebois, connaît une ascension rapide. Nommé lieutenant-ingénieur puis capitaine, il effectue à ce titre une visite d’inspection des places fortes de Finlande en compagnie de son supérieur. À la Cour, il est distingué par Catherine II, qui l’aurait « honoré de ses bontés particulières » (Aimé-Martin suggère sans preuves que Villebois aurait tenté de le pousser dans les bras de l’Impératrice pour contrer le pouvoir croissant d’Orloff, le favori du moment). Mais la disgrâce de Villebois met un terme à sa carrière.
Rédaction des premiers textes connus de Bernardin, les Observations sur la Finlande et un Projet d’une compagnie pour la découverte d’un passage aux Indes par la Russie. Ce mémoire remis à l’Impératrice est à la fois un essai géopolitique et un programme utopique d’implantation d’une république idéale située près de la mer d’Aral.
Vers cette époque ou un peu plus tard, commence à rédiger un « roman russe » inachevé, l’Histoire de la Régente Anne [Anne de Brunswick, régente de Russie], qui comporte des épisodes américains situés sur les bords de l’Amazone, et recueille les matériaux du manuscrit de l’Histoire de l’Indien, dont la partie russe est une autobiographie à peine transposée.
1764 : Disgrâce. Avec cinq cents francs prêtés par Duval et dix-huit cents livres gagnées au jeu, Bernardin part brusquement pour la Pologne, probablement à l’instigation du baron de Breteuil, ambassadeur de France en Russie, à un moment où les relations entre les deux pays sont particulièrement tendues, se disant « enchanté d’y trouver des citoyens qui combattaient pour leur liberté contre les Russes à qui je voulais faire regretter ma perte ».
Début de la correspondance avec le diplomate Pierre-Michel Hennin (1728-1807), le plus fidèle des correspondants de Bernardin (environ 260 lettres) et le principal de ses protecteurs. Comme beaucoup de ces derniers (notamment Vergennes, le comte de Broglie, le baron de Breteuil), Hennin, Résident de France à Varsovie, puis à Genève, ensuite premier commis aux Affaires
Étrangères, est un membre important du « Secret du Roi », le service de diplomatie parallèle de Louis XV, dont l’objectif (qui échoua) était alors de favoriser l’élection du prince de Conti au trône de Pologne en s’appuyant sur le clan Radziwill contre le clan Poniatowski (soutenu par la Russie).
Vraisemblablement recruté par Breteuil, Bernardin semble avoir joué un rôle dans les intrigues compliquées entre les deux factions, entrant notamment en contact avec la princesse Marie Lubomirska (ou Marie Miesnik), épouse répudiée du prince Radziwill et maîtresse de l’agent du Secret Durand de Distrof. Les lettres cryptées qu’elle échange avec Bernardin ne permettent guère de préciser la nature de leur relation, purement politique ou aussi amoureuse. Toutefois divers documents (dont une lettre à Hennin du 12 avril 1780) éclairent rétrospectivement l’aventure de Pologne : en quittant la Russie pour se mettre à la disposition de la faction polonaise opposée aux Russes, il a encouru la colère de ces derniers et risqué la déportation en Sibérie en cas de capture, car « c’est chez eux un crime d’État de passer de leur service à celui de leurs ennemis » ; ce qui eût pu lui arriver lorsqu’il fut arrêté le 29 juin 1764.
1765 : Mystérieux et décevant voyage à Vienne en début d’année. Il semble que l’ambassadeur de France Chatelet-Lomond lui ait refusé l’emploi attendu pour prix de ses services. Grâce aux secours financiers de Hennin, nouveau départ brusqué de Varsovie pour Dresde en mars 1765. Aurait obtenu un poste d’aide de camp de l’Électeur de Saxe à la cour de Dresde. En juin, il est à Berlin. Sollicite une audience auprès de Frédéric II, lequel lui aurait proposé un poste de capitaine-ingénieur qu’il aurait refusé. Le conseiller Taubenheim le prend sous sa protection ; il lui aurait offert la main de sa fille Virginie (?). Début d’une amitié fidèle et d’une longue correspondance. Selon Souriau, c’est l’appartenance à la franc-maçonnerie (non formellement attestée) qui expliquerait le don étonnant de Bernardin pour trouver partout secours, protecteurs et amis.
En novembre, retour à Paris, sans emploi et démuni. Son père meurt le 10 décembre. Séjour en Normandie ; mais l’héritage lui échappe ; le testament l’oblige même à rembourser à sa belle-mère ses frais d’éducation et d’études.
1766 : Vie difficile à Paris dans divers hôtels meublés. S’isole à Ville-d’Avray pour rédiger à l’intention des bureaux ses « Observations sur le Nord » (il s’agit des Voyages en Hollande, en Prusse, en Pologne et en Russie publiés par Aimé-Martin dans les Œuvres complètes posthumes). Marie Miesnik, avec qui se poursuit une correspondance de ton plus froid, l’engage à les
confier à un certain « M. Durand », commis des Affaires Étrangères, dont il comprend trop tard qu’il s’agit d’un ancien amant. Poliment éconduit, effectue de vaines démarches auprès de divers diplomates (Hennin, Choiseul, Dubucq, Breteuil) pour trouver un emploi.
1767 : Pour retenir l’attention des bureaux, compose une chronologie des principaux États d’Europe et un Mémoire sur la désertion destiné à Choiseul. Première ébauche du système du monde qui sera développé dans les Études et les Harmonies de la Nature : « J’ai formé un système si hardi, si neuf et si spécieux que je n’ose le communiquer à personne » (lettre à Hennin du 9 juillet 1767).
Suivant partiellement les conseils de son ami Hennin, qui l’incite à devenir un « riche colon » plutôt qu’un « militaire malaisé », envisage un départ dans les colonies. Par l’entremise de Breteuil et d’un autre « ancien » de Russie, le diplomate Rulhière, il est enfin commissionné capitaine-ingénieur du Roi, à l’île de France officiellement, en réalité à Madagascar, où il doit participer à une expédition tenue secrète afin de rétablir l’ancien comptoir de Fort-Dauphin abandonné depuis 1674, sous le commandement du comte de Maudave, « habitant » ruiné de l’île de France et concepteur d’un plan de colonisation « éclairée ». Bernardin, qui l’accusera plus tard d’avoir « abusé les premiers commis pour se procurer des Noirs à bon marché », est séduit par l’aspect philanthropique du projet : il établit des plans de gouvernement idéal et s’abandonne à ses rêveries utopiques, s’imaginant, à l’instar de « Télémaque au milieu du désert de l’Égypte », dans un rôle de civilisateur et de législateur des peuples sauvages.
1768-1769 : Embarquement à Lorient le 20 février 1768 à bord du Marquis de Castries. Avant même le départ, s’est brouillé avec Maudave, « homme de beaucoup d’esprit mais très méchant ». Arrivé au Port-Louis de l’île de France le 14 juillet 1768 après un voyage éprouvant, refuse de le suivre à Madagascar, fort du brevet qui l’affecte officiellement sur place, échappant ainsi aux fièvres qui frappèrent l’expédition (11 morts sur les 15 membres du détachement de reconnaissance du territoire d’Amboule, dont l’aventurier et homme de lettres Lamarche-Courmont, autre « ancien » de Pologne). « Si l’on m’eût envoyé avec M. de Modave, il est probable que j’aurais été de ce détachement. Il y a onze à parier contre quatre que j’y serais resté » (lettre à Hennin du 22 janvier 1769).
L’arrivée à l’île de France coïncide avec les débuts de la « royalisation » des îles Mascareignes, rétrocédées au gouvernement royal par la Compagnie des Indes, dont la gestion a été un échec. Une structure administrative
bicéphale est mise en place : un gouverneur général (Dumas, puis Desroches), investi du pouvoir politique et militaire, un intendant (Pierre Poivre), chargé des finances et de l’économie, dont les relations sont exécrables. Hiérarchiquement dépendant du premier mais ami et protégé du second, Bernardin est dans une position fausse. Ingénieur surnuméraire hors cadre, placé en demi-solde (2400 livres par an au lieu de 4000), il est relégué dans des fonctions subalternes mais peu absorbantes de « maître maçon ». Dépression, ennui, sentiment d’exil, difficultés financières (le coût de la vie dans l’île est prohibitif), relations difficiles avec l’ingénieur en chef et avec les gouverneurs successifs. En menant une « vie pythagorique » (au régime végétarien) et à force d’économies, il parviendra cependant à rembourser une partie de ses dettes. Un grand voyage à pied (août-septembre 1769) lui donne une vision plus positive de l’île, dont il fait le tour.
Il se lie avec Poivre, qui l’initie à la botanique, et surtout avec sa jeune épouse Françoise Robin (27 réponses de cette dernière, mais les lettres de Bernardin n’ont pas été retrouvées). Amitié amoureuse ou tentative de séduction ? Très discret sur le couple Poivre dans la version imprimée du Voyage, Bernardin indique dans les ajouts manuscrits postérieurs un refroidissement de l’Intendant à son égard et en laisse entrevoir les raisons : « Peut-être aussi ai-je eu apparence d’avoir quelque tort, mais je n’en ai eu aucun de réel. »
En novembre 1768, relâche à Port-Louis de l’expédition de Bougainville autour du monde. Rencontre Bougainville, le botaniste Commerson, le Tahitien Aotourou. Entretien sur les mœurs des Tahitiens avec le navigateur. Bernardin n’adhère pas sans réserve au mythe sensuel de la « nouvelle Cythère » polynésienne.
Importante activité d’écriture. Rédaction probable des Voyages de Codrus (autobiographie transposée) et de divers manuscrits sur la politique coloniale, l’Inde, Madagascar, la traite des Noirs et l’esclavage (positions anti-esclavagistes proches de celles de Poivre). Premières ébauches du futur Voyage à l’île de France et peut-être de ce qui deviendra Paul et Virginie : un plan non daté en quinze lettres s’achève sur l’« Histoire de Melle de La Tour », vraisemblablement à ce stade un bref récit anecdotique.
1770 : Mauvaises relations avec le nouveau gouverneur Desroches, qui souhaite l’affecter à l’île Bourbon (La Réunion) où l’on a besoin d’un ingénieur civil. Après de vaines démarches pour passer dans l’Inde, demande à Breteuil son retour en France et l’obtient ; le 19 septembre 1770, Desroches entérine la lettre de Breteuil en faveur de son départ (« Le consentement qu’il donne à votre retour en France achève de me déterminer au parti que
vous désirez »). Toutefois les conditions administratives dans lesquelles celui-ci s’effectue paraissent floues. Retraçant sa carrière à l’île de France, il indiquera plus tard avoir « reçu l’ordre et non le congé d’en partir ». Il résulte des correspondances ultérieures que ce départ a pu être interprété par l’Administration comme une démission privant l’intéressé de ses droits à pension. Pendant une quinzaine d’années Bernardin multipliera les démarches pour obtenir ce qu’il estime lui être dû.
Embarque le 9 novembre à bord de L’Indien. Escale de six semaines à l’île Bourbon. À Saint-Denis, reçoit l’hospitalité du commissaire-ordonnateur Crémont, ami et adjoint de Poivre. L’Indien (où se trouvent ses effets) ayant été chassé par un ouragan, obtient difficilement un passage sur La Normande en direction du Cap.
Le bref séjour à l’île Bourbon, particulièrement le tableau de la vie patriarcale des « anciens habitants de Bourbon », source inspiratrice de celle des deux familles dans la concession de Paul et Virginie, nourrira pendant des années l’imaginaire de l’auteur, servant de substrat à diverses ébauches d’utopies coloniales restées inédites.
1771-1772 : Longue escale au Cap (du 17 janvier au 2 mars 1771) dans l’attente d’un passage vers l’Europe. Cette colonie hollandaise, vue sous un jour idyllique contrastant avec l’image très négative de l’île de France, offre une autre forme d’utopie coloniale. Grâce à l’aide financière du Conseiller Berg, qui lui a ouvert sa bourse, embarque sur la flûte La Digue.
Retour en France début juin 1771. Par l’entremise de Rulhière, fait la connaissance de Rousseau et va lui rendre visite rue Plâtrière fin juin. Début de relations suivies, traversées d’humeurs et de brouilles, qui se poursuivront presque jusqu’à la mort de Rousseau en 1778 ; compagnon de ses promenades aux environs de Paris et confident de ses projets littéraires (notamment la trame d’Émile et Sophie ou les solitaires, connue principalement grâce à son témoignage), Bernardin fera figure dans l’opinion de légataire moral de sa pensée.
Parallèlement, sans doute dès fin 1771, entre en contact avec d’Alembert et Melle de Lespinasse, dont il fréquente le salon. En froid avec Breteuil, qui l’a hébergé à son retour à Paris mais ne lui a pas proposé l’emploi qu’il espère, Bernardin s’appuie sur les milieux encyclopédistes et « philosophiques » : Condorcet et d’Alembert multiplieront les interventions en sa faveur pour lui trouver un éditeur, lui faire obtenir une gratification, le recommander à Turgot…
Un voyage en Bretagne (Vitré) en 1771, un autre à Rennes en 1772, liés peut-être à des projets de mariage.
1773 : Grâce à d’Alembert, publication chez Merlin en janvier du Voyage à l’île de France, ébauché sur place (Mme Poivre en a lu des fragments) à partir des lettres envoyées à Duval. Non seulement l’auteur n’a pu obtenir du Ministère la prise en charge des frais d’impression, mais il a dû accepter quelques coupes imposées par la censure sans pour autant obtenir le privilège : il doit se contenter d’une permission tacite. L’ouvrage, qu’il qualifie abusivement de « grand succès littéraire », se vend mal. Un différend financier avec l’éditeur conduit à une violente algarade et à un procès. Sa modération dans cette affaire lui vaut l’ironie de ses amis et une remarque humiliante de Melle de Lespinasse dont il est vivement affecté.
Il reçoit cependant une gratification de 1000 livres, annuellement renouvelable. Elle lui sera continuée par Turgot.
1774-1778 : Années difficiles marquées par les difficultés financières, la vaine recherche d’un emploi et une activité d’écriture importante mais inaboutie. N’ayant reçu pour toute proposition de son ancien protecteur Breteuil que l’offre de retourner à l’île de France, Bernardin multiplie les démarches pour faire valoir ses droits à pension et cultive des amitiés utiles comme celle de la famille de Keralio (de l’École Militaire), de Mesnard (premier commis du Contrôleur des finances, donc bien placé pour l’attribution des pensions), de Mme Necker (épouse du financier et animatrice d’un salon prestigieux). Il propose aux ministères de mirifiques projets ; par exemple au ministre de la Marine un plan de voyage d’exploration de l’Asie par voie de terre jusqu’à l’Indus avec retour par la mer Rouge (août 1774), ou par l’entremise de Necker un voyage d’étude en Corse (mars 1778).
Rêves de riche mariage et relations féminines diverses (Louise de Kéralio, Mme Challe, épouse du peintre…).
Nombreux opuscules restés manuscrits ou ébauches inachevées. L’Éloge historique de mon ami – son chien –, pastiche des éloges académiques, n’amuse pas d’Alembert, spécialiste du genre. Le « mysticisme monarchique » (Souriau) de sa réponse à Helvétius intitulée De la royauté et des rois contribue à l’éloigner des Encyclopédistes, de même que ses bouffées de nostalgie religieuse (retraite à la Trappe à l’occasion d’un voyage en Normandie, 1775). En 1777, concourt infructueusement au prix d’éloquence de l’Académie de Besançon avec un Discours sur l’éducation des femmes. La même année vraisemblablement, lecture publique sans succès d’une première version de Paul et Virginie (intitulée Histoire de Mlle Virginie de La Tour) dans le salon de Mme Necker, laquelle critique particulièrement la « morale ennuyeuse et commune » de l’entretien entre Paul et le vieillard.
Vivement affecté par l’annonce de la mort de Rousseau le 2 juillet 1778 à Ermenonville, où il s’est installé à l’invitation du marquis de Girardin. Bernardin, qui lui en veut de ne l’avoir pas averti de son départ de Paris, commence cependant la rédaction de l’Essai sur J.-J. Rousseau. Pauvreté et solitude : démarches vaines auprès des bureaux, troubles nerveux, agressivité et aigreur. Hennin se plaint des missives « dures et injustes » de son ami et ajoute : « Comme le malheur vous a changé ! » (lettre du 13 août 1778).
1779-1783 : Début en 1779 de l’affaire Dutailli, frère de Bernardin, capitaine d’infanterie à Saint-Domingue passé au service des Insurgents d’Amérique, accusé de trahison au profit de l’Angleterre et embastillé. Bernardin remue ciel et terre en sa faveur, rédige un mémoire tendant à l’innocenter, fait jouer toutes ses relations, à commencer par d’Alembert. À partir de 1783, Dutailli donne des signes flagrants de dérangement mental (mégalomanie, délire de persécution). Il devra être interné dans des maisons religieuses aux frais de son frère jusqu’à sa mort, le 23 octobre 1791.
Supposant qu’« il y a dans la finance assez d’emplois lucratifs qui ne demandent aucun talent, et qui donnent assez de loisir pour cultiver les [siens] », sollicite Necker sans résultat par l’entremise de sa femme pour des projets d’établissement de colonies agricoles en France, puis en Corse. Un long mémoire justificatif adressé à Mme Necker en réponse aux griefs qui lui sont adressés (inconstance, susceptibilité, méfiance, oisiveté) reste sans réponse, entraînant la rupture avec les Necker vers la fin 1780 (lettre à Hennin du 11 novembre 1780).
Quémandeur mais orgueilleux, Bernardin refuse avec hauteur une gratification sur les fonds réservés aux indigents des Lettres – initiative malheureuse de Hennin –, ce qui provoque la colère de Vergennes, avant de se résoudre à l’accepter après avoir exigé et obtenu que la somme lui soit attribuée non comme un secours, mais au titre de ses services passés en Pologne. Cette affaire, qui prend un tour obsessionnel, occupe la correspondance échangée avec Hennin fin 1780-début 1781. En mars 1783, obtient un nouveau secours de 1000 livres.
Parallèlement, abandonne le projet de récit utopique de L’Amazone (qui sera repris sur de nouvelles bases après la Révolution) et travaille à un « roman archéologique » imité du Télémaque, L’Arcadie. Met aussi en ordre les matériaux destinés aux Études de la Nature.
1784 : Publication en juin des Études de la Nature, achevées en décembre 1783. Hennin a accepté d’avancer les frais d’impression. Excellentes ventes : « Quelque bon vent me pousse » (lettre à Hennin du 12 décembre).
1785 : Le vif succès des Études débloque la situation administrative de Bernardin : le maréchal de Castries lui demande un mémoire de ses services à l’île de France afin de lui faire accorder une pension de capitaine-ingénieur. Toujours aussi sourcilleux, Bernardin refuse une pension royale de 200 livres car elle n’est pas accompagnée d’une lettre personnelle du ministre – au risque de déplaire à Breteuil, qui est à l’origine de cette faveur.
1786 : Seconde édition des Études. Bernardin achète une petite maison dans le quartier des Gobelins et règle scrupuleusement ses dettes ; il demande à Hennin de retrouver la trace d’un certain Vignon à qui il a emprunté 100 livres vingt-quatre ans plus tôt alors qu’il était élève de l’école des Ponts et Chaussées. Pluie de pensions et gratifications (du Roi, du Ministère de la Marine, du Ministère des Affaires Étrangères, du duc d’Orléans, etc.). Célébrité et aisance matérielle.
1788 : En mars, publication de la troisième édition des Études, augmentées d’un quatrième tome où figurent l’édition originale de Paul et Virginie et celle de L’Arcadie (limitée au seul livre I, « Les Gaules »), que précède un long « Fragment servant de préambule ». L’ensemble est accompagné d’un « Avis » liminaire consacré au système des marées et des courants marins, objet de nombreuses polémiques dans la presse, qui semble être aux yeux de l’auteur le principal apport de ce quatrième tome des Études. Refroidissement des relations épistolaires avec Hennin.
1789 : La publication d’une édition séparée illustrée de Paul et Virginie amplifie le succès de l’œuvre. Nombreuses contrefaçons, vigoureusement dénoncées par l’auteur dans la presse et dont il s’efforce de limiter les effets. La célébrité européenne du roman est confirmée par les adaptations théâtrales (la première est celle de l’opéra-comique de Favières sur une musique de Kreutzer, représentée à la Salle Favart le 15 janvier 1791) et les traductions en diverses langues (la première en anglais dès 1789 sous le titre Paul and Mary, an Indian story). Nombreuses lettres d’admiratrices, et même des propositions de mariage.
Bernardin, dont les positions anti-esclavagistes sont connues depuis le Voyage de 1773, est sollicité par Mme Condorcet pour devenir le secrétaire de la Société des Amis des Noirs. Correspondance avec Brissot, créateur de la Société. Toutefois Bernardin s’abstient d’y adhérer.
Quoique fervent monarchiste et ennemi du désordre, accueille d’abord avec faveur la Révolution. L’ex-« chevalier de Saint-Pierre », devenu, depuis la conversion intérieure à la solitude et le renoncement à la vanité et à l’ambition relatés dans le préambule à L’Arcadie, le porte-parole officieux
du Tiers État dans sa lutte contre les corps privilégiés, fait sensation en septembre 1789 en publiant les Vœux d’un solitaire. Vif succès.
1790 : Correspondances et amitiés féminines (Jane Dalton, traductrice de Paul et Virginie ; Lucette Chappel, autre Britannique ; Mme de la Berlière ; Mme de Boisguilbert…). Controverses scientifiques sur la théorie de la Terre : contre la cosmologie newtonienne, défend la thèse de l’allongement de la Terre aux pôles et l’explication des marées par la fonte alternée des glaces polaires, déjà exposée dans la troisième édition des Études.
Publication à la fin de l’année du conte philosophique La Chaumière indienne, de nouveau avec un vif succès. Commence à travailler à une nouvelle édition très augmentée du Voyage à l’île de France.
1791 : Dernière lettre à Hennin le 1er janvier (pour accompagner l’envoi de La Chaumière). Publication au début de cette année (ou fin 1790 ?) de la Suite des Vœux d’un solitaire, où l’auteur se justifie de son choix apparent du retrait politique, mais prend position sur les problèmes coloniaux et sur l’esclavage. Travaille à Empsaël (commencé vers 1771 ?), drame d’inspiration anti-esclavagiste.
1792 : Inquiet face aux événements révolutionnaires, lance le 14 juillet 1792 une Invitation à la concorde pour la fête de la Confédération. Élu malgré lui à la Convention le 4 septembre (mais il n’était pas candidat), s’empresse d’en démissionner. En juillet, sa notoriété de « savant » (auprès du public sinon des spécialistes) lui vaut d’être désigné par Louis XVI comme Intendant au Jardin royal des Plantes, où il succède à Buffon. Les historiens s’accordent à reconnaître qu’il remplit ses fonctions avec conscience et efficacité, obtenant notamment la création d’une ménagerie demandée en octobre 1792 dans son mémoire Sur la nécessité de joindre une ménagerie au Jardin des Plantes de Paris.
Quatrième édition des Études, augmentée d’un cinquième volume comportant les Vœux d’un solitaire, La Chaumière indienne et Le Café de Surate.
1793 : Son poste est supprimé, mais une compensation financière lui conserve son traitement (juin). Retiré à la campagne, à Essonnes, et tout occupé par son récent mariage (27 octobre) avec Félicité Didot, la fille de son imprimeur, traverse apparemment sans les voir les orages révolutionnaires.
1794 : Naissance de sa fille Virginie. Le 4 février, abolition officielle de l’esclavage par la Convention, mais la décision se heurte à une situation révolutionnaire aux Antilles et au rejet des colons aux Mascareignes. Il s’abstient dorénavant de prises de positions publiques sur la question.
Création de l’École Normale par la Convention. Bernardin y est nommé professeur de morale républicaine. Toutefois, son cours, commencé dans l’enthousiasme en janvier 1795, surprend et déçoit l’auditoire par son optique déiste et par la bizarrerie de ses thèses scientifiques : le manuscrit (MS 170, fo 1-29) intitulé Essais sur les harmonies de la nature pour servir aux éléments de la morale et aux instituteurs des écoles primaires constitue une première ébauche des futures Harmonies.
1795-1797 : après la fermeture de l’École Normale (il a cependant conservé son traitement), est nommé à l’Institut. Guerre ouverte avec les matérialistes athées héritiers des Encyclopédistes et plus tard les Idéologues, qui y sont majoritaires. Il y mènera une longue lutte en faveur des thèses déistes, du système des marées et, sur un autre plan, de la protection du droit d’auteur.
En 1796, lance une souscription pour les Harmonies de la Nature et une autre pour une seconde version très augmentée du Voyage à l’île de France de 1773, à paraître « en Nivôse An V » (décembre 1796 ou janvier 1797). Elle ne verra pas le jour, peut-être en raison du revirement de l’opinion sur la question de l’abolition de l’esclavage et du traumatisme collectif des événements de Saint-Domingue.
Travaille à la nouvelle version de L’Amazone, dans laquelle le programme utopique de communauté idéale se greffe sur un roman de l’émigration. L’ensemble demeurera inachevé (publication posthume par Aimé-Martin dans les O.C.).
1798 : Naissance de son fils Paul. Procès entre les héritiers de la succession Didot. Bernardin défend ses intérêts avec âpreté. Publication du bref opuscule De la nature de la morale.
1799 : Mort de Félicité Didot, atteinte depuis plusieurs années d’une « maladie de langueur ». Doit s’occuper seul de deux jeunes enfants.
1800 : Remariage (à 63 ans) avec une jeune pensionnaire de vingt ans, Désirée de Pelleporc. Malgré la disproportion des âges, cette union semble avoir été plus heureuse que la précédente.
1802 : Naissance de son fils Bernardin, qui mourra deux ans plus tard. Déjà en relations avec Louis et Joseph Bonaparte, se rallie au Premier Consul et salue avec enthousiasme le coup d’État du 18 Brumaire, qui « vint éteindre, au péril de ses jours, le volcan intérieur dont les éruptions continuelles menaçaient le sol de la France d’un bouleversement inévitable ». Il sera sous l’Empire un personnage officiel couvert d’honneurs et de prébendes.
Polémiques à l’Institut autour du système des marées : en août, lit des Observations contraires au système de la gravitation de la lune sur l’Océan dirigées contre Romme et Laplace.
1803 : Réforme de l’Institut et rétablissement de l’Académie française. Bernardin la présidera à partir de 1807. Lancement d’une souscription pour l’édition de luxe de Paul et Virginie.
1804 : Cinquième édition des Études de la Nature, dernière édition authentique revue par l’auteur (mais il a paru également de nombreuses éditions contrefaites). Cette version « revue et corrigée » constitue le texte de référence pour l’édition de la majorité des œuvres non posthumes.
1806 : Décoré de la Légion d’Honneur. Publication de l’édition de luxe de Paul et Virginie, boudée par les souscripteurs et précédée d’un long et rébarbatif Préambule. Démarches en vue de la publication des Harmonies, auxquelles l’auteur travaille intensivement depuis plus de dix ans.
Retour (au moins extérieur) à la pratique religieuse : il loue quatre places à l’église d’Éragny-sur-Oise, où il s’est retiré.
1807 : Publication de La mort de Socrate. Amitié avec Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon. Devenu roi de Naples, il invite les époux de Saint-Pierre en Italie, mais sa promotion au trône d’Espagne (1808) interrompt les préparatifs du voyage.
Jusqu’à la fin Bernardin travaille aux Harmonies, commencées vraisemblablement dès 1790 et dont la publication a été maintes fois annoncée. Avec l’aide de son secrétaire Louis Aimé-Martin, il en multiplie de façon inextricable les différentes versions manuscrites.
1814 : Mort de Bernardin de Saint-Pierre le 21 janvier à Éragny-sur-Oise.
1815 : Publication par Louis Aimé-Martin des Harmonies de la Nature, chez Méquignon-Marvis, dans une version sans doute partiellement recomposée par ses soins.
1818 : Époux de la veuve de l’écrivain et détenteur de la plus grande partie de ses manuscrits, Aimé-Martin publie chez le même éditeur une monumentale édition des Œuvres complètes en 12 volumes in -8o, régulièrement rééditée jusqu’en 1865 sous différentes présentations. Ce travail très critiqué mais jamais remplacé à ce jour reste la base de notre connaissance de l’œuvre.
Cette chronologie a été établie principalement à l’aide des ouvrages suivants :
Aimé-Martin, Louis, Essai sur la vie de Bernardin de Saint-Pierre, in Œuvres complètes de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre, t. I, Paris, Lequien fils et Pinard, 1830.
Souriau, Maurice, Bernardin de Saint-Pierre d’après ses manuscrits, Paris, Société Française d’Imprimerie et de Librairie, 1905.
Cook, Malcolm, Bernardin de Saint-Pierre, a Life of Culture, London, Modern Humanities Research Association and Maney Publishing, « Legenda », 2006.
Seth, Catriona et Wauters, Éric (éds.), Autour de Bernardin de Saint-Pierre. Les écrits et les hommes des Lumières à l’Empire, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2010.
Racault, Jean-Michel, Meure, Chantale et Gigan, Angélique (éds.), Bernardin de Saint-Pierre et l’océan Indien, Paris, Éditions Classiques Garnier, 2011.
1 En donnant à ce nom la valeur d’un patronyme plutôt que d’un prénom, nous avons suivi cet usage.