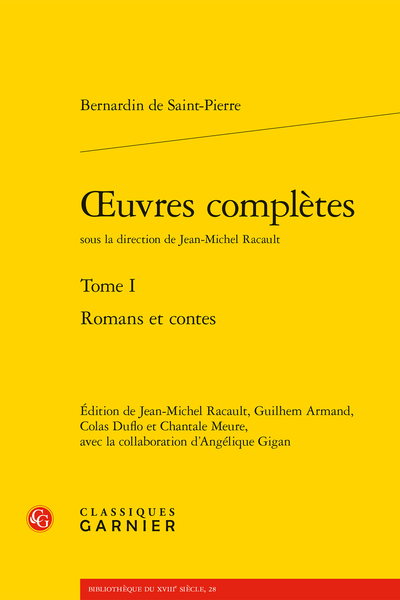
Avertissement Les Œuvres complètes de Bernardin de Saint-Pierre : état des lieux, préalables de méthode, principes d’édition
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Œuvres complètes. Tome I. Romans et contes
- Pages : 7 à 17
- Collection : Bibliothèque du xviiie siècle, n° 28
- Thème CLIL : 3439 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moderne (<1799)
- EAN : 9782812430886
- ISBN : 978-2-8124-3088-6
- ISSN : 2258-3556
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3088-6.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 16/12/2014
- Langue : Français
Avertissement
Les Œuvres complètes de Bernardin de Saint-Pierre :
état des lieux, préalables de méthode, principes d’édition
Le cas de Bernardin de Saint-Pierre est singulier : c’est le seul des auteurs littérairement consacrés du xviiie siècle français dont les écrits soient pour la plupart introuvables en librairie et dont les œuvres n’aient fait l’objet d’aucune publication d’ensemble récente et sûre. L’unique édition existante des Œuvres complètes, due à l’ancien secrétaire de l’écrivain, Louis Aimé-Martin, remonte à près de deux siècles (1818)1. Elle fut certes plusieurs fois réimprimée sous différents formats dans la première moitié du xixe siècle – les versions les plus courantes sont en douze volumes in-8o ou en deux gros volumes in-4o sur deux colonnes – mais elle n’est plus accessible depuis fort longtemps, sauf dans les fonds anciens de quelques rares bibliothèques. Son texte, de surcroît, soulève diverses interrogations, sur lesquelles nous reviendrons, qui militent en faveur d’une nouvelle version.
La présente édition, on l’aura compris, souhaiterait remédier à cette carence. Celle-ci, au demeurant, s’explique assez aisément. La première raison tient au statut littéraire et à l’image de l’auteur. Écrivain reconnu, Bernardin de Saint-Pierre l’a été sans aucun doute sous la Révolution et l’Empire, mais dans quelle mesure l’est-il resté ensuite ? Parvenu sur le tard à la notoriété et à une relative aisance grâce au succès des Études de la Nature (1784), qu’il sut gérer habilement à la faveur de nouvelles éditions augmentées, il élargit considérablement son audience avec la troisième édition (1788). Elle était enrichie d’un quatrième tome entièrement nouveau. On y trouvait, outre un « Avis » liminaire exposant des thèses scientifiques sur les causes des marées et courants marins qui n’intéressent guère aujourd’hui que les spécialistes (mais
suscitèrent à l’époque de vives polémiques), deux brefs romans promis à des destins pour le moins contrastés. L’Arcadie, sorte d’épopée en prose sur le modèle du Télémaque, est le reste d’un très vaste projet avorté dont seul fut sauvé le premier des douze livres initialement prévus. Malgré son actualité paradoxale – ce récit à l’antique est aussi une réflexion sur la société française à la veille de la Révolution – cet écrit n’eut guère d’échos. L’autre, Paul et Virginie, assura à son auteur une célébrité durable quoique à certains égards encombrante, celle dont jouissent plus ou moins malgré eux les créateurs de grands mythes littéraires quelque peu dépassés par leur création. Diffusé principalement par l’iconographie, les adaptations dramatiques, les réécritures diverses, le « mythe de Paul et Virginie » ne s’est pas seulement progressivement affranchi du texte générateur – souvent connu de façon indirecte plutôt que dans sa version authentique – et de son auteur, dont le nom seul est resté « notoire » ; il a aussi étouffé le reste de l’œuvre, délaissée assez tôt malgré l’édition Aimé-Martin, et dégradé l’image de l’écrivain, en transférant sur sa personne une réputation de mièvrerie voire de niaiserie qui doit moins au texte du roman qu’à la vulgate constituée à partir de lui.
Le déclassement dont a pâti Bernardin de Saint-Pierre a gagné même la critique universitaire. Il est significatif que les deux principales études de référence, celles de Maury (1892)2 et de Souriau (1905)3, remontent à plus d’un siècle. Fort heureusement l’époque de l’indifférence ou, pire, de la condescendance critique, semble bien révolue. On a pu enregistrer depuis une vingtaine d’années une floraison d’articles, une nouvelle biographie de référence4, tout récemment trois colloques spécialisés5, les premiers résultats d’une vaste entreprise en
cours portant sur l’édition en ligne de la correspondance6, sans que pour autant soient résolus les problèmes cruciaux d’accès matériel aux textes et même de définition des contours de l’œuvre.
Car là réside la seconde raison qui explique l’absence d’édition moderne des œuvres complètes : il s’agit d’une tâche considérable, qui soulève des difficultés très spécifiques et, d’une certaine façon, remet en cause la notion même d’« œuvre ».
Premier obstacle : la délimitation de cette dernière est en l’espèce incertaine, ce qu’on pourrait appeler le corpus bernardinien étant composé pour une part de textes posthumes dont l’établissement voire l’authenticité posent problème. On pourrait croire que pour ceux publiés par l’écrivain ou sous son contrôle au moins théorique il n’en va pas de même, et que la règle consistant à prendre pour base de référence la dernière version publiée du vivant de l’auteur est à suivre dans tous les cas ; mais, quoi qu’il en dise dans ses préfaces et avant-propos, Bernardin est un relecteur assez peu rigoureux dont il y a lieu de penser qu’il abandonne quelquefois à son imprimeur les ultimes corrections : la luxueuse édition de 1806 de Paul et Virginie7, la dernière revue par l’auteur et pour cette raison celle généralement retenue par les éditeurs modernes, offre en raison de sa ponctuation et de ses « améliorations de style » inopportunes (peut-être suggérées par l’imprimeur Didot) un texte nettement moins bon que celui de la première édition séparée (1789)8, qui a été retenu ici, et qui pour sa part corrige heureusement les incohérences de chronologie contenues dans l’édition originale au sein des Études (1788)9. En revanche,
tant pour l’« Avis » liminaire du quatrième tome que pour L’Arcadie et ses paratextes, et bien sûr pour les Études de la Nature elles-mêmes, il n’y a aucune raison de remettre en question l’autorité de la dernière édition des Études personnellement visée par l’auteur, celle de l’an XII (1804), publiée chez Deterville10, puisqu’on ne dispose d’aucune version meilleure ou plus complète.
Le cas des œuvres entièrement ou partiellement posthumes est différent. Il faut distinguer ici celles qui ont été déjà publiées (par Aimé-Martin pour la quasi-totalité d’entre elles) et celles qui n’existent présentement qu’à l’état manuscrit. Tous les spécialistes de Bernardin de Saint-Pierre le savent : ancien secrétaire, biographe et confident de l’écrivain, plus tard époux de sa veuve et détenteur de ses papiers, Aimé-Martin traîne avec lui une exécrable réputation d’éditeur abusif et même de falsificateur due aux jugements peu amènes des premiers critiques universitaires qui travaillèrent sur les manuscrits, Maury d’abord, puis Souriau. Cette fâcheuse réputation, répercutée sans réelle vérification dans des ouvrages critiques récents11, est-elle justifiée ? Et suffit-elle à invalider la version des Œuvres posthumes procurée par Aimé-Martin ? Les turpitudes prêtées à ce dernier paraissent en réalité très exagérées, même si son souci – qui est aussi le nôtre – de restituer aux manuscrits sur lesquels il travaillait une forme aussi lisible que possible l’a conduit très certainement à prendre des libertés avec les textes, ne serait-ce qu’en leur rendant la ponctuation, l’orthographe, voire la correction syntaxique qui bien souvent leur font défaut. Et peut-on véritablement attendre d’un homme de lettres dont le travail d’édition a été engagé aux alentours de 1815 la rigueur philologique revendiquée par l’érudition universitaire positiviste des années 1900 ?
Le procès fait à Aimé-Martin est, nous semble-t-il, un faux procès, appuyé sur des griefs exagérés et parfois erronés. Non pas seulement
parce que nous devons à son travail – infiniment méritoire, pour quiconque a peiné sur les manuscrits de la Bibliothèque Municipale du Havre – l’essentiel de nos connaissances sur les écrits posthumes ; mais aussi parce que, dans les rares cas où nous avons la possibilité de contrôler ses transcriptions, elles répondent parfaitement à leur but, qui était de rendre lisibles et corrects des textes établis à partir des versions manuscrites les plus utilisables. Il en est ainsi de deux des œuvres qui ont particulièrement focalisé les critiques de Souriau, L’Amazone et surtout les Harmonies de la Nature, pour lesquelles ce dernier, s’appuyant sur une version manuscrite différente de celle dont s’était servi Aimé-Martin, accuse à tort le premier éditeur de falsification12.
S’il en est ainsi, pourquoi, dira-t-on, ne pas faire entièrement confiance au travail d’Aimé-Martin ? Pourquoi, notamment, ne pas l’entériner comme la version de référence pour l’ensemble des textes posthumes dont il n’existe aucune autre édition imprimée ? Et pourquoi même, si celle-là est digne de confiance, en préparer une autre ?
Chaque fois que sa transcription peut être vérifiée et validée sur le manuscrit, c’est en effet la solution qui a été choisie. Mais ce n’est pas toujours le cas. Pour bien des titres on ne retrouve, ni dans le fonds du Havre ni ailleurs, rien qui corresponde réellement à un document suivi complet à partir duquel aurait pu être établie l’édition posthume, même si des passages similaires existent. C’est la raison pour laquelle, faute d’en avoir identifié les originaux parmi les centaines de feuillets constituant les manuscrits de L’Arcadie, nous avons relégué dans les Annexes les fragments « sauvés » par ses soins du second et du troisième livre ajoutés dans son édition. Nous ne croyons pas à l’hypothèse parfois avancée d’une fabrication pure et simple de l’éditeur, mais la preuve de l’authenticité des compléments de l’édition posthume fait défaut, sans qu’on puisse en tirer aucune conclusion : Aimé-Martin a donné ou détruit beaucoup de manuscrits13, et tel était fréquemment
le sort à l’époque de ceux, souillés d’encre par le passage à l’atelier, qui avaient servi à la composition.
Quant à l’opportunité de préparer une édition nouvelle des Œuvres complètes alors que celle d’Aimé-Martin existe, ne mérite pas semble-t-il la défiance qui lui a été témoignée et pourrait après tout être réimprimée à l’identique, deux raisons expliquent notre choix : ne comportant ni notes ni variantes, elle ne peut être tenue pour une édition critique ; même pour les textes posthumes, elle n’utilise que très partiellement la masse des matériaux manuscrits – ce qu’on ne saurait d’ailleurs lui reprocher – et, par les choix qu’elle opère entre les versions concurrentes qu’il est possible de rattacher, de façon d’ailleurs hypothétique, à un même noyau textuel, elle transforme arbitrairement en « œuvres » finies et closes des ensembles flottants, aux contours incertains, dont les composantes sont variables et l’unité hautement problématique.
Il n’existe guère qu’une seule « œuvre » de Bernardin de Saint-Pierre répondant au principe moderne de la « clôture du texte » : c’est Paul et Virginie, avec son dispositif d’encadrement rigoureusement parallèle qui s’ouvre et se referme sur la rencontre puis la séparation de l’« Européen » et du Vieillard narrateur au sein du même paysage, objet de deux descriptions panoramiques parfaitement symétriques. La plupart des autres titres semblent fonctionner « en structure ouverte », comme des nébuleuses sans limites définies susceptibles d’accueillir toujours de nouveaux contenus. Les Études de la Nature par exemple, dont les trois volumes initiaux dans l’édition de 1784 sont progressivement portés à quatre dans celle de 1788, puis à cinq en 1792, intégrant ainsi Paul et Virginie et L’Arcadie, puis les Vœux d’un solitaire et La Chaumière indienne, s’autorisent de la métaphore picturale du carnet d’esquisses inscrite dans leur titre pour absorber et regrouper librement les contenus les plus hétérogènes, sans arbitraire toutefois, car le providentialisme finaliste
et anthropocentré de la philosophie de la nature bernardinienne est pareillement à l’œuvre dans les textes théoriques et dans les expansions romanesques qui en sont l’illustration.
On pourrait avancer l’hypothèse que l’ensemble des écrits de Bernardin constitue une œuvre unique, susceptible toutefois de se configurer diversement, et dont l’élaboration jamais véritablement achevée s’inscrit dans la très longue durée. Les Études de la Nature semblent avoir eu vocation à accueillir l’essentiel des écrits publiés, et il existe une continuité évidente entre les Études, dont les premières ébauches doivent remonter à l’époque du séjour à l’île de France, et les Harmonies de la Nature, sur lesquelles l’auteur travaille encore à la fin de sa vie. De même, le projet de L’Amazone, engagé sans doute très tôt puis abandonné au début des années 1780 pour la rédaction de L’Arcadie, sera repris après la Révolution (la Terreur y est évoquée). Dans un hypothétique état définitif que l’auteur n’a pas mené à son terme, il aurait vraisemblablement accueilli d’amples récits insérés sans grand lien géographique ni rapport d’intrigue avec le récit principal, comme l’Histoire de l’Indien. Premier ouvrage publié de Bernardin, le Voyage à l’île de France est en réalité un texte non clos qui accueille au fil du temps de nouveaux matériaux en vue d’une nouvelle édition considérablement augmentée prévue pour 1797. À l’éditeur moderne de décider s’il doit respecter l’ordonnance du livre publié en 1773, ou s’efforcer de reconstituer une version conforme au vœu de l’auteur en y intégrant ces ajouts manuscrits, dont l’insertion n’est souvent indiquée que de façon imprécise.
Ce mode de composition assez anarchique, qui risque de faire perdre beaucoup de temps à l’éditeur consciencieux soucieux de s’assurer que tel manuscrit appartient ou non à telle « œuvre » dûment identifiée (mais la question s’agissant des écrits de Bernardin a-t-elle un sens ?), est à l’image de ces manuscrits eux-mêmes, pour la plupart des bribes de rédactions discontinues ou des notes éparses regroupant sur un même feuillet des sujets différents. Même lorsqu’un développement suivi se met en place, il entre ordinairement en concurrence avec d’autres versions entre lesquelles il est difficile de choisir la « bonne » ; choix arbitraire souvent, guidé par l’intérêt intrinsèque du passage plutôt que par son insertion dans la continuité de la narration, ou plus prosaïquement conditionné par sa lisibilité, car l’écriture minuscule des manuscrits du Havre, leur
orthographe calamiteuse et leur ponctuation défaillante rendent leur exploitation très difficile.
Quel profit attendre de ce travail ingrat pour la connaissance de Bernardin de Saint-Pierre ? Depuis les premiers travaux universitaires, « Bernardin de Saint-Pierre d’après ses manuscrits » – c’était le titre de la thèse de Souriau, dont le programme fut souvent repris par ses successeurs – a constitué un argument méthodologique et une promesse de renouvellement de l’image de l’écrivain qui toutefois n’a pu être pleinement remplie : il faudrait pour cela dépouiller les milliers de feuillets des dossiers du Havre, tâche impossible et qui, si elle était entreprise, élargirait la notion d’« œuvre » à des brouillons informes. Une édition intégrale du fonds du Havre, qui regroupe la plus grande partie des manuscrits de Bernardin, était donc exclue, d’autant que leur mise en ligne récente par l’équipe de Malcolm Cook a rendu leur consultation possible14.
Il a paru cependant utile de procéder à des transcriptions sélectives des manuscrits les plus « exploitables » appartenant à de grands massifs narratifs tels que L’Arcadie et L’Amazone, connus jusqu’alors seulement par quelques fragments publiés, ou en version intégrale dans le cas de l’Histoire de l’Indien. Malgré les difficultés de lecture résultant du code de transcription utilisé – normalisation orthographique, mais respect de la ponctuation originale, même fantaisiste – cette divulgation de fragments inconnus d’ouvrages dont on ne connaissait en réalité que le début enrichit incontestablement la figure de l’auteur, révèle son ouverture à des problématiques insoupçonnées, l’insère dans des débats que les textes du corpus imprimé n’évoquent que très peu. Les manuscrits confirment ainsi sa pente naturelle vers l’expérimentation utopique et, ce qui est moins connu, manifestent son vif intérêt pour les mythologies des peuples nordiques, pour les civilisations de l’Inde, pour le mythe tahitien naissant (même s’il l’accueillit avec réserve), dont il eut la primeur en rencontrant Bougainville et les membres de son expédition lors de leur escale à l’île de France sur leur trajet de retour.
Le mode de composition très particulier suivi par Bernardin de Saint-Pierre, qui complique l’édition des manuscrits, rend également
problématique le plan d’édition des Œuvres complètes. L’ordre chronologique de publication pourrait certes être retenu pour les ouvrages publiés de son vivant, mais il n’a guère de sens s’agissant des ouvrages posthumes, élaborés sur une très longue période et dont la date d’achèvement, lorsqu’ils ont été achevés, ne peut être nettement fixée. Les écrits de Bernardin formant un palimpseste dans lequel l’enchaînement des textes a énormément varié, un ordre génétique ne serait pas non plus satisfaisant. Le mode de regroupement que nous avons adopté vise à respecter une certaine cohérence thématique et chronologique tout en préservant l’équilibre quantitatif des différentes sections (dont chacune donnera lieu à un ou parfois deux forts volumes) ainsi réparties :
–Section I : Récits et voyages (deux volumes)
–Section II : Œuvres philosophiques et scientifiques (Études de la Nature)
–Section III : Œuvres philosophiques et scientifiques, suite (Harmonies de la Nature)
–Section IV : Œuvres politiques et pédagogiques
–Section V : Mélanges philosophiques, scientifiques et littéraires15.
On trouvera ci-après dans ce premier tome, qui sera suivi d’un second volume consacré aux voyages, l’essentiel des textes de fiction de Bernardin de Saint-Pierre, accompagnés de leurs divers paratextes auctoriaux (Bernardin, fidèle au principe de la composition par greffes et bourgeonnements, abuse plus que de raison des avis, ajouts, préambules, notes et appendices) et suivis lorsque cela a été jugé utile d’annexes documentaires16.
Soucieux de respecter autant que possible la disposition originale des textes du quatrième tome des Études de la Nature de 1788, où Paul et Virginie et L’Arcadie apparaissent pour la première fois, nous avons cru devoir conserver sa place liminaire au très long et quelque peu indigeste « Avis » qui les y précédait, bien que cet exposé fort technique du système des marées qui constitue presque un ouvrage indépendant ne relève en rien du genre romanesque. Le lien caché, mais qui doit exister, entre ces thèses géophysiques et Paul et Virginie est d’ailleurs un grand sujet de perplexité : en 1806, des développements assez parallèles à ceux de l’« Avis » occupent de nouveau une partie du long « Préambule » de l’édition in-4o du roman. Peu lisibles certes aujourd’hui, mais bien moins fantaisistes qu’on ne serait tenté de le croire, ces considérations para-scientifiques doivent nous rappeler que l’auteur des Études de la Nature, futur directeur du Muséum d’histoire naturelle, était perçu du grand public et se voyait lui-même avant tout comme un savant et un philosophe, ensuite seulement et par surcroît comme un homme de lettres.
Enfin, sous le titre Contes indiens et aventures philosophiques, intitulé factice dans lequel l’auteur n’est pour rien mais qui cherche à rendre compte d’une indiscutable unité formelle et thématique, ont été réunis divers opuscules de forme narrative à peu près introuvables aujourd’hui, dont un – La Chaumière indienne – fut l’un des grands succès de l’écrivain, ainsi que la transcription d’un récit demeuré manuscrit, l’Histoire de l’Indien, qu’Aimé-Martin renonça on ne sait pourquoi à intégrer aux œuvres posthumes. Ces écrits oubliés et pour certains inconnus révèlent la place de l’Inde dans l’imaginaire bernardinien et la fécondité, assez inattendue chez un disciple de Rousseau, du modèle voltairien du conte philosophique. Les pérégrinations romanesques qui y sont relatées offrent une continuité avec les voyages authentiques regroupés dans le second volume de cette édition, lequel devrait succéder à celui-ci dans un délai que nous espérons assez rapproché.
Jean-Michel Racault
Dans l’impossibilité de remercier toutes les personnes qui à divers titres ont participé à la réalisation de ce volume, nous souhaitons cependant rendre un hommage particulier à la responsable et au personnel du bureau transversal des colloques, de la recherche et des publications (faculté des lettres et sciences humaines, université de La Réunion), dont la contribution technique a été inappréciable. Nous exprimons également notre gratitude aux directeurs et aux personnels des institutions qui ont grandement facilité l’accès aux manuscrits et aux éditions anciennes de Bernardin de Saint-Pierre : la bibliothèque municipale du Havre, la bibliothèque départementale de La Réunion, la bibliothèque universitaire de La Réunion, le musée de Villèle (La Réunion), le musée Léon Dierx (La Réunion).
1 Œuvres complètes de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre, mises en ordre et précédées de la vie de l’auteur, par L. Aimé-Martin, Paris, Méquignon-Marvis, 1818, 12 vol. in-8o.
2 Fernand Maury, Étude sur la vie et les œuvres de Bernardin de Saint-Pierre, Paris, Hachette, 1892 [et Genève, Slatkine Reprints, 1971].
3 Maurice Souriau, Bernardin de Saint-Pierre d’après ses manuscrits, Paris, Société Française d’Imprimerie et de Librairie, 1905.
4 Malcolm Cook, Bernardin de Saint-Pierre, a life of culture, London, Modern Humanities Research Association and Maney Publishing, « Legenda », 2006.
5 Autour de Bernardin de Saint-Pierre. Les écrits et les hommes des Lumières à l’Empire, dir. Catriona Seth et Éric Wauters, Mont Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2010 ; Bernardin de Saint-Pierre au tournant des Lumières. Mélanges en l’honneur de Malcolm Cook, dir. Katherine Astbury, Louvain-Paris-Walpole, Ma., « La République des Lettres », 48, 2012 ; Bernardin de Saint-Pierre et l’océan Indien, dir. Jean-Michel Racault, Chantale Meure et Angélique Gigan, Paris, Classiques Garnier, « Rencontres », 15, 2011. On peut ajouter à cette liste le colloque plus ancien dirigé par Édouard Guitton, dont les Actes ont été publiés dans la Revue d’Histoire Littéraire de la France, 1989, no 5, le premier semble-t-il consacré à Bernardin de Saint-Pierre.
6 La correspondance de Bernardin de Saint-Pierre, édition électronique sous la direction de Malcolm Cook, The Voltaire Foundation, « Electronic Enlightenment », http://www.e-enlightenment.com/. Toutes les lettres appartenant à la correspondance active et passive de Bernardin de Saint-Pierre peuvent d’ores et déjà ou pourront prochainement être consultées à cette adresse dans une version électronique établie et annotée par l’équipe de Malcolm Cook. Le lecteur trouvera sur le site d’Electronic Enlightenment les informations nécessaires pour une recherche par date et par correspondant.
7 Paul et Virginie, par Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre, Paris, Didot l’Aîné, gr. in-4o avec un portrait et six gravures, 1806.
8 Paul et Virginie, par Jacques-Bernardin-Henri de Saint-Pierre, Paris, De l’imprimerie de Monsieur, Firmin Didot, in-18o de XXXV – 243 p. avec quatre gravures, 1789.
9 Paul et Virginie, in Études de la Nature, par Jacques-Bernardin-Henri de Saint-Pierre, troisième édition, revue, corrigée et augmentée, tome quatrième, Paris, De l’imprimerie de Monsieur, P.-F. Didot le jeune et Mequignon l’aîné, 1788.
10 Études de la Nature, nouvelle édition, revue et corrigée par Jacques-Bernardin-Henri de Saint-Pierre, De l’imprimerie de Crapelet, à Paris, chez Deterville, an XII, 1804.
11 Par exemple dans l’étude d’Anastase Ngendahimana (Les idées politiques et sociales de Bernardin de Saint-Pierre, Berne, Peter Lang, « Publications Universitaires Européennes », série XIII, Langue et Littérature Française, vol. 243, 1999), qui déplore que « L’Arcadie, L’Amazone, l’Essai sur Jean-Jacques Rousseau [aient] fait l’objet de réfection au point qu’aujourd’hui on a du mal à reconnaître les textes authentiques des apocryphes fabriqués par l’indigne héritier », qualifié d’« hagiographe et faussaire » (p. 42 ; voir aussi p. 75).
12 Voir Maurice Souriau, op. cit., p. xxxiv-xlviii et p. 386-418 pour une critique féroce du travail du « falsificateur » Aimé-Martin, critique elle-même fortement remise en question par Silvio Baridon dans l’introduction à son édition du manuscrit autographe des Harmonies de la Bibliothèque Nationale, ignoré ou négligé par Souriau (Silvio F. Baridon, Le Harmonies de la Nature di Bernardin de Saint-Pierre. Studi di filologia e di critica testuale, Milano-Varese, Istituto Editoriale Cisalpino, 1958, 2 vol.).
13 Il existe ainsi à la Bibliothèque Municipale d’Angers un manuscrit, retrouvé par Malcolm Cook, du « Préambule » de l’édition de 1806 de Paul et Virginie offrant des variantes intéressantes par rapport au texte imprimé, donné par Aimé-Martin à un ami si l’on en croit la note de couverture. On trouve fréquemment en marge des manuscrits du Havre, de la main d’Aimé-Martin, des mentions du genre « Inutile. À brûler » ou « Ceci a déjà été employé. À détruire », qui laissent penser que le nombre des feuillets effectivement éliminés a été très important et que cette élimination a été systématique dans le cas des manuscrits utilisés pour l’édition, ce qui suffit à expliquer l’absence de versions concordantes avec les textes publiés.
14 Ils peuvent être consultés sur le site de l’université d’Exeter à l’adresse suivante : <http://projects.exeter.ac.uk/bsp/frameset.htm>
15 Étant tributaire de l’ampleur des difficultés à résoudre et de la disponibilité des équipes en charge de l’édition des différentes sections prévues, l’ordre de publication des volumes ne correspondra pas nécessairement à ce plan. Les responsables des équipes chargées de l’édition sont, dans l’ordre, Jean-Michel Racault, Colas Duflo, Simon Davies, Didier Masseau, Malcolm Cook. Le secrétariat d’édition est assuré par Angélique Gigan.
16 Conformément au protocole de l’éditeur, nous avons placé les notes critiques en bas de page (appelées par des chiffres arabes) et les variantes (appelées par des renvois alphabétiques) à la fin de chacun des ouvrages. Les notes de l’auteur, appelées par des chiffres romains, sont placées à la fin de chacun des textes édités.