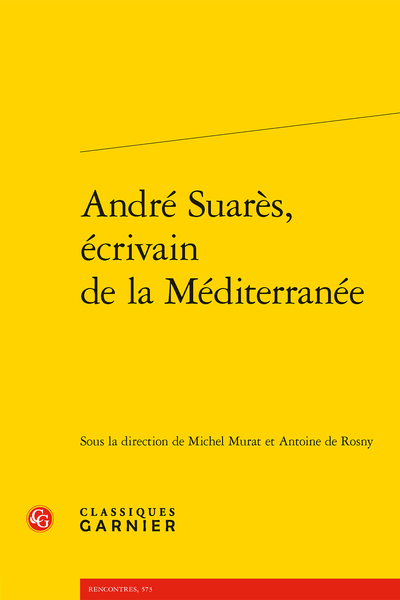
Résumés
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: André Suarès, écrivain de la Méditerranée
- Pages: 259 to 262
- Collection: Encounters, n° 573
- Series: Twentieth and twenty-first century literature, n° 45
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406144885
- ISBN: 978-2-406-14488-5
- ISSN: 2261-1851
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-14488-5.p.0259
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 04-19-2023
- Language: French
Résumés
Michel Murat, « Avant-propos »
On trouvera dans ce livre la Méditerranée de Suarès, et toutes les manières dont il la fait sienne : à travers une idée ou un moment de l’esprit ; par un moment de l’expérience, comme la réclusion à Marseille ; par l’amitié avec d’Annunzio, le compagnonnage avec Gustave Fayet ; dans les feuillets d’un livre rêvé sur la Provence, dans une ville ou un port. Toutes portent sa marque, et sont une invitation au voyage.
Antoine de Rosny, « Ports et rivages de la Méditerranée »
Ports et rivages méditerranéens constituent un aspect non négligeable de la vie et de l’œuvre d’André Suarès. L’auteur en parle selon des approches variées : tantôt, c’est l’arrière-plan familial qui affleure (Gênes, Marseille, Toulon) ; tantôt, c’est une approche plus idéologique qui transparaît (l’opposition de la Grèce et de Rome, de l’Orient et de l’Afrique) ; ailleurs, la fréquentation des petits ports suscite un désir de magnifier par l’écriture leur beauté toute picturale.
Giovanni Dotoli, « Un classicisme méditerranéen »
Pour André Suarès le classicisme est un art créateur, à l’opposé de toute doctrine de l’imitation. Sa culture lui permet de relire l’histoire entière de la Grèce et de Rome, et d’en tirer à la fois un esthétique et une éthique, sous le signe de la grandeur. La beauté, dont il fait son unique préoccupation, est harmonie et ordre, dans le respect de la nature. C’est une philosophie méditerranéenne, qui nous invite au banquet de la vie.
260Pauline Bruley, « Le français méditerranéen de Suarès »
Attaché à cinq langues méditerranéennes, André Suarès écrit à une époque où l’on observe le déclin des variantes diatopiques. En y adjoignant l’épaisseur diachronique, Suarès discerne une « nomade permanence » dans le français, dont il commente la latinité, en consonance avec les linguistes contemporains, et non par idéologie politique. Il sonde le caractère de ses langues, tout en prenant des libertés avec elles, voire en forgeant quelques variantes singulières.
Isabelle Pantin, « La Renaissance (italienne) d’André Suarès »
Les rencontres d’André Suarès avec la Renaissance ont été précoces et répétées. Il se reconnaissait dans diverses figures de cette période. Pour autant, son œuvre exprime-t-elle une idée de la Renaissance ? Cette expression ne saurait être directe, vu son refus d’agir en historien, ou d’emprunter aux historiens leurs synthèses – qui, selon lui, tuaient le contact vivant avec les vestiges du passé. Cette étude enquête donc sur les expressions indirectes et paradoxales d’une telle idée.
Frédéric Gagneux, « André Suarès et la musique italienne »
L’amour inconditionnel d’André Suarès pour l’Italie nous a valu des pages somptueuses et enthousiastes. Pourtant, cet amour de l’art italien ne s’applique pas à la musique. Suarès exècre le bel canto et Donizetti en fait tout particulièrement les frais. Sa conception de la musique l’unit profondément avec les romantiques allemands. Pour autant, ses réflexions l’amènent à exalter la musique de Monteverdi et de Palestrina, faisant de lui un précurseur bien avant la redécouverte de la musique ancienne.
Liana Nissim, « Milan, lourde, et compacte, et grasse »
Dans Le Voyage du Condottière, André Suarès manifeste les contradictions de sa vision du monde romantique et symboliste, hostile à la modernité mais capable de visions qui semblent annoncer notre réalité actuelle. Milan lui paraît une ville abominable, à cause de sa dissemblance par rapport à son idée préconçue de la ville italienne idéale. Malgré ce regard entravé, Suarès emploie à la décrire une écriture somptueuse, chargée de métaphores monstrueuses mais non dépourvues d’une sorte de prescience.
261Franco de Merolis, « Gabriele D’Annunzio et André Suarès, une amitié dans la culture »
André Suarès s’intéresse dès 1895 à Gabriele D’Annunzio et à son œuvre. Il devine en lui un frère en littérature, en quête, comme lui, de grandeur et de beauté. Les deux hommes se rencontrent en 1910, à l’occasion du séjour français de l’écrivain italien. Les échanges épistolaires témoignent dès lors d’une admiration réciproque. Avec la Première Guerre mondiale, Suarès découvre en D’Annunzio un homme d’action qui le fascine : en lui s’épanouit l’idéal du poète condottière.
Christel Brun-Franc, « Marseille au double visage vue par André Suarès et par les Cahiers du Sud »
Aucun compte rendu du Marsiho ne figure dans les Cahiers du Sud. Le livre d’André Suarès donne de Marseille l’image d’une cité pleine de vitalité mais réfractaire à la culture, proche de celle qu’en donnait en 1928 un numéro spécial de la revue. Gabriel Audisio, auteur du compte rendu refusé par Jean Ballard, poursuit Suarès de son indignation, alors qu’il s’agit plus d’une divergence esthétique que d’un désaccord sur le fond, tous deux entretenant avec leur ville une relation ambivalente.
Stéphane Cunescu, « L’enfance marseillaise d’André Suarès. Des Rêves de l’ombre »
À partir des deux sources que sont la correspondance de jeunesse avec Romain Rolland (1887-1891) et les chapitres autobiographiques de Marsiho (1933), cette contribution s’attache à démontrer comment Marseille devient le lieu matriciel de la vocation négative d’André Suarès. En analysant les discours de l’auteur formulés sur sa ville natale, notre étude identifie l’enfance marseillaise de Suarès comme étant à l’origine de motifs récurrents au sein de l’œuvre et structurant l’ethos suarèsien.
Michel Murat, « Le Prince des Baux. Suarès en Provence »
En Provence André Suarès est sur sa terre, comme un prince à la fois régnant et dépossédé. Sa Provence est une terre classique, dépositaire de l’héritage grec, contemplée depuis les ruines des Baux ou le théâtre antique 262d’Arles. Les figures littéraires n’en sont pas absentes : Suarès caricature Léon Daudet, prend ses distances avec Mistral et constate l’échec du mouvement félibrige. Maurras n’est pas loin, mais du même ciel de Provence tous deux tirent une leçon différente.
Élodie Cottrez, « L’itinéraire méditerranéen de Gustave Fayet et d’André Suarès »
Grand propriétaire viticole, collectionneur d’art moderne, Gustave Fayet est aussi dessinateur et graveur. Mis en relation avec André Suarès par Odilon Redon, il s’est lié d’amitié avec lui. Les deux hommes ont collaboré à des livres illustrés, notamment Sur le pont de la lune et Le Nuage messager. Suarès a suivi Fayet de loin, par correspondance, dans un voyage aux Baléares dont est issu Fleurs, et n’a pu l’accompagner, malgré ses vœux, dans un dernier voyage en Italie.
Dominique Millet-Gérard, « L’otium chez André Suarès »
Si André Suarès n’utilise pas le mot d’otium, la notion de « loisir cultivé » est très présente dans son œuvre. D’abord par opposition au negotium, ce monde de l’argent et de la politique qu’il hait. Le véritable otium, Suarès le trouve en pays méditerranéen, dans l’harmonie contrastée de la lumière et de l’ombre propice à la méditation et à la création. L’otium litteratum de Suarès est aussi un art poétique exigeant, qui rejette le pittoresque au profit de la concision qui traduit l’énergie intérieure.
Antoine de Rosny, « Terres et hommes de Provence, d’Espagne et d’Italie. Extraits d’André Suarès »
Dans l’immense somme de notes que forment les carnets de Suarès, un certain nombre de pages font écho aux différentes orientations dessinées par les communications réunies dans ce volume : réflexions sur la Méditerranée et sur ses langues, notes sur l’Italie, l’Espagne et la Provence, remarques sur certains contemporains majeurs (Unamuno, D’Annunzio et Gustave Fayet). Autant d’extraits inédits révélateurs d’un rapport souvent inattendu de Suarès à la Méditerranée.