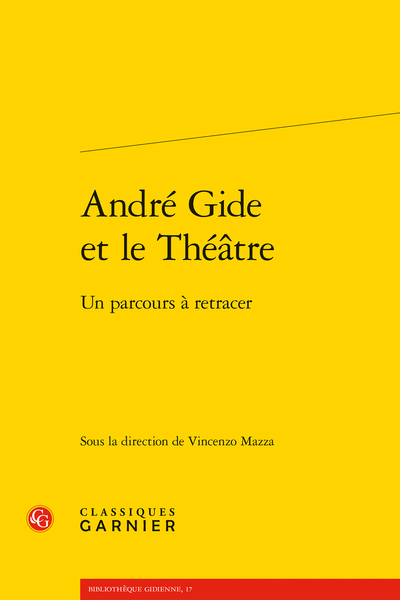
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : André Gide et le Théâtre. Un parcours à retracer
- Pages : 441 à 447
- Collection : Bibliothèque gidienne, n° 17
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406109679
- ISBN : 978-2-406-10967-9
- ISSN : 2494-4890
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-10967-9.p.0441
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 05/05/2021
- Langue : Français
RÉSUMÉS
Jean Claude, « Avant-propos »
Les nombreuses déclarations contradictoires d’André Gide sur le théâtre confirment la complexité de ses rapports avec les arts de la scène. La question du dialogue est centrale pour comprendre la portée de son écriture dramatique. Il s’agit d’un théâtre où l’existence littéraire l’emporte sur l’existence scénique.
Vincenzo Mazza, « Introduction. André Gide et le théâtre : remonter aux sources »
De l’expérience de la mise en scène du Roi Candaule à la relation avec Barrault, on explore les raisons d’un rendez-vous manqué – si l’on excepte les adaptations – d’André Gide avec le théâtre. Cependant, son apport à l’histoire du théâtre est important, et incite à la poursuite du travail de recherche sur les documents d’archives méconnus ou inexploités.
Peter Schnyder, « Regards sur la critique dramatique de Gide. Éléments herméneutiques de l’écrivain ? »
Dans sa jeunesse, André Gide s’est rêvé poète et romancier, mais également auteur dramatique. Seulement voilà : ses exigences littéraires ne lui ont pas permis de sauter le pas et de se défaire d’une dramaturgie restée pour une large part littéraire plutôt que scénique. De là, sans doute, les déboires essuyés. Si nous proposons de revenir brièvement sur la critique dramatique de Gide, c’est pour aborder sa réflexion comme une partie de son esthétique générale, enrichissant l’herméneutique de l’écrivain.
442David H. Walker, « Gide et l’art de la scène. Prolégomènes à une étude de ce qui aurait pu être »
Dès le début de sa carrière littéraire, André Gide a fait preuve d’un intérêt marqué pour le théâtre. En cela, il était sans doute influencé par les tentatives entreprises par ceux de sa génération pour renouveler l’art de la scène. Bien qu’ayant opté pour le roman, Gide a suivi de près ces expériences, et tout porte à croire qu’il caressait quand même des ambitions dramaturgiques, malgré le statut problématique que représentait le théâtre pour un artiste de son genre.
Laurette Burgholzer, « “C’est l’animalité qui ruine la beauté humaine”. Les démons masqués de Saül, d’André Gide à Jacques Copeau »
La création de Saül au Théâtre du Vieux-Colombier en 1922, un quart de siècle après la rédaction de la pièce, est étudiée sous l’angle de la transposition scénique du personnage choral des démons. La mise en scène des démons masqués, imprégnée d’exotisme, conjugue les essais de rénovation dramatique d’André Gide avec les recherches pédagogiques menées par Jacques Copeau et Suzanne Bing à l’École du Vieux-Colombier.
Vincenzo Mazza, « Antoine et Cléopâtre adaptée par Gide. Un théâtre propulsé par l’expression corporelle »
En pleine Occupation, André Gide et Jean-Louis Barrault commencent un échange épistolaire qui sera à l’origine de leurs trois collaborations, qui constituent les trois plus grands succès de Gide au théâtre. La première production, l’adaptation d’Antoine et Cléopâtre de Shakespeare à la Comédie-Française, est un spectacle où s’intègrent les parties plastiques des combats à un texte que la presse considère « admirable ».
Pierre Masson, « Entre modernité et engagement, Robert ou L’Intérêt général »
Ayant conçu, au début des années 30, le projet d’une pièce « moderne », André Gide, évoluant vers le communisme, va tenter de lui donner comme intrigue un conflit social et ses répercussions dans une famille bourgeoise. Il va alors se heurter à de nombreux problèmes techniques, liés à l’obligation de soumettre son inspiration à son engagement. Mais finalement, c’est en 443exprimant sa propre difficulté face à l’engagement, qu’il va réussir à donner à sa pièce une modernité remarquable.
Stéphane Poliakov, « Dialogismes gidiens, une formule dramatique ? »
À côté des grandes pièces, le théâtre d’André Gide comporte des traités indiquant la possibilité d’un théâtre conceptuel, une tentation du dialogue. On peut relire son œuvre à travers le dialogisme quel que soit le genre. Des conflits dialectiques, parfois embryonnaires, s’y construisent. Corydon est un « dialogue socratique » ; le genre des « interviews » témoigne d’une théâtralité critique. Les questions du conflit, du paradoxe, du renversement ironique sont posées par ces virtualités dialogiques.
Patrick Pollard, « Gide et la folie d’Ajax »
L’Ajax de Sophocle offre à André Gide des éléments importants : la folie (le jeu de la réalité et de l’illusion) ; la femme craintive ; l’idéal du héros ; l’apprentissage du disciple ; le devoir civique. Il ne mène à bien que la première scène de son projet, ce qui en constitue en effet le prétexte. Une analyse thématique de la maladie, de la cécité, de la faillite du héros individualiste des années 1894-1907, nous aide à mieux comprendre pourquoi il fut tenté de renouveler ce drame qui lui résistait.
Frank Lestringant, « Saül le Furieux de Jean de La Taille et Saül d’André Gide. La préfiguration huguenote d’une pièce symboliste »
Saül est tirée du premier Livre de Samuel, qui conte l’histoire de Saül, premier roi d’Israël. Or, André Gide n’est pas le premier auteur à mettre en scène son histoire. C’est déjà, au xvie siècle, le cas de Jean de La Taille, auteur de Saül le Furieux. Gide en a-t-il eu connaissance ? Le protestant Jean de La Taille décrit l’incertitude des temps à la veille de la Saint-Barthélemy ; André Gide montre la déchéance d’un roi amoureux d’un berger.
Amina Ben Damir, « La royauté dans le théâtre d’André Gide. Saül, Bethsabé et Amal et la lettre du roi »
Saül et Bethsabé réécrivent l’histoire des deux premiers rois hébreux, et Amal et la lettre du roi – de Rabindranâh Tagore, traduite par André Gide – montre 444l’intérêt de ce dernier pour le mysticisme hindou. Le thème de la royauté est commun à ces trois œuvres, notamment la royauté divine et la royauté terrestre en relation avec les questions sous-jacentes relatives aux genres, à la sexualité et à la transmission, en rapport avec la vie de Gide mais qui ne cessent d’être actuelles.
Frédéric Canovas, « Un classicisme suspect. Saül ou l’autobiographie à l’épreuve de la scène »
Saül correspond à une période où André Gide travaille à L’Immoraliste, où l’écrivain cherche à évoquer de façon plus frontale la question de l’homosexualité. Dans Saül, l’auteur tente encore une fois d’aborder le problème de façon indirecte en transposant le « drame » d’un homme comme Michel dans un lieu et une époque éloignés du présent. L’objectif de Gide est de pouvoir libérer sa parole et d’aller plus loin dans l’évocation de l’homosexualité sous couvert de grandes figures de l’Antiquité.
Augustin Voegele, « Œdipe, de Sophocle à Gide (via Freud ?) »
Notre but est de repenser les relations d’André Gide à Sophocle, d’une part, et à Freud, d’autre part en nous penchant sur deux textes : l’Œdipe (1930) de Gide, bien sûr, mais aussi la conférence intitulée « De l’évolution du théâtre », que Gide prononça le 25 mars 1904 à La Libre Esthétique de Bruxelles.
Clara Debard, « Gide et la critique dramatique, “un four noir” »
Lorsqu’André Gide publie à nouveau Le Roi Candaule en 1904, sa seconde préface est un collage d’articles dépréciant sa pièce. Lorsque Copeau crée Saül en 1922, vingt-quatre ans après son écriture, Gide résume l’accueil du public et le dossier de presse par l’image hyperbolique un four noir. Quel rôle la critique dramatique a-t-elle joué dans l’échec des premières pièces de Gide ? L’auteur des Lettres à Angèle exagère-t-il la bêtise critique pour mettre en garde sur la subtilité de son univers dramatique ?
Hélène Baty-Delalande, « “Cédez tentation pour amour Melpomène et amis.” Gide et Martin du Gard : critiques croisées »
Roger Martin du Gard et André Gide ont en commun une ambition dramatique réelle, mais intermittente et parfois décevante. Courant tout au long 445de leur dialogue littéraire, depuis le début de leur amitié, les réflexions et les conseils sur leurs œuvres dramatiques témoignent d’une attention commune portée au dialogue de théâtre et à la vérité humaine qu’il suggère, par-delà les différences esthétiques : réalisme ou distance ironique, objectivité ou creusement subjectif des caractères.
Maja Vukušić Zorica, « Gide bordé de pourpre. “Deux conférences” »
Représentant d’une génération qui prisait plus le texte que la scène, le sens que le jeu, l’intelligence que l’émotion, André Gide introduit dans les « Deux conférences » les questions du classicisme, du goût, des contraintes et de l’art. Face au Crayonné au théâtre de Mallarmé, le postsymbolisme gidien survit dans le concept de la figure, tout en voulant être dépassé par un théâtre moderne. Inauguré comme un théâtre tripartite, il devait devenir à la fois scénique et non spectaculaire.
Martina Della Casa, « Sur Antoine et Cléopâtre. “J’épouse avec ravissement le texte de Shakespeare” »
Cette contribution porte sur la traduction gidienne d’Antony and Cleopatra de Shakespeare et sur le travail d’adaptation de la pièce en vue de sa mise en scène en 1920, travail qui a passionné l’écrivain de manière tout à fait singulière dans le cadre de son parcours de traducteur. De quelle manière ses interventions sur la structure du texte peuvent-elles nous renseigner sur la nature de cette adaptation et sur l’origine du ravissement qu’il éprouve en travaillant sur ce texte ?
Ophélie Colomb, « Empreintes gidiennes dans la réécriture théâtrale du Procès kafkaïen »
En 1942, André Gide se voit suggérer par Jean-Louis Barrault l’adaptation au théâtre du Procès de Franz Kafka. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1947, Gide questionne de nouveau la justice des hommes en adaptant l’œuvre de l’écrivain tchèque. Au regard d’une comparaison entre l’œuvre originelle et la création dramaturgique, les empreintes gidiennes et contextuelles dévoilent une conception gidienne de la justice.
446Floriane Toussaint, « Gide, dramaturge de Copeau pour Les Frères Karamazov ? »
En avril 1911, le Théâtre des Arts présente l’adaptation des Frères Karamazov par Jacques Copeau. Le rôle central qu’a joué André Gide dans ce projet a été occulté par l’histoire théâtrale, alors qu’il a été conseiller littéraire, confident, premier lecteur et premier spectateur de Copeau – soit son dramaturge. La lecture de leurs Journaux respectifs et de leur Correspondance permet de réévaluer l’importance de Gide dans le mouvement de rénovation du théâtre qu’a initié Copeau avec ce premier spectacle.
Elena Chashchina, « Le reflet dostoïevskien dans Œdipe d’André Gide »
Le présent article propose une interprétation de la pièce Œdipe d’André Gide, qui vise à déterminer les liens explicites et implicites avec l’œuvre de Fiodor Dostoïevski. Sont également évoquées d’autres pièces gidiennes, telles que Philoctète, Le Roi Candaule et Saül. La nature tragique des romans de Dostoïevski est commentée. L’analyse est centrée sur les personnages du drame, qui se regroupent d’après leur orgueil et leur humilité, tout comme les héros dostoïevskiens.
Vincenzo Mazza, « Les premières étapes de la traduction d’Hamlet. D’une mise en échec à un succès tardif »
Le travail de Gide sur la traduction d’Hamlet, puis auprès de Jean-Louis Barrault pour son adaptation, représente un souffle nouveau que peut apporter une collaboration. Avec « la » pièce de Shakespeare, Gide passe par une phase enjouée, avant d’abandonner au début des années vingt son projet, rencontrant finalement le succès qui fera de la Compagnie Renaud-Barrault un symbole de la production théâtrale pendant plus de deux décennies.
Paola Fossa, « La réception des premières œuvres dramatiques de Gide en Italie. Le regard des revues »
Au seuil du xxe siècle, les revues littéraires italiennes présentent les œuvres d’André Gide aux lecteurs. L’intérêt pour le théâtre fait pleinement partie de la réception de l’auteur, mais il faudra attendre 1932 avant de voir une de ses pièces sur scène. Nous allons parcourir la réception « du théâtre avant le théâtre » : la présence des pièces de Gide dans les revues italiennes avant leur représentation, la réception écrite engendrant une abstraction de la spécificité du langage théâtral.
447Mechthilde Fuhrer, « André Gide, adaptation du Procès de Franz Kafka »
André Gide a adapté au Théâtre Marigny Le Procès de Franz Kafka, en 1947. Cette œuvre, traduite de l’allemand et remaniée par lui-même et Jean-Louis Barrault, a connu un certain succès. Cette adaptation scénique fait référence et a influencé d’autres mises en scènes du Procès, en France et surtout en Allemagne. Nous analysons comment André Gide revêt de ce fait le rôle de médiateur culturel.
Marco Longo, « Le Roi Candaule de Cutrufelli. Un souvenir pour des réflexions sur le désir et les avatars du triangle dans le théâtre de Gide »
La reconstruction détaillée de la mise en scène par Giovanni Cutrufelli du Re Candaule en 1951 est prétexte à une réflexion sur le théâtre gidien, projection de hantises et véritable « laboratoire du désir » de l’auteur, notamment le triangle, filtré à travers ses expériences personnelles. L’imaginaire triangulaire se manifeste dans les pièces de jeunesse et constitue le fil rouge des tentatives d’adaptation théâtrale.
Vincenzo Mazza, « Gide in scaena. Principales représentations en langue française de l’œuvre de Gide »
Cette liste restitue les spectacles ayant été créés à partir de la production non exclusivement dramatique de l’auteur du Roi Candaule. Loin d’être exhaustif, cet ensemble de données se veut être à la fois une recherche in fieri et un outil de travail pour chercheurs et passionnés de théâtre.