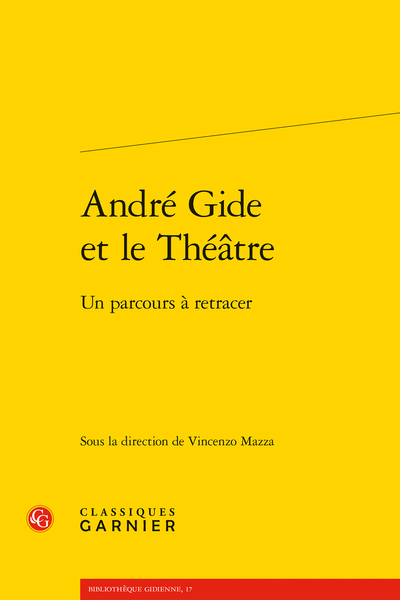
Avant-propos
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: André Gide et le Théâtre. Un parcours à retracer
- Author: Claude (Jean)
- Abstract: Les nombreuses déclarations contradictoires d’André Gide sur le théâtre confirment la complexité de ses rapports avec les arts de la scène. La question du dialogue est centrale pour comprendre la portée de son écriture dramatique. Il s’agit d’un théâtre où l’existence littéraire l’emporte sur l’existence scénique.
- Pages: 9 to 12
- Collection: The Gide Collection, n° 17
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406109679
- ISBN: 978-2-406-10967-9
- ISSN: 2494-4890
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-10967-9.p.0009
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 05-05-2021
- Language: French
- Keyword: Théâtre, dramaturgie, genèse, exégèse, dialogue
Avant-propos
En 1971, Claude Martin, dans un article où il faisait le point sur l’état et le devenir des études gidiennes, notait l’utilité et la nécessité d’une étude sur les rapports de Gide avec le théâtre. Beaucoup de lecteurs de Gide ignoraient encore l’ensemble des écrits dramatiques qu’avait produits l’écrivain, sauf ceux qui avaient dans leur bibliothèque le volume Théâtre édité par les Éditions Gallimard en 1942 mais qui ne contenait que cinq titres, ou ceux qui avaient pu se procurer le volume publié par Richard Heyd, entre 1947 et 1949, à Neuchâtel, intitulé Le Théâtre complet d’André Gide. Il convient de rappeler que la production dramatique de Gide est variée. Elle comporte ses trois drames les plus importants, à savoir Saül, Le Roi Candaule et Œdipe, ainsi qu’une comédie, Le Treizième Arbre, et une pièce aux multiples avatars, difficile à classer : Robert ou L’Intérêt général. S’y ajoutent trois œuvres que Gide avait publiées comme traités, mais qu’à l’origine il destinait expressément pour la scène : Philoctète, Le Retour de l’enfant prodigue et Bethsabé. Gide est aussi l’auteur d’un mélodrame : Perséphone, de fait livret d’opéra pour Stravinsky, et de plusieurs œuvres inachevées dont Le Retour, Ajax et Proserpine, première version de Perséphone. L’ensemble de ces œuvres est désormais disponible dans les deux volumes parus dans la Pléiade en 2009 : Romans et Récits. Œuvres lyriques et dramatiques. Enfin, on ne saurait oublier ni ses adaptations pour le théâtre : celle de son récit Les Caves du Vatican et celle du Procès de Kafka, ni ses traductions d’œuvres dramatiques : Antoine et Cléopâtre et Hamlet de Shakespeare, Amal et la lettre du roi traduit du Post Office de Tagore. Cette production dramatique, même si elle est étalée sur une cinquantaine d’années et, par-delà sa variété, même si elle n’a connu que trop peu de représentations, présente au sein de la carrière littéraire de l’écrivain tous les éléments d’une carrière dramatique.
Pour analyser et comprendre cette production dramatique, son originalité, voire son unité, ainsi que la place qu’elle occupe dans l’ensemble 10des œuvres de Gide, ce que nous avons tenté sous forme de synthèse dans notre étude André Gide et le théâtre, il est d’abord nécessaire de saisir ses rapports avec le théâtre. Certes, à cet égard, il a pu tenir des propos contradictoires. Il a pu ainsi déclarer qu’il n’aimait pas le théâtre, surtout à la suite des déceptions qu’il avait ressenties face à l’accueil que lui avaient réservé certaines publications ou, plus encore, celui de la plupart des représentations de ses œuvres dramatiques. Il faut citer ici l’ambivalence de l’affirmation de l’un de ses proches, Jacques Copeau : « Gide n’aime pas le théâtre. […] Il en parle avec une intelligence souveraine qui touche à l’essence de cet art. » On peut faire effectivement allusion à deux conférences : « De l’importance du public » et « De l’évolution du théâtre », à certaines Lettres à Angèle ou à plusieurs articles des Interviews imaginaires, mais tout autant à son Journal, aux Cahiers de la Petite Dame, à nombre de remarques glissées çà et là dans sa correspondance. De ces propos certes dispersés et parfois lapidaires, se dégagent des idées bien définies sur sa conception de l’art du théâtre.
Si nombre de didascalies jalonnent ses œuvres dramatiques, suffisamment judicieuses pour appeler une mise en scène, notamment dans ses trois grands drames, Gide a difficilement admis les exigences propres à l’existence scénique d’une œuvre dramatique. Il en a accepté la nécessité et a formulé à ce sujet bien des remarques pertinentes. Mais sa principale crainte a été que le texte échappe à son auteur. Qu’il s’agisse de l’approche globale du metteur en scène, du jeu des acteurs, surtout de leur diction, qu’il s’agisse des décors, des costumes ou des accessoires, parfois des accompagnements musicaux, tout, selon lui, doit être soumis au texte. L’accumulation des aléas liés à la représentation de Perséphone en 1934 en fournit un exemple parfait, au point que les arguments des différents intervenants lui ont fait abandonner la partie parce qu’il ne reconnaissait plus son texte et qu’il avait devant lui un univers très éloigné de celui qu’il avait imaginé. Le texte doit être la référence suprême et continuer à la scène de vivre de sa propre vie, celle que l’auteur lui a insufflée. Son existence littéraire doit l’emporter sur son existence scénique.
Cette volonté de Gide d’une soumission au texte théâtral part d’une conception plus générale propre à toute œuvre littéraire. Toute œuvre, quel que soit son genre ou sa destination, doit être une œuvre d’art. C’est ce qui lui fait multiplier les exigences pour tout ce qui concerne la 11réalisation scénique. La distinction qu’il établit dans sa conférence « De l’évolution du théâtre » est éclairante, d’un côté les pièces « de mérite purement littéraire », de l’autre celles « qui n’ont qu’un très lointain rapport avec la littérature ». Il est précisément conscient que ce choix présente un risque, « le risque fort de n’être pas même représenté ». Le risque d’être représenté, il l’a pris mais il a eu de la peine à l’assumer jusqu’à la réalisation finale et parfois au-delà.
Il est possible de trouver bien des explications à une telle attitude. Mais l’une paraît essentielle. Dans son Journal, Gide a revendiqué un « état de dialogue » nécessaire pour écrire. Ce qu’il affirmait en 1940 s’applique rétrospectivement à l’ensemble de son œuvre d’écrivain. Puisque l’œuvre théâtrale s’appuie sur les dialogues des personnages, il pourrait sembler normal qu’il se soit tourné vers le théâtre. Mais sa manière à lui est bien différente du traitement habituel du dialogue théâtral. Plusieurs formes de dialogues s’entrecroisent, s’interpénètrent avec beaucoup de subtilité. En premier lieu, le plus apparent, intervient le dialogue entre le héros, ou la figure centrale, et les autres protagonistes parfois réduits à des rôles subalternes. Plus important est le dialogue qu’entretient le héros avec lui-même, soit dans les monologues ou les apartés, mais tout autant dans l’ensemble du texte, au point que Gide a pu écrire que son Saül n’était qu’un vaste monologue. Ainsi la progression dramatique n’est pas déterminée par des obstacles extérieurs au héros mais par la recherche de lui-même, de sa vérité intérieure, par la résolution parfois tragique des conflits intérieurs qui l’animent. C’est un aspect essentiel lorsque l’on veut examiner comment Gide a utilisé ses sources, qu’elles soient bibliques ou qu’elles appartiennent à la littérature antique. Mais dans ses textes dramatiques, il reste une autre forme de dialogue plus secrète, moins évidente à repérer : le dialogue de l’auteur avec lui-même. Car les conflits qui agitent les personnages, surtout les figures centrales, sont ceux-là mêmes dans lesquels se débat, délibérément ou non, la conscience de Gide. On assiste alors à une sorte de dédoublement, de mise à distance : il se libère de ce qui l’obsède, des pensées qui agitent son esprit, en les confiant à la parole du personnage, donc à l’acteur qui incarnera ce personnage. Le héros vit pour lui une expérience, une évolution qui en réalité met en jeu les propres préoccupations de l’auteur, qu’elles soient morales, religieuses ou politiques, voire esthétiques, mais sans renvoyer à un quelconque événement précis 12de sa vie. Il arrive parfois que les allusions à ces préoccupations portent en elles, par une sorte d’ironie réflexive, une critique implicite. Théâtre critique ? Théâtre ironique ? L’idée serait à creuser. Cependant, il est difficile d’affirmer que le théâtre de Gide soit autobiographique. Le « je » est celui du personnage, jamais celui de l’auteur. Cette distinction propre au genre théâtral permet à l’écrivain un recul libérateur plus affirmé que dans les récits. Mais une telle démarche créatrice ne va pas sans risque sur le plan de la représentation théâtrale, notamment l’accueil du public. Ou bien le spectateur est un bon connaisseur de l’œuvre de Gide et il saisit l’arrière-plan qui s’inscrit dans la trame du texte ; ou bien il n’appréhende ce texte que d’une manière superficielle.
Cet aperçu de quelques grandes lignes qui caractérisent le théâtre de Gide devrait laisser deviner sa complexité. Certaines éditions critiques, les articles et les essais qui ont été publiés depuis une vingtaine d’années ne suffisent pas à la cerner. La voie est à suivre… tout comme l’illusoire attente d’une représentation.
Jean Claude
Université de Lorraine