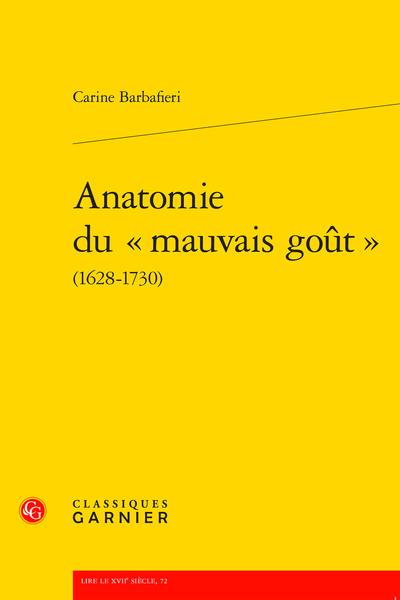
Introduction de la deuxième partie
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Anatomie du « mauvais goût » (1628-1730)
- Pages : 153 à 155
- Collection : Lire le xviie siècle, n° 72
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406113959
- ISBN : 978-2-406-11395-9
- ISSN : 2257-915X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-11395-9.p.0153
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 27/10/2021
- Langue : Français
Introduction de la deuxième partie
Qu’est-ce qu’un texte, un auteur, un lecteur de mauvais goût ? C’est à partir des années 1670 que, dans un contexte hautement polémique, celui de la querelle d’Iphigénie, du sublime et du poème épique, des inscriptions, s’esquisse, parallèlement à un examen des défauts comme de possibles négligences, une réflexion sur les procédés esthétiques de mauvais goût, fruit de mauvais choix théoriques (au plan du dessein) ou de techniques mal maîtrisées (au plan de l’exécution) de la part de l’auteur, autant que sur la froideur et l’incompétence du lecteur. Une deuxième vague de réflexions sur le texte de mauvais goût survient dans les années 1710, dans le cadre de la querelle d’Homère. Lors de ces deux « moments critiques » (années 1670-1680 et années 1710-1730), la question du sublime sous-tend vivement le débat sur le goût et le mauvais goût, et l’expression « mauvais goût » surgit dans un contexte où elle vise à disqualifier l’ennemi, mauvais auteur ou mauvais juge. La poésie d’Homère et, plus largement, la poésie épique cristallisent le débat : ne pas apprécier Homère, est-ce être insensible à la beauté, ce dont les Anciens accusent les Modernes, ou est-ce inversement juger sans prévention, sans avoir en tête la vénération transmise par l’école, comme le prétendent les Modernes ?
La constitution des camps toutefois est moins rigide qu’il n’y paraît et les positions sont forcées, dans les textes polémiques, pour accentuer des oppositions de principes : le mauvais goût n’est pas une notion critique objective et, parce qu’elle est hautement disqualifiante, elle servira même de principe discriminant, après 1730, pour classer les ouvrages, les auteurs, organiser et régenter les bibliothèques, comme l’a montré Jennifer Tsien1. Avant les années 1730, le thème de la prolifération des livres, qui entraîne celui de la nécessité du tri, existe, véritable lieu commun des bibliographes 154effrayés par la quantité d’ouvrages à répertorier2, mais il n’est pas suivi de l’usage de l’expression « mauvais goût ». Cette expression n’apparaît pas, par exemple, lorsque François Colletet, fils de Guillaume, se demande en 1665, au sein d’un poème, « s’il est nécessaire d’avoir beaucoup de livres3 » ni lorsque Richesource pose, la même année, à son public mondain, au sein d’une conférence, le problème : « si l’imprimerie a causé plus de mal que de bien à la République des Lettres4 ». L’expression pour frapper de bannissement est plutôt « mauvais livres » ou « méchants livres », qui désignent d’abord, dans les deux premiers tiers du xviie siècle, les livres menaçant l’Église ou l’État, présentant un danger pour la morale, la religion, l’ordre public, puis également, dans le dernier tiers du siècle, les livres esthétiquement défectueux5.
Or le méchant/mauvais livre6, à partir des années 1670, n’est pas exactement le livre de mauvais goût, puisque le premier condamne seulement l’auteur qui l’a écrit alors que le livre de mauvais goût a aussi en tête la réception du lecteur. Mauvais livres et livres de mauvais goût naissent bien tous deux de la vanité des auteurs, qui leur voile qu’ils sont dénués de talent, ou encore de leur « démangeaison d’écrire », qui les empêche de retenir leur plume. Ces « démangeaisons d’écrire », véritable prurit de l’esprit, constituent même un mal très répandu dans la deuxième moitié du xviie siècle, que déplorent à la fois Molière7, Grenaille8, Donneau de Visé9, Guéret10 et le vieux La Mothe Le Vayer :
155Ce n’est pas sans sujet que les meilleures plumes et les mieux taillées ont nommé la démangeaison d’écrire une maladie d’autant plus dangereuse qu’elle est incurable : Tenet insanabile multos scribendi cacoethes11.
Mais le livre de mauvais goût regarde aussi du côté du lecteur, dont il se préoccupe. Dire qu’un livre est de mauvais goût, c’est sous-entendre qu’il sera trouvé mauvais par un lecteur sain mais aussi qu’il pourra être trouvé bon par qui juge mal. Il importe donc aussi de prendre en considération ce lecteur, ce dont n’avait cure la formulation « mauvais/méchant livre » qui se contentait de condamner l’ouvrage en lui-même.
Accuser un texte d’être de mauvais goût revient ainsi à stigmatiser son auteur qui manque de discernement, d’adresse, de politesse dans son art, mais aussi à plaindre le lecteur qui, s’il juge bien, éprouvera énervement, colère, déception, ennui, répulsion devant ce mauvais texte. Le « mauvais goût » doit donc s’envisager aussi du côté du récepteur pour essayer de comprendre l’ensemble des émotions négatives et désagréables qui l’assaillent, déplaisirs que l’époque nomme dégoût.
1 J. Tsien, Le Mauvais goût des autres. Le jugement littéraire dans la France du xviiie siècle, trad. L. Bury, Paris, Hermann, 2017. L’ouvrage était paru initialement en anglais sous le titre The Bad Taste of Others. Judging Literary Value in Eighteenth-Century France, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2012.
2 Voir J.-M. Chatelain, « L’excès des livres et le savoir bibliographique », Littératures classiques, no 66, 2008, p. 145-160.
3 F. Colletet, La Muse coquette. Troisième et quatrième partie, Paris, J.-B. Loyson, 1665, p. 187.
4 Richesource, Troisième partie des conférences académiques et oratoires, « Douzième conférence de l’académie des orateurs dédiée à M. Colbert, sur la question posée par M. de Cany, si l’imprimerie a causé plus de mal que de bien à la République des Lettres », Paris, Académie des orateurs, 1665.
5 Voir A. Volpilhac, « Le secret de bien lire ». Lecture et herméneutique de soi en France au xviie siècle, Paris, H. Champion, 2016, p. 57-101.
6 La synonymie des deux adjectifs mauvais et méchant est attestée par tous les dictionnaires de l’époque.
7 Le Misanthrope, I, 2, v. 344-347.
8 François de Grenaille, La Sage résolu contre la fortune et contre la mort […]. Seconde partie,Rouen, C. Besongne, 1662 [1re éd. 1651], Entretien II « Des écrits et des auteurs », p. 11.
9 Défense de la Sophonisbe de Monsieur de Corneille, Paris, C. Barbin, 1663, p. 79 ; Jean Donneau de Visé et la querelle de Sophonisbe. Écrits contre l’abbé d’Aubignac, éd. B. J. Bourque, Tübingen, Narr, 2014, p. 70.
10 Guéret, Le Parnasse réformé, Paris, 1671 [1re éd. 1668], p. 13.
11 La Mothe Le Vayer, Œuvres, Dresde, M. Groell, 1757, tome V, partie 2, « Discours pour montrer que les doutes de la philosophie sceptique sont de grand usage dans les sciences », p. 13. Le vers cité est de Juvénal, Satires, VII, v. 51-52, (« Combien restent prisonniers d’une incurable manie d’écrire qui vieillit dans leur cœur malade ! »), trad. P. de Labriolle et F. Villeneuve, Paris, Les Belles Lettres, 1921, p. 90.