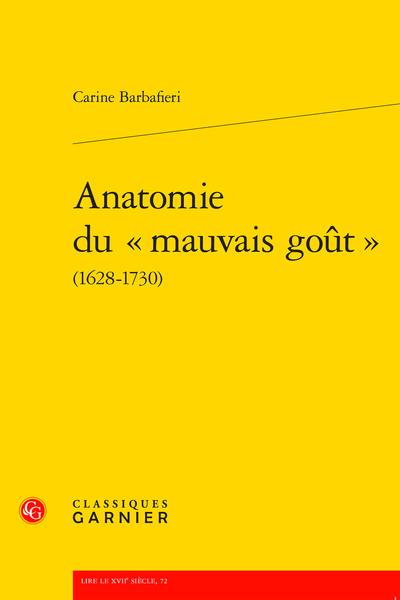
Chronologie
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Anatomie du « mauvais goût » (1628-1730)
- Pages : 431 à 447
- Collection : Lire le xviie siècle, n° 72
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406113959
- ISBN : 978-2-406-11395-9
- ISSN : 2257-915X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-11395-9.p.0431
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 27/10/2021
- Langue : Français
CHRONOLOGIE
La période d’étude de ce travail débute par la querelle de la régularité au théâtre (1628) qui pose le problème du lien entre raison et plaisir et voit émerger la notion de goût, et s’achève sur une autre querelle des règles dans la tragédie où se rejoue ce lien (1730). Toutefois nous avons indiqué, à titre de repères, les dates importantes pour notre propos à partir de 1606 et jusqu’en 1757.
|
1606 |
Malherbe annote son exemplaire des Premières Œuvres (Paris, Mamert Patisson, 1600) de Desportes. |
|
Date probable de composition de la satire IX de Mathurin Régnier contre Malherbe. |
|
|
1610 |
Publication de l’Académie de l’Art poétique du malherbien Pierre de Deimier. |
|
1615 |
Mort de la reine Marguerite et disparition de la cour ronsardienne de la rue de Seine. |
|
1617 |
Parution du Banquet des sages […] pour servir d’avant-goût à l’inventaire de quatre mille grossières ignorances et fautes notables, de Garasse. |
|
1619 |
Parution des Histoires tragiques de F. de Rosset. |
|
1623 |
Théophile, Première Journée, perçue par le ronsardien Claude Garnier comme une attaque contre Ronsard. |
|
Préface de Chapelain à L’Adone du Cavalier Marin, où Chapelain montre que L’Adone n’enfreint nullement les règles sur le poème épique fixées par Aristote. |
|
|
Traduction en français de l’ouvrage de Francis Bacon paru en 1605 en latin, sous le titre Du progrès et de la promotion des savoirs : « Les parties du savoir humain correspondent respectivement aux trois parties de l’entendement de l’homme, qui est le siège du savoir : l’histoire correspond à sa mémoire, la poésie à son imagination, et la philosophie à sa raison ». |
|
|
1624 |
Réponse à Théophile du ronsardien Claude Garnier, dans Le Frelon du temps et La Muze infortunée. |
|
Publication des Premières Lettres de Guez de Balzac. |
|
| 432
1626 |
Marie de Gournay, L’Ombre de la Demoiselle de Gournay, qui reparaîtra, avec d’importants ajouts et variations, en 1634 et en 1641 sous le titre Les Advis, ou les présents de la Demoiselle de Gournay. |
|
1627 |
Sorel, « Le Banquet des dieux » au sein du troisième livre du Berger extravagant. |
|
Ogier, Apologie pour Mr de Balzac, manifeste en faveur des modernes, contre les savants de la Montagne Sainte-Geneviève et Goulu en particulier. |
|
|
1628 |
Ogier, « Préface au Lecteur » en tête de Tyr et Sidon de Jean de Schélandre, véritable apologie de la modernité théâtrale (et à ce titre de la tragi-comédie). |
|
Publication du cinquième et dernier tome du Théâtre d’Alexandre Hardy, précédé d’une violente préface anti-malherbienne, qui vise particulièrement P. Du Ryer et J. Auvray, malherbiens auteurs de tragi-comédies. |
|
|
Réponse de P. Du Ryer et J. Auvray dans la Lettre à Poliarque et Damon sur les médisances de l’Auteur du Théâtre. |
|
|
Réplique de Hardy à P. Du Ryer et J. Auvray, La Berne des deux rimeurs de l’Hôtel de Bourgogne. |
|
|
Mort de Malherbe. Inventaire de la bibliothèque de sa dernière demeure (rue des Fossés-Saint-Germain-l’Auxerrois) établi le 14 octobre 1628. Figure dans cette bibliothèque l’exemplaire annoté des Premières Œuvres de Desportes (Paris, Mamert Patisson, 1600), que Guez de Balzac, partisan et admirateur de Malherbe, acquiert en 1653. |
|
|
1629 |
N. Faret, préface aux Œuvres de Saint-Amant dans laquelle Faret célèbre l’alliance de l’ingéniosité et de la mesure de son ami. |
|
Chapelain, Lettre sur la règle des vingt-quatre heures. |
|
|
1630 |
Dernière édition collective des Œuvres de Ronsard avant le xixe siècle, Paris, Buon et Macé, 1629-1630, 5 vol. |
|
Réunion des œuvres de Malherbe en un recueil, Œuvres complètes de Malherbe, par Arbaud de Porchères. Godeau préface ce recueil de son Discours sur les œuvres de M. de Malherbe, texte très important qui était paru séparément un an auparavant, en 1629. Ce Discours assure la promotion de la notion de « goût du siècle ». |
|
|
Godeau, Préface à Des causes de la corruption de l’éloquence, dialogue attribué par quelques-uns à Tacite et par d’autres à Quintilien, traduit par L. Giry, Paris, Charles Chappelain, 1630. |
|
|
N. Faret, L’Honnête homme ou l’art de plaire à la cour. |
|
|
Camus, Spectacles d’horreur, avec une préface. |
|
|
1634 |
Marie de Gournay, Les Advis et presens de la demoiselle de Gournay. |
|
Léon Alacci, Des fautes des grands hommes dans le discours, relais important dans la théorie du sublime. |
|
| 433
1635 |
Discours sur Homère prononcé par Boisrobert devant l’Académie française (non conservé). |
|
1637 |
Vers 1636-1637, Desmarets de Saint-Sorlin commence son Clovis. |
|
Création des Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin, comédie qui se moque de la figure du poète renaissant. |
|
|
Publication de la lettre latine adressée par Guez de Balzac à Silhon (lettre sans doute écrite vers 1635) qui pose Malherbe en rénovateur absolu et établit une ligne de fracture radicale entre Ronsard et lui, correspondant à la différence de deux siècles. Célébration de la douceur, qui est celle de Malherbe mais aussi de Cicéron (contre Sénèque). |
|
|
Vaugelas offre aux Messieurs de l’Académie Françaises ses « observations sur la langue », sous forme de manuscrit. |
|
|
Adrien de Monluc (comte de Cramail), Le Philosophe gascon. Discours moral dans le goût de Montaigne. |
|
|
Création du Cid de Corneille, suivie d’une vive querelle. |
|
|
1638 |
Ménage, La Requête des Dictionnaires (contre la réforme puriste de la langue). |
|
La Mothe Le Vayer, Considérations sur l’éloquence française de ce temps (contre la réforme puriste également). |
|
|
Saint-Évremond, La Comédie des Académistes (contre l’Académie Française) circule sous forme de manuscrit. |
|
|
Cotin, Discours sur les énigmes. |
|
|
1639 |
La Mesnardière, La Poétique. |
|
1641 |
Nouvelle édition avec des modifications des Advis ou Présens de la demoiselle de Gournay. |
|
1642 |
Grenaille, La Mode, contre ceux qui malmènent l’usage, tels Ronsard. |
|
1643 |
La Mothe Le Vayer, Petit traité sceptique sur cette commune façon de parler : N’avoir pas le sens commun. |
|
1644 |
Camus, Rencontres funestes, préface. |
|
1647 |
Chapelain écrit entre octobre 1646 et août 1647 « De la lecture des vieux romans ». |
|
Vaugelas, Remarques sur la langue française. |
|
|
La Mothe Le Vayer, Nouvelles Remarques sur la langue française. |
|
|
1649 |
Sarasin compose « S’il faut qu’un jeune homme soit amoureux ». |
|
Abraham Bosse, Sentiments sur la distinction des diverses manières de peinture. |
|
|
1651 |
Scipion Dupleix, Liberté de la langue française dans sa pureté. |
|
La Varenne, Le Cuisinier français. |
|
|
1652 |
En 1652-1653, composition du dernier des jugements de Balzac sur Malherbe, Entretien XXXI, « Comparaison de Ronsard et Malherbe », qui souligne la faveur de Ronsard en province |
| 434 |
Ménage, Dissertation sur les sonnets pour la Belle matineuse. Les commentaires de Ménage font intervenir la notion de « goût ». |
|
P. Mambrun, Dissertatio peripatetica de epico carmine. |
|
|
1653 |
Préface de Moïse sauvé de Saint-Amant, où il se justifie d’avoir sous-titré son poème « idylle héroïque » et non pas « poème héroïque » ou « épopée ». Il dit s’être fait de nouvelles règles, inconnues d’Aristote, du fait de la « nouveauté de l’invention » et se réclame de « la seule Raison » qui permet de juger si « une chose [est] judicieuse et […] convien[t] aux personnes, aux lieux et aux temps ». |
|
P. Le Moyne, Saint Louis, épopée. |
|
|
Colletet, Épigrammes avec un discours de l’épigramme. |
|
|
1654 |
G. de Scudéry, Alaric ou Rome vaincue, avec une préface. |
|
Godeau, Saint Paul, poème chrétien (épopée) avec une préface. |
|
|
1656 |
Chapelain, La Pucelle ou la France délivrée, dotée d’un important « avis ». |
|
La Mesnardière critique La Pucelle dans sa Lettre du Sieur Du Rivage contenant quelques observations sur le poème épique, et sur le poème de La Pucelle qui souligne les « messéances » de l’épopée de Chapelain. |
|
|
Très longue réponse de Chapelain à La Mesnardière : Réponse du Sieur de la Montagne au Sieur du Rivage où ses observations sur le poème de La Pucelle sont examinées. |
|
|
1657 |
Desmarets, Clovis ou la France chrétienne, avec un « avis » au lecteur contre le caprice de certains qui s’autorisent à pratiquer une nouvelle prononciation et méprisent les vieux mots dans le poème héroïque. |
|
Publication de La Pratique du théâtre de d’Aubignac, composée avant la mort de Richelieu. |
|
|
Guez de Balzac, Entretiens. |
|
|
[enfant Beauchâteau], La Lyre du jeune Apollon ou la Muse naissante du petit de Beauchâteau. |
|
|
1658 |
P. Le Moyne, Traité du poème héroïque en tête de la seconde édition de son Saint Louis, remanié à la suite des remarques du P. Mambrun. |
|
1659 |
Dissertation De vera pulchritudine et adumbrata, en tête du recueil Epigrammatum delectus, attribuée à Nicole. |
|
1660 |
Corneille, Discours sur le poème dramatique. |
|
Découverte du canal de Sténon par Niels Stensen. |
|
|
1661 |
P. L. Le Brun, Dissertatio de epico carmine. |
|
1662 |
Marolles, Traité du poème épique, conçu comme une sorte de complément aux remarques contenues dans sa traduction en prose des œuvres de Virgile (publiée en 1649, revue en 1662) : L’Énéide, les Bucoliques et les Géorgiques de Virgile en latin et en français […] accompagnées d’un traité du poème épique. |
| 435 |
Arnaud et Nicole, La logique, ou l’art de penser. |
|
Identification par Niels Stensen des canaux palatins et sublinguaux (G. Guéret fera allusion aux découvertes de Stensen dans sa Requête et arrêt en faveur d’Aristote, parue en 1671). |
|
|
1663 |
Coras, Jonas ou Ninive pénitente, épopée précédée d’une importante préface. Coras, calviniste qui se convertit au catholicisme, préfère, même dans une épopée, « la douceur et la clarté à la force et à l’éclat des expressions ». |
|
D’Aubignac, dans ses dissertations contre Sophonisbe et Sertorius de Corneille (Deux dissertations concernant le poème dramatique, en forme de remarques sur deux tragédies de M. Corneille intitulées Sophonisbe et Sertorius), évoque le « tribunal secret » des honnêtes gens qui leur permet de juger sans connaître les règles. |
|
|
Molière, La Critique de l’École des Femmes. |
|
|
Cotin, Lettre à Monsieur Tuffier […] sur la satire et principalement sur le Madrigal. |
|
|
1664 |
Louis Le Laboureur publie les trois premiers livres de son Charlemagne, précédés d’une importante préface peu encline à l’enthousiasme et l’énergie, même pour la poésie épique : est préféré le style simple et naturel. |
|
Sorel, La Bibliothèque française. |
|
|
Les Chevilles de Maître Adam, menuisier de Nevers. |
|
|
1665 |
La Rochefoucauld, Réflexion X, « Des goûts ». |
|
La Fontaine, préface de la première partie des Contes et nouvelles en vers. |
|
|
Lorenzo Bellini propose une interprétation de la fonction des papilles gustatives et Marcello Malpighi découvre la couche réticulaire muqueuse de la langue. |
|
|
1666 |
Publication des Satires I-VII de Boileau qui osent nommer les personnes. |
|
Première publication des Scaligerana qui rapportent les bons mots de l’humaniste protestant Joseph-Juste Scaliger. L’ouvrage, plein de moqueries acerbes à l’égard des savants de son époque (dont les descendants sont bien vivants dans les années 1660), voire de termes orduriers, est suivi d’un parfum de scandale, qui lui vaudra d’être sans cesse réimprimé ou contrefait, jusqu’à l’édition Des Maizeaux en 1740. |
|
|
La Fontaine, préface de la deuxième partie des Contes et nouvelles en vers. |
|
|
Ménage, Observations sur les poésies de Malherbe. |
|
|
Carel de Sainte-Garde, Les Sarrasins chassés de France, épopée qui a pour héros Childebrand, dont se moquera Boileau dans son Art poétique. |
|
|
Louis Le Laboureur publie les livres IV, V et VI de son épopée Charlemagne. |
|
|
Furetière, Le Roman bourgeois, précédé d’un « Avis au Lecteur » qui s’achève sur la promesse de l’auteur d’écrire une suite au Roman bourgeois si le lecteur « y trouve du goût ». |
|
| 436 |
Félibien, Entretien sur les vies et les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes. |
|
1667 |
Date probable de la composition par Chapelain de la préface des livres XIII à XXIV de La Pucelle. |
|
Traduction en français du Nouveau Testament par les Messieurs de Port-Royal (traduction dite du Nouveau Testament de Mons). |
|
|
Nicole, Lettres sur l’hérésie imaginaire (également appelées Les Imaginaires). |
|
|
Nicole, Traité de la comédie. |
|
|
Début des conférences de l’Académie Royale de peinture et de sculpture (éditées par Félibien). |
|
|
1668 |
Bouhours, Lettre à un seigneur de la Cour, contre la traduction du Nouveau Testament élaborée à Port-Royal. |
|
Méré, « De la conversation ». |
|
|
Guéret, Le Parnasse réformé. |
|
|
Segrais, longue préface à sa Traduction de l’Énéide de Virgile (qui est une traduction des six premiers livres de l’Énéide, sa traduction des six derniers livres paraissant en 1681). |
|
|
La Fontaine, publication du premier recueil des Fables. Contient une importante préface et, dans le livre II, une fable intitulée « Contre ceux qui ont le goût difficile ». |
|
|
Subligny, La Folle Querelle ou la Critique d’Andromaque. |
|
|
L ’ Art de peinture de Charles-Alphonse Dufresnoy traduit en français [par Roger de Piles], avec un glossaire ajouté par R. de Piles. |
|
|
1669 |
Huet, Lettre sur l’origine des romans. |
|
Vavasseur, De epigrammate liber. |
|
|
Molière, La Gloire du Val-de-Grâce, qui célèbre le coloriste Pierre Mignard. |
|
|
La Fontaine, Les Amours de Psyché et de Cupidon, qui contiennent l’histoire enchâssée de Myrtis et Mégano, « la grâce plus belle que la beauté ». |
|
|
Boileau, Dissertation sur Joconde, où Boileau trouve qu’il faut avoir « le goût bizarre » pour préférer la froide narration de Bouillon au conte de La Fontaine. |
|
|
Louis Le Laboureur, Les Avantages de la langue française sur la langue latine. |
|
|
La Mothe Le Vayer, Discours pour montrer que les doutes de la philosophie sont de grand usage dans les sciences. Sur les « démangeaisons d’écrire » qui poussent à écrire ceux qui devraient s’abstenir. |
|
|
1670 |
[Desmarets de Saint-Sorlin] « L’excellence et les plaintes de la poésie héroïque », en tête de son poème héroïque Esther. |
|
Desmarets de Saint-Sorlin, Comparaison de la langue et de la poésie française avec la grecque et la latine, et des Poètes grecs, latins et français. |
|
| 437 |
La première partie de l’ouvrage est consacrée à la critique des auteurs anciens et à la défense des poètes français du xviie siècle, la deuxième contient pour l’essentiel diverses pièces de Desmarets, des extraits de Virgile traduits et comparés à divers passages de Clovis. |
|
La Mothe Le Vayer, Hexaméron rustique. La « quatrième journée » reprend, dans une version différente, L’Explication de l’antre des nymphes qui circulait sous forme de manuscrit. |
|
|
Nicole, De l’éducation d’un Prince. |
|
|
1671 |
Sorel, De la connaissance des bons livres. |
|
Guéret, La Guerre des Auteurs anciens et modernes. |
|
|
Recueil de poésies chrétiennes et diverses, avec une importante préface attribuée à Nicole. |
|
|
Bouhours, Entretiens d’Ariste et d’Eugène. Le second entretien « De la langue française » trouve que l’agréable « je ne sais quoi » fait défaut aux solitaires de Port-Royal dans leurs traductions. |
|
|
Barbier d’Aucour, Sentiments de Cléante sur les Entretiens d’Ariste et d’Eugène. |
|
|
Montfaucon de Villars, De la délicatesse. |
|
|
Rapin, Réflexions sur l’usage de l’éloquence de ce temps. |
|
|
Conférence du coloriste Louis-Gabriel Blanchard prononcée à l’Académie Royale de peinture et de sculpture, « Sur le mérite de la couleur ». |
|
|
1672 |
Parution de la Vie de Malherbe écrite par Racan. |
|
Ménage, Observations sur la langue française. |
|
|
1673 |
Desmarets de Saint-Sorlin publie une nouvelle version de son Esther ainsi qu’une nouvelle version, fortement remaniée, de son Clovis. Cette nouvelle version de Clovis est précédée d’un « Discours pour prouver que les sujets chrétiens sont les seuls propres à la poésie héroïque », où il défend de nouveau le merveilleux chrétien, contre Boileau qui à cette époque lisait déjà son Art poétique dans les salons. Cette édition de Clovis est aussi pourvue de la « seconde épître au Roi », du « Traité pour juger des poèmes grecs, latins et français » qui reprend La Comparaison de la langue et de la poésie française avec la grecque et la latine parue en 1670. |
|
Marolles, Discours apologétique pour Virgile et Considérations sur le poème épique de Clovis composé par Monsieur Des Marets. |
|
|
[Desmarets], Lettre de Monsieur des Marets à Monsieur l’abbé de La Chambre sur le sujet apologétique de Monsieur l’abbé de Villeloin pour Virgile, et de ses Observations sur le poème de Clovis. |
|
|
Marolles, Quelques Observations sur la lettre de Monsieur Desmarets à Monsieur l’abbé de la Chambre, concernant un discours apologétique pour Virgile, avec des considérations sur le poème de Clovis. |
|
| 438 |
Molière, Le Malade imaginaire, dont l’intermède final est en latin macaronique. |
|
Montfleury fils, L’Ambigu comique ou les Amours de Didon et Énée, qui crée le genre de l’ambigu au théâtre. |
|
|
René Bary, Journal de conversation. Contient un dialogue sur les mauvais lecteurs. |
|
|
Saint-Glas, Contes nouveaux en vers. |
|
|
Roger de Piles, Dialogue sur le coloris. |
|
|
Claude Perrault traduit le De architectura de Vitruve afin d’introduire, selon ses propres termes, « le bon goût » en architecture et d’en diffuser la pratique. |
|
|
1674 |
Rédaction de l’Épître à Huet (qui défend les Anciens) de La Fontaine qui, explique Huet dans ses Mémoires, s’ajoute à un cadeau (une édition de Quintilien en italien) que La Fontaine lui avait fait pour célébrer l’élection de Huet à l’Académie Française, le 13 août 1674. L’Épître à Huet ne sera publiée qu’en 1687, lors du déclenchement officiel de la Querelle des Anciens et des Modernes. |
|
P. Rapin, Réflexions sur la poétique d’Aristote et sur les ouvrages des poètes anciens et modernes. |
|
|
Parution de l’Art poétique de Boileau et de sa traduction du Traité de sublime. |
|
|
Desmarets de Saint-Sorlin, La Défense du poème héroïque, avec quelques remarques sur les œuvres satiriques du Sieur D***, qui réagit à la publication de l’Art poétique de Boileau. |
|
|
Malebranche, De la recherche de la vérité, dont le livre II est consacré à l’imagination. |
|
|
L. S. R., L’Art de bien traiter, ouvrage qui connaît un très grand succès et qui contribue à hausser la cuisine au rang des arts nobles. |
|
|
1675 |
Pierre Perrault, Critique de l’opéra ou examen de la tragédie lyrique intitulée Alceste ou le triomphe d’Alcide. |
|
Racine, préface d’Iphigénie. |
|
|
Pierre Perrault, Lettre à M. Charpentier de l’Académie française sur la préface de l’Iphigénie de M. Racine. |
|
|
Desmarets, Défense de la poésie et de la langue française adressée à Ch. Perrault. Desmarets s’insurge contre les Français qui écrivent des poésies en latin, comme le P. Commire et Santeuil. |
|
|
P. René Le Bossu, Traité du poème épique, qui n’a pas pour dessein, explique Le Bossu, d’enseigner à faire une épopée mais bien « de faire mieux concevoir l’Énéide ». |
|
|
[Carel de Sainte-Garde], Défense des beaux esprits de ce temps contre un satirique, où l’auteur justifie le choix de Childebrand comme héros d’épopée. |
|
| 439 |
Bouhours, Remarques nouvelles sur la langue française. |
|
1676 |
Carel de Sainte-Garde, « La défense d’Homère et de Virgile, ou la belle manière de composer un poème héroïque » (dans Réflexions académiques sur les orateurs et sur les poètes), où il défend Homère, Virgile et Aristote contre les Modernes qui les avaient attaqués. |
|
François Charpentier, Défense de la langue française pour l’inscription de l’arc de Triomphe. |
|
|
1677 |
Racine, préface de Phèdre. |
|
Subligny, Dissertation sur la tragédie de Phèdre et Hippolyte. |
|
|
Saint-Évremond, Dissertation sur le mot vaste, qui est aussi une réflexion sur « le mauvais goût » (l’expression figure au début du texte). |
|
|
Marolles, dans ses Considérations en faveur de la langue française, est favorable aux écritures en français plutôt qu’en latin sur les monuments royaux. |
|
|
Roger de Piles, Conversations sur la connaissance de la peinture. |
|
|
1678 |
Fontenelle, Description de l’empire de la poésie : contre « les pensées sublimes » qui ont « quelques pointes si élevées, qu’elles donnent presque dans les nues ». |
|
B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de parler suivie des Nouvelles réflexions sur l’art poétique. Dans « Du poème épique » (qui figure dans les Nouvelles Réflexions sur l’art poétique), Lamy insiste notamment sur la nécessaire « modestie » de l’auteur épique quand il annonce le dessein de son ouvrage. |
|
|
Alemand, Nouvelles Observations, ou Guerre civile des Français sur la langue. |
|
|
Bernier, Abrégé de la philosophie de Gassendi. |
|
|
1679 |
Huet, Demonstratio evangelica, où Huet conteste que Fiat lux soit un exemple de sublime. |
|
Carel de Sainte-Garde, Charles Martel ou les Sarrasins chassés de France, nouvelle version de son épopée parue pour la première fois en 1666. |
|
|
1680 |
Parution de L’Académie des Dames. |
|
1681 |
1681-1686 : Date de composition probable des Dialogues sur l’éloquence de Fénelon parus après la mort de leur auteur. |
|
André Dacier publie entre 1681 et 1689 une traduction d’Horace avec des remarques : Remarques critiques sur les œuvres d’Horace avec une nouvelle traduction. |
|
|
Anne Dacier fait paraître sa traduction des Poésies d’Anacréon et de Sapho, avec une préface. |
|
|
Segrais fait paraître sa traduction des six derniers livres de l’Énéide, la parution des six premiers datant de 1668. |
|
|
Martignac propose sa traduction des œuvres de Virgile (Virgile, de la traduction de M. de Martignac avec des remarques). |
|
| 440 |
[Anonyme], Entretiens galants ou conversations sur la solitude, le tête à tête, le bon goût, la coquetterie. |
|
1682 |
Fleury, Les Mœurs des israélites. |
|
Perrault, Le Banquet des dieux. |
|
|
1683 |
Du Plaisir, Sentiments sur l’Histoire. |
|
Fontenelle, Dialogues des morts. |
|
|
Boileau publie une nouvelle édition du Traité du sublime qui intègre une grande partie des remarques que lui avait communiquées André Dacier sur la traduction du texte grec, et insère dans sa préface à la fois un hommage à André et Anne Dacier et une contestation de la position de Huet. |
|
|
Huet réplique dans une « Lettre à M. de Montausier dans laquelle il examine le sentiment de Longin sur le passage de la Génèse : Et Dieu dit : Que la lumière soit, et la lumière fut », datée du 26 mars 1683. |
|
|
Duverney, Traité de l’organe de l’ouïe, qui met à mal la distinction aristotélicienne entre sens de contact et sens à distance, distinction qui contribuait à disqualifier le goût. |
|
|
1684 |
Saint-Évremond, « Observations sur le goût et le discernement des Français ». |
|
Rapin publie une nouvelle édition, fortement remaniée, de ses Réflexions critiques sous le titre Réflexions sur la poétique et sur les ouvrages des poètes anciens et modernes. |
|
|
Anne Dacier fait paraître les premières traductions françaises en prose de deux pièces d’Aristophane, le Ploutos et Les Nuées avec une ample préface théorique qui comporte de nombreuses considérations sur le goût, à tel point qu’elle doit se reprendre : « Mais ce n’est pas une Dissertation sur le goût, c’est une Préface que je fais sur Aristophane » (Le Plutus et Les Nuées d’Aristophane. Comédies grecques traduites en français. Par Mademoiselle le Fèvre) |
|
|
Fontenelle, De l’origine des fables. |
|
|
Traduction de l’Oraculo manual y arte de prudencia de B. Gracian par Amelot de la Houssaye sous le titre L’Homme de cour. Une place de choix est accordée au goût comme faculté de bien juger pour plaire en société. |
|
|
1685 |
Adrien Baillet, « Des jugements sur les livres en général », traité destiné à servir de préface aux premiers volumes des Jugements des savants. |
|
1686 |
Rapin, Observations sur l’éloquence des bienséances (dans Du grand et du sublime dans les mœurs avec quelques observations sur l’éloquence des Bienséances). |
|
Fontenelle, Préface à l’Histoire des oracles : « Les matières que j’avais en main […] m’ont invité à une manière d’écrire fort éloignée du sublime. Il me semble qu’il ne faudrait donner dans le sublime qu’à son corps défendant ; il est si peu naturel ». |
|
| 441 |
Charles Perrault, Saint Paulin évêque de Nole (épopée). |
|
Saint-Évremond, Sur les poèmes des Anciens. |
|
|
1687 |
Charles Perrault, Le Siècle de Louis-le-Grand. |
|
Publication de l’Épître à Huet de La Fontaine. |
|
|
Longepierre, Discours sur les Anciens. |
|
|
Bouhours, La Manière de bien penser dans les ouvrages d’esprit. |
|
|
Fontenelle, Digression sur les Anciens et les Modernes. |
|
|
1688 |
1688-1697, Perrault, Parallèle des Anciens et des Modernes en ce qui regarde les Arts et les Sciences. |
|
Fontenelle, Poésies pastorales avec un Traité sur la nature de l’églogue. |
|
|
Fontenelle, Digression sur les Anciens et les Modernes. |
|
|
La Bruyère, Les Caractères. Définition du goût dans « Des ouvrages de l’esprit », 10. |
|
|
Andry de Boisregard, Sentiments de Cléarque sur les Dialogues d’Eudoxe et de Philante[contre Bouhours]. |
|
|
1689 |
Locke, Essai sur l’entendement humain, dont le résumé de l’ouvrage, en français, avait été diffusé dès 1688 en France par Jean Le Clerc. |
|
1690 |
Regnard, La Critique de l’homme à bonnes fortunes. |
|
Pierre de Villiers, Réflexions sur les défauts d’autrui. |
|
|
1692 |
1692-1694 : composition des neuf premières Réflexions critiques sur quelques passages de Longin de Boileau, parues ensemble en 1694. |
|
Parution de la traduction française de La Poétique d’Aristote établie par André Dacier, avec des commentaires. |
|
|
Début de la parution des Dialogues des morts de Fénelon. |
|
|
Parution du traité « Du merveilleux qui se trouve dans les poèmes des Anciens » de Saint-Évremond. Est souligné que les dieux de l’antiquité sont souvent invraisemblables et immoraux, dans la mesure où ils inspirent aux hommes et accomplissent eux-mêmes des actions pernicieuses. |
|
|
Parution du traité « Sur la dispute touchant les Anciens et les Modernes » de Saint-Évremond. |
|
|
Bouhours, Suite des Remarques nouvelles sur la langue française. |
|
|
1693 |
Boileau, Ode sur la prise de Namur, précédée d’un « Discours sur l’ode » (réhabilitation de l’inspiration). |
|
Perrault, Lettre à Monsieur D*** touchant la préface de son ode sur la prise de Namur. |
|
|
1694 |
Publication par Boileau des neuf premières Réflexions critiques sur quelques passages de Longin et de la Satire X. |
|
Perrault, Réponse aux réflexions critiques de M. Despréaux sur Longin. |
|
|
Perrault, Apologie des femmes (contre la Satire X de Boileau). |
|
|
Réconciliation entre Perrault et Boileau. |
|
| 442
1695 |
Perrault, préface des Contes en vers. |
|
Pierre de Villiers, Traité de la satire. |
|
|
1696 |
1696-1711 : Charles Perrault, Des hommes illustres qui ont paru en France. |
|
Martignac, Entretiens sur les anciens auteurs. Débute par un entretien entre Cléante et Timandre sur Homère. Timandre d’affirmer : « Notre siècle a donc le goût dépravé de se déchaîner contre Homère ». |
|
|
Gacon, Le Poète sans fard. |
|
|
1697 |
Ch. Perrault, Adam ou la création de l’homme, sa chute et sa réparation, « poème héroïque » précédé d’une préface où Perrault soutient que le poème héroïque se peut « construire en cent manières différentes, rien n’étant plus agréable que la diversité dans les productions de l’esprit ». |
|
Contes et nouvelles de Boccace [ … ] Traduction libre accommodée au goût de ce temps. |
|
|
Bayle, Dictionnaire historique et critique. |
|
|
1698 |
André Dacier, Dissertation critique sur l’Art poétique d’Horace, où l’on donne une idée générale des pièces de théâtre. |
|
1699 |
Fénelon, Les Aventures de Télémaque. |
|
Pierre de Villiers, Entretiens sur les contes de fées et sur quelques autres ouvrages du temps, pour servir de préservatif contre le mauvais goût. |
|
|
Roger de Piles, Abrégé de la vie des peintres. |
|
|
1700 |
Régnier-Desmarais, Dissertation sur Homère. |
|
Regnard, Critique de l’homme à bonne fortune. |
|
|
1701 |
Traduction par Houdar de La Motte du chant I de l’Iliade, dédiée au duc de Bourgogne. |
|
1702 |
Jean-Baptiste Rousseau, Odes. |
|
Morvan de Bellegarde, Lettres curieuses de littérature et de morale. Contient une lettre « Sur le bon goût ». |
|
|
Blaise Gisbert, Le Bon goût de l’éloquence chrétienne. |
|
|
Bayle, « Éclaircissement sur les obscénités » |
|
|
1704 |
Abbé de Gamaches, Système du cœur, ou Conjectures sur la manière dont naissent les différentes affections de l’âme par rapport aux objets sensibles. |
|
1705 |
Le Passe-temps des gens de goût. |
|
Baraton, Poésies diverses. |
|
|
1706 |
Massieu, Défense de la poésie. |
|
Félibien, Conférences de l’Académie Royale […] augmentées […] des traités des dessins, des estampes, de la connaissance des tableaux et du goût des nations. |
|
|
Naissance d’un fœtus formé de deux enfants unis par le bassin, qui meurt rapidement et que Duverney dissèque. Il conclut que le monstre a une conformation interne particulière, merveilleuse d’ingéniosité, qui permettrait presque d’imaginer que le monstre puisse rester longtemps en vie. Début en médecine de « la querelle des monstres ». |
|
| 443
1707 |
La Motte publie des Odes avec un Discours sur la poésie en général et sur l’ode en particulier. |
|
Genest, Dissertation sur la poésie pastorale. |
|
|
Lesage, Critique de la comédie de Turcaret. |
|
|
1708 |
Regnard, La Critique du légataire [universel]. |
|
Fin de la rédaction du Traité du sublime de Silvain qui ne sera publié qu’en 1732. |
|
|
André Dacier, Nouveaux Éclaircissements sur les œuvres d’Horace. |
|
|
1709 |
1709-1710 : composition des Réflexions X (contre Pierre-Daniel Huet et Jean Le Clerc ne voyant pas le sublime du Fiat lux), XI (contre Houdar de La Motte s’en prenant à Racine)et XII de Boileau qui paraîtront, de manière posthume, en 1713. |
|
Fraguier, Le Caractère de Pindare. |
|
|
Saint-Gilles, La Muse mousquetaire. |
|
|
1711 |
Traduction de l’Iliade en français par Anne Dacier, « avec des remarques » (L’Iliade d’Homère traduite en français avec des remarques). |
|
Pierre de Villiers, Épître sur l’opéra. |
|
|
Dufresny, Parallèle burlesque, ou Dissertation ou discours qu’on nommera comme on voudra, sur Homère et Rabelais (dans Œuvres de Monsieur Dufresny, Paris, Briasson, 1731, t. V). |
|
|
Shaftesbury, Caractéristiques des hommes, des mœurs, des opinions, des temps. |
|
|
1712 |
Huet, Lettre de M. Huet à M. Perrault sur le Parallèle des Anciens et des Modernes. |
|
1713 |
Parution des trois dernières Réflexions critiques de Boileau dans l’édition de ses Œuvres complètes. |
|
Frain du Tremblay, Discours sur l’origine de la poésie, sur son usage et sur le bon goût. |
|
|
1714 |
Publication de la traduction d’Houdar de La Motte, L’Iliade, poème, avec un Discours sur Homère. |
|
Fénelon, Lettre à l’Académie. |
|
|
1713-1714 : Correspondance entre La Motte et Fénelon sur Homère : Lettres de La Motte et de Fénelon sur Homère et sur les anciens, éd. M. E. Dubois, Paris, 1845. |
|
|
Abbé de Pons, Lettre à M*** sur l’Iliade de M. de La Motte (en faveur de La Motte). |
|
|
La Motte, Réponse à la onzième Réflexion de M. Despréaux sur Longin. |
|
|
[Van Effen ?]Dissertation sur Homère et Chapelain. |
|
|
Fontenelle, De l’origine des fables. |
|
|
Thémiseul de Saint-Hyacinthe, Le Chef d’œuvre d’un inconnu. |
|
|
1715 |
Salengre, Histoire de Pierre de Montmaur. |
| 444 |
Crousaz, Traité du Beau. |
|
Suite de la Querelle d’Homère déclenchée l’année précédente. |
|
|
Anne Dacier, Des causes de la corruption du goût (février 1715). |
|
|
La Motte publie les trois premières parties des Réflexions sur la critique. |
|
|
Gacon, Dissertations sur les ouvrages de M. de La Motte [contre les Réflexions sur la critique de La Motte]. |
|
|
Gacon, Homère vengé, ou Réponse à M. de La Motte sur l’Iliade [défendant Homère]. |
|
|
Boivin, Apologie d’Homère, et Bouclier d’Achille[défendant Homère et Anne Dacier]. |
|
|
Buffier, Homère en arbitrage, tente de réconcilier les deux partis (mai 1715). |
|
|
Terrasson, Dissertation critique sur l’Iliade [favorable à La Motte] (juillet 1715). |
|
|
Publication posthume des Conjectures académiques ou dissertation sur l’Iliade de l’abbé d’Aubignac, qui met en doute l’existence d’Homère (novembre 1715). |
|
|
Thémiseul de Saint-Hyacinthe, Lettre à Madame Dacier puis Seconde Lettre à Madame Daciersur son livre Des causes de la corruption du goût. Dans cette seconde lettre, Saint-Hyacinthe reproche à Anne Dacier de ne pas avoir défini précisément le goût et le mauvais goût. |
|
|
1716 |
Fourmont, Examen pacifique de la querelle entre Mme Dacier et M. de La Motte sur Homère. |
|
Abbé de Pons, Observations sur divers points concernant la traduction d’Homère [contre Mme Dacier et Fourmont]. |
|
|
Hardouin, Apologie d’Homère, février-mars 1716 : Hardouin soutient que l’Iliade a été écrite pour célébrer le seul Énée et qu’il faut procéder à une lecture allégorique du poème (les dieux figurent des vertus morales ou des forces météorologiques). |
|
|
Anne Dacier, Homère défendu contre l’apologie du P. Hardouin. |
|
|
Terrasson, Addition à la Dissertation critique sur l’Iliade d’Homère (décembre 1716). |
|
|
Anne Dacier, L’Odyssée d’Homère, traduite en français. |
|
|
Réconciliation de La Motte avec ses adversaires par l’intermédiaire de Valincour le 3 avril 1716. |
|
|
Seconde édition des Réflexions sur la critique de La Motte, qui contient le Discours sur le différent mérite des ouvrages d’esprit. |
|
|
1717 |
Marivaux, Homère travesti ou Iliade en vers burlesques. |
|
Ramsay, Discours de la poésie épique et de l’excellence du poème de Télémaque. |
|
|
Abbé de Pons, Dissertation sur le poème épique contre la doctrine de M. D. [Dacier]. |
|
| 445 |
Abbé Trublet, Réflexions sur le Télémaque. |
|
[Anonyme], La Critique des Eaux d’Eauplet. |
|
|
1718 |
Traduction de Quintilien (qui contient l’unique occurrence de gustus au sens figuré) par l’abbé Gédoyn. |
|
Fénelon, Dialogues sur l’éloquence. |
|
|
Abbé de Gamaches, Les Agréments du langage réduits à un même principe. |
|
|
1719 |
Parution des Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture de Du Bos. |
|
Parution de l’Œdipe de Voltaire qui avait été représenté triomphalement en 1718, avec, dans un même volume, les Lettres sur Œdipe qui répondent aux critiques. Œdipe travesti, parodie de la pièce de Voltaire, est donnée sur la scène du Théâtre Italien le 17 avril 1719. Le déclenchement de la querelle d’Œdipe est comparé par le satirique Gacon (qui est un Ancien, auteur d’un Homère vengé en 1715) à la querelle d’Homère. |
|
|
Nouvelle édition, par Mme Dacier, de son Odyssée, avec une réponse à la préface que Pope avait donnée de sa propre traduction de l’Iliade en 1715. |
|
|
1721 |
Traduction française de la Bataille des livres et du Conte du tonneau de Swift. |
|
La Motte, Les Macchabées et « Discours à l’occasion des Macchabées ». |
|
|
1722 |
Parution des Huetiana ou pensées diverses de M. Huet. |
|
La Motte, Romulus et « Discours à l’occasion de Romulus ». |
|
|
Pierrot Romulus, parodie de Lesage et Fuzelier représentée à la Foire Saint-Germain. |
|
|
1723 |
Vers 1723 : date probable de composition des Réflexions sur le goût de l’abbé Gédoyn, qui seront publiées tardivement, en 1767, dans un Recueil d’opuscules littéraires. |
|
La Motte, Inès de Castro et « Discours à l’occasion de la tragédie d’Inès ». |
|
|
Parodie d’Inès de Castro : Agnès de Chaillot de Dominique et Legrand jouée à la Foire Saint-Laurent par les Italiens le 24 juillet. |
|
|
Bel, Apologie de M. Houdar de La Motte. |
|
|
Abbé Desfontaines, Paradoxes littéraires. Anti-paradoxes. |
|
|
1726 |
La Motte, Œdipe et « Discours à l’occasion de la tragédie d’Œdipe ». |
|
L’abbé Sallier prononce devant l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres son « Discours sur l’origine et sur le caractère de la parodie », qui sera publié en 1733. |
|
|
1727 |
Baratier, Contes et nouvelles. |
|
1728 |
Publication du dialogue de Chapelain De la lecture des vieux romans, écrit en 1647, dans la Continuation des mémoires de Littérature et d’Histoire de M. de Salengre, par Desmolets et Goujet. |
| 446
1729 |
[Saint-Hyacinthe ?], L’Anti-Mathanase ou critique du chef-d’œuvre d’un inconnu, le tout critiqué dans le goût moderne. |
|
1730 |
La Motte publie, en deux volumes, ses Œuvres de théâtre. Avec plusieurs discours sur la tragédie. Le premier volume propose un ensemble de textes critiques : (1) quatre discours composés chacun à l’occasion d’une des tragédies (Les Macchabées, Romulus, Inès, Œdipe) augmentés d’un Discours préliminaire ; (2) deux textes nouveaux : Comparaison de la première scène de Mithridate avec la même scène réduite en prose et une ode en prose (La Libre Éloquence) contestant la suprématie du vers. Cet ensemble de textes est communément appelé Réflexions (parfois Discours) sur la tragédie |
|
Voltaire riposte en donnant une nouvelle édition de son propre Œdipe, avec une nouvelle et importante préface qui remplace les lettres critiques originales (L’Œdipe de M. de Voltaire. Nouvelle édition. Avec une préface dans laquelle on combat les sentiments de M. de La Motte sur la poésie). Cette préface entreprend de réfuter les thèses de La Motte et réaffirme la nécessité des trois unités et de la versification dans la tragédie. |
|
|
En mars 1730, La Motte répond à Voltaire dans une Suite des réflexions sur la tragédie où l’on répond à M. de Voltaire. |
|
|
1731 |
Fuzelier, Discours à l’occasion d’un discours de M. de La Motte contre les parodies. |
|
1732 |
Publication du Traité du sublime de Silvain. |
|
1733 |
Voltaire, Temple du Goût. |
|
D. M. Perrin, Entretien de deux Gascons à la promenade sur le Temple du Goût. |
|
|
Pierre-Charles Roy, Essai d’apologie des auteurs censurés dans leTemple du Goût de Voltaire. |
|
|
Claude-Pierre Goujet, Lettre à M*** à un ami au sujet du Temple du Goût de M. de V***. |
|
|
Jean Du Castre d’Auvigny, Observations critiques sur le Temple du Goût. |
|
|
Jean-Antoine Romagnesi, Le Temple du Goût représenté pour la première fois par les Comédiens Italiens […] le 11 juillet 1733. |
|
|
Mme de Saintonge, L’Origine des contes, ou le triomphe de la folie sur le bon goût. |
|
|
Réédition, avec des modifications, des Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture de Du Bos. |
|
|
Publication du Discours sur l’origine et sur le caractère de la parodie de l’abbé Sallier. |
|
|
1734 |
Rémond de Saint-Mard, Trois lettres sur la décadence du goût précédées de Réflexions sur la poésie en général. |
|
Nicolas, Lettres au sujet d’un livre intitulé Réflexions sur la poésie en général. |
|
|
1735 |
Baumgarten, Méditations philosophiques. Est employé pour la première fois le terme esthétique, en latin (aesthetica) |
| 447 |
Abbé Trublet, Essais sur divers sujets de littérature et de morale (parution des deux premiers tomes). |
|
1736 |
Cartaud de la Vilate de Maudouyt, Essai historique et philosophique sur le goût. |
|
Louis-Bernard Castel, Lettre de Monsieur *** à Madame la Princesse *** au sujet des Essais historiques et philosophiques sur le goût. |
|
|
Luigi Riccoboni, Observations sur la parodie. |
|
|
1737 |
[Saint-Mard]Lettre de Madame de *** à Monsieur de ***. Avec la réponse de M. de *** sur le goût et le génie, et sur l’utilité dont peuvent être les règles. |
|
Pope, Les Principes de la morale et du goût, traduits par M. Du Rensel. |
|
|
1738 |
Publication de la Lettre à M. D*** de l’abbé Nadal qui contient une vive réfutation des Réflexions sur la critique de La Motte. |
|
1739 |
Gachet d’Artigny, Relation de ce qui s’est passé dans une assemblée tenue au bas du Parnasse pour la réforme des Belles Lettres. |
|
1741 |
P. André, Essai sur le beau. |
|
1743 |
Jean-Basptiste de Boyer, marquis d’Argens, Réflexions historiques et critiques sur le goût et sur les ouvrages des principaux auteurs anciens et modernes. |
|
1744 |
Le Dénonciateur du mauvais goût, et observations critiques sur l ’ ode de l ’ abbé Pellegrin. |
|
Fougeret de Montbron, Odes dans le goût des autres. |
|
|
1746 |
Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines (sur l’imagination). |
|
Batteux, Les Beaux-Arts réduits à un même principe. |
|
|
1747 |
Jean Fontaine-Malherbe, Le Goût et le Caprice. Épître à Mme du B***. |
|
Lévêque de Pouilly, Théorie des sentiments agréables. |
|
|
Leblanc, Lettre sur l’exposition de 1747. |
|
|
1748 |
Louis Travenol, Épître chagrine du chevalier Pompon à La Babiole contre le bon goût, ou Apologie de Sémiramis, tragédie de Voltaire. |
|
La Mettrie, L’Homme-machine (sur l’imagination). |
|
|
1750 |
Baumgarten, Æsthetica (publication du premier volume). |
|
1752 |
Anneix de Souvenel, Épître à l’ombre de Despréaux, ou Essai sur le goût moderne. |
|
Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaud, Trois ouvrages de goût. Contient Dissertation sur un ancien usage de la ville de Troyes ; L’Art de péter, essai théori-physique ; Sirop-au-cul, tragédie héroï-merdifique. |
|
|
1754 |
Claude-Pierre Patu, Les Adieux du Goût. Comédie représentée par les Comédiens Français le 13 février 1754. |
|
François-Antoine Chevrier, Le Retour du Goût. Comédie représentée par les Comédiens Italiens le 25 février 1754. |
|
|
1755 |
Réédition, avec des coupes et des corrections, du Système du cœur de l’abbé Gamaches. |
|
1757 |
Montesquieu, Essai sur le goût (publié de façon posthume dans l’Encyclopédie, Montesquieu étant mort en 1755). |