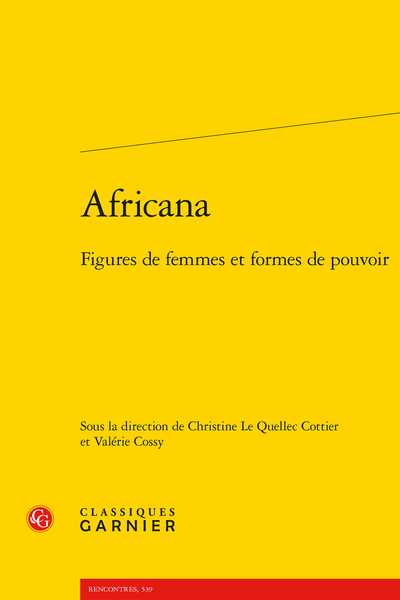
Présences des femmes dans les films documentaires de réalisatrices sénégalaises En attendant les hommes de Katy Lena Ndiaye et Congo, un médecin pour sauver les femmes d’Angèle Diabang
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Africana. Figures de femmes et formes de pouvoir
- Auteur : Dibinga (Daddy)
- Résumé : À partir de l’analyse comparative des films En attentant les hommes et Congo, un médecin pour sauver les femmes, réalisés par deux Sénégalaises (Kati Lena Ndiaye et Angèle Diabang), il s’agit de montrer comment, avec l’aide du média et du contact avec les réalisatrices, les femmes interviewées passent d’une situation d’enfermement à une situation « ouverte » que la caméra et le discours manifestent.
- Pages : 373 à 386
- Collection : Rencontres, n° 539
- Série : Francophonies, n° 2
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406127352
- ISBN : 978-2-406-12735-2
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12735-2.p.0373
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 18/05/2022
- Langue : Français
- Mots-clés : Angèle Diabang, Katy Lena Ndiaye, cinéma, documentaire, réalisatrices
Présences des femmes
dans les films documentaires
de réalisatrices sénégalaises
En attendant les hommes de Katy Lena Ndiaye
et Congo, un médecin pour sauver les femmes
d’Angèle Diabang
Films documentaires au féminin
Pour Françoise Balogun, « même si les femmes ont conquis leurs places dans le métier du cinéma, en tant que réalisatrices, elles sont encore rares » (1996, p. 141). En 1991, lors du Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, elles étaient une cinquantaine à discuter de leur position, de leur statut, et à poser les fondements de la défense de leurs intérêts. Ceux-ci avaient besoin d’être explicités, malgré le fait que plusieurs films avaient déjà été réalisés par des femmes ou proposaient des personnages féminins. Sambizanga (1972) de Sarah Maldoror, mettant en scène la vie de l’épouse d’un combattant angolais torturé dans les geôles des colons portugais, est un film pionnier de fiction africaine, réalisé par une femme qui raconte la vie d’une femme. La Sénégalaise Safi Faye, première réalisatrice d’Afrique noire, commence sa carrière en 1972 avec son court métrage La Passante, ouvrant ainsi la voie du métier à ses concitoyennes. Au Sénégal, en 2019, parmi les cinq récipiendaires des diplômes de mérite pour des films diffusés au plan international, remis par le ministère de la Culture et de la Communication, trois femmes ont été primées. Adama Binetou Sow est lauréate du meilleur court métrage au Festival du film de femmes de Fontenay-le-Fleury (France) avec son film À nous la Tabaski (2019), Mati Diop a remporté le Grand Prix du 72e Festival international de Cannes (France) grâce à 374son film Atlantique (2019) et, de Mame Woury Thioubou, Fifiri en pays cuballo (2018) est nommé meilleur long métrage documentaire à la 35e édition du Festival international Vues d’Afrique (Canada). Pour nous, la particularité des deux réalisatrices Angèle Diabang et Kati Lena Ndiaye est leur intérêt à filmer et raconter l’Afrique qui n’est pas leur Sénégal d’origine, c’est-à-dire faire le choix d’un ailleurs pourtant continental. Nous postulons que cette démarche conforte une reconnaissance de la sororité, en même temps que sa nécessité. Les films dépassent les cas particuliers, propres à une proximité nationale ou culturelle, mais témoignent, avec les femmes de Oualata en Mauritanie et les femmes violentées à l’Est du Congo, d’une condition partagée, d’une réalité commune qui implique une coopération, une confiance et un partage. Avec la caméra, la parole et le portrait surgissent et débordent la situation personnelle afin de dénoncer, à travers les époques et les espaces, les violences commises.
Malgré ce sujet significatif, ce n’est qu’à partir des années 2000 que la recherche cinématographique s’est penchée sur la présence des femmes dans les films documentaires, qu’il s’agisse des intervenantes filmées ou des réalisatrices. Parmi quelques travaux de recherche, l’article d’Alexie Tcheuyap (2010) « Cinéma documentaire et expériences féminines en Afrique francophone » aborde la question de la mise en scène d’enjeux sociopolitiques dans les documentaires Femmes aux yeux ouverts (1993) d’Anne-Laure Folly et Une affaire de nègres (2008) d’Osvalde Lewat, deux pratiques documentaires différentes, mais complémentaires. Cette réflexion motive notre propre démarche comparative, avec les deux films cités, et nous allons la poursuivre en insistant sur l’analyse sémiologique et pragmatique du parcours des femmes « montrées », en considérant que chacune vit simultanément un « enfermement » et la possibilité d’y échapper, dualisme rendu perceptible par la construction filmique.
375Portraits
Afin de saisir les motivations – diverses – des réalisatrices sénégalaises, il importe de les présenter et de situer le contexte de production de leurs films. Présentatrice pendant dix ans de « Reflets Sud » sur TV5, une émission de reportages africains consacrés aux beautés et aux richesses du continent noir, Katy Lena Ndiaye est née en 1968, à Dakar, et a grandi entre le Sénégal et l’Europe où elle a fait ses études. Elle débute sa carrière cinématographique en réalisant son premier film, Traces. Empreintes de femmes en 2003, un documentaire de 52 minutes, portrait croisé de trois vieilles femmes burkinabés et de leur « petite fille » qu’elles initient aux peintures murales à partir des techniques ancestrales. C’est avec le même élan de confronter la tradition et la modernité qu’elle réalise son deuxième documentaire de 56 minutes En attendant les hommes en 2007, financé par Néon Rouge Production1, basé en Belgique, producteur également de son premier film. Dans ce documentaire réalisé à Oualata (Est de la Mauritanie), Katy Lena dresse le portrait de trois femmes : Khady, Massouda et Cheicha qui décorent les maisons de fresques d’une remarquable beauté et qui confient à la réalisatrice à travers un entretien confidentiel leurs espoirs, rêves et désillusions. Ces femmes abordent les sujets qui touchent à leur choix du conjoint, leur sexualité, le second rôle qui leur est réservé dans la communauté. Leur parole, que nous analyserons par la suite, est révélatrice d’une société dans laquelle la tradition, la religion et les hommes occupent la part belle. L’interview qu’elles accordent à Ndiaye met en évidence que leur pratique artistique de décoration murale, donc leur entreprise professionnelle, est le moyen trouvé pour sortir des stéréotypes sociaux. Quant à Angèle Diabang Brener, elle est née à Dakar en 1979 et s’est formée au cinéma au Média Centre de Dakar2, puis en France, 376à La Fémis3, et en Allemagne à la Filmakademie4. Elle fait ses débuts comme monteuse en 2005 à Karoninka Production Dakar5, puis passe à la réalisation en 2005 avec Mon beau sourire, un documentaire réalisé avec le soutien du Goethe Institut6 de Dakar, sur les souffrances que s’infligent des Sénégalaises pour répondre aux canons de beauté. Parmi ses films, en 2007 elle réalise Sénégalaises et Islam, documentaire de 35 minutes dans lequel elle s’entretient avec les femmes musulmanes sénégalaises qui s’expriment sur leur façon de vivre leur religion et qui donnent leur avis sur leur place dans la société africaine, leur liberté d’expression, l’image de l’islam dans le monde, autant que sur le port du voile, la charia ou encore les extrémismes7. Déjà légitimée en tant que réalisatrice faisant surgir la parole de femmes sur des sujets sensibles, elle a eu l’initiative de se rendre au Congo pour interviewer les femmes recueillies dans la clinique – fondée dans la région de l’Est du Congo-Kinshasa – du désormais Prix Nobel de la Paix, le Dr. Mukwege, auquel se réfère le titre du documentaire Congo, un médecin pour soigner les femmes (2014). Ce film de 50 minutes est co-produit par Roches Noires Productions en France et Karoninka au Sénégal. Les femmes rencontrées par Diabang Brener ont subi les pires violences et outrages, victimes de divers groupes armés. Traumatisées, elles sont « enfermées » en elles-mêmes, bien que les soins prodigués permettent progressivement la 377reconstruction physique et morale, avant celle civique et économique, grâce à la générosité du fondateur du centre hospitalier. Ainsi, qu’il s’agisse des femmes des Oualata qui se libèrent en s’exprimant sur les contraintes que leur impose leur société, ou des femmes victimes de violences sexuelles, ces films mettent à nu un cheminement personnel, féminin qui, indépendamment de situation et d’espaces différents, ont pour point de départ un enfermement destructeur.
Ces deux films sont donc le fruit de la coopération Nord-Sud. En attendant les hommes est produit par une société de production belge tandis que Congo, un médecin pour sauver les femmes est une coproduction de deux sociétés audiovisuelles : l’une française, l’autre sénégalaise appartenant à la réalisatrice. Dans les deux cas, le regard des réalisatrices reste déterminant pour montrer l’Afrique, sa diversité culturelle, sa pluralité et ses réalités. Raconter cette mosaïque d’histoires, celle des femmes enfermées dans l’enclos de la tradition et de la religion, ou qui subissent l’injustice de la guerre, avec un regard à la fois féminin et africain, témoigne d’un altruisme teinté de panafricanisme, à l’instar de celui de la Guadeloupéenne Sarah Maldoror8. Découvrir d’autres cultures, se confronter à des sociétés retirées du monde, exposer les violences faites à la femme est une forme de plaidoyer pro domo, en faveur de celles qui sont généralement les premières victimes chaque fois qu’une société est confrontée aux divers disfonctionnements systémiques susceptibles de conduire à la guerre, à l’extrémisme, au conservatisme, à la confiscation des droits.
Notre analyse veut mettre en évidence comment ces films, grâce aux points de vue des réalisatrices qui gagnent suffisamment la confiance des protagonistes, peuvent être perçus dans une relation de sororité qui fait naître la parole. À travers des plans tantôt rapprochés, tantôt larges, la caméra est un lien d’intimité entre les interviewées et les réalisatrices, permettant tout à la fois d’évoquer des parcours de vie et de déconstruire ce que ceux-ci ont généré comme souffrance. La privation de liberté peut impliquer l’existence d’espaces clos, désignés ici sous 378les termes de « lieu de réclusion », des territoires clôturés mais aussi des espaces mentaux ou sociaux qui empêchent la femme d’imaginer une alternative ; nous nous référons à la notion d’enfermement selon ces deux modalités. Pour situer ce processus d’extraction d’un tel univers, nous donnerons des exemples de cet enfermement, ainsi que de celui de la « libération », en tant que disponibilité choisie au monde. Mais avant cela, il nous importe de situer plus précisément la démarche des femmes réalisatrices africaines, en tenant compte des présupposés genrés.
Femmes africaines et documentaires
« Les représentations genrées véhiculées par la société et les organisations, la force des stéréotypes, la socialisation sexuée sont souvent à la base de la sous-représentation des femmes dans les métiers du numérique » (Quiros, 2018). Le documentaire d’auteur, sans doute grâce au boom du numérique, ne connaît plus ce clivage et les femmes, jadis en marge, sont bien représentées sur l’affiche des cinéastes du continent. Sans doute que la légèreté du matériel technique, ainsi que des coûts moindres facilitant un accès à tous, avec aussi l’ouverture de formations supérieures aux métiers du cinéma9, sont quelques facteurs leur ayant permis une appropriation du septième art.
Le genre du documentaire fait appel à un « mode10 » spécifique qui consiste à voir un film pour s’informer des réalités du monde. Le simple fait pour les deux réalisatrices d’aller vers les victimes des violences sexuelles au Congo, vers les femmes d’Oualata en Mauritanie pour essayer de cerner au mieux leur vie quotidienne avec une caméra, est un engagement dans leur carrière, au front, pour « faire passer par les images 379un message comblant un manque, pour donner leurs visions de femmes sur des questions de femmes africaines dans leur société » (Hoffelt, 1998, p. 2111). Elles sont donc locutrices et allocutaires12, ce que Jong Choy nomme d’ailleurs « l’astuce de l’immersion » (2017, p. 138), mais qui plus qu’une astuce s’impose ici pour créer une situation de confiance et ainsi tisser le lien d’une sororité. Cette pratique documentariste qui s’associe le plus souvent à une observation participante13 permet en même temps d’affirmer une interprétation de la réalité à travers leur point de vue ; leur présence implique ce point de vue et un rapport au monde face auquel elles prennent position. De même, les femmes violées présentes face à l’objectif pour raconter sans détour les circonstances de leur agression, ou la femme Khady qui parle avec passion de sa sexualité, les yeux fixés vers la camera, confortent la relation de proximité entre les réalisatrices et les femmes. Cette complicité relationnelle entre les différents protagonistes du film – les femmes réalisatrices et celles qu’elles filment – se voit à travers les jeux des questions-réponses qui sont des interactions et font partie du processus de reconstruction. Cette sororité bâtie, médiatisée, insuffle alors la possibilité d’instaurer une relation qui fait toute la différence en termes de production et de réception. Les réalisatrices ont bien sûr choisi leurs partenaires, ce qui implique du temps consacré sur place, en immersion, et renforce le processus d’une collaboration. Un autre moment significatif, dans le film d’Angèle Diabang, est celui où la réalisatrice demande à Regina quel nom elle donnerait à son bébé – issu d’un viol – et celle-ci répond sans hésiter « Angèle ».
Entre femmes, cette complicité devient une complémentarité, d’une part entre celles qui ont des choses à dire et qui sont victimes dans la société, d’autres part avec celles qui veulent porter un regard sur le monde, ce qui détermine un angle de vision sur une réalité. Les deux 380documentaires sont donc à percevoir comme un échange, un film sur la voix des femmes. Ainsi, réaliser ces films documentaires dépasse largement la question d’une représentation nationale – sénégalaise – de cas particuliers, mais s’inscrit dans une démarche bien plus vaste, celle d’une conscientisation du monde à la cause de la femme. Cette approche compréhensive associée à l’observation participante du documentaire se prolonge également avec le spectateur qui se sent à son tour impliqué à travers les personnages féminins qu’il découvre à l’écran. Ainsi, de l’approche des réalisatrices sur les questions des violences sexuelles et libertés des femmes, et de la relation qu’elles installent avec les femmes qu’elles filment, naît un documentaire dont le spectateur lui-même pourrait s’emparer à sa manière, par exemple lors d’un débat après une projection. Cela a toute son importance dans des sociétés où les sujets abordés sont présentés frontalement, assumés par les protagonistes, alors qu’ils sont très souvent tabous et jamais évoqués en public. Une telle médiatisation vise à ouvrir le débat au sein des communautés, de façon peut-être plus spontanée pour les spectateurs, les décideurs et les institutions, du fait d’une réalisation par des femmes africaines.
L’enfermement des femmes
ou la liberté confisquée
Dans En attendant les hommes, trois femmes aux profils et tempéraments différents se confient à la réalisatrice : Khady Coulibaly, Tycha et Massouda Mint Heiba. Dans cette contrée, comme le dit Khady, la tradition voudrait que ce soient les parents qui fassent le choix du futur beau-fils pour leur fille. En effet, en Afrique de l’Ouest, en dépit des trois pouvoirs (judiciaire, exécutif, législatif), la tradition et la religion occupent une importante place dans la régulation et l’appréhension du mariage, y compris dans la relation au sein des couples et c’est bien ce sujet qui motive une grande partie des propos des trois femmes de Oualata, filmées dans deux espaces différents. L’un est propice à la parole, l’intérieur de la maison, l’autre, l’extérieur, est le lieu où elles exercent leur activité, où se perçoit le retour des hommes, ainsi que leur prière à la mosquée.
381Dans ce documentaire, la réalisatrice et son opérateur de prise de vue (donc deux instances d’énonciation) ont fait des choix de cadrages qui passent de l’intérieur à l’extérieur, et vice-versa. Au début se découvre une succession de plans généraux du village, dans lesquels on aperçoit les maisons badigeonnées à l’argile. La caméra capte le vide, le silence du village, qui finit par céder à un plan d’ensemble dans lequel on voit les hommes, en train de partir à la prière, sans les femmes. La plupart du temps, dans le film, elles prient chez elles à la maison. Cet enfermement d’ordre religieux amplifie les inégalités déjà existantes entre elles et les hommes, même si « la question de la femme est une source inépuisable de quiproquos, de polémiques et d’incompréhension dans la religion musulmane » (El Tibi, 2014, p. 59). Les plans d’ensemble créent une dichotomie avec les plans rapprochés des trois femmes durant leur entretien dans leur maison. Chaque fois qu’elles parlent de leur intimité, de leur vie, on les voit grâce à un cadrage serré qui prend légèrement la partie supérieure du buste, et elles sont collées contre les murs. L’espace diégétique est totalement occupé par leur visage et une partie du buste, de telle sorte que pendant l’entretien, l’attention du spectateur se focalise sur les différents traits, émotions et sentiments transmis par leurs regards. Khady Coulibaly est une femme extravertie, un peu taquine et pleine d’humour qui avec le sourire parle de ses trois divorces. Lors de son premier mariage, ce sont ses parents qui ont choisi son désormais ex-mari, qu’elle a désavoué par la suite puisqu’elle ne l’aimait pas. Massouda Heiba est une divorcée, moins réservée, révoltée et en colère. Le regard plein de rage, les dents serrées, la tête penchée légèrement vers le bas, elle expose les blessures et l’injustice dont elle a été victime, dans un mariage qu’elle a rompu à cause de la pression de sa belle-sœur qui a eu raison de son union.
Déception, restriction du droit le plus fondamental, vie de couple disloquée par les barrières de la distance sont autant d’aveux longtemps enfermés dans le secret de la pensée de ces femmes. En ne partageant pas ce qu’elles vivent, elles sont prisonnières de leurs pensées, de leurs convictions, de leurs émotions qu’elles ne peuvent malheureusement pas manifester.
Congo, un médecin pour soigner les femmes entraîne le spectateur dans la région du Kivu, à l’est du Congo-Kinshasa, en proie aux violences de tout genre depuis plus de vingt ans. Les femmes de cette région sont 382très souvent abusées sexuellement, mais aussi psychologiquement et socialement. Leurs paroles sont réduites au silence face à la violence des hommes armés et les actes atroces qui sont commis provoquent chez ces femmes un sentiment de rejet que le mépris et les regards biaisés de la société amplifient. Ce qu’elles ont subi en tant que victimes est retourné contre elles-mêmes et projeté sur les enfants issus du viol. Bien que déjà installée dans un espace spécifique, la réalisatrice établit des lieux intimes, favorisant la relation de confidence propre à la sororité. Avec certaines, c’est dans un espace vert, loin des bruits du centre de traitement de Panzi, qu’elle mène l’entretien et tient sa caméra. Chaque histoire signifie une approche différente, significative du respect porté et de la pudeur nécessaire à la confession. Avec Barakhomewa, violée par cinq personnes, Diabang filme son dos et d’autres parties du corps, mais jamais ses yeux. À travers les plans buste, rapprochés, la caméra capte beaucoup d’émotions, des silences, des tremblements vocaliques, des pauses, des hésitations dans la voix, ce qui traduit l’enfermement d’un point de vue esthétique. Dans le cas de Françoise, violée sur le chemin du retour de son école alors qu’elle avait 17 ans, elle l’accompagne pendant la marche qui l’amène, avec une assistante sociale, chez la psychologue ; le film propose un mouvement panoramique de la gauche vers la droite, avec en fond sonore de la voix anticipée et extra-diégétique de la psychologue, avant de proposer un moment de leur entretien, en champs et contre-champs. C’est une femme perdue dans sa pensée que la caméra filme de profil, dont le regard se tourne parfois vers la thérapeuthe. Cette jeune fille est enceinte de son agresseur et tout ce qui signifiait « ouverture », entre autres aller à l’école, a disparu. Parmi tant d’exemples, ces destins tragiques confrontent à la violence du monde et dressent le tableau de la précarité et de la résilience des femmes dans des zones de guerre civile.
383Parcours vers la libération
et représentation
En tant que communication audio-scripto-visuelle, le documentaire s’inscrit dans une interaction qui fait partie intégrante d’un vaste système des rapports sociaux14. L’analyse de différents messages documentaires ne peut se faire sans a priori aborder de façon détaillée la question des interlocuteurs du message. Dans En attendant les hommes, il existe une forme de co-énonciation sans intervention d’aucune voix off. La réalisatrice, en tant que femme, s’approprie le combat de toutes les femmes victimes de privation de liberté, et qui représentent toutes celles qui vivent dans les mêmes situations. Le film Congo, un médecin pour soigner les femmes commence quant à lui avec un plan de situation dans lequel apparaît la grande verdure qui colore le beau paysage du Kivu traversé d’une grande rive donnant l’impression d’un environnement écologiquement beau à vivre. La voix off de la réalisatrice vient en appui aux images et l’on peut entendre : « En Afrique, à l’est du Congo, le Kivu ressemble à un paradis… ». Cette voix off, qui ne réapparaît plus dans la suite du film, situe le contexte spatio-temporel tout en fixant la trace de l’énonciation documentaire. Les deux films sont constitués essentiellement d’entretiens, générés par l’énonciation off, qui bien qu’insaisissable, génère les gestes, le sourire, le regard, le silence et les réponses des témoins ; même les mouvements, les échelles et les angles de la caméra informent de la présence effacée de l’énonciatrice. Et ce fait, au-delà d’être une manière de penser le documentaire, de mettre en valeur les femmes, universalise leur volonté à se faire entendre. L’efficacité de leur communication intersubjective dépasse le cadre restreint de l’entretien.
Lorsque Kati Lena Ndiaye interagit avec les trois femmes mauritaniennes, elle n’exclut aucun domaine de leur vie. Le film est d’abord un échange intime et un parcours thérapeutique durant lequel elles cherchent à épancher leur vision et montrer leurs aspirations, ce qui est leur liberté. Au-delà du fait qu’elles passent leur temps dans leur maison, elles ont chacune une ou deux activités qui leur permettent de 384se prendre en charge et d’être moins dépendantes de leur mari. Khady est sage-femme – elle est filmée dans un hôpital lors d’un accouchement – et aide-malade. Ce travail la met à l’abri de toute mauvaise surprise. Elle joue aussi du tam-tam. Massouda et Tycha s’occupent quant à elles en faisant de la peinture murale, qui leur permet aussi de subsister à leurs besoins. Tycha vend des objets pour les femmes, tels des bijoux et des robes. Leur bravoure en tant que personnes autonomes et indépendantes – qui vivent grâce au travail, à l’art, à la danse, aux petits commerces – est une forme de libération et de résistance, leur permettant de ne pas conditionner leur existence à celle des hommes.
Les femmes congolaises interviewées par Angèle Diabang sont toutes animées, au début, par un désir de mort, de suicide. Les rebelles et autres groupes armés, conscients du rôle central qu’occupe la femme au sein de la société congolaise, développent par le viol systématique une campagne de déstabilisation de la société. Par ce crime, ils détruisent les différents repères sociaux – comme la famille, le mariage – mais cela va plus loin puisque les femmes s’occupent aussi de l’éducation des enfants et nourrissent les familles grâce à leurs travaux champêtres : une telle violence rend toutes ces fonctions caduques, car la victime est rejetée par sa communauté et sa famille. Un tel acte crée un silence absolu, alors que la démarche de la réalisatrice veut rétablir un lien et surtout des voix, en les plaçant au cœur de la société, en leur donnant la parole afin qu’elles se libèrent, qu’elles interpellent et qu’elles résistent. C’est au cours de ce processus que les femmes parviennent à sortir de leur enfermement mental, pour retrouver le monde. Le film présente, à l’hôpital, des heures de jeux communautaires inclusives avec des chants. On peut apercevoir Regina, Anne-Françoise, Aline, ou Barakhomewa en train de savourer ce précieux instant avec sourire, cris de joie et chants d’allégresse. À l’hôpital, elles ont la possibilité d’apprendre la couture, le tissage de sac en raphia, le français ou encore l’informatique. Une autre séquence panoramique, sans interview, traverse une salle de classe où une femme note quelques mots en français, en présence de ses amies et de l’institutrice, dans une ambiance sororale ; cela montre à quel point le processus de reconstruction passe par l’instruction qui leur offre des repères pour affirmer des libertés. Ce processus, au sein de la clinique, s’observe avec des transformations d’allures quand ces femmes ne marchent plus têtes baissées, désespérées. Anne-Françoise, 385par exemple, tient à tout prix à retourner à l’école et à garder l’enfant issu du viol, qu’elle est désormais capable d’accepter, même comme une providence divine. Regina quant à elle fixe la caméra, exhorte les autorités congolaises à réfléchir et trouver des voies pour sécuriser le pays.
Le titre En attendant les hommes est sans doute un rappel ironique à propos de celui ou ceux qui n’arrivent jamais15, et combien leurs occupations vont au-delà des attentes des femmes. Celles-ci en ont conscience, mais la hiérarchie patriarcale n’en est guère perturbée. Qu’il suffise d’évoquer une voix off féminine, secondée de celle d’un homme, qui tel un leitmotiv énumère les catégories des femmes identifiées, et donc acceptées, dans le groupe. Aucune n’incarne un être autonome, entier, car elles sont rattachées à un objet, un jeune animal, une partie du corps : la petite oreille, le livre, la mariée (le ventre, la hanche, les épaules), Azeiba (la petite vierge), l’oisillon. La femme est une subalterne dont la société se satisfait. Dans Congo, un médecin pour sauver les femmes, malgré les violences qui sont à l’origine de l’initiative du gynécologue congolais, la démarche insiste plus sur un partenariat possible avec les hommes ; ceux qui ont détruit ne doivent pas rendre impossible le processus de reconstruction personnelle, de confiance envers autrui et enfin d’émancipation. Dans les deux films, la sororité montrée, construite et défendue fait sens dans l’interaction subjective que les réalisatrices affirment, tout en générant un processus global interpellant autant les témoins que les destinataires, à travers le monde.
Daddy Dibinga
Université Gaston Berger
de Saint-Louis du Sénégal
Bibliographie
Balogun, Françoise, « Visages de femmes dans le cinéma africain », Présence africaine, no 153, p. 141-150.
Diabang Brener, Angèle, Congo, un médecin pour soigner les femmes (film, 2014).
El Tibi, Zeina, « La place de la femme dans l’islam », Société, droit et religion, CNRS Éditions, no 4, 2014, p. 59-64 : « http://www.cairn.info/revue-societe-droit-et-religion-2014-1-page-59.htm (consulté le 23/11/2020) ».
Folly, Anne-Laure, Femmes aux yeux ouverts (film, 1993).
Gardies, André, Le Récit filmique, Paris, Hachette, 1993.
Hoffelt, Sophie, « Les femmes réalisatrices en Afrique subsaharienne », L’Afrique politique : Femmes d’Afrique, Paris, Karthala, 1998, p. 21-44.
Jong Choy, Hyun, Les Origines et prémices du personnage documentaire. La Liminalité du personnage documentaire 1, Paris, L’Harmattan, coll. « Champs visuels », 2017.
Lewat, Osvalde, Une affaire de nègres (film, 2008).
Meunier, Jean-Pierre, Peraya, Daniel, Introduction aux théories de l’information et de la communication, Bruxelles, de Boeck, 2010.
Ndiaye, Katy Lena, En attendant les hommes (film, 2007).
Odin, Roger, « La question du public. Approche sémio-pragmatique », Réseaux : Cinéma et réception, vol. 18, no 99, 2000, p. 49-72 : « https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_2000_num_18_99_2195 (consulté le 23/11/2020) ».
Oswald, Ducrot, « Analyses pragmatiques », Communications : Les Actes du discours, dir. Anne-Marie Diller, no 32, 1980, p. 11-60 : « https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1980_num_32_1_1481 (consulté le 28/11/2020) ».
Ponet, Blandine, Morlhon, Laurent, Goze, Tudi, « Enfermer, être enfermé, s’enfermer », Empan, no 114, 2019/2 : « https://www.cairn.info/revue-empan-2019-2-page-9.htm (consulté le 23/11/2020) ».
Quiros, Carlota Tarin et als., « Les femmes à l’ère du numérique », Commission européenne DG Communications, Content and Technology, Iclaves, 2018 : « https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/7745_4.78.lesfemmesal’erenumerique.pdf (consulté le 25/11/2020) ».
Tcheuyap, Alexie, « Cinéma documentaire et expériences féminines en Afrique francophone », French Forum, vol. 35, no 2/3, 2010, p. 57-77 : « www.jstor.org/stable/41306662 (consulté le 25/11/2020) ».
Winkin, Yves, Anthropologie de la communication. De la théorie au terrain, Paris, Seuil, 2001 [1996].
1 Néon Rouge Production est une société de production audiovisuelle établie à Bruxelles, créée pour promouvoir les œuvres socio-culturelles de haute qualité en proposant un autre regard sur le monde ; elle a pour objectif de découvrir des auteurs, des réalisateurs, des artistes et des techniciens pour développer avec eux des projets originaux.
2 Le Média Centre de Dakar (MCD) est une société à responsabilité limitée et centre de formation aux métiers de l’audiovisuel et de la communication sociale qui forme depuis 1997 les jeunes à la prise de vue, prise de son, écriture de scénario, montage, mise en scène et réalisation. La formation se conclut par la réalisation d’un film court métrage. Le Centre œuvre pour le changement et l’émergence d’une société civile dynamique ainsi que pour la promotion des valeurs humaines. Le feu réalisateur-documentariste Samba Félix Ndiaye en a été le Directeur.
3 La Fémis, également appelée École nationale supérieure des métiers de l’image et du son dans sa forme longue, est un établissement public d’enseignement supérieur français, membre de l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL). Elle délivre un enseignement technique et artistique destiné à former des professionnels des métiers de l’audiovisuel et du cinéma. La Fémis est fondée en 1986 et prend la suite de l’Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC) créé en 1943.
4 L’académie du film du Bade-Wurtemberg (Filmakademie Baden-Württemberg) fondée en 1991 à Ludwigsburg, est une école de cinéma allemande de renom. Elle propose des spécialisations variées allant de la musique de film à la production.
5 Karoninka est une Société de production cinématographique et audiovisuelle crée en 2006 par la cinéaste Angèle Diabang qui exerce ses activités entre le Sénégal et la France.
6 Le Goethe-Institut est l’institut culturel de la République fédérale d’Allemagne actif au niveau mondial. Il promeut la connaissance de la langue allemande à l’étranger et entretient des collaborations culturelles internationales. Sa présence est forte en Afrique de l’Ouest.
7 Voir : Sénégalaises et Islam : « http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/18790_1 (consulté le 23/03/2021) ».
8 Sarah Maldoror est une pionnière du cinéma panafricain ; elle a milité pour réhabiliter l’histoire noire au cinéma à travers plusieurs documentaires et a notamment travaillé avec talent sur l’œuvre d’Aimé Césaire. Elle est née en 1929 dans le Gers (sud-ouest de la France), d’un père guadeloupéen et d’une mère métropolitaine. Décédée en avril 2020, elle est une victime du coronavirus.
9 Dans le cadre d’une coopération entre l’Université Gaston Berger, l’Université Stendhal de Grenoble 3, la Région Rhône-Alpes et l’Association Ardèche Images/Africadoc, le Master Réalisation Documentaire de Création de Saint-Louis du Sénégal a été fondé en octobre 2007 à l’UFR des Lettres et Sciences Humaines, et transféré à l’UFR des Civilisations, des Religions, des Arts et de la Communication en décembre 2014. La nouvelle génération des femmes cinéastes du continent africain telles que Mame Woury, Macky Aicha sont passées par ce cadre de formation en documentaire.
10 Nous utilisons la notion sémio-pragmatique, proposée par Roger Odin (2000, p. 59).
11 Dans son article « Femmes réalisatrices d’Afrique subsaharienne » (1998), Hoffelt observe que si seule une minorité d’entre ces réalisatrices a bénéficié d’une formation cinématographique, en revanche, elles ont toujours un sérieux bagage scolaire et mènent une carrière de front.
12 Dans Analyses pragmatiques (1980, p. 30), Oswald Ducrot, évoquant la notion d’énonciation, utilise les termes locuteur pour parler de la personne autrice du message, et allocutaire comme celle qui prend en charge le message. Les réalisatrices sont des locutrices puisqu’elles sont les autrices du message, et elles sont allocutaires puisqu’elles sont porte-parole des femmes africaines.
13 Sur cette notion, se référer à Winkin, 2001, p. 156-165.
14 Cette analyse est développée par Jean-Pierre Meunier et Daniel Peraya dans Introduction aux théories de l’information et de la communication, Bruxelles, de Boeck, 2010, p. 310.
15 Que l’on songe à En attendant le vote des bêtes sauvages (1998) de Kourouma ou En attendant Godot (1952) de Beckett, tout en anticipant Celles qui attendent (2010) de Fatou Diome…