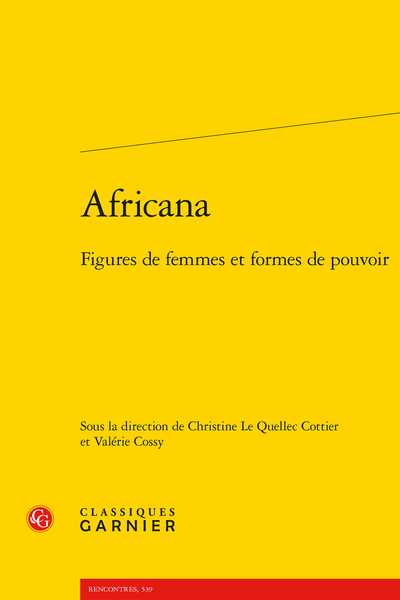
Préface
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Africana. Figures de femmes et formes de pouvoir
- Auteurs : Cossy (Valérie), Le Quellec Cottier (Christine)
- Résumé : Sous le terme Africana, cet ouvrage propose une réflexion sur des œuvres fictionnelles et culturelles, conçues sur le continent ou parmi ses diasporas, mettant en scène des figures de femmes africaines et des formes de pouvoir. Il associe des perspectives disciplinaires et des chercheurs de plusieurs continents afin de comprendre les enjeux du féminisme et du genre selon les contextes convoqués, dans une relation critique avec la perspective hégémonique européenne ou nord-américaine.
- Pages : 7 à 17
- Collection : Rencontres, n° 539
- Série : Francophonies, n° 2
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406127352
- ISBN : 978-2-406-12735-2
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12735-2.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 18/05/2022
- Langue : Français
- Mots-clés : Afrique, femmes, littérature, représentation, pouvoir, fiction
Préface
À l’heure où les questions de parité et de représentation féminine occupent le devant de la scène sociale et politique, à l’heure où les stéréotypes de genre sont dénoncés au niveau planétaire, il paraît essentiel de questionner les discours portant sur les représentations des voix et des personnages féminins subsahariens. Dès sa préface au volume La Parole aux Africaines ou l’idée de pouvoir chez les romancières d’expression française de l’Afrique sub-saharienne, paru en 1993, Jean-Marie Volet déclarait : « Si les années 1980 doivent figurer au palmarès de l’histoire littéraire, ce sera sans doute parce que les grandes maisons d’édition se sont mises à publier les romancières africaines, un public intéressé s’est mis à les lire, des critiques littéraires chevronnés ont pris la peine de commenter leurs œuvres, des jurys se sont mis à leur décerner des Prix et surtout parce qu’un nombre croissant d’Africaines d’expression française se sont mises à écrire à ce moment-là1 ».
Quarante ans plus tard, le constat s’est vérifié et la fiction portée par des femmes auteures proposant des personnages féminins connaît toujours un essor considérable. Il s’agit sans doute d’une première forme de pouvoir, donnant voix et représentation à celles qui ont été des subalternes dépendantes d’un ordre patriarcal assurant sa propre pérennité en maintenant ses filles dans la conviction de leurs devoirs d’obéissance et de patience, ou encore, en remontant le temps, soumises à un système de domination coloniale. Paradoxe d’une époque, en situation de domination physique et symbolique, l’école des « toubabs » où la langue française était enseignée aura été un mode d’émancipation revendiqué par des femmes d’Afrique, telle Mariama Bâ, auteure en 1979 du célèbre roman Une si longue lettre, mais aussi Anna-Bouissi, personnage au destin intense dans 8Les jours viennent et passent, roman d’Hemley Boum couronné du Prix Ahmadou-Kourouma en 20202.
La littérature est un des lieux où se pense le monde réel ; elle crée, grâce à des subjectivités, des actions et des temporalités, la possibilité de questionner le monde, ce que le peintre Paul Klee affirmait en 1920 à propos de l’art plastique, car il « ne copie pas le réel, il le dévoile3. » Ce même pouvoir de la fiction motive notre volonté de mettre en évidence des « figures de femmes et des formes de pouvoir » dévoilées dans des récits mettant en scène l’Afrique et ses diasporas féminines, longtemps restées invisibles. Très dynamiques, les fictions brisent le silence et récupèrent des stéréotypes de genre ; leurs auteurs s’y impliquent souvent par un discours social et politique touchant autant à des pratiques locales traditionnelles qu’aux conséquences de la migration ou à celles de grandir en situation de minorité en Europe ou ailleurs. Il nous importe de mettre au jour comment des processus d’émancipation et de résistance se sont joués et se jouent à travers des personnages féminins placés sur le continent africain ou partout dans le monde.
Africana. Figures de femmes et formes de pouvoir propose de revisiter ces représentations symboliques en phase avec les questionnements internationaux, diasporiques et interculturels qui traversent les champs du savoir et de l’expérience. Son titre « Africana », motivé par la proposition du philosophe Souleymane Bachir Diagne dans son essai L’Encre des savants, est une invitation à réfléchir de façon transversale sur un ensemble de représentations et de savoirs touchant autant des systèmes de pensée, des événements ou des actes esthétiques impliquant des Africains vivant sur le continent ou issus d’une diaspora4. Cette intention réflexive, impliquant des interactions et non des postures essentialisantes, a conforté notre démarche collaborative et transcontinentale. Celle-ci ne pense pas le continent africain comme une périphérie de ses diasporas, souvent plus accessibles grâce à leur présence culturelle et médiatique relayée aux 9États-Unis et en Europe. Nous envisageons le domaine de recherche de façon interdisciplinaire, incluant des temps et des espaces différents dont les savoirs ont soit su converger, soit ont été antagonistes. L’expérience coloniale est l’un de ces temps de négation, mais il nous paraît essentiel de ne pas nous passer de la fameuse « bibliothèque coloniale5 » : ainsi, sans se limiter à une approche décoloniale, notre titre Africana favorise un croisement d’origines, d’expériences et de savoirs, en considérant que ceux-ci sont interdépendants et permettent le vivre ensemble dans des espaces globalisés.
Pour aborder aujourd’hui ces représentations féminines dans le domaine de la littérature, des arts et de l’histoire, il nous a semblé fondamental de reconnaître des formes de pouvoir, en tant que rapport de forces6. Les sujets féminins à découvrir dans les fictions expérimentent toujours et encore des moyens de se faire entendre et de se faire respecter, en usant de diverses stratégies et de toutes sortes de formats, par exemple le théâtre, la poésie, le roman, la littérature jeunesse, sentimentale ou encore l’autobiographie. Les imaginaires proposés ne favorisent plus seulement l’introspection mais, souvent par la démultiplication des points de vue ou la subversion des codes et des registres de la langue, déploient des réalités contrastées qui récusent la frontière entre sphère privée et publique : la maternité et le rapport au corps, placés sous le signe de l’expérience, de l’autonomie et du choix de la filiation sont devenus, par exemple, des formes de pouvoir au même titre que le pouvoir régalien. L’autorité acquise n’est cependant pas celle de la contrainte (power over) – avec un renversement de la dynamique d’exploitation – mais celle d’une reconnaissance, désormais nommée 10empowerment, soit « un pouvoir créateur qui rend apte à accomplir des choses (power to), un pouvoir collectif et politique mobilisé notamment au sein des organisations de base (power with) et un pouvoir intérieur (power from within) qui renvoie à la confiance en soi et à la capacité de se défaire des effets de l’oppression intériorisée7 ».
Il ne s’agit donc plus de hiérarchiser des modes d’action et des valeurs, mais de les reconnaître comme équivalents et nécessaires, qu’il s’agisse des décisions d’une figure royale cherchant à sauver son peuple, d’une mère de famille qui veille à la survie des siens, de lutte contre les hypocrisies sociales ou encore de l’affirmation individuelle d’une orientation de vie et de la réappropriation de son propre corps, parmi tant d’autres options.
Dès le début des années 1980, de nombreuses intellectuelles et auteures d’Afrique ont affirmé publiquement leur droit à l’égalité, aux soins et au respect. Elles ont nommé ces revendications essentielles, en phase avec leurs cultures d’origine, en prenant souvent leur distance avec le mot « féminisme », porteur d’une perception européenne ou états-uniennes des rapports entre les sexes. L’auteure, metteuse en scène, poète et musicienne camerounaise Werewere Liking invente dans son « chant-roman » Elle sera de jaspe et de corail (1984) le terme « misovire », pour exprimer le ressenti d’une nouvelle génération de femmes qui ne trouve aucun homme admirable. Sans doute en phase avec l’Africana womanism de Clenora Hudson-Weems qui se développe parallèlement dans un contexte afro-américain, mais en voulant toucher toutes les femmes d’origine africaine, le terme « féminitude », proposé par Calixthe Beyala, en 1995 dans sa Lettre d’une Africaine à ses sœurs occidentales, forge un mot qui rattache féminin et négritude. Il s’agit de postuler une appréciation différente de la relation homme-femme, en la plaçant dans un contexte culturel significatif : « la définition de ma féminitude […] ne prône pas l’égalité entre l’homme et la femme mais la différence-égalitaire entre l’homme et la femme. Il fallait un autre mot pour définir cette femme nouvelle qui veut les trois pouvoirs : carrière, maternité et vie affective8 ». La dénonciation est donc réactive, sans qu’il y ait adhésion à un féminisme américain ou européen. L’inventivité lexicale – citons 11encore l’acronyme stiwanism pour Social Transformation Including Women in Africa de Molara Ogundipe-Leslie – reflète la diversité des perceptions genrées, en tant que « système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes (homme-femme) et entre les valeurs et les représentations qui leur sont associées9 ». Cette approche ne saurait se décliner de façon universelle et elle participe aussi à un processus de décolonisation. C’est ce que l’« afro-féminisme » revendique de nos jours dans les communautés diasporiques, pour rendre compte de particularités « intersectionnelles10 » – désignant l’imbrication complexe des différents systèmes d’oppression et des multiples facettes de l’identité – des Afropéennes définies par Miano comme des Européennes d’ascendance africaine ayant grandi en situation de minorité11. En portant notre attention sur les productions culturelles du continent africain, nous reconnaissons qu’y importent plus deux identités sexuées signifiées par le corps que celles, multiples, définies en fonction du genre. Cette polarisation constitue un hiatus face aux représentations et revendications LGBT, majoritairement rejetées socialement et légalement sur le continent, et encore peu représentées dans les fictions francophones de ses auteurs, alors qu’une telle scénographie n’est pas un tabou pour la création diasporique12.
Traversant ces diverses remises en question et mises en garde, le terme « féminisme » n’a jamais cessé d’être mobilisé voire défendu, que ce soit au moment où, à l’ère de Mariama Bâ, les femmes africaines ont conscience de s’emparer de l’écriture pour la première fois, jusqu’au monde globalisé d’aujourd’hui où le « TED talk » de Chimamanda Ngozi Adichie de 2012 – Nous sommes tous des féministes – bat des records d’audience sur la toile, faisant l’objet de publications et de nombreuses 12traductions. « C’est à nous, femmes, de prendre notre destin en main pour bouleverser l’ordre établi à notre détriment et ne point le subir. Nous devons user, comme les hommes, de cette arme pacifique, mais sûre, qu’est l’écriture13. » Tel était l’appel lancé par Mariama Bâ en 1980. Quarante ans plus tard, Chimamanda Ngozi Adichie continue de juger le féminisme indispensable car « se limiter à cette vague expression des droits de l’homme serait nier le problème particulier du genre. Ce serait une manière d’affirmer que les femmes n’ont pas souffert d’exclusion pendant des siècles14 », propos que le récent Africa Freedom Prize 2020 a soutenu en présentant l’auteure nigériane comme « la voix non dogmatique et longtemps perdue du féminisme libéral du xxie siècle15 ». De l’ère des indépendances à aujourd’hui, le féminisme relève d’un choix philosophique, d’une démultiplication lexicale et critique, d’une adhésion entière ou nuancée, mais il continue de concerner les Afriques – continentale et diasporique – dans le monde.
Afin de répondre à la portée du mot « Africana », nous avons conçu ce volume en croisant les représentations, les aires géographiques et culturelles, ainsi que les époques. Les réflexions proposées envisagent des interprétations qui ont conscience que « la clôture de la fiction ne se confond pas avec celle du texte », car la lecture reste « éminemment plurielle et singulière16 », comme l’écrivait Jean-Marie Volet. Le chercheur suisse à la carrière australienne a fondé dès le début des années 1990 les sites Lire les femmes écrivains et les littératures d’Afrique puis Mots pluriels qui ont bouleversé la diffusion et la réception des voix continentales méconnues17. Le don à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (BCUL) de sa collection riche de 3500 volumes consacrés à cette 13littérature, ainsi que de ses archives, est à l’origine du projet Africana. Figures de femmes et formes de pouvoir, qui s’est concrétisé en 2020 avec une exposition, des soirées culturelles, une table ronde avec les auteures Bessora et Véronique Tadjo, rejointes à distance par Calixthe Beyala. Malmené par la pandémie, le colloque international dont ce volume est le résultat s’est transformé en ateliers en ligne, permettant aux invités de discuter de leurs approches et propositions, ce qui a nourri la rédaction des articles que nous publions. Nous avons ainsi assuré des contacts transcontinentaux puisque les intervenants discutaient simultanément depuis plusieurs fuseaux horaires, en Afrique de l’Ouest et du Nord, en Europe et en Amérique du Nord, tant sur la côte Est que la côte Ouest. Ces collaborations se sont tissées depuis la Suisse romande, d’où nous travaillons à la valorisation de ce patrimoine littéraire, désormais renouvelé avec de nouveaux médias, tels les feuilletons subsahariens – pensons à Maîtresse d’un homme marié – ou encore des blogs qui ironisent sur la #vraiefemmeafricaine.
Les catégories hégémoniques européennes face auxquelles se sont longtemps élaborées les fictions et des contre-discours – qu’il s’agisse de la « fétichisation » de la femme africaine ou de la façon d’aborder l’« héritage colonial » au féminin – sont mobilisées et réévaluées. Les contributions à ce volume constituent donc un espace de réflexion qui envisage des « études africaines » à partir de propositions esthétiques dont les actrices et personnages fixent les termes. Le regard et les voix proposées dans les textes peuvent donc se situer en Afrique ou hors de celle-ci, tissant ou non des liens entre les espaces et les époques. Une telle orientation va de pair avec des partenariats constructifs pour que savoir et expérience ne soient pas des antonymes, mais bel et bien les aspects pluriels d’une envie commune de faire connaître, grâce à la poétique, à l’art et leurs enjeux, des univers symboliques qui rendent compte du monde, qui l’interrogent et le façonnent, pour que chacun et chacune puisse en être un acteur déterminé.
Africana. Figures de femmes et formes de pouvoir se présente en quatre grandes parties déclinées en fonction des formes de pouvoir retenues lors de l’exposition homonyme et des ateliers de l’année 2020 : les pouvoirs de dénoncer, de participer, de choisir et encore de résister, actions qui souvent n’impliquent pas la rupture avec les proches ou la communauté, mais plutôt le souhait de négocier une place autre, nouvelle, parmi eux.
14En ouverture, le pouvoir de dénoncer est associé aux discours et imaginaires qui disent le monde contemporain, en Afrique ou dans les diasporas. Assumant ou revendiquant des voix souvent perçues comme transgressives qui font du corps l’emblème d’une conquête, les fictions expriment une quête libertaire, puisque la figure féminine choisit et se choisit. Au cœur de ce processus se déploient le monde afropéen et celui de fictions afro-américaines, mais est aussi questionné un afro-futurisme où la franchise Marvel et ses super-héroïnes affichent un pouvoir qui joue des stéréotypes. Ces ambiguïtés sont d’ailleurs discutées par les trois auteures que nous avons eu le plaisir d’accueillir à Lausanne et qui ont répondu avec ferveur à toutes nos questions.
Avec le pouvoir de participer, les rapports de force ne sont pas toujours antagonistes : dans les récits, les femmes d’Afrique participent à la vie de leur communauté en faisant entendre leur voix, en témoignant de conditions de vie ou de survie, en œuvrant pour des transformations sociétales. Le pouvoir de participer rend compte d’un sentiment d’appartenance qui articule des histoires personnelles à l’histoire collective ou nationale. L’intime et le public sont imbriqués, dans les fictions et les témoignages, et les voix féminines font de cet espace nouveau un champ ouvert à des formes d’engagement qui traversent le temps, par exemple avec la figure de Kimpa Vita au Congo au xviiie siècle. L’histoire et la mémoire sont des espaces désormais occupés par des personnalités féminines, fictives ou réelles – dans des anthologies ou des récits de filiation – et nous y associons les perceptions du continent par les essais historiques d’Adame Ba Konaré, par les récits des séjours de Lucie Cousturier au début du xxe siècle, ou encore par les comptes rendus évolutionnistes et racistes des savants européens penchés sur le corps de Saartjie Bartman, la Vénus hottentote, au début du xixe siècle. Ce regard occidental sur l’« autre », dénoncé depuis, reste en suspens dans certains récits qui désormais caricaturent les instances internationales occidentales aux discours focalisé sur une éternelle vulnérabilité de genre.
Le pouvoir de choisir envisage, quant à lui, différentes configurations médiatiques, tant picturales que cinématographiques ou bédéistes : personnages ou réalisatrices, peintres, sculptrices ou performeuses, les figures de femmes surgissent sur toutes sortes de supports ; elles sont mises en scène ou créent leur scène. Leur présence affirme des singularités qui privilégient la sororité, la mise en résonance de moments de 15vie qui interpellent la communauté des femmes, que ce soit à travers l’humour provocateur des vignettes de Goorgoorlou, des performances des drag kings sud-africains, des rôles féminins dans les films de Sembène Ousmane, ou encore des interviews filmées d’anonymes. Leur présence médiatique permet de dépasser les situations de violence endurées, la « performance » incarne ce choix.
Nous concluons avec le pouvoir de résister qui est une mise en péril assumée, manifestée par l’action, la réaction ou même l’indifférence des personnages féminins : ne pas jouer son rôle est aussi une façon de protester, de s’insurger pour tenter d’affirmer une autonomie. Et c’est bien la contestation du principe moral de la patience qui a séduit les lecteurs du dernier roman de Djaïli A. Amal, Goncourt des Lycéens 2020, où se déploie une réalité quotidienne en lutte avec le risque de la folie et l’envie de fuir. Cette patience attendue de toute femme – en Afrique et ailleurs – est thématisée dans l’interview que l’auteure nous a accordée, permettant ainsi d’associer démarche poétique et activisme associatif, ce qu’elle a aussi évoqué à propos de l’attitude sahélienne envers un bébé fille ou garçon en train de pleurer : le petit mâle sera rapidement calmé et consolé ; le bébé fille devra attendre avant que quelqu’un vienne la chercher, afin qu’elle intègre le munyal, la patience18… Face à de tels codes, résister à l’autorité patriarcale, aux stéréotypes sexistes ou coloniaux, réfuter un destin tracé par la famille, refuser la mainmise d’une religion ou voir en elle le soutien à une génération perdue sont autant de façons de faire front. Les personnages féminins résistent aux espaces étriqués qui leur sont attribués, refusent d’être relégués au statut de bien négociable et développent des stratégies de survie dans des environnements hostiles, parce que les hommes les dominent et parce que la terre ne peut effacer, réparer les violences commises : le temps n’est plus à l’idylle avec la terre mère et nourricière.
Africana. Figures de femmes et formes de pouvoir convoque de nombreuses approches critiques, en privilégiant les textes fictionnels qui donnent à lire notre monde sans obligation référentielle, offrant à chaque lecteur une immersion poétique et esthétique. Celle-ci génère un rapport au monde que d’autres formes de créativité et de savoir dévoilent, selon leurs propres codes. Nous avons privilégié cette ouverture méthodologique, 16significative de la diversité de nos contributrices et contributeurs, et surtout trace fondamentale de la puissance des représentations féminines africaines et diasporiques, en ce début de xxie siècle. Les statues de terre cuite façonnées par l’artiste Awa Camara qui scandent les parties de ce volume sont pour nous signes de la performance à l’œuvre, tant par la démarche proposée que la richesse des réflexions à découvrir : la figure féminine aux formes démultipliées, debout sur un ou deux pieds, concentre les forces déployées et négociées afin de se renouveler sans cesse.
Christine Le Quellec Cottier
et Valérie Cossy
Université de Lausanne
Nous remercions de leurs soutiens l’Université de Lausanne, le Département fédéral des affaires étrangères, l’Académie suisse des sciences humaines et sociales, la Société suisse d’études africaines et la Société académique vaudoise. Nous saluons aussi la générosité de The Jean Pigozzi Collection of African Art, du CNAP-Paris, de la Collection de l’Art Brut-Lausanne et des ayants-droit mentionnés.
17
Fig. 1 – Seni Awa Camara, Sans titre, 2006 :
Terre cuite (136,5 x 37,5 x 27,5 cm). © Seni Awa Camara,
courtesy The Jean Pigozzi Collection of African Art.
1 Jean-Marie Volet, La Parole aux Africaines ou l’idée de pouvoir chez les romancières d’expression française de l’Afrique sub-saharienne, Amsterdam, Rodopi, 1993, p. 13.
2 Remise du Prix Ahmadou-Kourouma, « Salon du Livre en ville », Genève, Galerie ILAB-Design, 30 octobre 2020 : « https://www.lepoint.fr/afrique/salon-du-livre-de-geneve-hemley-boum-laureate-du-prix-kourouma-2020--30-10-2020-2398794_3826.php (consulté le 29/06/2021) ».
3 Paul Klee, « Credo du créateur » [1920], Théorie de l’art moderne, Genève, Gonthier/Denoël, coll. « Bibliothèque Médiations », 1969, p. 34.
4 Voir : Souleymane Bachir Diagne, L’Encre des savants. Réflexions sur la philosophie en Afrique, Paris-Dakar, Présence africaine-CODESTRIA, 2013, p. 20.
5 L’expression proposée en 1988 par l’historien Valentin Y. Mudimbe dans son essai The Invention of Africa : Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge (Bloomington, Indiana University Press) désigne un ensemble de textes produit par l’Occident, représentant l’Afrique et les Africains, source de divers « savoirs » sur ce continent.
6 Cette interprétation du pouvoir est développée par Foucault dès 1975 dans Surveiller et punir. Ces « rapports » sont synthétisés par G. Bouchard dans « Le savoir-pouvoir de/du sexe », Laval théologique et philosophique, vol. 52, no 2, juin 1996, p. 527-549 : « Tout d’abord, le pouvoir n’est pas une propriété, une sorte de marchandise que l’on posséderait, mais quelque chose qui s’exerce au moyen de certaines stratégies : il ne constitue pas le privilège d’une classe dominante, mais résulte des positions stratégiques de celle-ci. En second lieu, le pouvoir ne s’applique pas simplement, en tant qu’interdiction ou obligation, à ceux qui “ne l’ont pas”, mais il les investit, il s’appuie sur eux, comme eux-mêmes, dans leur lutte contre lui […]. » (p. 529) : « https://doi.org/10.7202/401009ar (consulté le 29/06/2021) ».
7 Anne-Emmanuèle Calvès, « “Empowerment” : généalogie d’un concept clé du discours contemporain sur le développement », Revue Tiers-Monde, no 200, octobre-décembre 2009, p. 735-749 : « https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2009-4-page-735.htm (consulté le 29/06/2021) ».
8 Calixthe Beyala, Lettre d’une Africaine à ses sœurs occidentales, Paris, Spengler, 1995, p. 20-21.
9 Collectif GenERe, Épistémologies du genre. Croisements des disciplines, intersections des rapports de domination, Lyon, ENS éditions, 2018, p. 9.
10 Ibid., p. 122. On se réfèrera aussi à l’essai de Françoise Vergès Un féminisme décolonial (Paris, La Fabrique, 2019) et au volume collectif à l’approche multiculturelle, Écrire et penser le genre en contextes postcoloniaux, dirigé par Anna Castaing et Élodie Gaden (Bruxelles, Peter Lang, 2017).
11 Voir : Léonora Miano, Afropéa, Paris, Grasset, 2020, p. 10 et p. 48. Johny Pitts a publié en 2019 Afropean: Notes from Black Europe (Penguin Books) et sa traduction française Afropéens, carnets de voyages au cœur de l’Europe noire (Massot, 2020) a reçu le Prix de l’Essai 2021 de la Fondation Charles Veillon-Lausanne.
12 Le dossier de la revue Études littéraires africaines (ELA 51, 2021) s’intitule « (Re)lire les féminismes noirs » et le Congrès de l’APELA, organisé en septembre 2021 par S. Ghermann (Université Humboldt) et D. Boulanger (Université d’Oxford), a proposé : « Activismes et esthétiques queer dans les littératures africaines ».
13 Mariama Bâ, « La fonction politique des littérature africaines écrites », Écriture africaine dans le monde, no 3, 1981, p. 7.
14 La version originale anglaise fait référence aux « Human Rights », « droits humains », à la résonance bien différente de « droits de l’homme » en français. Chimamanda Ngozi Adichie, Nous sommes tous des féministes, Gallimard, Folio, 2016 [2012], p. 44.
15 Friedrich Naumann Fondation for Freedom : « https://www.freiheit.org/sub-saharan-africa/focus/africa-freedom-prize-2020 (consulté le 29/06/2021) » [nous traduisons].
16 Jean-Marie Volet, Imaginer la réalité : la lecture des écrivaines africaines, Fremantle (Australia), Gecko, 2003, p. 12 et 13.
17 Les sites restent disponibles sur la plateforme de l’Université Western Australia : « https://aflit.arts.uwa.edu.au » et « https://motspluriels.arts.uwa.edu.au (consultés le 29/06/2021) ». L’inventaire de la Bibliothèque et celui du Fonds Jean-Marie Volet sont désormais disponibles en ligne sur le site de la BCUL : « sp.renouvaud.ch » et introduire le mot-clef LAFVOL ; « https://www.patrinum.ch/record/218935 (consultés le 29/06/2021) ».
18 Conférence donnée par D. A. Amal le 8 juin 2021 au « Club 44 » de La Chaux-de-Fonds, dans le cadre du Printemps culturel neuchâtelois : « Sahel, terre de lumière ».