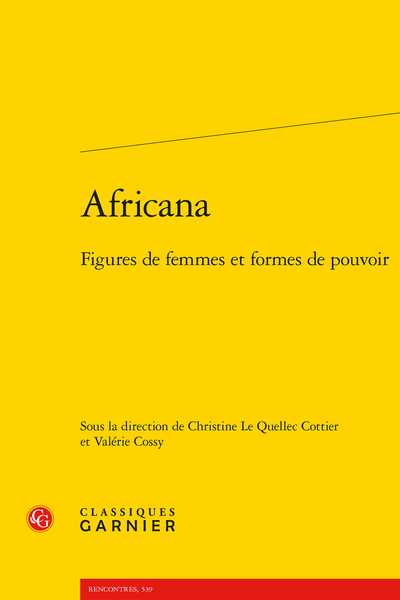
Hommage à la femme noire de Simone et André Schwarz-Bart Mise en lumière de plusieurs générations d’héroïnes noires
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Africana. Figures de femmes et formes de pouvoir
- Auteur : Stampfli (Anaïs)
- Résumé : Cet article étudie Hommage à la femme noire d’André et Simone Schwarz-Bart. Il s’agit ici de revenir sur la genèse de ce projet encyclopédique et d’étudier les moyens mis en œuvre pour restituer l’histoire de femmes noires de la préhistoire aux années 1980. Nous reviendrons sur le choix de mêler récits fictifs et historiques. Ce choix a fait l’objet de critiques mais il est assumé par le couple Schwarz-Bart qui propose une vision poétique et vivante des femmes ainsi mises en valeur.
- Pages : 253 à 270
- Collection : Rencontres, n° 539
- Série : Francophonies, n° 2
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406127352
- ISBN : 978-2-406-12735-2
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12735-2.p.0253
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 18/05/2022
- Langue : Français
- Mots-clés : André et Simone Schwarz-Bart, intersectionnalité, témoignages, légendes, traduction
Hommage à la femme noire
de Simone et André Schwarz-Bart
Mise en lumière
de plusieurs générations d’héroïnes noires
L’Hommage à la femme noire est une encyclopédie en six volumes élaborée par le couple d’écrivains André et Simone Schwarz-Bart en 1988-1989. Ils ont, entre autres, été soutenus dans leur travail de recherche par l’historienne Malka Marcovich et l’éditrice Jacqueline Sag qui a réuni de nombreux documents iconographiques.
Cette encyclopédie a été rééditée en 2020 en une version réduite chez Caraïbéditions selon le souhait de Simone Schwarz-Bart, de l’éditeur et de la communauté de lecteurs qui ont manifesté le désir de voir cette œuvre épuisée à nouveau accessible1. Cette réédition sous-titrée Héroïnes de l’esclavage correspond au tome III de la première version, qui est consacré à la période esclavagiste. Dès son édition originale, l’ouvrage retrace le parcours de femmes noires oubliées, de la préhistoire aux années 1980. Ce vaste projet naît de la constatation d’un vide à combler, l’histoire des femmes noires restant globalement inconnue du grand public. Le couple d’écrivains antillais a ressenti le besoin de les sortir de l’ombre et mettre au jour l’univers référentiel de ses lecteurs et lectrices. Il leur a semblé nécessaire et urgent de se souvenir que la soumission à l’esclavage ne s’est pas faite dans une passivité générale. Ils ont ainsi dressé le portrait de reines africaines qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de leur peuple. Cependant, les Schwarz-Bart ne se sont pas contentés d’une écriture de la consolation. Leur plume nuancée n’hésite pas à rappeler que la vision de l’Afrique 254comme un paradis perdu, vision partagée par nombre de caribéens descendants d’esclaves, n’est qu’un mythe.
L’Hommage à la femme noire présente cent onze portraits de femmes répartis en six tomes. Le premier revient sur les mythes de la création et évoque les destinées de reines africaines et de descendantes d’esclaves. Le deuxième tome évoque l’histoire de l’esclavage à partir non pas de la traversée océanique comme il est coutume de l’écourter mais de l’Afrique : il est ainsi question des différents réseaux de traite d’esclaves sur le continent africain et du marchandage d’esclaves qui se conclut en Afrique avant la traversée de l’Atlantique. Les auteurs mettent ainsi en lumière aussi bien les figures de résistance et les enclaves non-réduites en esclavage que les intermédiaires complices qui ont contribué au bon déroulement du commerce triangulaire. Le tome III porte quant à lui sur l’esclavage d’un point de vue élargi en évoquant l’exploitation négrière en place dans la Caraïbe, au Brésil et en Amérique du Nord. Dans le tome IV, il est question des Africaines qui ont œuvré pour l’émancipation féminine depuis la fin du xixe siècle. Le tome V est consacré aux femmes artistes et écrivaines engagées en Amérique du Nord et enfin le tome VI met en lumière les parcours de femmes caribéennes contemporaines lors de la première publication2. L’encyclopédie se clôt sur une invitation à poursuivre et actualiser ce travail de recensement et de mémoire.
Nous analyserons ainsi les raisons d’être de ce projet encyclopédique, l’interprétation que font les auteurs de l’histoire mais également les moyens mis en œuvre pour mettre en avant les parcours de ces femmes malgré le peu d’informations dont on dispose au sujet de certaines d’entre elles. Les Schwarz-Bart multiplient les supports pour pallier le manque d’écrits. L’encyclopédie est ainsi constituée de reproductions de gravures, peintures, photographies, de textes d’archives et de passages fictifs donnant voix à ces héroïnes. Cette composition faite de textes d’archives et de fiction ne fait pas l’unanimité. Alain Huetz de Lemps a ressenti une certaine gêne à la lecture : « La valeur des témoignages est inégale et il est souvent difficile de faire la part de ce qui est véritablement historique et de ce qui relève de la légende 255et de l’imaginaire » (A. Huetz de Lemps, 1991, p. 89). Cet avis nous donnera l’occasion de songer à la portée de cette encyclopédie polymorphe ainsi qu’à la manière d’envisager ce tressage de références historiques et imaginaires.
Genèse de l’Hommage à la femme noire
Dans le cadre du documentaire Simone et André Schwarz-Bart. La Mémoire en partage, Simone Schwarz-Bart revient en 2018 sur les raisons qui ont motivé l’établissement de l’encyclopédie :
[…] en tant que femme noire il fallait que je trouve dans le passé des exemples exaltants qui m’aident à vivre dans un univers pas toujours motivant – pour décider à me donner pleine valeur en tant que noire – en tant que femme noire. Alors, j’ai voulu créer ma galerie d’ancêtres. J’ai essayé d’écrire une espèce de Bible des femmes noires. Et c’est ainsi que j’ai commencé à glaner des histoires portugaises, des histoires anglaise, des histoires américaines, des histoires brésiliennes, des histoires… Tout ça, je les archivais et j’en avais besoin. [Propos recueillis par Clavel, 2018, je transcris.]
Ces propos témoignent d’un investissement personnel fort de la part de Simone Schwarz-Bart : l’Hommage est né, dans le cadre d’une quête identitaire, d’un « besoin » de repères et d’histoires : besoin de se construire une « galerie d’ancêtres » dont elle peut être fière, qui brisera le silence sur l’histoire de la femme noire. Dans le même esprit que l’historien et anthropologue Nathan Wachtel qui a tenté de reconstituer l’histoire des peuples d’Amérique latine dans La Vision des vaincus (1971), les Schwarz-Bart ont donc entrepris de réécrire une histoire qui ne soit pas centrée sur le point de vue occidental en regroupant les quelques traces qu’ils ont eues à disposition. À la lecture des chapitres consacrés à Kimpa Vita (tome II) et à la mulâtresse Solitude (tome III), entre autres, le lecteur se détache rapidement des a priori historiques autour de la passivité des peuples africains qui se seraient docilement livrés aux esclavagistes. Nous pouvons rapprocher ces deux femmes car, malgré le siècle qui les sépare, leurs parcours tels que narrés par les Schwarz-Bart sont très semblables et elles ont durablement marqué les mémoires collectives alors que rien 256ne les y prédestinait. Kimpa Vita venait de M’Bligha, une vallée reculée du Congo. Quant à Solitude, elle était une esclave abandonnée à huit ans par sa mère qui a fui l’habitation (terme dont on désigne ensemble la plantation sur laquelle travaillent les esclaves, la maison du maître et les cases des esclaves). André Schwarz-Bart a imaginé les origines de Solitude qui serait le fruit du viol qu’un marin français aurait commis sur une esclave africaine. Cette mulâtresse incarne ainsi un métissage contraint et lourd à porter. Les Schwarz-Bart précisent : « Dans la condition de l’esclavage, le mélange des sangs a souvent produit des êtres flous, aux contours indistincts, déchirés entre l’Afrique et l’Europe et ne trouvant nul point d’appui en ce bas monde » (t. III, p. 138). Kimpa Vita est également emprunte d’un certain métissage culturel. Habitée par des croyances africaines ancestrales, elle mêle cette spiritualité à la foi chrétienne : elle est guidée par la prophétesse Matuffa tout en étant animée par une vision de Saint Antoine et trouvera sa moitié en la personne de Borro qui n’est autre que la réincarnation de Saint Jean. C’est inspirée par ces influences syncrétiques que Kimpa Vita va guider le peuple, initier des processions et lutter contre la misère. Parallèlement, c’est la situation de Solitude, esclave abandonnée et fruit d’un viol, qui va la pousser à se rebeller et à devenir la dirigeante d’un groupe d’esclaves en marronnage, les survivants de la Goyave. Ces deux meneuses ont pour point commun d’avoir vécu une maternité ambivalente dans le sens où elle a été à la fois l’assurance de leur descendance et de leur condamnation. Les ennemis de Kimpa Vita ont profité du jour de son accouchement pour attaquer le palais royal, l’enlever, la condamner lors d’un simulacre de procès pour enfin la séparer de son fils et la brûler. Avec son accouchement, elle a à la fois assuré sa descendance et baissé la garde, ce qui l’a menée à sa perte. De même, lorsqu’elle et les siens ont été cernés par l’armée française, Solitude a eu quelque temps la vie sauve, le temps que son enfant naisse, pour ensuite subir également une séparation avec sa progéniture devenue propriété de son ancien maître. Les Schwarz-Bart précisent : « l’on a remis l’exécution au lendemain de sa délivrance » (t. III, p. 130). Délivrance et condamnation sont ici intimement liées. C’est lorsque ces deux femmes deviennent mères qu’elles deviennent vulnérables et perdent le pouvoir. On peut voir derrière ces portraits une réflexion sur la maternité, symbole courant du pouvoir de la femme. Cependant, cette faculté de donner la vie effraie 257et suscite une volonté de contrôle qui se traduira par différentes formes d’oppression. L’on retiendra également la dignité de ces héroïnes qui après avoir perdu leur progéniture affrontent la mort sans crainte aucune et deviennent des femmes martyrs entrées dans la légende. La sagesse de Kimpa Vita sur le bûcher impressionne et nourrira le mythe autour de sa personne. Elle aurait déclaré lors d’un échange avec le père Laurenzo da Lucca : « Que m’importe de mourir, […], ce pas, j’ai à le faire une seule fois. Mon corps n’est pas autre chose qu’un peu de terre, je n’en fais aucun cas : il sera, tôt ou tard, réduit en cendres » (t. II, p. 20). Quant à Solitude, elle impressionne par le contraste entre sa jeunesse et sa mort toute proche : « Les traits creusés jusqu’à l’os, les cheveux d’un blanc éblouissant au soleil, elle avance paisiblement entre les deux rangées de spectateurs, tandis que le devant de sa chemise de nuit s’auréole, peu à peu, de taches de lait : elle a trente ans… » (t. III, p. 130). Son corps est encore plein de vie – en témoigne sa montée de lait – et sera pourtant bientôt d’une funeste rigidité. Se créé ainsi un effet de contraste entre sa jeunesse, sa sagesse et sa proximité avec la mort (elle affronte « paisiblement » sa mort alors qu’il s’agit d’un être « éblouissant », dans la fleur de l’âge). Avec l’histoire de ces deux héroïnes, la galerie d’ancêtres que Simone Schwarz-Bart appelait de ses vœux prend vie et dissémine en les subvertissant les idées reçues sur la passivité des ancêtres africains et des esclaves qui se seraient laissé coloniser et livrer aux oppresseurs sans fierté aucune.
Cependant, un autre souci habite les auteurs de cette anthologie. Ils précisent à la fin du chapitre consacré à la Mulâtresse Solitude que cette dernière est restée la grande oubliée dans la mémoire collective guadeloupéenne jusque dans les années 1960 contrairement à ses compagnons de lutte masculins3.
Souvenons-nous que l’Hommage à la femme noire a été publié en 1988-1989. Il est donc contemporain de l’Éloge de la créolité, manifeste paru en 1989, coécrit par Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant. Dans cet ouvrage, les auteurs martiniquais appellent à la célébration de l’identité antillaise créolisée. Certains reprochent aux 258signataires de ne pas avoir ouvert leur démarche aux femmes du monde culturel caribéen4. Plus généralement, les femmes apparaissent souvent comme les grandes oubliées des militants pour l’affirmation culturelle caribéenne. Nous pouvons penser à Suzanne Césaire, épouse d’Aimé Césaire, qui a été une grande penseuse de la Négritude et a tenu la revue fondatrice Tropiques publiée de 1941 à 1945, mais qui est restée dans l’ombre. De même, sa contemporaine Paulette Nardal a été à l’initiative de grandes rencontres littéraires parisiennes et est tombée dans l’oubli. À la fin de l’Hommage, les Schwarz-Bart expriment à ce sujet le regret de n’avoir pas eu la place de lui consacrer un chapitre. La rédaction de cette anthologie a véritablement été motivée par le souhait de combler un injuste silence : « On fait beaucoup de bruit sur le droit des Noirs, mais pas un mot sur les femmes noires », peut-on lire dans l’Hommage (t. III, p. 233). Les Schwarz-Bart écrivent cette anthologie alors que les mouvements féministes commencent tout juste à explorer la question de l’intersectionnalité. Leurs propos font ainsi écho à l’engagement contemporain de militantes féministes comme bell hooks.
Les auteurs ont donc cherché à inverser la tendance en consacrant de nombreuses pages de l’anthologie aux femmes militantes d’Afrique et de sa diaspora. Nous pouvons penser à l’élogieux portrait d’Angela Davis (t. V) ainsi qu’à celui de Winnie Mandela (t. IV) qui occupe une place importante dans cette anthologie : parallèlement à son portrait, ses propos sont rapportés et ponctuent les fins de chapitres du quatrième tome. Les auteurs s’appuient sur le recueil de cette dernière intitulé Une part de mon âme (1986) pour illustrer le tome IV consacré aux militantes de l’émancipation féminine. Sont mis en exergue des extraits au cours desquels Winnie loue le combat de son illustre mari mais aussi ceux où elle répond aux regards envieux sur la femme d’un héros national5. Elle évoque les lourds sacrifices familiaux faits au nom des ambitions politiques de Nelson Mandela et critique plus généralement l’ANC et sa tendance à écarter les femmes de ses combats. En relayant ces dires, 259les Schwarz-Bart contribuent à militer pour la légitimité des femmes à s’engager au même titre que les hommes. Ce faisant, ils n’oublient pas d’illustrer ces propos engagés de portraits graphiques de femmes, de proverbes et de chants. Dès le début de l’Hommage, le lecteur comprend qu’il a entre les mains un ouvrage engagé, non seulement grave mais aussi ouvert, faisant de nombreux parallèles entre différentes formes d’expression artistiques et différents corps de métiers (il est question de chanteuses, mannequins, cuisinières, femmes politiques…). L’ouverture vers la mythologie a également sa place dans cette réécriture de l’histoire du point de vue des femmes. Il est ainsi précisé dans le tome I consacré aux mythes fondateurs que selon certaines légendes africaines le premier homme aurait été façonné par Mébère, le Créateur, à partir d’un lézard6. En découvrant ce récit, le lecteur occidental fait rapidement le rapprochement avec l’épisode biblique de la création de la femme à partir d’une côte d’Adam. Cette conception réductrice de la femme selon la Genèse trouve ainsi son équivalent masculin africain avec ce récit des origines fondé sur un simple reptile. On peut deviner ici une certaine satisfaction de voir une réciproque masculine au récit biblique de la création.
L’Hommage ne comporte pas uniquement des textes décrivant des femmes puissantes et affirmées. Quelques passages dressent les portraits de femmes modestes, soumises et conscientes de leur infériorité. Ces extraits détonnent du reste de l’ouvrage et surprennent à la première lecture. Dans le chapitre mettant à l’honneur Tata Ajaché, l’esclave qui devint reine, une page consacrée aux « paroles d’une femme ordinaire » du peuple peul woDaaBe explique longuement l’infériorité féminine :
Une femme ne t’expliquera pas beaucoup de choses. Une femme ne sait rien. Nous, les femmes, nous ne décidons rien, nous ne pouvons rien. Nous suivons. C’est tout. Si tu veux apprendre beaucoup de choses sur la vie des WoDaaBe, il faut aller voir les vieux. Il faut aller chez les hommes et les écouter. Ce sont eux qui savent tout, qui décident tout, qui peuvent tout. (t. II, p. 73)
Nous notons ici une opposition ternaire des plus assertives (rien-rien-rien/tout-tout-tout). Il est précisé en bibliographie que les Schwarz-Bart ont ici cité des propos recueillis par Angelo B. Maliki. On retrouve 260effectivement en page 13 de Bonheur et souffrance chez les peuls nomades la retranscription textuelle de ces propos tenus par une femme woDaaBe. S’affirme donc la volonté de retranscrire fidèlement les propos tenus par une femme peul sans jugement et sans le filtre de nos valeurs occidentales7. Cela dit, il semble que ces paroles n’aient pas été sélectionnées par hasard pour figurer dans l’anthologie, car à la fin de l’extrait cité, la femme woDaaBe raconte un renversement : pendant la sécheresse, les hommes ont perdu la maîtrise de la situation et ce sont les femmes qui ont assuré la survie du foyer par leur débrouillardise, en vendant leurs services de coiffeuses, par exemple. Ce témoignage peut faire penser au paradigme wolof de la soutoura qui renvoie à la dignité, à la discrétion ou à la décence des femmes qui laissent transparaître une certaine humilité alors que ce sont elles qui assurent la vie du foyer par des stratégies cachées8.
Par ailleurs, certaines références à l’infériorité des femmes noires semblent être choisies pour alerter au sujet de l’auto-aliénation qui a intégré la vision hiérarchisée de l’homme blanc. Dans « Paroles d’esclaves », les auteurs transposent les propos de Sojourner Truth déjà cités par Gerda Lerner9 : « Les Blanches sont plus malignes et plus avisées que les Noires. Elles ne savent pas grand-chose, les Noires. Elles ne font que laver le linge – et elles ne peuvent guère monter plus haut […] » (t. III, p. 233). Il s’agit là des propos d’une militante pour les droits de la femme dont la teneur auto-dépréciative est liée au constat que les femmes noires sont mises en position d’infériorité par la société qui leur refuse l’instruction, alors que cet état de fait peut et doit évoluer. Sojourner Truth confirme son engagement dans ce même passage : « On fait beaucoup de bruit sur le droit des Noirs, mais pas un mot sur les femmes noires […] Je suis pour qu’on continue à se battre tant que les choses bougent, car si on attend qu’elles se calment, il faudra longtemps pour les remettre en route » (t. III, p. 233).
261Cette vision de la femme noire comme un être inférieur est également reprise dans le cinquième volume pour mettre en avant son absurdité. On conçoit ainsi rapidement les paradoxes de la bourgeoisie du Sud des États-Unis pendant la Ségrégation. Le chapitre consacré à Mary McLeod Bethune s’achève sur un témoignage intitulé « Parole de femme » donnant voix à une militante et ces propos non référencés laissent supposer qu’ils proviennent d’un personnage inventé par les Schwarz-Bart bien qu’ils fassent écho aux combats de Mary McLeod Bethune : « Une femme de couleur, si respectable soit-elle, vaut moins qu’une prostituée blanche. La femme blanche du Sud déclarera qu’aucune femme noire n’est vertueuse, et pourtant c’est à ses soins qu’elle confie ses enfants innocents… » (t. V, p. 37). La formulation antiphrastique interpelle le lecteur qui adhèrera d’autant plus aux combats des militants contre la Ségrégation évoqués dans le tome V. Cette « parole de femme » en particulier n’est pas reprise d’un recueil anthologique. Les Schwarz-Bart ont ici imaginé le probable discours d’une femme noire américaine victime de la Ségrégation. Les propos fictifs abondent dans l’anthologie et nous pouvons interroger leur raison d’être.
Reconstituer par la fiction
des paroles de femmes
Moyen de combler les béances
de la mémoire collective
Avec l’Hommage à la femme noire, l’idée était de raconter l’histoire du point de vue des femmes. Pour ce faire, il a fallu combler les vides laissés par les textes officiels relatant le point de vue lacunaire des dominants. Les Schwarz-Bart ont donc choisi de mêler aux textes cités des passages de leur plume imaginant la manière dont les femmes dépeintes se seraient présentées. Ce faisant, ils ont entrepris une démarche analogue à celle de Virginia Woolf qui, dans Une chambre à soi, comble l’absence de femmes dramaturges lors de la Renaissance anglaise en inventant Judith Shakespeare, la petite sœur de William. L’ancrage féminin et le thème de la maternité sont les points communs d’une grande 262partie de leurs interventions. Il est en effet régulièrement question de grossesse, d’éducation, de déchirantes séparations des mères et de leurs enfants. Les « Paroles d’esclaves » du tome III évoquent, par exemple, les pleurs d’une esclave mère qui sera malgré ses supplications vendue séparément de ses enfants. On note ici la forte charge pathétique et la noblesse des propos décrivant la mère éplorée : « La répétition ne peut réduire l’amertume d’une telle expérience, et c’est quelque chose de si désespérant qu’elle jette sur tout le reste de l’existence une ombre plus noire qu’un voile funèbre » (t. III, p. 63).
L’attention portée au corps et à ses fluides est grande dans l’écriture de la femme qu’esquissent les Schwarz-Bart. Elle naît probablement des paroles et proverbes africains qu’ils ont relevés. Il est rapporté dans le tome I que la valeur du Togu (que l’on pourrait définir comme un charme) émane de tout le corps des bonnes personnes : « Nous disons que c’est à cause du sang qui est en eux, des os qui sont en eux, de l’eau qui est partout dans leur corps » (t. I, p. 10510). Plus loin, l’on apprend par des proverbes que le bonheur est une « goutte de lait giclée au moment de la traite » (t. I, p. 193) et que « La bouche garde le sang et crache la salive. Si quelqu’un se blesse à la bouche, sa bouche va saigner. Mais s’il crache, il ne crache que de la salive » (t. II, p. 197). Imprégnés par ces images qu’ils ont retranscrites, les Schwarz-Bart ont à leur tour entretenu l’isotopie autour des fluides corporels en évoquant, comme mentionné plus haut, la poitrine tachée de lait de Solitude au moment de sa mort ou encore le sort des esclaves allaitantes dont le lait se mêlait au sang au contact du fouet du maître (t. III, p. 215). Ces images très visuelles peuvent être interprétées comme autant de références à l’énergie vitale et au risque de mort intimement liés dans le quotidien des femmes esclaves.
Les « Paroles de femmes » du tome VI récapitulent à ce sujet les risques funestes encourus par une femme noire au cours de sa vie dans la société esclavagiste et post-esclavagiste. Cette synthèse se fait par l’intermédiaire de citations de passages clés du roman de Simone Schwarz-Bart Pluie et vent sur Télumée Miracle (1976). Est ainsi décrite une société marquée par la violence, qu’elle soit conjugale ou patronale. Cependant, ce sort n’est pas une fatalité et Télumée sort plus forte des 263épreuves traversées, comme celle de la tentative de viol par le patron, qu’elle a vaillamment détournée (t. VI, p. 115).
Les propos d’enfants sont également très fréquemment rapportés dans la section « Paroles de femmes » de l’anthologie. Ces filles livrent une version fragmentaire des événements dont elles sont témoins car leur jeunesse ne leur permet pas de comprendre la gravité de la réalité. Ces récits parcellaires mettent ainsi en exergue par contraste la dureté d’une réalité trop difficile à concevoir pour l’assimiler. Nous pouvons, entre autres, penser aux « paroles de femmes » qui relatent rétrospectivement, dans le tome V (p. 125), un souvenir de parade nocturne du Ku Klux Klan. Ce souvenir d’enfance est conté de manière fragmentaire par le biais d’un assemblage d’images choc où la perception de l’inquiétude des parents cachés se mêle aux lumières et sons détonants de la parade.
La figure de l’enfant permet également de mettre en évidence la cruauté des tortionnaires s’exerçant sans distinction sur les adultes et les enfants innocents. Le lecteur se souviendra ainsi des « paroles d’esclave » relatant l’histoire d’une fillette fouettée pour avoir trouvé et mangé un biscuit : « Ensuite, ils ont répandu du sel sur les plaies pour me punir encore plus. J’ai encore les marques aujourd’hui sur mon vieux dos, exactement comme ma grand-mère lorsqu’elle est morte, et je porterai les miennes jusque dans la tombe, comme elle » (t. III, p. 17711). Cette précision postérieure crée de l’empathie pour la victime d’un lynchage acharné subi de mère en fille. Ces chaînes de violence ont eu pour effet d’entretenir la méfiance et la haine de la communauté noire envers la communauté blanche, comme en témoigne Winnie Mandela, dont les souvenirs d’enfance marqués par le racisme ont été recueillis dans le tome IV : « Une colère naît en vous, l’enfant, et grandit et détermine la conscience politique de l’homme noir » (p. 3812).
Enfin, il faut remarquer que le point de vue enfantin donne l’occasion aux Schwarz-Bart d’introduire une dimension poétique et méditative dans l’anthologie régulièrement marquée par des passages très sombres. Ils introduisent ainsi dans les « paroles de femmes » du tome V des souvenirs de rêveries enfantines sur le chemin du retour de l’église :
264Nous n’avions pas de jouets et nous nous amusions parfois à attraper des papillons. Grand-père nous disait le nom des belles couleurs sur leurs ailes, et puis nous les laissions partir ; souvent, je les suivais du regard aussi loin que possible, puis je demandais où ils étaient partis ; est-ce qu’il y avait une autre ville comme la nôtre ? Il répondait que oui et il parlait de la grande ville très loin d’ici où il espérait aller un jour. (t. V, p. 85)
Cet ajout de pauses méditatives aux témoignages rapportés fait de l’Hommage à la femme noire un ensemble hybride qui représente un défi de taille pour les traducteurs de cette encyclopédie. En effet, si la traduction de propos poétique est toujours délicate, il faut aussi avoir à l’esprit que dans l’Hommage les voix de personnages fictifs se mêlent aux témoignages historiques sans que les sources ne soient toujours rappelées. Il semble ainsi ardu pour les traducteurs de faire la part des choses et la voie de la facilité consisterait à cultiver ce flou. Ce n’est cependant pas le parti pris par les traducteurs anglophones dont la transposition sera à présent étudiée.
Transposition anglaise
de l’encyclopédie
Les Presses Universitaires du Wisconsin ont soutenu le projet de traduction de l’anthologie en anglais. L’Hommage à la femme noire devient In Praise of Black Women sous la plume de Rose-Myriam Réjouis et Val Vinokurov, rejoints par Stephanie Daval pour le volume II et par Stephanie K. Turner pour les volumes III et IV13. Le volume IV a été augmenté de quelques présentations par Rose-Myriam Réjouis afin d’actualiser cette galerie de portraits, quinze ans après la première publication.
La tâche n’a pas été évidente. Il leur a fallu restituer de manière équivalente et compréhensive les nombreux proverbes que les Schwarz-Bart 265ont recueillis dans l’ouvrage en français d’Angelo B. Maliki. Il s’agissait donc de transposer en anglais des propos qui étaient déjà une transposition du wolof en français. « Quand tu vois la barbe de ton prochain brûler, mouille la tienne ! » (t. I, p. 167) devient ainsi « When your neighbour’s beard is on fire, wet yours », et « les bonheurs n’ont pas leur campements proches » (t. II, p. 111) : « Happy things do not camp close together14 ». Le verbe de perception du premier proverbe a été élidé et le « bonheur » a évolué en « choses heureuses ». Cela-dit, malgré ces détails, la transposition est fidèle et éclairante.
Lorsque la source sur laquelle les Schwarz-Bart s’appuient est anglaise, les traducteurs peuvent directement reprendre celle-ci. Lorsqu’il y a retour aux sources premières, néanmoins, Rose-Myriam Réjouis et Val Vinokurov se permettent de préciser les noms des personnes citées qui ne figuraient pas toujours dans la version française. On peut penser aux « paroles d’esclaves » qui évoquent l’histoire de Patsey15. La version anglaise reprend également certains traits de ponctuation16 et des expressions argotiques qui n’avaient pas été conservées dans la version française17. Enfin, les traducteurs se permettent de préciser que l’accouchement évoqué par Mary F. Smith s’est fait dans les cris contrairement à ce qu’en dit la traduction des Schwarz-Bart18. Les auteurs de la version en anglais ont tenté de concilier deux objectifs dans leur démarche : retranscrire la langue poétique des Schwarz-Bart le plus fidèlement possible et rechercher la même précision lorsque ceux-ci citaient des sources externes, conformément à ce qui est exigé des éditions universitaires qui ont publié leur traduction. Val Vinokurov confirme : « Our goal in the translation was to retain the poetry of the original while lending it somewhat more scholarly credibility as a popular history that 266was ultimately co-published by a university press. This is why we used original English sources whenever we could19 ».
Ce que l’on retiendra surtout, c’est que les traducteurs ont été habités par un souci de préciser leurs sources et d’indiquer comme tels les propos qui ne sont pas les leurs. Les noms des tribus et les emprunts à des langues africaines sont ainsi constamment typographiés en italique alors qu’ils ne l’étaient pas systématiquement dans la version des Schwarz-Bart20. Cette volonté de démarcation peut être comprise comme un souci de ne pas laisser de doute, voire comme une volonté de ne pas faire passer le geste de traduction pour un geste d’appropriation des paroles citées. On peut imaginer ici l’influence de Gayatri Chakravorty Spivak qui blâme dans Can the Subaltern Speak ? l’indignité consistant à prétendre pouvoir parler au nom des autres.
Les Schwarz-Bart n’ont cela-dit jamais eu cette prétention. André Schwarz-Bart a, à ce sujet, grandement souffert d’attaques l’accusant de s’être approprié l’histoire de la Mulâtresse Solitude21. Or, il s’inscrivait dans une démarche de libre création littéraire. L’existence de cette esclave marronne n’est attestée que par quelques lignes dans les archives. C’est André Schwarz-Bart qui a pris cette source comme point de départ pour imaginer l’histoire d’une héroïne guadeloupéenne. Son récit est d’une vivacité telle que certains ont confondu fiction littéraire et réalité historique et lui ont reproché de s’être emparé d’un récit qu’il a en réalité inventé. Francine Kaufmann revient sur cet amalgame dans un article où elle regrette que les récentes célébrations autour de la Mulâtresse Solitude à Paris (où un parc a été baptisé en son honneur) n’aient pas reconnu le rôle d’André Schwarz-Bart dans la création de ce personnage héroïque22. Simone Schwarz-Bart a également réagi suite à l’inauguration 267du jardin parisien en retenant surtout la grandeur de son époux défunt qui a su faire de son récit un mythe universel : « De là-haut, je le sais, tu nous fais un clin d’œil quelque peu amusé : c’est que selon Paul Auster : “Pour pouvoir dire la vérité, il nous faudra une fiction”. Et c’est là que la légende devient l’histoire » (S. Schwarz-Bart, 2020).
Conclusion
Avec ces propos de l’écrivain américain en tête, nous pouvons conclure que la fiction a servi de socle aux Schwarz-Bart dans leur quête de l’histoire des femmes noires. Ils n’ont pas eu la prétention de parler à la place de quiconque, mais ont fait un travail de création et de construction d’une galerie d’ancêtres en s’appuyant sur tous les supports à leur disposition. S’il y a quelque chose de subjectif dans la démarche de sélection des profils figurant dans l’anthologie, cette subjectivité est assumée. Et l’anthologie doit moins être lue comme un registre historique que comme une « sentimenthèque23 » regroupant les grandes femmes qui ont façonné le paysage intérieur des Schwarz-Bart. Le recours à la fiction leur a permis de conférer une dimension poétique à cet hommage et de sensibiliser le lecteur par les perspectives abordées ainsi que par leur style qui donne vie à l’histoire.
Simone Schwarz-Bart a exprimé le souhait de voir une relève reprendre cette démarche de mise en valeur de la présence des femmes. Il ne s’agit pas d’un vœu pieux. Les essais mettant à l’honneur des combats de femmes ont le vent en poupe et occupent le devant de la scène littéraire. On peut penser à l’essai Femmes puissantes de Léa Salamé (2020), qui dresse le portrait de femmes influentes dans la société contemporaine. Plus proche de la démarche des Schwarz-Bart, l’historienne Audrey Célestine met en lumière le parcours de femmes noires en Europe et en Amérique, de la fin de l’esclavage à la période contemporaine avec le mouvement Black 268Lives Matter. Tout comme les Schwarz-Bart qui ont révélé des femmes de l’ombre, le livre d’Audrey Célestine Des vies de combat – Femmes noires et libres évoque autant des femmes très médiatisées comme Michelle Obama ou Beyonce que des oubliées dont le combat mérite d’être mis en avant, parmi lesquelles l’artiste martiniquaise Darling Légitimus à qui Audrey Célestine réserve de belles pages de son essai.
Anaïs Stampfli
Université de Lausanne
269Bibliographie
Bernabé, Jean, Chamoiseau, Patrick, Confiant, Raphaël, Éloge de la créolité, Paris, Gallimard, 1989.
Célestine, Audrey, Des vies de combat. Femmes noires et libres, Paris, L’Iconoclaste, 2020.
Cendrars, Blaise, Anthologie nègre, Paris, Denoël, TADA 10, 2005 [1921].
Chamoiseau, Patrick, Écrire en pays dominé, Paris, Gallimard, 1997.
Clavel, Camille, Simone et André Schwarz-Bart. La mémoire en partage, INA, avec la participation de France Télévisions, la CNC, la Commission Régionale du Film de Guadeloupe, 2018, 52 minutes.
Huetz de Lemps, Alain, « Schwarz-Bart, S. Hommage à la femme noire », Les Cahiers d’Outremer, no 173, 1991, p. 89-90 : « swww.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1991_num_44_173_3383_t1_0089_0000_2 (consulté le 02/02/2021) ».
Kaufmann, Francine, « “La Mulâtresse Solitude” : une héroïne de papier statufiée », Mabatim.info : « https://mabatim.info/2020/10/02/la-mulatresse-solitudenbspnbsp-une-heroine-de-papier-statufiee/ (consulté le 02/02/2021) ».
Lerner, Gerda, De l’esclavage à la ségrégation, Paris, Denoël, 1972.
Maliki, Angelo B. (propos recueillis par), Bonheur et souffrance chez les peuls nomades, Paris, Conseil International de la langue française, 1984.
Mandela, Winnie, Une part de mon âme, Paris, Seuil, 1986.
Northup, Soomon, Twelve Years a Slave, Auburn-N.Y., Derby and Miller, 1853.
Salamé, Léa, Femmes puissantes, Paris, France Inter, Les Arènes, 2020.
Schwarz-Bart, André et Simone, Hommage à la femme noire, 6 vol., Paris, Éditions Consulaires, 1988-1989.
Schwarz-Bart, André et Simone, Hommage à la femme noire. Héroïnes de l’esclavage, Le Lamentin (Martinique), Caraïbéditions, 2020.
Schwarz-Bart, André et Simone, In Praise of Black Women, 6 vol., trad. par Stephanie Daval, Myriam-Rose Réjouis, Stephanie K. Turner, Val Vinokurov, Madison, The University of Wisconsin Press, 2001, 2002, 2003, 2004.
Schwarz-Bart, André, La Mulâtresse Solitude, Paris, Seuil, 1967.
Schwarz-Bart, Simone, Pluie et vent sur Télumée Miracle, Paris, Seuil, 1972.
Schwarz-Bart, Simone, « “La Mulâtresse Solitude”, quand la légende devient l’histoire », Mabatim.info : « https://mabatim.info/2020/10/01/la-mulatresse-solitude-quand-la-legende-devient-lhistoire/ (consulté le 02/02/2021) ».
Smith, Mary F., Baba of Karo : A Woman of the Hausa, New Haven, Yale University Press, 1981.
270Spivak, Gayatri Chakravorty, « Can the Subaltern Speak ? », Marxism and the interpretation of Culture, dir. Cary Nelson et Larry Grossberg, Urbana, Chicago, University of Illinois Press, 1988, p. 271-313.
Stampfli, Anaïs, « Écrire en “Simone Schwarz-Bart” et en “Maryse Condé”… Les deux grandes dames des lettres guadeloupéennes face au Manifeste de la Créolité », Les Cahiers du GRELEF, no 3, 2012 : « http://www.uwo.ca/french/grelcef/cgrelcef_03_numero.htm (consulté le 02/02/2021) »
Wachtel, Nathan, La Vision des vaincus. Les Indiens du Pérou devant la conquête espagnole (1530-1570), Paris, Gallimard, 1971.
1 A. et S. Schwarz-Bart, Hommage à la femme noire. Héroïnes de l’esclavage, Le Lamentin (Martinique), Caraïbéditions, 2020. Le succès de cette réédition a permis d’entreprendre également la réédition du volume VI en 2021 : A. et S. Schwarz-Bart, Hommage à la femme noire. Héroïnes du xxe siècle, Le Lamentin (Martinique), Caraïbéditions, 2021.
2 Les citations seront tirées de cette édition originale en six volumes – A. et S. Schwarz-Bart, Hommage à la femme noire, 1988-1989 – et les références apparaîtront dans le texte en indiquant entre parenthèses le volume et les pages concernés.
3 « Elle n’est même pas devenue navire, comme son compagnon, le Commandant Delgrès, qui deux fois la semaine faisait le va-et-vient entre la Pointe-à-Pitre et l’île de Saint-Barthélémy, d’où il ramenait un peu de viande sur pied », ajoutent les auteurs (A. et S. Schwarz-Bart, Hommage à la femme noire, t. III, p. 140).
4 Voir à ce sujet A. Stampfli, « Écrire en “Simone Schwarz-Bart” et en “Maryse Condé”… Les deux grandes dames des lettres guadeloupéennes face au Manifeste de la Créolité », Les Cahiers du Grelcef, no 3, 2012 : « http://www.uwo.ca/french/grelcef/cgrelcef_03_numero.htm (consulté le 02/02/2021) ».
5 Winnie Mandela : « Nous n’avons jamais connu aucune sorte de vie dont je puisse me souvenir comme étant celle d’une famille. » Propos cités par les Schwarz-Bart, Hommage à la femme noire, op. cit., t. IV., p. 109.
6 A. et S. Schwarz-Bart, Hommage à la femme noire, op. cit., t. I., p. 14 : pour citer cette légende, les co-auteurs se sont appuyés sur l’Anthologie nègre de Blaise Cendrars.
7 De même, le lecteur occidental peut être surpris par une référence ultérieure aux propos de femmes peuls qui affirment qu’en dehors de la maternité, une femme ne vaut rien. Hommage à la femme noire, t. II, p. 153 ; A. B. Maliki (propos recueillis par), Bonheur et souffrance chez les peuls nomades », op. cit. p. 16.
8 Voir l’article de Fatoumata Seck, dans ce volume, pour le développement de cette proposition.
9 Voir son essai : De l’esclavage à la ségrégation, Paris, Denoël, 1972.
10 Propos repris de A. B. Maliki, op. cit., p. 40.
11 A. et S. Schwarz-Bart citent ici le témoignage de Jenny Proctor relaté par G. Lerner (op. cit.).
12 Le propos est extrait de W. Mandela, Une part de mon âme, Paris, Seuil, 1986.
13 L’édition anglaise s’est faite en quatre volumes : le premier volume regroupe les tomes I et II de l’édition française, le volume II correspond au tome III français, le volume III correspond au tome IV français et le quatrième et dernier volume regroupe les tomes français V et VI.
14 A. et S. Schwarz-Bart, In Praise of Black Women, vol. I, p. 139 et vol. II, p. 307.
15 A. et S. Schwarz-Bart, In Praise of Black Women, vol. II, p. 161. Source : S. Northup, Twelve Years a Slave.
16 On peut penser aux points de suspension dans les propos de Winnie Mandela qui ne sont présents que dans la version anglophone (In Praise of Black Women, vol. 3, p. 75).
17 Les traducteurs ont par exemple conservé la formulation apocopée et oralisée des « Slaves Speak » empruntés à Jenny Proctor (propos retranscrits par G. Lerner, voir note 32) : « We didn’t have no good beds, jes’ scaffolds nailed up to de mall out of poles and de ole ragged beddin’ throwed on dem » (In Praise of Black Women, vol. II, p. 173).
18 « I heard ‘A-a-a-a- !’ » (In Praise of Black Women, vol. III, p. 153) avait été traduit par : « je n’ai rien entendu » (Hommage à la femme noire, t. IV., p. 157). Source : M. F. Smith, Baba of Karo : A Woman of the Hausa.
19 Val Vinokurov : propos tenus lors d’un échange de courriels datant du 29 octobre 2020. Notre traduction : « Notre objectif était de conserver la poésie de l’original tout en lui donnant un peu plus de crédibilité scientifique en tant qu’histoire populaire finalement co-publiée par un éditeur universitaire. C’est pourquoi nous avons utilisé des sources anglaises originales chaque fois que nous le pouvions ».
20 Nous pouvons penser aux références à différents termes exprimant la peur : « Kulol », « pulaaku », « Words of an Ordinary Woman », In Praise of Black Women, vol. I, p. 219. Source : A. B. Maliki, op. cit.
21 A. Schwarz-Bart, La Mulâtresse Solitude, Paris, Seuil, 1967.
22 Voir, en ligne : F. Kaufmann, « “La Mulâtresse Solitude” : une héroïne de papier statufiée » : « Les chercheurs antillais, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, la Ville de Paris et tous ceux qui honorent Solitude devraient aujourd’hui honorer aussi son auteur, créateur d’une héroïne de roman devenue selon son vœu symbole bien réel de la lutte des femmes et des noirs pour la liberté et pour la reconnaissance de leur dignité. »
23 Cette notion a été créée par Patrick Chamoiseau dans Écrire en pays dominé pour désigner la suite de notes qu’il dresse par ordre alphabétique sur les auteurs et artistes qui ont marqué son univers d’écriture.