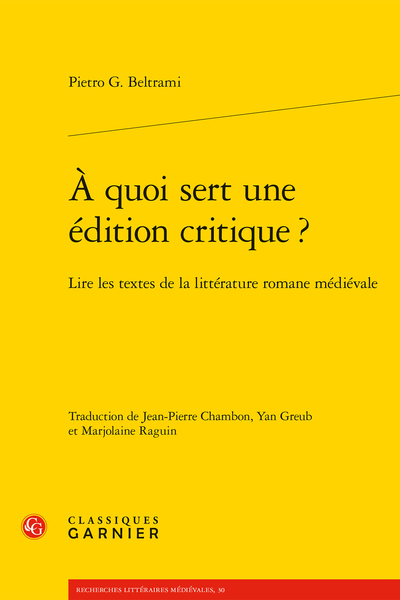
Glossaire et index des sujets traités
- Publication type: Book chapter
- Book: À quoi sert une édition critique ?. Lire les textes de la littérature romane médiévale
- Pages: 225 to 230
- Collection: Medieval Literary Research, n° 30
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406113423
- ISBN: 978-2-406-11342-3
- ISSN: 2261-0367
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-11342-3.p.0225
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 03-25-2021
- Language: French
Glossaire
et index des sujets traités
abréviation – Fait d’écrire un mot en supprimant une ou plusieurs lettres ou en les remplaçant par des signes conventionnels ; résultat de cette action ; voir encore signe d’abréviation spécial, tilde.
acrostiche [s. m.] – Figure selon laquelle les lettres initiales de plusieurs vers successifs ou de plusieurs strophes successives forment un mot ou une phrase.
adiaphore – voir variante indifférente.
anisosyllabisme – Système métrique dans lequel on considère comme équivalents des vers dont la mesure est fluctuante, et qui comportent en général une syllabe en plus ou en moins : § 14.2.
antécédent – Manuscrit dont dérive directement ou indirectement un manuscrit donné ; voir encore antigraphe.
antigraphe – Dans l’usage courant, ce terme désigne le manuscrit, conservé ou perdu, sur lequel a été copié un manuscrit donné. Dans la mesure où, pris à la lettre, le mot signifie le contraire, c’est-à-dire “copie d’un manuscrit donné”, il est préférable de le remplacer par le terme de modèle. En italien en particulier, mais pas seulement, on utilisera dans ce sens un correspondant d’exemplaire (cf. Spiaggiari/Perugi 2004, p. 19).
apparat (apparat critique, apparat de(s) variantes) : § 89-92.1.
arbre généalogique – voir méthode stemmatique.
archétype : § 46-48, 52, 57.
assonance – En fin de mot ou en fin de vers, identité des voyelles à partir de la dernière syllabe accentuée et d’elles seulement.
autographe : § 5.
banalisation : § 18, 53.
bon manuscrit : § 48, 64-66.1., 75.
branche de la tradition manuscrite : § 46, 54.
canon éditorial : § 74.
césure épique – Procédé métrique selon lequel le décasyllabe français et occitan comporte un premier hémistiche de quatre syllabes dont la quatrième est accentuée et une cinquième syllabe inaccentuée ne comptant pas dans la mesure du vers.
césure lyrique – Procédé métrique selon lequel le décasyllabe français et occitan comporte un premier hémistiche de quatre syllabes dont la troisième est accentuée et la quatrième inaccentuée.
chansonniers : § 8, 24.2., 24.3., 26.2., 26.3., 29.
coblas capfinidas – Strophes liées entre elles par la reprise en début de strophe, avec ou sans variation, d’un ou de plusieurs mots de la fin de la strophe précédente.
codex antiquissimus – Manuscrit le plus ancien conservant un texte
226donné. Le terme s’emploie pour désigner une méthode d’édition possible, mais généralement à rejeter, selon laquelle le texte est basé sur le manuscrit le plus ancien.
codex descriptus – Manuscrit copié sur un modèle ayant été conservé : § 24, 24.1-3., 51.
codex interpositus : § 46.
codex optimus – voir bon manuscrit.
codices antiquiores : § 30, 30.1.
codices plurimi – La majorité des manuscrits. S’emploie pour désigner une méthode d’édition possible, mais à rejeter, selon laquelle on considère (en l’absence de stemma) la leçon de la majorité des manuscrits comme plus proche de l’original.
codices recentiores – Manuscrits “les plus récents” : § 30.
collatio – Collation (q. v.) en latin.
collation – Comparaison entre les leçons de deux ou de plusieurs manuscrits. On désigne aussi sous le même terme la liste des leçons alternatives établie par rapport à un manuscrit pris comme base, ou exemplaire de collation ou encore texte de référence (voir encore contamination) : § 41-44.
collecteur de variantes : voir editio variorum.
conjecture – Leçon hypothétique proposée pour combler une lacune ou en l’absence de leçons acceptables dans la tradition (y compris de la part d’un copiste, par rapport au modèle qu’il copie) : 15.2., 48, 69.1., 73, 74, 82-85.
constitutio textus – Établissement (mise au point) du texte critique.
contamination : § 35-38.
copiste-éditeur : § 8.
corruption – Segment de texte transmis sous une forme erronée, soit de manière évidente, soit d’une manière pouvant être démontrée.
crux (crux desperationis) – Signe en forme de croix marquant un lieu textuel inamendable ou jugé comme tel, et conservé dans le texte critique ; ce lieu lui-même : § 84.
décasyllabe – Vers français ou occitan de dix syllabes (comptées jusqu’à la dernière syllabe accentuée), divisé en deux hémistiches de quatre et six syllabes, dont le premier peut comprendre, dans la poésie épique, une syllabe inaccentuée supplémentaire après la quatrième syllabe accentuée ; voir césure épique et césure lyrique.
descriptus – voir codex descriptus.
diacritique – Signe graphique non alphanumérique ayant pour fonction d’interpréter les caractères (accent graphique, diérèse graphique) ou les séquences de caractères (apostrophe, point haut).
dialèphe – Procédé prosodique selon lequel une voyelle en fin de mot et la voyelle initiale du mot suivant comptent pour deux syllabes ; voir diérèse.
diasystème : § 73n.
diérèse – Procédé prosodique selon lequel deux voyelles successives à l’intérieur d’un mot comptent pour deux syllabes ; voir dialèphe.
diffraction : § 73-73.2.
distique d’octosyllabes – Forme métrique non lyrique – française et occitane – constituée d’octosyllabes à rimes plates.
distinctio – Identification et séparation des mots (et d’autres éléments lexicaux, comme les particules enclitiques et proclitiques) au moyen d’espaces, de signes de ponctuation, d’apostrophe, de points hauts : § 87, 87.1-3.
dittographie – Répétition fautive d’un mot ou d’une séquence de caractères.
divinatio – voir conjecture.
227editio variorum : § 37, 37.1.
édition princeps – Première édition imprimée d’un texte (généralement employé en référence aux impressions anciennes).
édition diplomatique (et transcription diplomatique) : § 61, 61.1-2.
édition interprétative (et transcription interprétative) : § 61.
édition reconstructive : § 39, 67, 85.
édition semi-diplomatique (et transcription semi-diplomatique) : § 61.
édition synoptique – Édition présentant le texte tel qu’il est donné par certains manuscrits ou par tous les manuscrits, soit en disposant les différentes versions en regard, soit en recourant à d’autres artifices éditoriaux, dans le but de faciliter la comparaison entre les versions.
eliminatio codicum descriptorum : § 50.1.
eliminatio lectionum singularum – Élimination des leçons individuelles (voir leçon individuelle).
emendatio ope codicum : § 75.
emendatio ope ingenii (voir conjecture) : § 75.
enclise – Phénomène prosodique dans lequel une particule postposée à un mot forme avec lui un seul mot phonologique ; la particule est dite enclitique. En ancien occitan, la particule perd sa valeur syllabique et en général sa voyelle ; dans les éditions, il est d’usage de séparer l’enclitique du mot sur lequel il prend appui au moyen d’un point haut (par exemple, e·m = e mi, no·us = no vos) : § 87.
enclitique – voir enclise.
encodage : § 86.
erreur – voir faute.
erreur conjonctive : § 50-52.7.
erreur séparative : § 50-51.3.
erreur significative – Faute permettant de formuler des hypothèses sur la tradition et, le cas échéant, de construire le stemma (allemand Leitfehler ; italien errore guida). Dénomination recouvrant, de fait, les erreurs conjonctives et les erreurs séparatives.
erreur stemmatique – Faute utile à la construction du stemma : § 50.
étiologie des fautes – voir genèse des fautes.
examinatio – Dans la théorie stemmatique, examen du texte pouvant être reconstruit à partir de la tradition, en vue d’établir s’il peut être considéré comme conforme à l’original.
exemplaire de collation (ou texte de référence) – voir collation.
exponctuation – Pris à la lettre, ce terme désigne l’annulation d’une partie du texte (une lettre, un mot, une phrase) au moyen d’un point écrit au-dessous du ou des caractères. Le terme peut être employé par extension pour désigner tout type de suppression (y compris avec d’autres moyens, par exemple une ligne tracée au-dessus du texte), même virtuelle (omission d’une partie du texte par un copiste), à condition que l’omission soit volontaire.
famille – Classe de manuscrits apparentés par une erreur conjonctive : § 46, 54.
faute : § 13-17.4., 21, 49, 50-52.6, 59.
faute d’auteur : § 16-17.4.
faute par anticipation : § 15.1.
faute polygénétique : § 52, 52.2., 52.6.
forme : § 10-11, 43, 93-97.
genèse des fautes – Cause expliquant par hypothèse pourquoi une faute s’est produite : § 15-15.3.
graphie (et normalisation graphique) : § 60.1, 69.1, 93, 95-97.
haplographie – Réduction à une seule séquence de deux brèves séquences de caractères identiques et consécutives.
228hiatus – voir dialèphe, diérèse.
histoire drôle (comme exemple de tradition orale) : § 9.
homéotéleute [s. f.] – Répétition d’une terminaison identique ou similaire dans deux mots ou dans deux segments d’une phrase, ou, plus généralement, de deux segments de texte suffisamment proches pour qu’un copiste puisse sauter par erreur le segment de texte intermédiaire (lacune par homéotéleute ou saut du même au même [q. v.]).
hypermétrique (ou hypermètre) – Se dit d’un vers qui compte une ou plusieurs syllabes en plus que de règle.
hypométrique (ou hypomètre) – Se dit d’un vers qui compte une ou plusieurs syllabes en moins que de règle.
idiographe : § 5.
impression (tradition constituée uniquement par des impressions anciennes ou modernes) : § 23.1., 23.2.
innovation : § 13, 49, 53.
interpolation – Insertion dans le texte de mots ou de phrases non contenus dans l’antécédent ; le segment de texte inséré.
intertextualité – Relation entre différents textes consistant dans le fait qu’un texte réagit ou répond à d’autres textes, de manière patente ou, généralement, implicite, ou en remploie des éléments ; on s’accorde à penser que cette relation est une partie importante du sens du texte : § 70.
inventaire des manuscrits : § 40.
judicium : § 59, 75.
lachmanienne, méthode – Même sens que méthode stemmatique (cf. § 46n.).
lacune – Omission d’une partie du texte dans un manuscrit ou dans la tradition : § 14.1., 14.3., 37.6., 52.3-5., 52.6.
laisse – Séquence de vers, en nombre variable, liés par une même rime ou une même assonance.
latin et langues vulgaires : § 10.
leçon – Ce qu’on lit dans un manuscrit ou dans le texte d’une édition (souvent en référence à un lieu précis du texte).
leçon adiaphore – voir variante indifférente.
leçon caractéristique : § 54.
leçon alternative : § 18, 70-73.4.
leçon indifférente – voir variante indifférente.
leçon individuelle – Leçon propre à une branche isolée et minoritaire de la tradition, – mais non obligatoirement propre à un seul manuscrit (si un manuscrit constitue à lui seul l’une des branches principales de la tradition, ses leçons ne sont pas des leçons individuelles).
leçon séparative (voir aussi erreur séparative) : § 51-51.3.
lectio difficilior : § 53, 54, 72-72.7.
lectio facilior – voir banalisation.
lectio singularis – voir leçon individuelle.
loci critici : § 44, 44.1.
manuscrit contenant un seul texte : § 27.
manuscrit contenant plusieurs textes (miscellanées, manuscrits cycliques, etc.) : § 28, 28.1., 28.2.
manuscrit perdu : § 23.2., 23.3.
manuscrit unique : § 45.1.-2, 60-65.
mémoire (rôle dans le processus de copie) : § 9, 15.
méthode stemmatique : § 45-48, 75.
métrique : § 37.1., 52.3., 52.4. ; voir anisosyllabisme, assonance, césure épique, césure lyrique, décasyllabe, dialèphe, diérèse, distique d’octosyllabes, hypermétrique, hypométrique, laisse, octosyllabe, rime, synalèphe, synérèse, tornada.
mouvance : § 12.
229normalisation graphique – voir graphie.
note tachygraphique, note tironnienne – voir signe d’abréviation spécial.
octosyllabe – Vers français ou occitan de huit syllabes (comptées jusqu’à la dernière syllabe accentuée).
oralité (tradition orale) : § 5, 7, 8, 9, 81.
ordre des strophes (dans la poésie lyrique) : § 8, 60.2.
original : 76-81.
patine linguistique : § 11, 94.1.
polygénèse – Fait que la même faute ou la même innovation se produise de manière indépendante dans plusieurs copies.
polygénétique – voir faute polygénétique.
ponctuation : § 88.
princeps – voir édition princeps.
proclise – Phénomène prosodique dans lequel une particule (dite proclitique) antéposée à un mot forme avec lui un seul mot phonologique (par exemple, en français, et dans et moi).
proclitique (voir proclise) : § 87.
recensio – Examen critique de la tradition : § 45-59.3.
réfection libre : § 12.
reproductions de manuscrits (en microfilm ou digitales) : § 42, 91.2.
résolution – Transcription en toutes lettres d’un segment de texte écrit au moyen d’une abréviation, d’un signe d’abréviation spécial, d’un tilde : § 60.1., 62.
rime – Identité phonique (sans considération de graphie) de la partie finale de mots ou de vers, à partir de la voyelle accentuée (d’un mot) au moins ou à partir de la dernière voyelle accentuée (d’un vers) au moins : § 11, 14.2.
rubrique – Dans les manuscrits, titre du texte, d’une section, d’un chapitre, souvent écrit en rouge (d’où le nom de rubrique).
saut du même au même – Lacune se produisant parce que le copiste a sauté d’un point du texte à un autre, identique ou très similaire (voir aussi homéotéleute) : § 14.3., 52.5.
scriptio continua – Écriture sans séparation des mots (ni au moyen d’espaces ni au moyen de signes diacritiques) : § 86.
selectio (choix entre variantes) : § 47.
signe d’abréviation spécial (ou note tachygraphique, note tironnienne) – Signe tachygraphique ou de l’écriture cursive valant pour plusieurs caractères (pour en, er, et, con, per, pre, pro).
sources 1 – Manuscrits conservés ou perdus, à commencer par le manuscrit de l’auteur, s’il a existé, dont descendent les manuscrits conservés.
sources 2 – Textes employés par un auteur pour composer son propre texte : § 71 (voir aussi § 91.1.).
sous-famille de manuscrits : § 46, 54.
stemma – voir méthode stemmatique.
stemma biparti (à deux branches) : § 56, 56.1.
subarchétype : § 46, 52.
substance : § 11, 12, 43, 93-97.
synalèphe – Procédé prosodique selon lequel une voyelle en fin de mot et la voyelle initiale du mot suivant comptent pour une seule syllabe ; voir synérèse.
synérèse – Procédé prosodique selon lequel deux voyelles successives à l’intérieur d’un mot comptent pour une seule syllabe ; voir synalèphe.
témoin : § 6.
texte transmis (italien testo tràdito) : § 59.
textus receptus : § 22, 22n.
230tilde – Petit trait suscrit valant pour n, m ou en, ou, s’il est ondulé, pour r.
tornada – Strophe finale facultative de la chanson occitane, de dimension réduite par rapport à une strophe normale, et reproduisant exactement le schéma métrique et les rimes de la fin de la strophe correspondante.
tradition : § 22, 23-23.4., 25-29.
tradition active : § 12.
tradition bipartie : § 56-56.1.
tradition conservée : § 34.
tradition constituée par deux manuscrits : § 68-68.3.
tradition contaminée : § 35.
tradition fermée – Tradition sans contamination (voir contamination) permettant d’appliquer le critère de la majorité (voir méthode stemmatique).
tradition indirecte : § 32-32.4.
tradition de la lyrique : § 26.2, 26.3.
tradition monotestimoniale : voir manuscrit unique.
tradition non contaminée : § 35.
tradition orale – voir oralité.
tradition ouverte – Tradition manuscrite à deux branches (cf. stemma biparti) ou tradition contaminée (voir contamination) ne permettant dans aucun de ces deux cas de reconstruire un archétype (voir archétype) par application du critère de la majorité (voir méthode stemmatique).
tradition réelle : § 34.
usus scribendi – Style et particularités linguistiques dominantes chez un auteur ou dans un texte : § 70, 74.
variabilité formelle : § 10.1.
varia lectio : § 18.
variante : § 18, 58, 70-73.4.
variante adiaphore – voir variante indifférente.
variante d’auteur : § 19-20.2., 58.
variante indifférente (dit de variantes concurrentes dont il n’est exclu pour aucune d’entre elles qu’elle remonte à l’auteur) : § 18-18.1., 47, 49, 54, 55, 70-73.4.
variation synonymique : § 12.
versions différentes d’un texte : § 33.1., 55, 64, 79, 80.
vulgate : § 22-22.2., 30.1.